2008
→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE
Approche philosophique du jeu1
Article publié dans : La performance humaine : art de jouer, art de vivre. sous la dir. de f. bigrel, éditions du CREPS Aquitaine, 2006, p. 61-76. Cette communication visait à présenter de façon très résumée mes travaux sur le jeu : Le Jeu de Pascal à Schiller (Paris, PUF, 1997) et Jouer et philosopher (Paris, PUF, 1997).
Sans s’engager ici dans une définition de ce qu’est la philosophie, on peut la caractériser fort classiquement par la mission de connaissance de soi-même que Socrate lui fixait, d’après l’inscription fameuse du temple de Delphes qu’il avait prise pour maxime. Ce « connais-toi toi-même » peut bien sûr s’interpréter de diverses façons, mais on peut admettre qu’
a minima il veuille dire quelque chose comme : « essaie de comprendre ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis ». Pour répondre à cette exigence, on peut envisager deux façons de procéder, soit par une analyse directe des pratiques et des façons dont nous les pensons, soit, de façon plus indirecte semble-t-il d’abord, par une analyse de l’histoire de nos idées. Or, il apparaît assez rapidement que cette deuxième démarche doit être en réalité la première, car il y aurait une assez grande naïveté à prétendre analyser directement ce que nous pensons, ce que nous faisons et la façon dont nous pensons ce que nous faisons, sans prendre en compte le fait que les concepts mêmes dont nous nous servons pour penser sont marqués par une histoire qui les produit et qui se livre avec eux. Les questions mêmes que nous nous posons, et la façon dont nous nous les posons, sont souvent le résultat d’un héritage dont nous devons nous rendre conscient, si nous ne voulons pas simplement les subir. Lorsqu’on se demande en philosophe ce qu’est un jeu, il importe, si on ne veut pas rester naïf, de faire un travail d’historien des concepts avant d’entamer la recherche d’une définition ou une analyse des pratiques. Sur le jeu, en particulier, on peut montrer que la façon dont cette notion est entrée en philosophie a durablement contribué à marquer la façon dont les philosophes l’ont traitée.
Le jeu, naissance d’une notion
Le thème du jeu n’est pas très étudié en philosophie (il a cependant connu un certain renouveau ces dernières années, comme élément d’une comparaison plutôt que comme objet d’une étude propre, notamment avec la diffusion de la notion wittgensteinienne de « jeu de langage ») mais tout le monde admet maintenant qu’il s’agit d’un objet digne de l’attention du philosophe. Or, il est clair qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Les quelques textes de l’Antiquité ou du Moyen-Âge qui parlent du jeu (une dizaine de pages d’Aristote, une vingtaine de la « Somme théologique » de Thomas d’Aquin) le font pour lui donner un statut doublement mineur : une activité de peu d’importance, réservée aux enfants, à ceux qui se sont peu élevés dans l’ordre des activités de l’âme, ou encore à ceux qui, ayant élevé leur esprit jusqu’à la théorie, doivent le détendre de cette activité. De ce point de vue, les pages de l’« Éthique à Nicomaque » sont exemplaires, puisqu’elles mentionnent le jeu pour dénoncer par avance une confusion possible du jeu et de l’
eudaimonia (le bonheur comme souverain bien). Le jeu en effet semble être une activité qui a sa fin en soi. Aristote va s’employer à montrer qu’en réalité, ce n’est pas une activité mais un délassement, qui n’a pas sa fin en soi, mais bien dans la véritable activité
2
C’est dans la parfaite continuité de cet héritage antique que Thomas d’Aquin écrit ainsi : « Les actions mêmes que l’on fait en jouant, considérées en elles-mêmes ne sont pas ordonnées à une fin. Mais le plaisir que l’on trouve en de telles actions est ordonné à la récréation et au repos de l’âme. De la sorte, si on le fait modérément, il est permis de se servir du jeu. C’est pourquoi Cicéron a dit aussi : « Il est permis d’utiliser le jeu et la plaisanterie, mais comme le sommeil et les autres délassements, c’est-à-dire après avoir satisfait aux obligations graves et sérieuses. » IIa IIae, Q. 168, art. 2.
. L’ouvrage « Le Jeu de Pascal à Schiller » (1997) a pour vocation de tâcher de comprendre comment, et au prix de quelles transformations conceptuelles, le jeu entre dans la sphère des objets dignes de l’attention du sage.
L’étude de l’histoire de la notion de jeu permet de montrer que cette mutation conceptuelle a lieu essentiellement aux XVII
e et XVIII
e siècles. On peut en fixer les balbutiements dès la fin du XVI
e siècle, de façon très indirecte, quand les mathématiciens ont commencé à considérer les jeux de hasard et d’argent comme des objets intéressants. C’est là le début de ce qui deviendra au XVII
e siècle une branche importante des mathématiques : le calcul des probabilités, qui naît du jeu dans la mesure où les mathématiciens semblent d’abord avoir cherché à répondre à des questions venues de joueurs, relatives au calcul des parties. La légende prétend que les questions de ce type trouvent leur origine chez les soldats, souvent obligés d’interrompre leurs parties en cours : comment répartir équitablement l’argent mis en jeu en fonction des chances de gagner de chacun, si l’on interrompt en cours de route un jeu de hasard et d’argent composé de plusieurs manches ? Le fait que les mathématiques, qui sont en train de devenir la branche modèle du savoir, découvrent dans les jeux des problèmes qui méritent une étude propre, contribue sans doute pour beaucoup à l’entrée du jeu dans les objets dignes d’attention. On peut dire que cette mutation conceptuelle s’achève avec Schiller qui, à la fin du XVIII
e siècle, dans les « Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme », donne au concept de tendance au jeu (
Spieltrieb) une dimension paradigmatique. L’activité de jeu devient un modèle qui permet de penser toute l’humanité dans ce qu’elle a de spécifique, car l’homme seul est capable de jouer, comme le dit la phrase fameuse (qui, en un sens, signe l’accomplissement de cette mutation) : « L’homme ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot il est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue »
3
schiller. Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, trad. R. Leroux, Paris Aubier, 1943, rééd. 1992, p. 221
. C’est dire qu’on ne joue plus par défaut, parce qu’on est un enfant incapable de s’élever à des activités plus consistantes ou parce qu’on est une âme faible incapable de s’élever jusqu’à la théorie, activité du savant, mais on joue de façon essentiellement liée à notre humanité.
Entre les deux, entre le début du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette mutation ? Il y en a certainement un grand nombre, mais trois semblent particulièrement significatifs : un changement social, un changement d’épistémologie et un changement d’anthropologie.
Le philosophe n’est pas un être abstrait : il écrit dans son temps et, au moins pour partie, de son temps. S’il se préoccupe tant du jeu, aux XVII
e et XVIII
e siècles, c’est indéniablement parce que la société dans laquelle il vit est aussi une société du jeu. L’exemple de Pascal est ici significatif. On sait en effet qu’il rencontre d’abord, en tant que savant, la question du jeu sous la forme de deux problèmes que lui pose le chevalier de Méré et qui viennent directement de la pratique des jeux de hasard et d’argent et des réflexions qu’ils suscitent. Mais s’il élabore par la suite, en tant que moraliste, une pensée du divertissement qui prend le jeu pour modèle pour penser tout le social et le politique, c’est aussi parce que la société qu’il observe lui renvoie le spectacle d’un monde où chacun joue, dans toutes les classes sociales. Au XVIII
e siècle, c’est toute la littérature qui renvoie l’image d’une société en proie au jeu
4
Les travaux des historiens, comme le livre d’Olivier Grussi, « La Vie quotidienne des joueurs sous l’Ancien Régime à Paris et à la Cour » (Paris, Hachette, 1985), montrent à quel point le phénomène ludique tient à différents niveaux une place importante aux XVIIe et XVIIIe siècles. On peut se demander cependant si les gens jouent véritablement plus à cette période qu’au MoyenÂge ou à la Renaissance, ou si ce qui apparaît dans l’abondance des textes sur lesquels l’historien peut s’appuyer n’est pas plutôt une plus grande présence du jeu à la conscience d’époque, qui fait qu’on en témoigne, qu’on en écrit, qu’on s’en moque, qu’on s’en inquiète... Il est évidemment difficile de trancher. Toujours est-il que le jeu se constitue en phénomène de société à ce moment là.
. L’« Histoire de ma vie » de Casanova est à cet égard un témoignage exemplaire, dont on oublie souvent qu’il compte beaucoup plus de pages consacrées aux divers jeux qu’aux exploits amoureux, et que ceux-là sont tout autant le moteur des diverses aventures qui lui arrivent que ceux-ci. Par ailleurs, c’est aussi le moment où se diffusent des traités consacrés aux jeux, où des pièces de théâtre, comme ce « Joueur » que Diderot traduisit de l’anglais
5
C’est en septembre 1760 que Diderot termine la traduction de The Gamester, de Moore.
, mettent en scène les méfaits du jeu, où la vogue des échecs connaît un succès tel que le jeune Rousseau, à Chambéry, y succombe... Le jeu est un phénomène de société qu’il faut penser.
Simultanément, on voit se développer l’intérêt des savants pour les jeux, qui change le regard qu’on peut porter sur le phénomène ludique. Il s’agit des jeux de hasard et d’argent, comme on l’a dit, mais pas seulement. Ainsi, Leibniz peut-il considérer les jeux comme un des lieux où s’exprime librement l’intelligence humaine, et souhaite-t-il qu’on étudie les jeux de plus près, parce que l’activité ludique peut nous offrir des enseignements précieux pour perfectionner l’art d’inventer. Car, dans le monde clos du jeu, l’esprit humain se manifeste dans sa libre inventivité, il s’exerce à l’estimation des chances dans les jeux de hasard et d’argent, aux calculs et à l’analyse des combinaisons stratégiques dans ceux de réflexion, à la prévision des desseins de l’adversaire dans les jeux de conflit. Le jeu offre un espace privilégié où s’exerce l’intelligence humaine, à cause du plaisir qu’il suscite, qui attire, qui sait maintenir l’intérêt, et qui est le premier moteur de l’ingéniosité. L’esprit s’y exerce librement, sans les contraintes du réel et les urgences du besoin, il offre des conditions pures d’exercice de l’ingéniosité : « Les hommes ne sont jamais plus ingénieux que dans l’invention des jeux ; l’esprit s’y trouve à son aise » (à Rémond de Montmort, 17 janvier 1716). Plus d’un demi-siècle plus tard, les Encyclopédistes s’émerveilleront à leur tour de l’inventivité ludique et de la façon dont les joueurs font, au jugé, des estimations de probabilité qui demanderaient des heures au mathématicien rigoureux.
Enfin, il est clair qu’on assiste au XVIIIe siècle à un changement d’anthropologie philosophique, dont les œuvres de Rousseau et de Kant sont les exemples les plus manifestes. Cette mutation s’observe entre autres dans le regard porté sur l’enfant. En un sens, on peut dire à grands traits qu’on n’est plus enfant par défaut. L’enfant devient humanité à réaliser. Ce qui explique l’importance accordée à l’éducation. Du coup, il devient crucial de s’intéresser au jeu, activité de l’enfant par excellence, et de souligner à quel point il peut être une découverte de la liberté par soi-même, de la règle, du corps... Il s’agit d’un lieu exemplaire de l’apprentissage de soi par soi.
C’est cette évolution historique, doublée de l’héritage de l’esthétique et de l’anthropologie kantienne, qui fait que Schiller peut accorder au jeu la place qu’il lui accorde, et que, bien plus tard, nous pouvons nous intéresser sérieusement, en philosophes, au jeu. Nous avons appris à considérer que le jeu a une place essentielle dans la société et dans la constitution même de l’humain. Mais ce que cette histoire nous permet de comprendre, c’est que la façon dont nous l’avons appris nous a donné une façon d’approcher le jeu en philosophe qui est tout à fait particulière. C’est qu’à faire du jeu un paradigme pour penser tout l’humain, on finit par oublier le jeu réel, et par éviter soigneusement de s’interroger sur sa spécificité, voire même par ne pas vouloir s’en occuper, comme l’affirme Fink à la suite de Schiller
6
Schiller refuse de considérer « les jeux qui sont usités dans la vie réelle » (Op. cit., p. 221), et Fink précise explicitement que ce qui l’intéresse n’est pas « un aspect constatable du phénomène ludique tel que nous le connaissons dans la vie quotidienne » (Le Jeu comme symbole du monde, trad. H. Hildenberg et A. Lindenberg, Paris, Minuit, coll. « Arguments », 1966, p. 54).
. Sans doute, sans ce travail préalable, aurais-je fait peu ou prou la même chose. La prise de conscience de cet héritage m’a permis, d’une certaine façon, de me libérer de cet automatisme de l’idéal, et de m’interroger d’abord sur la nature de cette spécificité ludique.
Une définition philosophique du jeu
Il existe en effet un certain nombre d’analyses philosophiques (ou assimilées) du jeu, chez des auteurs bien connus, tels que Huizinga, Caillois, Henriot, qui manifestent une volonté de faire du jeu un modèle pour penser toute la société, ou tout le réel, ou tout l’être, ou tous les phénomènes humains... Huizinga a ainsi produit une analyse remarquable du phénomène ludique et a présenté une définition qui a servi de modèle à tous ses successeurs, mais c’est à dessein de montrer combien tous les phénomènes humains (l’art, le droit, la religion...) sont assimilables à des jeux. On dit souvent qu’une bonne définition doit définir tout le défini et rien que le défini. Mais il ne faut pas s’étonner si la définition du jeu par Huizinga ne définit pas seulement le défini, puisqu’elle a dès l’origine pour mission de pouvoir s’appliquer à d’autres choses. Il semblait intéressant, contre toute cette tradition du jeu-paradigme, de tâcher de comprendre ce qui peut être spécifique dans le jeu. Que disons-nous lorsque nous proposons à des amis : « On fait un jeu ? » (phrase que tout le monde comprend, et dont tout le monde comprend qu’elle désigne un champ d’actions possibles assez précis, qui n’englobe pas les pratiques religieuses ou juridiques). Que faisons-nous lorsque nous jouons à la belote, au ballon, aux échecs, à la roulette… ?
Or, pour rendre compte de ce qu’est le jeu, il fallait d’abord construire une définition qui ne soit pas simplement une addition de propriétés, mais qui permette de montrer de quelle façon toutes ces propriétés se déduisent du concept de jeu ainsi mis au jour. En effet, on peut dire que ces différentes propriétés étaient déjà bien cernées dans les différents ouvrages consacrés au jeu depuis Huizinga. La définition qu’il propose dans «
Homo ludens » est à cet égard exemplaire : « Le jeu est une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension et de joie, et d’une conscience, d’« être autrement » que la « vie courante ». Ainsi définie, la notion semble apte à englober tout ce que nous appelons jeu, à propos d’animaux, d’enfants et d’hommes adultes : performances d’adresse, de force, d’esprit, de hasard »
7
Huizinga J. Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, trad. C. Seresia, Paris, Gallimard, 1951, rééd. coll. « Tel », 1988, p. 58
. On le voit, toutes ces propriétés (la règle, la liberté, la fermeture, le plaisir...) sont simplement additionnées, sans qu’on comprenne comment elles peuvent aller ensemble. Or, aucune d’elles considérée séparément n’est spécifique au jeu, comme les différents critiques de Huizinga qui se sont intéressés au jeu après lui n’ont pas manqué de le souligner. Il fallait donc montrer le point central où se laisse déchiffrer la spécificité du jeu et dont peuvent se déduire ses différentes propriétés, dans leur spécificité ludique. Or, il avait été remarqué depuis longtemps (Kant en particulier avait insisté sur ce point) que le jeu se caractérise par la présence conjointe de la liberté et de la règle. Mais on ne s’était pas interrogé sur leurs rapports. C’est pourtant là que peut se décrire la spécificité du jeu. D’où la définition proposée dans « Jouer et philosopher » (1997) : « Le jeu est l’invention d’une liberté par et dans une légalité ».
Dans cette interrogation sur les rapports de la liberté et de la règle qui intéresse depuis longtemps les philosophes – et particulièrement ceux qui tâchent de penser le droit – le jeu offre un terrain d’étude paradoxal qui invite à un renouvellement de perspective. Ce qui est spécifique du jeu, c’est cette liberté produite par une légalité particulière, les règles du jeu, qui la produit comme une liberté déjà réglée. Pour qu’il n’y ait pas de confusion entre le concept métaphysique de liberté et cette liberté ludique spécifique, on désigne celle-ci sous le néologisme de « légaliberté ».
On peut ici donner un exemple qui précisera le sens de cette définition. Soit un individu quelconque, M. Untel, cadre dans une grande ville. Pour garder la forme, M. Untel veut faire « du sport ». Il va donc se rendre dans une de ces institutions spécialisées qui se sont multipliées dans les grandes villes ces dernières années, où un choix lui sera proposé pour occuper l’heure qu’il a prévu de consacrer à cette fin. Supposons qu’il puisse ainsi faire de la musculation ou du squash. Tout le monde accorde que, dans les deux cas, il s’agit de sports, mais que le choix de M. Untel va le porter soit vers une activité qui n’est pas un jeu et que personne ne considère comme telle, soit vers une activité qui est un jeu. De cet accord général témoigne bien le fait que l’usage ordinaire du langage nous fait dire que « M. Untel joue au squash entre midi et deux », mais jamais que « M. Untel joue à la musculation ». Que pouvons-nous tirer de cet exemple ? Que pouvons-nous apprendre de ce que tout le monde sait sans toujours en tirer toutes les conséquences ?
D’abord que jeux et sports sont deux ensembles présentant une surface d’intersection, mais qui ne se recouvrent pas totalement. De nombreux jeux ne sont pas des sports (la bataille navale, la roulette...), certains sports ne sont pas des jeux, comme ici la musculation, et certains sports sont aussi des jeux. Quand disons-nous d’un sport qu’il est aussi un jeu ? L’exemple qu’on vient de donner nous aide à le comprendre. Dans le cas de la musculation, l’activité existe avant la salle de musculation. Ses diverses installations sont inventées pour faciliter et rendre plus efficace une activité qui leur préexiste, et qui pourrait se pratiquer ailleurs et autrement. Il y a là un sport qui n’est pas un jeu. Dans le cas du squash, ce qui se passe est complètement différent. Si on ne peut pas pratiquer le squash chez soi, ce n’est pas parce que c’est trop petit ou parce que cela ferait trop de bruit. On ne peut pratiquer le squash que dans une salle qui répond à la définition de la surface de jeu telle qu’elle est donnée dans les règles du jeu. C’est la règle qui, en définissant l’espace de jeu, définit les règles qui vont présider à la construction des salles de squash dans lesquelles M. Untel pourra jouer au squash. De même, le temps de la partie est produit par la règle qui, en l’occurrence, fixe un nombre de points à atteindre, et non par la durée de l’heure creuse de M. Untel. De même, et pour les mêmes raisons, la règle définit les conditions de possibilité du fait même de jouer au squash (sinon, ce serait un autre jeu), du fait même d’être un joueur de squash. Il y a eu des gens musclés avant les salles de musculation. Il ne pouvait en revanche y avoir aucun joueur de squash avant les règles du squash. Nous comprenons à présent la différence que l’usage commun du langage soulignait déjà : même s’il y a sport dans les deux cas, il n’y a jeu que lorsque la règle préexiste à l’activité et la rend possible.
On peut montrer qu’il suffit pour s’en rendre compte de penser que la liberté du joueur d’échecs, qui est toujours libre de faire ceci ou cela (roquer ou non, bouger la tour ou le cavalier) dans la forme prescrite par la règle, n’a pas de sens avant la règle elle-même. D’une certaine façon, il faut dire que c’est la règle des échecs qui produit le joueur d’échec comme tel. Il en va de même pour la boxe : la différence entre la boxe et le combat de rue ne tient pas tant dans l’emploi des gants que dans le fait que les boxeurs, la situation, le temps et la forme de la rencontre sont produits par la légalité ludique qui définit la boxe possible. Les boxeurs eux-mêmes, en ce sens, sont des « objets ludiques », c’est-à-dire produits par les règles du jeu. La règle invente la liberté-du-joueur (la légaliberté) qui va à son tour être inventive dans le cadre qui la produit et qui la rend possible.
De même, on s’est souvent interrogé sur l’activité imaginaire déployée dans le jeu, en se demandant quelle est la différence entre un récit d’imagination (fable, conte, roman) et un jeu qui fait intervenir des situations imaginaires comme les cow-boys et les indiens des enfants. Or, il est facile de montrer que la fiction dans le jeu, le fameux « on dirait que... » (on serait des indiens), n’est pas le début d’une histoire, n’est pas du tout l’équivalent à un « il était une fois », mais est bien plutôt l’énoncé d’un ensemble de régies d’action, ensemble qui est ouvert de façon interne (on peut ajouter qu’on est des Comanches ou des Apaches, qu’on est les alliés des Tuniques Bleues ou pas) mais clos sur lui-même (on ne peut pas faire intervenir un mousquetaire dans le jeu – et par conséquent les bâtons, dans le jeu, ne pourront être utilisés comme des épées, mais seulement comme des arcs, ou comme des lances – on voit par là comment le « on dirait que... » est en fait l’énoncé d’un ensemble de règles d’action, l’énoncé d’une forme particulière de ce qu’on peut appeler « contrat ludique »). Le linguiste Émile Benveniste écrivait : « C’est le jeu qui détermine les joueurs et non l’inverse. II crée ses acteurs, il leur confère place, rang, figure ; il règle leur maintien, leur apparence physique, et les faits selon les cas morts ou vivants ». Aux petits indiens, au casino, dans les jeux de rôles, au Go, il se passe quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs (ce qui explique la fascination des romanciers pour le monde du jeu) qui est que celui qui entre dans le monde du jeu abandonne sa liberté à l’entrée, pour la troquer contre la légaliberté produite par la légalité ludique.
Ces points une fois établis, il est alors possible d’aller d’une interrogation sur les conditions de possibilité du jeu à une investigation relative aux conditions dans lesquelles le jeu s’exerce. Il faut d’abord étudier le fonctionnement des jeux comme structures productrices. Deux modèles complémentaires étudient la productivité de la structure, l’approche qu’il est convenu de qualifier de « structuraliste », et l’approche économico-mathématique, qui est structuraliste en un sens plus large, puisqu’elle vise à comprendre comment la règle d’un jeu est génératrice d’une structure (l’arbre d’actions possible) qui permet de formaliser l’agir « rationnel ». Il faut ensuite s’intéresser à la question de la compétence, se demander ce que doit être un individu pour être capable de jouer. De ce point de vue, le théoricien du jeu peut reprendre certaines des analyses de ce qu’est la compétence linguistique (les théoriciens du langage ayant souvent eux-mêmes recours à l’analogie du jeu). La distinction faite par Searle entre les règles régulatives et les règles constitutives est ici une aide précieuse. Enfin, il faut essayer de comprendre de quelle façon, une fois les règles du jeu intégrées (stade primordial sans lequel le jeu n’est pas possible), nous les faisons fonctionner. L’intelligence ludique peut être alors analysée comme une appréciation de tendances. On peut alors réinterpréter l’agir ludique à l’aide des catégories de la philosophie classique, sous le thème de la prudence. La conduite ludique s’avère être un type particulier de conduite prudentielle dans ces structures à produire du risque que sont les jeux : les règles produisent un espace d’indétermination dans lequel la légaliberté trouve son lieu d’exercice.
On peut alors montrer comment les caractéristiques du jeu se déduisent de la définition, et comment elle permet de les comprendre dans leur spécificité ludique. Un point avait été souvent observé, aussi bien chez Huizinga que chez des psychologues comme Château : il s’agit de ce qu’on peut appeler la clôture ludique. Elle s’explique par le fait que le jeu n’existe qu’en tant que l’espace et le temps du jeu sont formés – et par là fermés – par les règles qui les définissent. Cette idée est souvent un des éléments importants des romans qui prennent le jeu pour thème principal, comme « Le Joueur » de Dostoïevski, « Le Joueur d’échecs » ou « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme » de Zweig, ou encore, d’une façon très différente, « W ou le souvenir d’enfance » de Perec. Formés par la règle, l’espace du jeu est relationnel et le temps du jeu est séquentiel. Ainsi, ce qui fait la différence entre un terrain de football et un pré à vaches n’est pas la qualité de l’herbe : les règles relatives au terrain de football définissent non seulement les limites du terrain mais encore les relations dans cet espace. Elles produisent ce terrain comme un espace qualitatif, en définissant une surface de réparation, des lignes de touche, les côtés respectifs des deux équipes. Ces espaces ne sont plus neutres, mais deviennent qualifiés par ces relations (le terrain adverse n’a de sens que dans la relation d’adversité). La règle du hors-jeu, par exemple, montre bien qu’il s’agit ici des relations entre joueurs dans l’espace occupé. De même, le temps de la partie est un temps séquentiel, qui acquiert par là des qualités : ouverture (temps d’observation, de placement, d’intimidation), fin de partie (urgence des dernières minutes, dernières forces à jeter en jeu...). C’est en partie ce temps qualifié qui fait la capacité du jeu à nous distraire du temps indifférencié du désœuvrement. La règle fondatrice produit la clôture ludique, qui définit un temps et un espace clos : par là, le jeu peut apparaître comme créant, à l’intérieur de la vie courante et avec sa matière même, un monde à part, dedans-dehors, qui est un des éléments fascinants du phénomène ludique.
Si c’est un monde, alors il faut y entrer : c’est le sens de ce contrat ludique par lequel les participants entrent dans le jeu (c’est en ce sens que Huizinga parlait d’activité volontaire). Il est explicite lorsqu’on participe à un tournoi, ou lorsqu’on entre dans un casino. Il est tacite dans la plupart des jeux d’enfants (ce qui explique qu’il y faille souvent négocier en cours de partie sur ce que l’on a le droit de faire). Dans les jeux de concurrence et de conflit, ce contrat ludique prend tout son sens : il dit la création de deux légalibertés adverses, dont chacune a pour condition de survie dans le jeu l’élimination de l’autre.
C’est que le jeu crée chaque légaliberté comme un
conatus spinoziste : volonté de persévérer dans son être et d’augmenter sa puissance d’agir. À la roulette, par exemple, cette puissance d’agir se matérialise dans le nombre de plaquettes possédées, qui représente la marge de manœuvre du joueur, qui va travailler à se maintenir dans le jeu et à l’augmenter si possible
8
Leibniz, dans l’étrange projet d’une institution à mi-chemin entre la cité des sciences et un casino qui est donné en annexe du « Jeu de Pascal à Schiller », souligne déjà, à une époque où leur usage est très loin d’être généralisé, l’intérêt qu’il y a à faire jouer les joueurs avec des « marques » plutôt qu’avec de l’argent, « ce qui fait jouer les gens plus aisément » (p. 121)
. Les jeux de concurrence sont des jeux dans lesquels la règle organise un conflit des puissances d’agir tel que chaque joueur ne peut persévérer dans son être ludique qu’en réduisant celle de l’autre. À l’inverse, les jeux de collaboration sont ceux où chaque puissance d’agir doit travailler, pour se maintenir dans son être, à ce que toutes se maintiennent. Cette notion de
conatus aide à comprendre ce qu’il peut y avoir de spécifique dans le plaisir ludique. Certes, tout jeu est une somme de plaisirs différents, joie de la dépense dans l’un, de l’excitation dans l’autre, de l’activité intellectuelle dans un troisième, mais il y a bien un plaisir spécifique qui donne sa tonalité au jeu, qui fait qu’il ne procure pas le même plaisir que d’autres distractions, et qui tient à ce conatus ludique. Tout ce qui accroît la puissance d’agir de notre légaliberté dans le jeu nous réjouit. « La clôture ludique instaure un temps séquentiel et un espace relationnel qui forment le monde spécifique dans lequel existent (et éventuellement s’affrontent) les légalibertés. L’exercice par lequel la légaliberté se maintient dans l’existence dans son monde (et par là même maintient son monde) n’est pas le seul élément, mais constitue la composante spécifique du plaisir ludique »
9
Je me permets de citer les dernières lignes, synthétiques, du dernier chapitre de Jouer et philosopher, p. 249
.
En conclusion, sur la base des éléments brossés à grands traits dans cette présentation, dont on voudra bien excuser la rapidité, on aura compris qu’il s’agit dans ce travail de dire ce qui fait la spécificité du jeu. On peut se demander, comme souvent en philosophie, à quoi cela peut bien servir. Il ne faut pas rougir de cette question, à la condition bien sûr qu’elle ne serve pas à dissimuler un mépris pour toute dimension réflexive. D’une part, il n’est sans doute pas totalement inutile d’essayer de mieux comprendre, d’une façon plus précise, ce qu’on sait déjà d’une certaine façon sans le savoir vraiment de façon explicite : les activités d’éclaircissement permettent souvent, malgré la lenteur apparente des démarches, d’éviter de bien plus longs faux débats, et de construire d’autres réflexions sur des fondements plus sains. D’autre part, dans le cas particulier du jeu, l’exploration de ses dimensions spécifiques (tout ce que nous savons déjà lorsque nous proposons « on fait un jeu ? »), permet de mieux comprendre en quoi l’univers ludique est une forme particulière de culture, avec ses richesses, ses histoires, ses points culminants et ses lieux communs. On peut alors décrire et, si on le souhaite, défendre le jeu comme culture. Mais évidemment, c’est une autre histoire…
Colas Duflo
Université Jules Verne de Picardie, Amiens
Hasard et duplicité1
Ce texte a également fait l’objet d’un article dans la revue Psychotropes 2007, vol. 13, n° 3-4, p. 77-96.
Nous mettons en évidence dans cette communication les liens profonds entre la pratique des jeux de hasard et la constitution des probabilités comme discipline mathématique au XVIIe siècle. En chemin nous évoquons brièvement les façons fort différentes dont la notion de hasard est perçue par ses « utilisateurs », avant d’entamer le long périple temporel séparant la première loterie centralisée (Loterie de l’École Militaire) sous Louis XV du Rapido de la Française des jeux.
Naissance des probabilités et jeux
À bien des égards, le dé n’est pas seulement l’origine étymologique du mot « hasard »
2
Hasard : substantif masculin. Mot d’origine arabe (az-zahr : le dé) apparu en français via l’espagnol azar. A d’abord signifié jeu de dés avant de désigner plus généralement un événement non prévisible, sans cause apparente (les hasards de la vie) et, par extension, le mode d’apparition d’événements de ce type (ex. : En passant par hasard…).
, il est aussi directement à l’origine de la naissance du calcul des probabilités. En effet, on semblait s’ennuyer ferme dans les cours royales aux XVI et XVII
e siècles, alors pour tuer le temps, que ce soit en Toscane ou à Versailles, on jouait aux dés. On jouait de l’argent évidemment, sinon l’ennui se serait ajouté à l’ennui. Et certains se mettent à réfléchir aux moyens d’être plus malins que les autres. Les deux problèmes qui suivent sont de ces cogitations, et peuvent être considérés malgré leur apparente futilité comme parmi les premiers problèmes de probabilités en tant que tels :
• question du prince de Toscane à Galilée (1554-1642) : les nombres 9 et 10 s’écrivent d’autant de façons différentes comme somme de trois nombres compris entre 1 et 6... Pourquoi, lorsque l’on lance trois dés, leur somme fait-elle plus souvent un total de 10 que de 9 ?
• question du Chevalier de Méré (1610-1685) demandant à son ami Blaise Pascal (1623-1662) : est-il plus probable d’obtenir un 6 (au moins une fois) lors de 4 lancers d’un seul dé qu’un double 6 (au moins une fois) lors de 24 lancers de deux dés (faire sonner les dés) ?
Outre les liens historiques entre probabilités et jeux de hasard, ceci met en évidence le fait que les probabilités en tant que discipline mathématique sont nées relativement tardivement en comparaison d’autres branches, comme la géométrie, l’arithmétique et, dans une certaine mesure l’analyse (théorie des fonctions).
Question du prince de Toscane à Galilée
Lorsque l’on lance trois dés (sous-entendu non pipés et indistinguables), il y a, comme l’avait noté le prince de Toscane, autant de façons d’écrire 9 et 10 comme somme des trois dés. En effet, une façon est alors symbolisée par un triplet croissant de trois chiffres inférieurs ou égaux à 6 dont la somme vaut respectivement 9 ou 10. Or :

Les résultats possibles au terme du lancer de trois dés peuvent être représentés comme des triplets (ordonnés) de trois nombres compris entre 1 et 6. Il y a donc selon cette façon de compter 63 = 216 sorties possibles. On notera qu’en procédant ainsi chaque dé correspond à une « position » dans le triplet.
Dans le cas d’une somme égale à 9, on obtient donc :

En effet, si les trois nombres de la somme sont distincts deux à deux, il y a 3 choix possibles pour le premier dé, deux pour le deuxième, et 1 pour le troisième, soit 6 = 3 × 2 × 1 façons d’obtenir 9 comme somme de ces trois nombres. Si la somme est obtenue comme somme de deux nombres distincts, l’un étant utilisé deux fois, on n’a le choix que de la position du nombre non répété, soit 3 choix possibles. Et si 9 est obtenu comme somme de trois fois le même nombre, il n’y a qu’une façon d’arriver à ce résultat. D’où le résultat obtenu.
Dans le cas de 10, on obtient donc par les mêmes arguments :

Le prince de Toscane avait vu juste ! On en déduit aussi qu’il avait lui une intuition instinctive de la loi des grands nombres et surtout beaucoup de temps à perdre...
Question du Chevalier de Méré à Pascal
Lorsque l’on lance quatre dés (non pipés), il y a 64 résultats possibles, tous équiprobables. Il est plus aisé de dénombrer les lancers ne comportant aucun 6, c’est-à-dire l’événement contraire, d’où, presque immédiatement :
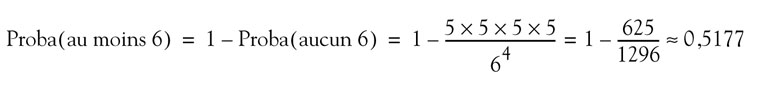
On lance deux dés : 62 = 36 résultats possibles. On lance ces deux dés 24 fois, il y a donc 3624 ≈ 2,245226.1027 résultats possibles (équiprobables si les dés sont non pipés).
Alors
3
Signalons pour mémoire que, vu les ordres de grandeur en jeu, Pascal a sans doute eu recours aux premières tables logarithmes pour finaliser son calcul... Coup de chance, le mathématicien écossais John Neper (ou Napier, 1550-1617) les avait inventés et tabulés quelques années plus tôt, en 1614. Ce qui fit la fortune... de l’un de ses collaborateurs – qui participa au calcul explicite – qui les diffusa de par le monde (notamment parmi les assureurs, grands consommateurs de calcul, déjà...). La révolution que les logarithmes apportèrent en termes de capacités de calculs à l’époque est en tous points comparable à celle induite par l’invention des ordinateurs ou plutôt celle des micro-ordinateurs diminuant drastiquement le coût des calculs dans une proportion que les contemporains ne pouvaient même pas imaginer quelques années auparavant.
:

Forts d’une réponse numérique exacte et précise aux questions qu’ils avaient posées, le Chevalier et le Prince pouvaient engager des paris avec d’autres joueurs sur ces jeux. En pariant systématiquement sur la configuration la plus probable, la loi des grands nombres (et le temps...) leur permettaient de tirer un bénéfice financier du léger biais dont eux seuls avaient connaissance (hormis leurs conseillers mathématiques qui n’étaient sans doute pas dans les parages). L’idée d’une telle stratégie de jeu sous-tend cette fois une intuition de la notion d’espérance mathématique, quantité qui, dans un jeu de hasard, s’exprime comme le produit des gains par leur probabilité d’occurrence, sommé sur tous les gains possibles.
En fait, les jeux de hasard agitaient de façon encore plus profonde les précurseurs des probabilités que sont Pascal et Fermat (1601-1665) puisqu’ils entamèrent à partir de 1654 à l’initiative du premier une longue correspondance initialement motivée par le problème de la répartition des mises et que l’on peut considérer comme les premières contributions théoriques au calcul des probabilités. Ce problème, fort discuté à l’époque, toujours pour les mêmes raisons, consistait à déterminer la répartition équitable des mises entre les participants d’un jeu de hasard lors d’une interruption prématurée de la partie. Au départ, Pascal avait soumis à Fermat une solution qu’il avait apportée au problème. Plusieurs savants éminents de l’époque avaient cru y apporter des solutions qui se révélèrent fausses. En langage moderne – et si l’on raisonne en moyenne – la réponse est immédiate : les mises doivent être réparties au prorata des probabilités que chacun des participants a de gagner à l’instant de l’interruption. Problème : à l’époque, le concept de probabilité restait à inventer. Et effectivement, dans cette correspondance publiée en 1679, la notion de probabilité (comme nombre compris entre 0 et 1) mais aussi d’espérance mathématique sont clairement employées, sans jamais s’extraire cependant d’un contexte numérique. L’origine précise de l’espérance mathématique est elle à trouver dans le texte fameux du pari de Pascal
4
Dans le recueil des Pensées, pensée no 233 de l’édition Brunschvig.
. Son but était de démontrer aux libertins qu’ils avaient en tout état de cause intérêt à croire en Dieu. Le philosophe et mathématicien y introduit le concept fondateur d’espérance mathématique consistant à multiplier un gain (la quantité finie des plaisirs terrestres versus la quantité infinie des plaisirs apportées d’une vie paradisiaque et éternelle) par la probabilité que Dieu existe, que l’on peut supposer arbitrairement petite mais que l’on ne peut pas affirmer n’être pas strictement positive, quelle que soit l’intensité de son incroyance.
Quelques dates-clés
Il n’est pas dans notre propos de retracer en détail l’histoire des probabilités mais, brossons-en néanmoins les grandes étapes pour fixer les idées. L’Histoire commence donc par la correspondance Pascal-Fermat à partir de 1654. Puis, première pierre angulaire, la loi (faible) des grands nombres est établie par Bernoulli (Jacques 1er, 1654-1705) et publiée à titre posthume dans l’ouvrage Ars conjectandi en 1713. Cette première version de la loi des grands nombres est établie par des méthodes de dénombrement dans le cadre du jeu de Pile ou Face équilibré : Bernoulli démontre que lorsqu’on lance indéfiniment une pièce de monnaie équilibrée, on observe peu à peu que les fréquences d’apparition de pile et de face convergent vers 1/2, probabilité a priori d’obtention de pile ou face. Diverses généralisations auront lieu au fil du temps jusqu’à la version moderne qui étend ce comportement à la répétition indéfinie et indépendante d’un phénomène aléatoire quelconque.
Le second étage de la fusée probabiliste est ce que les spécialistes appellent de façon particulièrement absconse le théorème central limite qui n’est autre que la description de la vitesse à laquelle les fréquences empiriques s’approchent de la probabilité a priori de l’événement aléatoire reproduit indépendamment. C’est une mesure des fluctuations autour de la moyenne qui se révèle suivre une loi probabiliste appelée (pour cette raison d’ailleurs) loi normale ou gaussienne. C’est Abraham de Moivre qui met le phénomène en évidence, toujours dans le cas du jeu de Pile ou Face équilibré. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) généralisera ce résultat dans le cadre plus général de l’analyse des incertitudes dans les mesures physiques. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’encore aujourd’hui la loi normale est portée à la connaissance de beaucoup d’entre nous, sous la forme d’une séance plus ou moins appréciée de travaux pratiques de Physique consistant à consigner un grand nombre de mesures de la distance focale d’un lentille convergente pour faire apparaître la célèbre courbe en cloche. Les sciences humaines s’en sont aussi emparées, notamment dans les années 1970 avec le livre pour le moins controversé intitulé la « bell curve » et qui prétendait démonter à partir de la répartition statistique des résultats obtenus lors de test de QI que les différentes minorités ethniques n’étaient pas dotées de la même intelligence. Ce qui évidemment en disait plus long sur les tests que sur les gens que l’on y soumettait.
D’autres grands contributeurs des probabilités sont apparus au fil des ans, notamment Laplace, Poisson en France, mais, on peut néanmoins marquer la naissance de la théorie moderne des probabilités au début du XXe siècle avec Émile Borel (avec les applications probabilistes de la théorie de la mesure vers 1900) puis Andreï Kolmogorov qui posa aux environs de 1930 les bases axiomatiques du calcul des probabilités tel qu’il existe aujourd’hui.
À propos, le hasard existe-t-il ?
Il s’agit d’une controverse éternelle, qui paradoxalement intéresse peu le probabiliste. Lancer les dés, c’est faire de la mécanique du solide, point de hasard là-dedans, sauf que la sensibilité des dites équations aux conditions initiales est telle qu’il est impossible de contrôler le comportement du dé et qu’une modélisation aléatoire est plus efficace. Au temps des babyloniens, dans la haute Antiquité, les éclipses et les comètes furent un temps considérées comme des phénomènes aléatoires ce que tout détenteur du calendrier des postes peut démentir sans peine aujourd’hui. Fort de ma quarantaine bien tassée, je suis né comme un phénomène aléatoire pour mes parents : ils ignorèrent durant toute la grossesse quel serait le sexe de leur enfant. Échographie aidant, mes enfants ont été des filles et des garçons bien avant de sortir du ventre de leur mère. Dans un autre registre, la mécanique quantique a donné lieu à une controverse de titans quant à son caractère irrémédiablement aléatoire : un électron a-t-il une position au sens commun du terme ou celle-ci est-elle par nature une distribution de probabilité dans l’espace ? L’interprétation de Copenhague de Bohr va dans ce sens quand Einstein proclame « Dieu ne joue pas aux dés » et imagine un système de variables cachées pour cacher cet aléa qu’il ne saurait voir. L’expérience menée par Alain Aspect et son équipe dans les années 1980 tranchera en faveur du premier même si certains ne furent jamais convaincus, de Broglie, notamment.
Autre domaine où chacun de nous peut se poser la question : celui de la reproduction sexuée et de son cortège de spermatozoïdes. Les chanteurs attendris imaginent parfois la conception comme une course bien troussée :
De Ruth ou de Moïshé, lequel a eu l’idée ?
Qu’importe j’ai gagné la course, et parmi des milliers
Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers,
Une fois au moins les meilleurs, nous sommes nés.
(Bonne idée, JJ Goldman/JJ Goldman, En passant, Columbia, 1998)
Mais pour les généticiens, c’est tout le contraire d’une compétition, c’est une loterie qui a pour fonction de maintenir le réservoir génétique de l’espèce. Le patrimoine génétique d’un être humain est constitué de 23 paires de chromosomes. Chaque cellule sexuelle contient 23 chromosomes (un de chaque paire). Un couple peut donc produire :
223 × 223 = 246 7.1013 = 70 000 milliards de combinaisons
Finalement, cette analogie nous ramène à notre sujet, les jeux de hasard.
Brève histoire de la Loterie
À Gênes, au XVIe siècle, le Conseil de la Cité comporte 90 sénateurs. Cinq d’entre eux sont tirés au sort pour diriger la Cité. Cette règle suscite dans la population des paris sur les notables désignés, les gains étant fonction du nombre de coïncidences avec les sénateurs effectivement désignés.
Bendetto Gentile a l’idée de remplacer les noms par 90 numéros : il crée le premier Loto ! L’extrait simple, l’ambe (double), le terne, le quaterne, la quine sont les noms donnés aux différents niveaux de gain. Il y a donc 43 949 268 combinaisons possibles, et environ une chance sur 4 de gagner quelque chose à ce Loto.
Casanova (de Seingalt) (que l’on ne présente pas) propose l’idée au Contrôleur Général de Boulogne, Ministre de Louis XV qui crée la Loterie de l’école Militaire, le 15 octobre 1757, fédérant et centralisant au profit de l’état central les différentes loteries existant à l’époque en France. Le jeu est « rationnalisé », on ne parie que sur 2 ou 3 coïncidences, soit :

La loterie devient Loterie Royale le 30 juin 1776 sous Louis XVI et marque un retour à la loterie de Benedetto Gentile (fréquence bi-mensuelle). La loterie est supprimée sous la Révolution le 25 Brumaire an II (15.11.1793) pendant la Terreur pour des raisons morales. Puis elle est rétablie en septembre le 9 Vendémiaire an VI (30.09.1797) par le Directoire sous la contrainte budgétaire. Elle prend sans surprise le nom de Loterie Impériale sous l’Empire. Mais elle suscite des détracteurs acharnés (Mirabeau, Necker, Talleyrand...), elle est supprimée en 1835 puis mise hors-la-loi le 21 mai 1836. C’est la première mort de la Loterie. Elle renaît néanmoins de ses cendres le 31 mai par décret ministériel (sous l’égide du Conseiller d’état Henri Mouton), pour prendre, enfin, le nom de Loterie nationale.
Le 1er tirage a lieu le 7 novembre 1933 au Trocadéro. Le gagnant du gros lot (5 millions de francs de l’époque) est coiffeur de Tarascon : Paul Bonhoure avait acheté le bon billet 18414 de la série H. Il s’agit d’une véritable loterie au sens classique du terme : vente de tickets pré-imprimés, par tranches avec des gains croissants en fonction du nombre de chiffres en coïncidence avec le numéro tiré au sort. La Loterie nationale connaît son apogée en 1958, puis décline lentement. Entre-temps, un concurrent redoutable est né : le Tiercé.
Loto national : de la SLNLN à la FDJ
Le Loto national naît le 9 mai 1976, comme jeu d’accompagnement du tirage de la Loterie nationale.
1er tirage : 15-27-31-33-36-48 et 34
Aucun gagnant aux 1er et 2e rangs (voir ci-après, mais deux nombres consécutifs dans le tirage). Ce jeu va marquer un tournant dans la gestion des jeux de hasard et d’argent en France. On va en quelques années passer de la Loterie nationale à vocation socio-compassionnelle (« Gueules cassées »…) à une logique purement économique à base de marketing agressif, fondée sur un matraquage télévisuel sous forme de spots publicitaires bien conçus et de slogans qui se révèlent dévastateurs (« 100 % des gagnants ont testé leur chance »...). Le Loto, c’est un peu la panacée fiscale : on fait payer par les joueurs un impôt volontaire. Tout le monde a des raisons d’être satisfait : l’État engrange, le joueur rêve, et l’abstinent se doit d’être un contribuable reconnaissant puisque d’autres paient ses impôts à sa place (certes en partie seulement).
Et effectivement là, la machine s’emballe, publicité télévisuelle aidant :
• chiffre d’affaire de la Société de la Loterie nationale et du Loto national (SLNLN) en 1976 : 2 jeux et 327 millions d’euros (2,15 milliards de francs) ;
• chiffre d’affaire de la SLNLN en 1987 : 17,5 milliards de francs. Le Loto reste la pièce maîtresse de l’édifice avec 65 % du chiffre d’affaire. La Loterie nationale est comateuse ;
• chiffre d’affaire de la Française des jeux (FDJ) en 2005 : environ 8,9 milliards d’euros (multiplié par 27 depuis 1976) pour 30 jeux.
Entre-temps, la SLNLN a changé de statut, devenant France-Loto en 1989 (société détenue à 72 % par l’État). La mutation était engagée depuis 1988 avec pour but d’améliorer le rendement des activités de jeu pour l’État et d’assouplir l’usage des revenus qu’il en tire (qui étaient auparavant « fléchés » vers diverses grandes causes nationales un peu comme la Vignette automobile dans les premières années). En contrepartie, la société devient peu ou prou une société ordinaire. Pour en savoir plus, on peut se reporter au site de la FDJ
5
qui est intarissable de détails et d’anecdotes sur ses ancêtres et sur elle-même.
En 1989, le premier jeu de grattage est lancé (Cash) avec 100 000 francs comme gros lot à la clé pour une mise de 10 francs. On peut enfin jouer compulsivement comme sur les machines à sous que Charles Pasqua venait juste d’autoriser deux ans auparavant (en 1987) dans les casinos. Le « comme » est sans doute malvenu car il n’y a pas (encore) de casinos à chaque coin de rue.
En 1991, dans la foulée d’un plan social qui divise les effectifs par deux (soit 500 personnes au final), l’entreprise devient la Française des jeux (FDJ). Pour le grand public, l’événement marquant est le lancement du Millionnaire et son « Je passe à la Télé » qui apparaît comme une quintessence, un nirvanah puisque l’on réalise deux rêves à la fois : passer à la Télé et devenir millionnaire (en francs). Auparavant, il a fallu gratter et gratter encore.
Quelques réponses indiscrètes sur le Loto
Pour mieux comprendre les quelques lignes qui suivent, il est utile de savoir que dans une collection de n objets, il y a :

Ainsi, il y a

façons de tremper trois doigts dans un pot de confiture.
Règles
Il faut :
• cocher 6 numéros parmi 49 ;
• valider la grille pour un ou deux tirages consécutifs, le mercredi ou le samedi ;
• lors d’un tirage, on tire 6 boules numérotées parmi 49 d’une sphère transparente animée de mouvements gyroscopiques. Puis on tire 1 boule supplémentaire, le numéro complémentaire.
Probabilités de gain
Les rangs :
• Rang 1 : 6 bons numéros (identiques au tirage) ;
• Rang 2 : 5 bons numéros et le numéro complémentaire ;
• Rang 3 : 5 bons numéros ;
• Rang 4 : 4 bons numéros et le numéro complémentaire ;
• Rang 5 : 4 bons numéros ;
• Rang 6 : 3 bons numéros et le numéro complémentaire ;
• Rang 7 : 3 bons numéros.
Tableau I Résultats par rang
|
(Attention au numéro complémentaire !)
(Attention au numéro complémentaire… bis !)
(Attention au numéro complémentaire… ter !)
|
Il y a :

combinaisons dont : 260 624 combinaisons gagnantes soit environ :

chance(s) de gagner… comme à la Loterie Royale sous Louis XVI.
L’espérance de gain brut est de 50 % des mises environ (fluctue à la marge) ; l’espérance de gain net est de 50 euros de perte pour 100 euros misés.
Un détour par les jeux de casino : de 2 à 10 euros de perte moyenne pour 100 euros misés. Dans les jeux casinos, plus la mise unitaire est élevée, plus le taux de retour moyen est élevé. On perd en moyenne plus à la Boule, sorte de roulette qui fait antichambre dans les salles de jeux, qu’à la Roulette.
Quelques expériences de pensée
Pour se représenter les paramètres qui régissent un jeu de hasard et d’argent tel que le Loto, les chiffres bruts ne sont pas parlants. Il faut trouver des analogies avec des événements de la vie. Tentons l’expérience.
On adopte la stratégie suivante : à chaque tirage, on valide deux grilles (distinctes), soit 8 grilles par semaine (2 grilles car cela a longtemps été le minimum réglementaire). Qu’advient-il au fil du temps ?
• temps d’attente moyen du « gros lot » (gain au rang 1) : 336 siècles 17 ères chrétiennes ;
• temps d’attente moyen du « demi-gros lot » (rang 2) : 56 siècles ;
• temps de retour d’une combinaison donnée : 672 siècles.
À titre de comparaisons : un conducteur a 7/10 000 chances de se tuer en voiture dans l’année si bien que, même s’il était biologiquement immortel un automobiliste mourrait en moyenne à 1 400 ans dans un accident de voiture. De même, la probabilité pour une femme de mourir en couches est malheureusement, y compris dans les pays développés, plus de 10 fois supérieure à celle de gagner au Loto au premier rang. Et dire que les joueurs sont souvent superstitieux !
Gagner au Loto à chaque tirage ?
Question : combien doit-on valider de grilles à 6 numéros pour être certain de gagner à chaque tirage ? Question saugrenue ? Les auto-proclamés systémistes en ont inondé les boîtes aux lettres et les kiosques pendant des années de listes de telles grilles-miracles.
Traduction mathématique : quel nombre minimum de combinaisons de 6 numéros doit-on cocher de façon à « contenir » toutes les combinaisons possibles à 3 numéros ? Et comment accéder à ces combinaisons ? Il s’agit en fait d’une question très difficile à résoudre mathématiquement parlant et à dire vraie encore ouverte à ce jour : personne n’a démontré que la meilleure solution connue était optimale. Ce record est de 174 grilles à 6 numéros (voir Pagès, 1999 pour une solution explicite pouvant être mise en œuvre par tout joueur motivé).
Ces officines de prétendus « systémistes » vendent des listes-miracle à 193 puis, étrange coïncidence à 174 numéros, construites à partir d’un chiffre de la chance (l’ensemble pour 300 francs environ à la fin des années 1990, soit 45 euros)... Le chiffre de la chance provient du fait qu’il existe un degré de liberté permettant de décider a priori quel numéro sera le plus souvent utillisé dans la liste de combinaisons.
Détail bon à savoir : lorsque l’on joue une liste à 174 combinaisons « toujours gagnante », on perd en moyenne et comme d’habitude la moitié de ses mises. Sauf que là, on a investi beaucoup (achat de la liste, validation des 174 grilles…).
Revue partielle des succès récents de la FDJ
Gagner à Euromillions
Le dernier avatar majeur de la FDJ en matière de Loto, c’est Euromillions. Un Loto (à double-grille) mais à l’échelle européenne ! Démarré avec trois pays (France, Espagne, Royaume-Uni), il englobe aujourd’hui une bonne partie de l’Europe occidentale sous l’égide de la FDJ.
Il existe cependant une recette infaillible pour gagner à Euromillions que je ne résiste pas à vous livrer ; chacun pourra ainsi faire une bonne action en refilant le tuyau aux accros de son entourage :
• ingrédients : un avion privé, un parachute, l’annuaire téléphonique de l’Allemagne, un papier et un crayon ;
• procédure : s’arrimer au parachute et monter dans l’avion ; décoller et demander de mettre le cap sur l’Allemagne ; choisir au hasard un nom dans l’annuaire ; le noter soigneusement accompagné de son numéro de téléphone sur son papier avec son crayon ; ouvrir à nouveau l’annuaire au hasard et demander au pilote d’ouvrir la porte dans le nombre de minutes correspondantes au numéro de la page que l’on a sous les yeux ; sauter à son signal ; profiter de la chute libre puis ouvrir son parachute ; atterrir, replier son parachute et avancer droit devant soi ; saluer le premier passant que vous croisez, lui demandez poliment son nom et son numéro de téléphone.
Le moment de vérité :
• vous avez de la chance, ce sont précisément les coordonnées que vous aviez notées dans l’annuaire ! Ça y est, c’est arrivé, enfin... vous avez gagné le gros lot à Euromillions !
• pas de chance ! Ce n’était pas lui ! Mais qu’importe, vous reprendrez l’avion la semaine prochaine...
Pour mieux comprendre la recette ci-dessus (y compris son caractère un peu approximatif), il faut se pencher brièvement sur la règle du jeu de l’Euromillions. Elle reste simple bien que comportant deux étages : il faut cocher 5 « cases » parmi 50 et 2 « étoiles » parmi 9. Chaque bulletin comporte donc deux grilles et non une comme au Loto.
Un rapide calcul, analogue à celui détaillé pour le Loto « national », montre qu’il existe donc une combinaison gagnante au tirage pour : 76 275 360 combinaisons distinctes.
D’où la comparaison (approximative) avec l’Allemagne qui compte cependant 81,5 millions d’habitants. Il existe évidemment des gagnants à des rangs inférieurs comme au Loto et dont nous ne parlons pas ici.
Gagner au grattage : le Végas
Le Végas est un jeu de grattage, l’un des gros succès de la FDJ de ces dernières années sur ce créneau. Peu importe la mécanique du jeu, intéressons-nous un instant à la structure des gains.
Principe du jeu
D’après le décret du 12 septembre 2004 :
• un « bloc » est constitué d’un rouleau de 500 000 tickets, réparti en 10 000 bandes de 50 tickets ;
• un ticket est vendu 3 euros (soit 1 500 000 euros le bloc) ;
• il y a 117 197 tickets gagnants dont 7 697 lots significatifs ( 20 euros dont 1 de 40 000 euros) et 109 500 petits lots (de 3 à 10 euros) ;
• redistribuant 1 020 500 euros, soit 67 % des mises.
Principe d’addiction
Ce jeu, comme tous les autres jeux de grattage, adopte une structure de gains en trois segments, fruit d’un principe marketing dont le but évident est de créer une addiction chez le joueur.
Le gros lot pour le passage à l’acte : on crée l’envie de jouer, généralement à distance (via la télévision, la radio, le journal quotidien ou magazine…) en suscitant du rêve.
Les lots « significatifs » (affichés et commentés sur les lieux d’achat) sont des piqûres de rappel sur site (comme le bruit des jetons qui tombent dans les machines à sous) : ils créent le désir immédiat de jouer en matérialisant sinon dans le temps du moins dans l’espace le rêve de gain.
Les petits lots créent une forme de dépendance compulsive : le joueur rejoue systématiquement son gain jusqu’à la perte de sa mise initiale (la ruine du joueur est le terme probabiliste consacré).
Principe d’optimisation
La loi a introduit il y a quelques années la notion de hasard prépondérant dans la conception des jeux de hasard et d’argent. Il faut rendre hommage à l’auteur de la formule qui frise l’oxymore et ne signifie rien ni pour les probabilistes ni pour les juristes. Pour autant, une telle modification a sans aucun doute dû avoir des conséquences. Par exemple, celle consistant à vouloir mieux répartir les gains « significatifs » sur le territoire à des fins marketing. À cette fin, on peut imaginer le dispositif suivant (encore en cours en février 2006, et semble-t-il modifié depuis) :
• garantir au moins 50 euros par bande en lots (pas forcément petits) ;
• mettre au plus un lot significatif par bande donc dans 7 697 bandes, soit 3 chances sur 4.
Mais que se passe-t-il lorsque le hasard n’est que prépondérant au sens décrit ci-dessus et que l’on constate que la quasi-totalité des joueurs grattent sur place ?
Deux cas de figure peuvent se poser au détaillant :
• que faire du reste d’une bande une fois le lot significatif vendu et gratté ? C’est certes uniquement un dilemme moral pour le détaillant qu’il pourra résoudre à l’occasion du passage d’un joueur inconnu ou en garnissant les pochettes-cadeaux de la FDJ vendus lors des Fêtes ;
• que faire lorsque le lot significatif d’une bande ne sort pas ? Là, c’est un problème de mathématiques (contrôle stochastique)... qui débouche sur un second dilemme : pour détaillant vigilent et patient, retirer la bande après le 31e ticket vendu et gratter pour son compte ; pour détaillant distrait et impatient, retirer la bande après le 42e ticket vendu et gratter pour son compte.
C’est là le résultat d’un calcul probabiliste élémentaire faisant appel à des techniques dites de contrôle stochastique. Le second scénario ne prend pas en compte dans le calcul les petits lots (pour soulager la mémoire du détaillant). Dans les deux cas, le gros lot (40 000 euros) est intégré au calcul ce qui rend peu réaliste la mise en œuvre effective de la stratégie avec les valeurs indiquées. Des valeurs réalistes sont néanmoins calculables par la même méthode sans difficulté particulière. Quoi qu’il en soit, cet avatar du hasard prépondérant illustre parfaitement une règle probabiliste et statistique absolue : toute distorsion du hasard dans un phénomène aléatoire (ici la répartition aléatoire « uniforme » des tickets gagnants) induit pour celui qui possède l’information une possibilité d’en tirer partie.
Soyons clair, point n’est besoin de connaître la nature de la distorsion, il suffit de savoir qu’elle existe. Un bon sens de l’observation, les statistiques (pour déterminer effectivement la nature exacte de la distorsion introduite) et les probabilités (pour en tirer partie) feront le reste.
Le hasard prépondérant n’est pas du hasard, simplement une manipulation hasardeuse.
Loi du Rapido
Tout bistrot est un tripot qui s’ignore !
Sous couvert de lutter contre le jeu clandestin, la FDJ crée en 1999 ce jeu qui n’est autre qu’un vulgaire Loto ayant simplement la particularité de donner lieu à un tirage toutes les 5 minutes. Et on peut valider son bulletin pour une quantité affolante de tirages consécutifs. Une lutte contre le jeu clandestin somme toute redoutablement efficace : le jeu devient l’une de ses vaches à lait et est développé à marche forcée dans toute la France avec une prédilection pour les quartiers populaires. Le profil-type du joueur : un homme, célibataire, ouvrier ou petit employé, souvent attiré aussi par les courses hippiques, capable de valider pour plusieurs dizaines d’euros de grilles chaque jour, voire plus en week-end. Au point que Bercy s’en inquiète en 2005 et demande à la FDJ de mettre la pédale douce.
Et pourtant ils jouent...
Pour terminer sur une note peut-être plus mathématique et plus constructive, on peut tenter de modéliser pourquoi aucun calcul de probabilité ou d’espérance produit par un probabiliste n’a jamais convaincu un joueur de cesser de jouer. En économie en général et en économie mathématique en particulier, on part toujours du principe que l’individu a un comportement rationnel. Il faut donc modéliser cette rationalité du joueur face au jeu ou, de façon duale, modéliser la structure de gain d’un jeu pour en optimiser l’emprise sur le joueur. On peut imaginer schématiquement de procéder comme suit.
Soit G le gain (brut) dans un jeu de hasard et d’argent :
• le joueur ne raisonne pas en « espérance » (en moyenne...) ;
• il est « aimanté » par un risque inversé :
Espérance (Gain) + λ × Variance (Gain)
λ > 0 cœfficient d’attraction propre à chaque individu ou, par souci d’homogénéité,
Espérance (Gain) + λ × Écart-type (Gain)
• le joueur joue si « son λ » est strictement supérieur à celui du jeu, noté λV, et déterminé par :
Espérance (Gain) + λV × Écart-type (Gain) = Mise
Exemple : Le Végas (Mise = 3 euros)
• Espérance (Gain) = 2,041 euros
• Écart-type (Gain) = 22 851
• λV ≥ 4.20 10–5
On peut dans un second temps envisager de se lancer dans une comparaison des λJ des autres jeux de grattage, de tirage et classer ces différents λJ. Puis, pourquoi ne pas vérifier si l’hypothèse d’un λ propre à chaque joueur est cohérente en l’interrogeant sur les jeux auxquels il envisage de jouer et ceux auxquels il n’est pas tenté de jouer ?
En conclusion, cette communication peut laisser croire que l’auteur conçoit une acrimonie particulière contre la Française des jeux et qu’il saisit chaque occasion de la vilipender, dans un brouet de considérations mathématico-moralisantes. Cette impression est en fait le fruit d’un état de fait : la FDJ bénéficie d’un monopole dans l’organisation des jeux de hasard et d’argent (hors casinos), donc dispose de fait du monopole des jeux de masse à destination du grand public. Si le joueur va au casino, il est indubitable que la Française des jeux va au joueur au travers de son omniprésence publicitaire et sponsorisante. Et c’est ce qui fait toute la différence, pas seulement morale. Or, à l’origine, ce monopole était, au moins officiellement, justifié par le constat que le jeu d’argent étant un « vice » chevillé à l’âme (de certains...), il était vain de vouloir le prohiber, un peu comme l’alcool, le tabac ou la prostitution, et qu’en conséquence, il était du rôle de l’État de le réguler au mieux de l’intérêt général, au profit des causes qui le méritent. Le comportement marketing agressif adopté cyniquement par la FDJ ces vingt ou trente dernières années a fait tomber le masque : elle cherche simplement et par tous les moyens l’argent là où il se trouve, sans trop s’embarrasser de scrupules en chemin... La notion de hasard prépondérant introduite dans les règlements régissant la conception des jeux en a constitué l’un des plus notables dérapages, mal contrôlé comme la suite l’a montré. À mon sens, l’apogée marketing du système a été atteint par le lancement puis le développement à marche forcée du Rapido.
Mais les temps changent. Bruxelles s’intéresse depuis peu aux jeux de hasard et d’argent dans le cadre de sa politique de régulation et la FDJ voit les nuages s’amonceler au-dessus de son monopole, alors qu’elle a perdu à peu près toute crédibilité comme régulateur des jeux de hasard et d’argent en France. De nouveaux opérateurs tentent, sans (trop) de succès à ce jour, de pénétrer le marché français, grâce à la répression active menée par l’État à leur encontre. La FDJ réagit en arguant de sa vertu – on parle ici d’opérateur de jeux « responsable » – et de ses efforts d’auto-limitation (self-containment !) : ainsi, elle vient tout juste d’interdire l’accès à ses jeux aux mineurs. Ceci laissera sans doute perplexes les naïfs qui croyaient qu’il en avait toujours été ainsi. Des commissions sont créées, des études lancées, la FDJ coopère sans barguigner, finance à l’occasion et se penche en mère fouettarde sur le Rapido. Un tel revirement peut prêter à sourire et suggère plus Tartuffe qu’Alceste. Pour autant, ce qui se profile actuellement en France en matière de rupture de monopole des jeux fait penser à Pandore, juste au moment où il retrouve sa boîte.
Bibliographie
[1] bernoulli j. Ars conjectandi. Ouvrage posthume publié à Bâle par Thurnisii fratri (1713). Rééd..
En allemand in Die Werke von Jakob Bernouilli.
vol. 3:Bâle, Birkhäuser Verlag:1975;

[2] pagès g,
bouzitat c. En passant par hasard.
Vuibert;
Paris: (1
re éd. 1999 ; 3
e éd. 2003).

[3] pascal b. Pensées (pensée n° 233 de l’édition Brunschvicg).
Œuvre posthume. 1670;
Hachette;
Paris:1897;

Gilles Pagès
Laboratoire de Probabilités et Modèles aléatoires
UMR-CNRS 7599,Université Pierre et Marie Curie, Paris
Santé mentale : transformations de la psychiatrie et transformations de la société
Vous m’avez demandé de parler de ce « fait social nouveau qu’est, dans nos sociétés, la tendance croissante à considérer les comportements individuels comme problèmes de santé publique et l’abord de ces problèmes en termes de santé mentale ». D’abord une remarque liminaire sur les addictions.
Dans un livre publié il y a douze ans (Ehrenberg, 1995

), j’avais consacré une des deux parties de l’ouvrage à la drogue et à ses mutations, l’autre partie étant consacrée aux mutations de la télévision, elle-même objet hautement addictif, paraît-il. M’intéressaient tout particulièrement la crise de la loi via l’extension de la préoccupation aux médicaments psychotropes et les addictions sans drogues, c’est-à-dire centrées sur le comportement. Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de drogues, pas de substances, qu’il n’y a pas d’objet, ces comportements investissant justement sur toutes sortes d’objets, nourriture, jeux, sexe, sport… Progressivement, la toxicomanie a été redécrite sous un nouveau point de vue, celui des addictions (après que l’on eut parlé de « nouvelles addictions »), point de vue relativisant la dimension pénale de la drogue et la réification de l’interdit. Ce n’est plus la loi qui fait la différence pertinente. La loi interdisait la consommation de produits, pas les comportements addictifs. L’addiction, la toxicomanie, était seconde par rapport à l’interdit de l’acte.
De là, je me suis mis à travailler sur la dépression que j’évoque pour souligner un point : on voit très bien à partir des années 1970, la montée d’une préoccupation commune pour les addictions et les dépressions (Ehrenberg, 2000

). Dans les années 1970 dans la psychopathologie : addiction et dépression sont en relation causale ou, à tout le moins, comorbide, l’addiction étant conçue comme une autothérapie de la dépression. Une petite dizaine d’années plus tard, l’addiction devient une catégorie générale : on va parler d’addiction positive (c’est le support social) et d’addiction négative, la première favorisant l’autonomie individuelle, la seconde l’annihilant. L’extension du concept est telle qu’il ne désigne plus nécessairement une pathologie. Avec l’addiction, il me semble qu’il y a une double dimension à prendre en compte : le couple stimuler/calmer et le couple s’attacher/se désattacher.
La préoccupation sociale et politique pour les dépressions et les addictions se fait dans un contexte où tout ce qui concerne la souffrance psychique, les dysfonctionnements ou les handicaps personnels, et, à l’inverse, le développement personnel et la réalisation de soi en tant qu’individu autonome, se trouvent au centre de l’attention. C’est une affaire de mœurs, de changement global de la socialité, des manières de vivre. Et il faut prendre cela en compte.
La santé mentale est une rubrique regroupant des faits fort disparates, mais, le point est qu’elle désigne une réorganisation générale des relations santé, maladie et socialité. C’est ce triplet qui doit être au cœur de l’analyse pour que les expertises aient des conséquences plus positives pour les politiques en santé publique que les séismes polémiques auxquels nous avons assisté. Une expertise en santé publique ne doit pas développer une conception purement médicale, surtout quand on a affaire à des pathologies pour lesquelles aucun mécanisme physiopathologique n’a été découvert. Un point de vue médical n’est pas un point de vue partiel susceptible d’être complété par d’autres approches, mais un point de vue erroné, inadéquat et sans conséquences pour l’action à mener
1
Malaise dans l’évaluation de la santé mentale, Esprit, mai, p. 89-102/Santé mentale : malaise dans l’évaluation, Médecine/Science, 22 (5) mai, 548-563 (il s’agit du même article) et Épistémologie, sociologie, santé publique : tentative de clarification (à propos du trouble des conduites), Neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, octobre 2007. Je reprends dans cet exposé des éléments dispersés dans plusieurs publications (dont ces deux articles). Ils sont l’objet d’un travail en cours de développement sur les relations entre le social et le mental dans la société contemporaine, à partir des trois cas de la psychanalyse, de la psychiatrie et des neurosciences.
.
Élaborer le concept de santé mentale
Commençons par la façon dont on parle de la santé mentale dans des rapports typiques comme Le Livre vert de l’Union Européenne en 2005 ou le rapport du
Surgeon General des États-Unis en 1999. Ils se caractérisent par une conception de la santé mentale en termes de faits positifs de santé qui se montrent dans les données. Par exemple, dans Le Livre vert, on écrit que « le pourcentage d’adultes européens ayant connu une forme de maladie mentale au cours de l’année écoulée est estimé à 27 % » (Commission Européenne, 2005

). Le nombre de personnes touchées par ces maux et leurs coûts pour la société sont démesurés (dans le Livre vert, 3 à 4 % du PIB), ce qui en fait un domaine pathologique majeur aujourd’hui, à côté du cancer ou des maladies cardiovasculaires, mais en plus coûteux.
Ces régularités statistiques impressionnantes montrent que l’on a affaire à un fait social, mais la façon dont elles sont présentées ne nous dit rien de ce en quoi consiste ce fait, de quel genre de fait il s’agit : ce
style matter of facts rend mal compte de la santé mentale et de la souffrance psychique en tant que fait social, c’est-à-dire en tant que santé mentale et souffrance psychique qui ont pris depuis vingt ou vingt-cinq ans une valeur telle dans nos sociétés qu’elles semblent être devenues un point de repère majeur de l’individualisation de la condition humaine. Cette question de la valeur apparaît seulement en filigrane : « Pour les citoyens, la santé mentale est une ressource qui leur permet de réaliser leur potentiel émotionnel et intellectuel, et de trouver et de réaliser leur rôle dans la vie sociale, à l’école et au travail. Pour les sociétés, la bonne santé mentale des citoyens contribue à la prospérité, la solidarité et la justice sociale »
2
« Inversement, la mauvaise santé mentale impose des coûts, des pertes et des fardeaux multiples sur les citoyens et les systèmes sociaux ». Commission Europeenne, 2005

, p. 4
(Commission Européenne, 2005

).
Ce qui apparaît en filigrane dans des rapports où l’on insiste sur les faits, les régularités statistiques, c’est que la santé mentale est une valeur au sens où elle concerne non seulement la santé, mais aussi la socialité de l’homme d’aujourd’hui. Le rapport sur la santé mentale du
Surgeon General le dit clairement : « La santé mentale est état d’exécution réussie des fonctions mentales, ayant pour résultat des activités réussies, des relations accomplies avec les autres, la capacité à s’adapter au changement et à surmonter l’adversité. La santé mentale est indispensable au bien-être personnel, à la famille et aux relations interpersonnelles, et contribue à la société et à la communauté. De la petite enfance à la mort, la santé mentale est le tremplin des compétences de pensée et de communication, de l’apprentissage, de la croissance émotionnelle, de la résilience et de l’estime de soi. […] Les Américains sont inondés de message sur le succès […] sans qu’ils se rendent compte que ces succès reposent sur le fondement de la santé mentale » (
Office of the Surgeon General, 1999

). De quoi nous parle-t-on dans tous ces rapports sinon de nos idéaux sociaux ? Une vie réussie aujourd’hui implique la santé mentale : c’est ce qui fait le caractère consensuel de la notion (il n’y a pas de santé sans santé mentale).
C’est pourquoi il est très important du surmonter le dualisme fait/valeur qui pose que, les faits sont objectifs, donc relèvent de la science, et que les valeurs, étant subjectives, relèvent de l’opinion. C’est de la pure métaphysique, c’est de la science magique, car la caractéristique du fait social est précisément que l’opinion n’est pas extérieure à l’objet, mais bien au contraire en est une propriété. Par exemple, quand nous parlons d’absence de culpabilité dans le trouble des conduites ou, au contraire, d’excès de culpabilité dans la mélancolie – et nous avons d’excellentes raisons de le faire –, ne faisons-nous pas une évaluation, ne jugeons-nous pas, n’accordons-nous pas une valeur à un fait sans laquelle il n’y aurait aucun fait ? Si nous ne parlions pas d’excès de culpabilité dans la mélancolie ou d’absence de culpabilité dans le trouble des conduites, ni le fait mélancolique ni le fait du trouble des conduites n’existeraient : ils seraient sans valeur en tant que fait. Émile Durkheim, dans la préface à la seconde édition de « Les Règles de la méthode sociologique », distinguait de la manière suivante la contrainte sociale de la contrainte chimique ou de la contrainte physique : « Ce qu’a de tout à fait spécial la contrainte sociale, c’est qu’elle est due, non à la rigidité de certains arrangements moléculaires, mais au prestige dont sont investies certaines représentations » (1973

). Les notions de prestige, de respect ou d’attente sont des concepts sociaux, ils impliquent des coutumes, des mœurs, des institutions, un esprit commun que j’entends sur le mode de l’esprit des lois de Montesquieu.
Cette socialité est engagée dans un profond changement et un style de changement qui, dans de nombreuses sociétés, notamment dans la société française, soulève des inquiétudes sur le devenir du lien social, de la vie commune. Cela fait de la santé mentale non seulement une notion consensuelle, mais aussi conflictuelle. Ce caractère conflictuel tient à ce que les pathologies mentales ont une double spécificité. La première est de mettre en relief un aspect moral et social qui est beaucoup moins présent dans les autres espèces pathologiques. Ces pathologies touchent en effet le sujet dans sa « personnalité », c’est-à-dire dans ce que les sociétés occidentales pensent être l’essence même de l’humain. La deuxième spécificité est d’être le domaine dans lequel la double constitution biologique et sociale de l’espèce humaine, double constitution qui conditionne la possibilité de notre vie psychique, s’entremêle inextricablement. La tension entre l’homme comme être de nature et l’homme comme être historique ou social y est bien plus vive que dans les autres domaines pathologiques.
La santé mentale est donc une notion à la fois consensuelle, sur sa nécessité, et conflictuelle, sur ses contenus et ses significations. La notion de santé mentale désigne un spectre de problèmes qui va des psychoses et des graves retards mentaux au développement personnel ou à ce que la psychiatrie appelle « la santé mentale positive ». Comment élaborer cette notion sans limites ?
Les questions portant sur la « subjectivité individuelle » occupent aujourd’hui une place centrale dans la société et dans les savoirs. Dans la société, c’est le souci pour la souffrance psychique et la santé mentale qui semblent être les principaux points de repère de l’individualisation de la condition humaine en même temps que comme un carrefour de conflits. Dans les savoirs, ce sont les émotions et les sentiments moraux. Ces thèmes sont désormais transversaux à la biologie, la philosophie, et aux sciences sociales. À ces deux niveaux, de la société et des savoirs, la subjectivité individuelle, ses liens avec le corps (le cerveau) et la société sont la cible des préoccupations.
En conséquence, la santé mentale est certes un nouveau problème de santé publique, un domaine pathologique majeur, mais le point décisif est qu’elle ne correspond pas seulement à une réalité précise qu’on pourrait découper dans la vie sociale : elle relève d’une attitude, elle dessine une ambiance, elle caractérise une atmosphère de nos sociétés, c’est un état d’esprit.
À la différence de la psychiatrie, la santé mentale relève des phénomènes de sociologie générale, phénomènes qui concernent la cohésion sociale. C’est cette situation neuve, cet état d’esprit que je cherche à clarifier. On emploie en effet aujourd’hui ces deux notions dans un nombre de situations tellement variées qu’on peut se demander dans quelle mesure elles ne sont pas devenues des systèmes d’identification de problèmes généraux de la vie sociale contemporaine. Elles sont le fruit d’un contexte par lequel l’injustice, l’échec, la déviance, le mécontentement tendent à être évalués par leur impact sur la subjectivité individuelle (qualité de vie, souffrance/bien-être) et sur la capacité à mener une vie autonome réglée. La santé mentale se caractérise par la mise en relation systématique d’afflictions individuelles et de relations sociales, y compris en neurobiologie où la question de l’interaction sociale et des émotions fait l’objet de recherches intensives depuis une vingtaine d’années, notamment sur les syndromes autistiques et les schizophrénies. C’est pourquoi l’angle par lequel j’aborde la santé mentale consiste à la considérer comme une grille de lecture transversale de dilemmes et des tensions de la société démocratique d’aujourd’hui.
De la psychiatrie à la santé mentale : la triple transformation
La clarification doit se faire en posant deux questions : quelles sont les conditions ayant permis que la santé mentale et la souffrance psychique deviennent des références sociales centrales ? Quels en sont nos usages, quels rôles jouent-elles dans la société d’aujourd’hui ? L’enjeu sociologique et politique porte sur la signification du tournant individualiste pris par les sociétés démocratiques depuis la fin des années 1960. Ce tournant est celui du basculement progressif des valeurs de la discipline dans celles de l’autonomie : elle se caractérise par un ancrage dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous d’un double idéal de réalisation de soi et d’initiative individuelle. Autonomie, responsabilité, subjectivité sont les trois mots clés de ce que j’appelle le tournant personnel de l’individualisme contemporain. Le problème est le suivant : ce n’est pas parce que la vie humaine apparaît plus personnelle aujourd’hui qu’elle est pour autant moins sociale, moins politique ou moins institutionnelle. Elle l’est autrement, c’est cet autrement dont je voudrais donner un aperçu. C’est un problème d’identification du changement.
Mon hypothèse globale est que le souci généralisé pour la souffrance psychique et la santé mentale s’est imposé à la fois comme un carrefour de multiples tensions inhérentes au monde de l’autonomie dans lequel nous vivons désormais. Pourquoi ? La raison tient à ce qu’elles offrent des moyens de formuler ces tensions et d’y répondre. La grande différence entre la psychiatrie et la santé mentale peut se formuler dans des termes simples : la psychiatrie est un idiome local, spécialisé dans l’identification de problèmes particuliers ; la santé mentale, dans la mesure où elle imprègne l’ensemble de la vie sociale, est un idiome global permettant de mettre en forme les conflits de la vie sociale contemporaine, c’est-à-dire d’identifier des problèmes très généralement liés à des interactions sociales, de leur attribuer des causes et de leur trouver des solutions, autrement dit, de les réguler en mobilisant des rapports sociaux. C’est le ressort de la valeur accordée à la santé mentale. Cette hypothèse se décline en trois aspects, et j’insisterai sur le troisième aspect.
La souffrance psychique et la santé mentale s’insèrent dans la tradition des « maladies de la vie moderne » qui commence à la fin du XIXe siècle avec la neurasthénie. Depuis lors, l’idée que la vie en société produit de la psycho-pathologie est un thème récurrent. Cependant, la situation contemporaine est totalement différente, parce que nous avons affaire à une véritable forme sociale insérée dans les routines de la vie quotidienne. Le premier aspect peut être caractérisé par des critères de valeur. L’atteinte psychique est aujourd’hui considérée comme un mal au moins aussi grave que l’atteinte corporelle et, souvent, plus insidieux. Elle concerne également chaque institution (école, famille, entreprise ou justice) et mobilise les acteurs les plus hétérogènes. Enfin, l’atteinte psychique est une justification générale de l’action : non seulement aucune maladie, mais encore aucune situation sociale « à problèmes » (la délinquance adolescente, le chômage, l’attribution du RMI, la relation entre employés et clients ou usagers…) ne doivent aujourd’hui être abordées sans prendre en considération la souffrance psychique et sans visée de restauration de la santé mentale. Ce souci pour les troubles de masse de la subjectivité individuelle balance entre inconfort et pathologie, inconduite et déviance. Nos deux expressions forment un système de référence permettant de faire de la subjectivité un objet identifiable socialement et donc d’agir sur elle. Ce sont des concepts ou des catégories qui érigent la subjectivité en autant d’entités opératoires (dépression, obsessions, compulsions, hyperactivité, phobies sociales…) auxquelles les individus peuvent s’identifier (par exemple, les associations d’hyperactifs adultes et d’Aspergers aux États-Unis et au Canada revendiquant moins un statut de malades à traiter que d’individus au « style cognitif différent ») et sur lesquelles il est possible à des professions hétérogènes d’agir. La transformation d’entités cliniques en raison d’agir dans des situations sociales quelconques indique une direction d’analyse : on y voit comment s’instituent de nouveaux idéaux pour l’action, des manières de vivre qui rassemblent le prestige.
Mais elle implique d’abord de passer par un deuxième aspect qui concerne la relation normal-pathologique. Pour de nombreux observateurs, la psychiatrisation du social brouillerait la distinction du normal et du pathologique. La souffrance psychique et la santé mentale sont supposées être aujourd’hui des symptômes du « malaise dans la civilisation », de la crise du lien social. Ne parle-t-on pas couramment de psychologisation, de pathologisation, de médicalisation de la vie sociale ? Parler en ces termes implique que l’on fait face à une dégradation qui ne nous dit qu’une chose : la vraie société, c’était avant. Les souffrances sociales seraient causées par le nouveau capitalisme mondialisé et les nouvelles pathologies de type narcissique seraient causées par la libération des mœurs qui a entraîné une crise du symbolique. Il s’agit de deux variantes d’une même représentation : elles seraient causées par cette disparition de la vraie société, celle où il y avait de vrais emplois, de vraies familles, une vraie école et une vraie politique, celle où l’on était dominé, mais protégé, d’une part, névrosé, mais structuré, d’autre part.
Il y a là une erreur de perspective qui ne permet ni de voir et de comprendre les changements normatifs de nos sociétés ni de bien décrire la nature des transformations de la psychiatrie. Nous assistons plutôt à une recomposition, une reformulation d’ensemble de la relation normal-pathologique, parallèle d’ailleurs à celle des rapports entre le permis et le défendu, et non à une psychiatrisation de la société. Pour le comprendre, il ne faut pas se demander, contrairement à l’usage fâcheux, quelle est la frontière entre le normal et le pathologique, parce que cela oblige à poser d’abord deux entités substantielles séparées, le normal et le pathologique, puis à chercher ensuite leurs relations. Il faut, au contraire, employer une approche relationnelle qui consiste à décrire comment la relation normal-pathologique se modifie, car ces deux pôles ne se définissent que l’un par rapport à l’autre, ils sont relatifs l’un à l’autre. Ce n’est pas seulement la maladie et la pathologie qui changent, mais aussi la santé et la normalité. C’est l’ensemble maladie-santé-socialité qui est reformulé et non la société qui s’est psychiatrisée ou psychologisée, et cela en fonction de la valeur suprême qu’est aujourd’hui l’autonomie individuelle.
L’autonomie du point de vue sociologique ou comment être l’agent de son propre changement
Ce qui conduit donc au troisième aspect, celui de la vie sociale : la santé mentale et la souffrance psychique forment un couple qui s’est socialement imposé dans notre vocabulaire à mesure que les valeurs de propriété de soi, c’est-à-dire l’accroissement considérable des possibilités morales de choisir son « style de vie », d’accomplissement personnel (quasi droit de l’homme) et d’initiative individuelle s’ancraient dans l’opinion. Choisir par soi-même, s’accomplir en devenant soi-même, agir par soi-même, l’autonomie consiste à placer l’accent sur des valeurs et des normes incitant à la décision personnelle, qu’il s’agisse de recherche d’emploi, de vie de couple, d’éducation, de manières de travailler, de se conserver en bonne santé ou… d’être malade.
Si l’autonomie est une caractéristique générale de l’action humaine, sur un plan sociologique, c’est-à-dire dans le contexte d’aujourd’hui, nous ne sommes plus dressés à la discipline mais à l’autonomie. C’est un changement général de l’esprit de la socialité. L’obéissance mécanique, « les corps dociles et utiles » décrits par Foucault, n’a évidemment pas disparu, mais elle a été englobée dans et subordonnée par l’autonomie qui lui est désormais supérieure en valeur. Cet englobement de la discipline dans l’autonomie met partout en relief un aspect personnel dans l’action (agir par ou de soi-même, même si on obéit à un ordre). Or, dans notre société, on a tendance à penser que « personnel » équivaut à psychologique et privé, c’est l’une des croyances individualistes les plus ancrées dans l’opinion commune et savante.
Pour sortir de la psychologie, de ce qui se passe dans la tête des gens, il faut situer la centralité de la subjectivité par rapport à la généralisation des valeurs de l’autonomie. Nous sommes confrontés à de nouveaux parcours de vie et de nouvelles manières de vivre affectant la famille, l’emploi, l’école, les âges de la vie en même temps que nous assistons à la fin de l’État-Providence tel qu’il s’est constitué au cours du XXe siècle : nous vivons dans une socialité où il faut s’engager personnellement dans des situations sociales très nombreuses et hétérogènes. C’est un changement de nos conceptions de l’action : l’action faite de soi-même est celle qui a à la fois le plus de prestige et le plus d’efficacité aujourd’hui, c’est celle que nous respectons et que nous attendons le plus, à laquelle nous accordons le plus de valeur, l’instrumental et le symbolique étant enchevêtrés. La référence à la responsabilité individuelle est intimement liée à ces idéaux. Elle est la toile de fond de la vie en société, quelle que soit la position de chaque individu dans la hiérarchie sociale.
L’impératif d’autonomie, à travers ses deux facettes de la libération des mœurs et de la libération de l’action, a élargi les frontières de soi à tous les niveaux. En conséquence, le nombre d’actions que vous pouvez, mais aussi que vous devez considérer comme vôtres est tel que l’on a l’impression d’assister à un déclin de l’irresponsabilité personnelle. L’élargissement des frontières de soi inhérent à ce changement général de nos valeurs s’est accompagné de l’augmentation parallèle de la responsabilité personnelle et de l’insécurité personnelle. C’est l’insécurité personnelle qui fait de la santé mentale une réponse à l’accroissement de la responsabilité.
Dans cette socialité, la subjectivité individuelle, l’affect souffrant ou épanoui, devient un problème majeur, une question collective, parce qu’elle met en relief des problèmes de structuration de soi, structuration sans laquelle il est impossible de décider et d’agir par soi-même de façon appropriée et à laquelle on ne faisait guère attention dans une société d’obéissance disciplinaire. Le fulgurant succès d’entités comme l’estime de soi se comprend dans ce contexte, et vous trouverez dans plusieurs livres psychiatriques populaires, mais aussi de sociologie et de philosophie sociale l’idée que tout problème de pathologie mentale ou de souffrance est un problème d’estime de soi et de reconnaissance par autrui.
Dans la discipline, l’accent est placé sur l’exécution mécanique des ordres, dans l’autonomie, il est placé sur la prise en charge des problèmes, y compris quand on exécute des ordres, y compris par la contrainte. C’est ce déplacement d’accent dans les conceptions de l’action qui met au premier plan un aspect personnel dans les relations sociales, aspect inexistant dans les sociétés de type disciplinaire. Ce déplacement conduit à l’idée que l’esprit de l’autonomie consiste en ce que le patient de l’action en soit simultanément l’agent. Pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’une subordination de soi à soi où l’on ne voit pas ce qui oblige le sujet à obéir à lui-même, l’obligation sociale étant enveloppée d’un halo de mystère, il faut adopter une philosophie de l’action plus subtile que celle de l’agent et du patient en considérant qu’il y a des degrés de l’agir, ce qui permet de distinguer un agent principal et un agent immédiat (Descombes, 2004

).
Dans la discipline, l’agent principal est l’ingénieur, le maître ou le médecin tandis que l’agent immédiat de l’action est le travailleur, l’élève ou le malade, en ce sens que leur activité est entièrement prédéterminée. La discipline implique l’idée d’une force passive qu’il faut actionner de l’extérieur pour la rendre « docile et utile ». Dans l’autonomie, l’action est conçue de telle sorte que le patient (travailleur, élève, malade) en soit l’agent principal. Nous n’avons alors plus besoin de la psychologie pour caractériser l’autonomie, c’est-à-dire qu’on peut sortir de l’idée de l’autonomie comme rapport de soi à soi. C’est la seule manière de voir les choses sociologiquement, sinon on fait de la psychologie, qu’elle soit psychanalytique, cognitiviste ou sociologique.
Il existe un modèle historique qui permet de préciser l’idée que le patient de l’action en est aussi l’agent, ce sont les trois métiers impossibles de Freud, psychanalyser, éduquer, gouverner, selon l’interprétation de Castoriadis. Le caractère impossible signifie que ces métiers visent le développement de l’autonomie au sens où « le patient est l’agent principal du processus psychanalytique », car ce qui est visé est le « développement de sa propre activité » (l’activité du patient). L’objet de la psychanalyse « est l’autonomie humaine […] pour laquelle le seul « moyen » d’atteindre cette fin est cette autonomie elle-même » (Castoriadis, 1990

). Dans le couple de partenaires que forment le psychanalyste et son patient, l’action se déroule de telle sorte que ce dernier soit non l’agent immédiat, mais l’agent principal de l’action, en l’occurrence de l’action de changer. Cela se voit parfaitement à la conception de la guérison que Freud explique à la dernière page des « Études sur l’hystérie » en caractérisant le genre de changement qui s’opère chez le patient : « Vous trouverez grand avantage, en cas de réussite, à transformer votre misère hystérique en malheur banal. Avec un psychisme devenu sain, vous pourrez lutter contre ce dernier »
3
freud s, breuer j. Études sur l’hystérie, Paris, Puf, 1975 (1894), p. 247. Dans le paragraphe précédent, comparant sa méthode à la chirurgie, il la distingue ainsi : « Cette analogie se trouve confirmée non pas tant par la suppression des parties malades que par l’établissement de conditions plus favorables à l’évolution du processus de guérison », p. 247
(Freud et Breuer, 1894

), vous pourrez être l’agent de votre propre changement.
Sociologiquement, justement, cette socialité se décompose, à mon avis, en trois schémas sociaux que l’on retrouve partout, mais qu’il faut analyser différemment selon les contextes : la transformation permanente de soi, le développement de compétences sociales ou relationnelles et l’accompagnement des trajectoires de vie. Ils sont les modes d’institution permettant aux individus d’agir par soi-même de façon appropriée dans des situations sociales en nombre croissant, y compris dans les plus contraintes, que ces individus soient schizophrènes, adolescents en difficulté ou guichetiers de banque. Cela ne veut pas dire que l’individu est abandonné à lui-même, mais que toutes nos institutions évoluent actuellement vers de telles pratiques. Qu’elles fonctionnent bien ou mal est un problème qui vient en second. Il vient en second, parce que c’est un jugement sur la réalité, il faut d’abord passer par une phase descriptive permettant de comprendre ce qui se passe dans notre société. Comment, par exemple, une personne atteinte de schizophrénie pourrait-elle vivre dans la communauté sans disposer de compétences sociales et cognitives dont elle n’avait guère besoin quand elle était supposée vivre à l’hôpital ?
Voici deux exemples. Y compris dans les situations les plus contraintes, disais-je, car dans ce type de socialité, la contrainte elle-même change de signification, et l’autonomie ne doit surtout pas être réduite, d’un point de vue descriptif, au consentement. Il faut élargir le point de vue de Castoriadis, car la contrainte peut parfaitement être un moyen de l’autonomie. Il faut seulement considérer la situation en cause. Par exemple, les centres d’éducation renforcée et les centres d’éducation fermée ne sont pas une nouvelle normalisation disciplinaire (contrairement à ce que pensent la plupart de mes collègues sociologues), car la contrainte y est un moyen pour restaurer ou contribuer à instaurer une capacité à décider et à agir par soi-même de manière appropriée. La contrainte vise l’adhésion du jeune, elle vise à lui permettre d’être l’agent de son propre changement, à le rendre capable de changer par lui-même. Cyrille Canetti, psychiatre à Fleury-Mérogis où il s’occupe des adolescents, écrit que « le but [des interventions psychiatriques en prison est] de leur redonner un espace de choix, de leur restituer une position de décideur dans la gestion de leur existence. Ils se sentent en effet régulièrement privés de toute capacité à interagir sur leur parcours et c’est avec fatalisme qu’ils s’en remettent à ce qu’ils appellent leur destin » (HAS, 2005

). C’est une condition pour ouvrir l’espace des possibles dans la socialité de l’autonomie. La contrainte physique, dans ce contexte, est un moyen d’offrir des possibilités.
Deuxième exemple, les inégalités sociales. Dans ce nouveau monde, la polarité gagnant-perdant domine la polarité dominante-dominée de la société industrielle. L’égalité visée est une égalité de capacité qui est une égalité tout au long de la vie, qu’elle prenne la forme de l’empowerment américain ou du caring state scandinave. Gosta Esping-Andersen résume ainsi l’idée du caring state : « Un bas salaire ou un emploi médiocre ne constituent pas en soi une menace au bien-être d’un citoyen, pourvu que l’expérience soit temporaire ; ils ne le deviennent que si les individus s’y trouvent enfermés. Il convient donc de redéfinir le principe directeur des droits sociaux […] comme ensemble fondamental de garanties des chances de la vie » (Esping-Andersen, 2001

). Car c’est à une transformation de l’égalité à laquelle nous avons affaire, une égalité de l’autonomie qui ne consiste pas seulement à donner des chances égales dans une temporalité statique, mais à offrir des opportunités dans une temporalité dynamique, une temporalité de trajectoire, plaçant de multiples manières les individus dans des situations leur permettant ou les obligeant d’être les agents principaux de leur propre changement.
En conclusion, dans une telle société, au niveau de l’idéologie, on a la rhétorique subjectiviste, au niveau de la réalité de la société de l’homme-individu, le développement de schémas sociaux qui visent à faire en sorte que le patient de l’action en soit en même temps l’agent : c’est ce déplacement d’accent dans les conceptions de l’action qui met en relief un aspect personnel dans les relations sociales, aspect inexistant dans les sociétés de type disciplinaire. C’est la seule manière de voir les choses sociologiquement, sinon on fait de la psychologie, qu’elle soit neurologique, psychanalytique, cognitiviste ou sociologique.
Pour clarifier la socialité propre à l’autonomie généralisée, la subjectivité ou l’affectivité doit être élaborée dans ce cadre sociologique. Si on ne le fait pas, il me semble qu’on ne fait que reconduire l’idéologie individualiste sans se donner les moyens d’en faire des guides politiques pour l’action. Quand on parle de souffrance aujourd’hui, on a tort de l’appréhender à partir d’un causalisme sociologique, comme on le fait si souvent en sociologie, qui la réifie au lieu de la situer. La souffrance est une nécessité de la socialité contemporaine, elle est, pour reprendre le concept maussien, une expression obligatoire des sentiments
4
mauss m. L’expression obligatoire des sentiments. 1921,
Œuvres, 3, Paris, Minuit, 1969

. « Une catégorie considérable d’expressions orales de sentiments et d’émotions n’a rien que de collectif […]. Disons tout de suite que ce caractère collectif ne nuit en rien à l’intensité des sentiments, bien au contraire. […] Mais toutes ces expressions collectives, simultanées, à valeur morale et à force obligatoire des sentiments de l’individu et du groupe, ce sont plus que de simples manifestations, ce sont des signes, des expressions comprises, bref, un langage. Ces cris, ce sont comme des phrases et des mots. Il faut les dire, mais s’il faut les dire c’est parce que tout le groupe les comprend. On fait donc plus que manifester ses sentiments, on les manifeste aux autres, puisqu’il faut les leur manifester. On se les manifeste à soi en les exprimant aux autres et pour le compte des autres. C’est essentiellement une symbolique », p. 277-278.
. Elle est le ressort d’un changement dans l’esprit des institutions qui fait du métier impossible l’institution propre à l’autonomie généralisée, et il existe des versions psychanalytiques autant que cognitivistes (Ehrenberg, 2008

). Or, c’est justement à la généralisation de ces métiers, dont la pratique consiste à faire en sorte que chacun soit l’agent de son propre changement, à laquelle nous avons assisté en une trentaine d’années, et non à un affaiblissement du lien social, à mesure que les valeurs de l’autonomie imprégnaient l’ensemble de la vie sociale. Le changement de statut de la souffrance psychique bien au-delà de la psychopathologie, c’est-à-dire son érection en raison d’agir sur un problème qui est toujours relationnel, voilà l’épicentre de la généralisation de ces métiers où l’autonomie est à la fois le moyen et le but de l’action.
Bibliographie
[1] castoriadis c. Psychanalyse et politique, Le Monde morcelé. Carrefours du Labyrinthe.
3:Paris:Seuil;
1990;
178179et la discussion de V. Descombes qui enrichit l’idée, ibid, chap XXV.

[2]commission europeenne. Improving the Mental Health of the Population: Toward a Strategy of Mental Health for the European Union.
Green Paper. Direction générale de la Protection des consommateurs et de la santé. octobre 2005;
4:

[3] descombes v. Le complément de sujet, Enquête sur le fait d’agir de soi-même.
Paris:Gallimard;
2004;

[4] durkheim e. Les Règles de la méthode sociologique.
PUF;
18
e éd..
1973;

[5] ehrenberg a. L’individu incertain.
Calmann-Lévy;
Paris:1995;
coll. Pluriel, Hachette;
1996;

[6] ehrenberg a. La fatigue d’être soi : dépression et société.
Odile Jacob;
Paris:1998;
Odile Jacob Poche;
2000;
chapitre IV.

[7] ehrenberg a. Le cerveau « social » Chimère épistémologique et vérité sociologique.
Esprit. janvier 2008;

[8] esping-andersen g. Quel État-providence pour le XXI
e siècle ? Convergences et divergences des pays européens.
Esprit. février 2001;

[9] freud s,
breuer j. Études sur l’hystérie.
PUF;
Paris:1975 (1894);

[11] mauss m. L’expression obligatoire des sentiments.
1921;
Œuvres. 3:Paris:Minuit;
1969;

[12]office of the surgeon general. Mental Health : A Report of the Surgeon General.
US Departement of Health and Human Services;
1999;
4:

Alain Ehrenberg
Directeur du Cesames (Centre de recherches psychotropes, santé mentale, société)
UMR 8136 CNRS-U Paris 5, Inserm U 611
Addiction au jeu : éléments psychopathologiques, transgression, victimisation et rapport oblique à la loi
L’addiction aux jeux de hasard et d’argent, frénétique et dévastatrice, apparaît emblématique de la formulation de Jean-Louis Pedinielli, énonçant que les addictions se caractérisent par une mise en scène particulière de l’avidité, de la dette et de la mort. Dompter, domestiquer le hasard plutôt qu’apprivoiser son murmure séducteur...
Quant à explorer les dessous des cartes du jeu compulsif, en privilégiant une approche analytique, un pari risqué ?… Peut-être, a priori, mais il n’en reste pas moins que cette notion d’addiction au jeu n’a guère été prise en compte par la psychiatrie classique : par exemple, dans son manuel, Henri Ey ne consacre même pas une ligne entière au jeu compulsif, qu’il insère furtivement dans la catégorie des déséquilibres caractériels !
En France, la problématique du jeu demeure longtemps délaissée par la psychiatrie. Et, à notre connaissance, il faudra attendre 1991 pour qu’une revue thématique sur les dépendances y consacre un numéro spécial qui fera date, suscitant ainsi un écho plus large, avec notamment les textes de J. Adès, R. Ladouceur et M. Valleur…
Dans un autre registre, la fonction soulageante de la dépense d’argent avait déjà été pointée par K. Abraham dans « Prodigalité et crise d’angoisse » (1916) : « la tendance aux dépenses inconsidérées est le fait de névrosés vivant dans un état de dépendance infantile permanente à l’égard de leurs parents, présentant des troubles de l’humeur ou de l’angoisse dès qu’ils s’en éloignent. Les patients affirment eux-mêmes que la dépense soulage leur angoisse ou leur humeur ». Ainsi, en première approche, à défaut de guérir, la dépense apaise, pallie transitoirement le malaise interne, à l’instar de la drogue ou du médicament calmant le toxicomane.
Dans le contexte social actuel (incitation aux crédits, valorisation de la consommation, explosion de l’offre des jeux), les diverses formes de dépense compulsive (des achats aux jeux d’argent) pourraient constituer en première approche une « mauvaise rencontre » entre un individu fragile quant à ses désirs insatisfaits et une offre commerciale aguichante donnant l’illusion de combler un manque à être.
Éléments psychopathologiques
La psychopathologie se veut explicative de symptômes, de conduites et de comportements. Et s’appuie de longue date sur des théories psychanalytiques, mais aussi sur des conceptualisations issues de la philosophie, voire sur des concepts de Droit, et également sur des données de la psychologie.
Freud, Bergler et Fenichel : la compulsion à perdre
Freud (à partir de Dostoïevski, vœu de mise à mort du père et châtiment de soi-même… perdre, se perdre aussi, pour libérer l’écriture), puis Bergler (régression orale, masochisme) ont mis l’accent sur la compulsion à perdre du joueur dans son « combat contre le destin » (Fenichel), où « le passe-temps primitif est maintenant une question de vie ou de mort ».
Freud et Dostoïevski : mise à mort du père et châtiment de soi-même…
Dès 1928, Freud, dans son texte fameux sur Dostoïevski («
Dostojewski und die Vatertötung », à noter qu’en fait, «
Vatertötung » renvoie plus précisément à la mise à mort du père et non au parricide – «
Vatermord »), avait mis en lumière les soubassements de la personnalité de l’écrivain, marquée par une attitude ambiguë envers le père, « faite de soumission et de vœu de mort » (Chassaing et Petit, 1995

).
La thématique de la mise à mort du père, qui hante l’œuvre de l’écrivain (avec en toile de fond l’expression d’une sympathie quasi « convulsive » pour le criminel) serait la pierre angulaire de sa conduite masochiste. « Tout châtiment est bien, dans le fond, la castration et l’accomplissement comme tel de l’ancienne attitude passive envers le père. Même le destin n’est finalement qu’une projection ultérieure du père. ».
Nous souscrivons du reste aux observations des traducteurs de ce texte dans la revue de psychanalyse l’Unebévue, 1993, prônant l’emploi du mot « châtiment » plutôt que « punition » pour traduire ici «
Bestrafung » (Bucher et Chassaing, 2007

). Et ce, en tant que « la punition est plutôt connotée à la justice humaine : la loi punit, sanctionne un délit. Le châtiment, lui, est plutôt d’ordre moral. Il n’implique pas forcément la faute réelle ; il répond au contraire au sentiment de culpabilité qui, lui aussi, est moral ».
Ce qui revient à préconiser « châtiment de soi-même » pour « Selbststrafung » de préférence à la traduction traditionnelle « autopunition ». En effet, « il s’agit plus d’un châtiment moral que d’une punition par la justice humaine. Se châtier soi-même n’est pas exactement identique à s’autopunir et introduit une nuance quant à la persistance d’un sentiment de culpabilité. » Et ce dernier point nous semble particulièrement intéressant dans une perspective psychopathologique.
Et « le jeu était aussi pour lui une voie pour se châtier lui-même », Freud écartant d’entrée de jeu l’idée que l’appât du gain soit en cause (Dostoïevski étant d’ailleurs très explicite sur ce point dans une lettre : « l’essentiel est le jeu lui-même », Freud renchérissant en faisant mouche avec la formule : « le jeu pour le jeu. »).
Passion du jeu connotée expressément par Freud à une dimension pathologique. « La publication de ses écrits posthumes et du journal intime de sa femme a crûment relaté un épisode de sa vie, la période où, en Allemagne, Dostoïevski était possédé par la passion du jeu (Dostoïevski à la roulette). On ne peut pas méconnaître qu’il s’agit d’un accès de passion pathologique ; on ne saurait d’aucune façon l’estimer autrement ».
Ainsi, le jeu, « passion pathologique » ruineuse, prend valeur de conduite de « châtiment de soi-même » corrélée au vœu de « mise à mort du père ».
Au jeu de la vie, le joueur, un « maso » ? Ce que résume bien J. Adès : « Le joueur est possédé par une recherche morbide de l’échec, de l’expiation, la poursuite d’un parcours éclairé par le tragique du plaisir et de la mort » (Adès, 1991

).
Quant à la dimension addictive, au fil des lignes du texte de Freud sur Dostoïevski (1928

), l’expression «
Spielsucht » – littéralement l’addiction au jeu – semble prendre le pas sur celles de «
Spielzwang » (compulsion du jeu) et «
Spielwut » (fureur du jeu, une expression un peu datée mais intéressante car renvoyant à la frénésie, au «
craving »). En outre, en considérant (à partir d’une digression sur la nouvelle de S. Zweig, « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ») le jeu comme un succédané de la masturbation, cette addiction originaire («
Ursucht »), Freud le rapproche de facto des toxicomanies classiques, au sujet desquelles il avait émis cette hypothèse en 1897.
Le joueur de Bergler, un névrosé « oral » animé par un désir inconscient de perdre
Sollicité par la problématique du jeu dès 1936 (date de sa première publication en la matière, dans la revue Imago), Bergler réalise une synthèse de ses observations cliniques relatives aux joueurs en 1957 dans son ouvrage «
The psychology of gambling »

. Il affiche de surcroît l’ambition de préciser les soubassements de la conduite de jeu et de dresser un constat des diverses variantes typologiques de joueurs.
C’est ainsi qu’il élabore une liste de critères permettant de « définir » le joueur pathologique, en contrepoint du joueur « social » ou récréatif (prise habituelle de risques, envahissement de la vie par le jeu, optimisme pathologique, incapacité de s’arrêter de jouer, escalade des enjeux, « frisson » du jeu) et ce, en s’appuyant sur l’expérience du traitement d’une soixantaine de joueurs.
À rebours des motivations conscientes, mises en avant par les patients (notamment l’appât du gain), la théorisation de Bergler dispose que le jeu, expression d’une « névrose de base », correspond à une « régression orale » (Bergler, 1949

), se définissant par la mise en acte d’une séquence toujours identique, où la rébellion contre la loi parentale se traduit directement, chez le joueur, par une « rébellion latente contre la logique ». Et, selon Bergler, le joueur est à considérer comme un névrosé animé par un désir inconscient de perdre (« désir de gagner dynamiquement sans effet »), gouverné par le masochisme moral, un besoin inconscient d’être puni après avoir fait montre d’une « pseudo-agressivité » teintée de mégalomanie infantile.
Masochisme moral que Bergler nomme « masochisme psychique » (cf. dans « La névrose de base », 1949

). Lequel s’articule autour d’une séquence en trois temps : « je me créerai le désir inconscient d’être rejeté par la mère », « je ne serai pas conscient de mon désir d’être rejeté », « je m’apitoierai sur moi-même en un plaisir masochique ». Ces « masochistes psychiques » se caractérisent par une dilection particulière pour « l’humiliation, la défaite, le refus ».
Ainsi, le masochisme est relié par Bergler à la recherche du « être refusé », certes une définition assez large du masochisme, où prime l’idée de la répétition de situations plus ou moins pénibles, comme si le sujet y trouvait une satisfaction.
Mais aussi, comme le note P-L. Assoun, une véritable « intuition du lien entre position masochiste et relation à l’objet » qui affleure aussi chez les joueurs dans la demande récurrente de « se faire interdire » d’accès aux salles de jeux, la voix pronominale, avec la voix moyenne réfléchie, caractérisant la grammaire du masochiste (Assoun, 2003

). Grammaire renvoyant à la spécificité du masochiste de se mettre dans une position particulière… « se faire objet ».
Enfin, quoique mettant l’accent sur le masochisme moral intrinsèque aux conduites de jeu, Bergler souligne que les chances de succès d’une thérapie analytique sont grandes si l’implication du joueur est de mise (et prévaut sur celle de son entourage).
Dans la théorisation de Bergler, vient poindre l’exigence d’un dédommagement pour des blessures précoces du narcissisme en s’exemptant de la loi de la castration (Freud, 1915

; Assoun, 1999

).
Otto Fenichel : « névrose impulsive », égo-syntonie
Dans « La théorie psychanalytique des névroses », ouvrage publié en 1945, Otto Fenichel réalise un vaste panorama de l’ensemble des formes de pathologie mentale. Il y accorde une place au jeu, citant du reste Bergler à ce propos.
Fenichel reprend les propositions freudiennes relatives à Dostoïevski dans ses développements sur le jeu (« dans son essence, une provocation du destin », où se profile la « figure-écran » du père). Et formule de manière très fine la dérive du plaisir à la jouissance qui happe le sujet confronté au jeu, aussi bien « tentative magique d’obliger le destin à faire son devoir » que « combat contre le destin » : « sous la pression des tensions internes, le caractère badin peut se perdre ; le Moi ne peut plus contrôler ce qu’il a mis en train, et est submergé par un cercle vicieux d’anxiété et de besoin violent de réassurance, angoissant par son intensité. Le passe-temps primitif est maintenant une question de vie ou de mort ».
Or, Fenichel avait suggéré (Fenichel, 1945

) que certains comportements impulsifs répétitifs se caractérisaient par une contrainte proche de celle retrouvée dans la dépendance à l’alcool et aux drogues. Pour Fenichel, les toxicomanies représentent du reste « les types les plus nets d’impulsions », le mot « addiction » faisant allusion pour lui à « l’urgence du besoin et à l’insuffisance finale de toute tentative de le satisfaire ». Il dispose les addictions à la drogue dans le cadre des « névroses impulsives », qu’il oppose aux névroses de compulsion. Et s’attache à différencier impulsions et compulsions, qui ont en commun le sentiment du patient d’être obligé d’exécuter l’action pathologique. Cependant, les impulsions sont – ou promettent d’être – plaisantes, elles ne sont pas vécues à l’instar des compulsions sur un mode pénible, mais comme « syntones » du moi et non pas étrangères à lui.
Pour mettre en tension ces deux auteurs, Bergler et Fenichel (Bucher, 1997

) : cette dimension d’égo-syntonie (où l’action est conforme au « désir conscient immédiat ») promue par Fenichel semble un peu approximative pour rendre compte du processus « ludopathique ». Et Bergler fait montre en la matière de davantage de subtilité, en décrivant le sentiment d’étrangeté («
feeling of uncanniness » se rapproche du
Unheimlich freudien, de l’inquiétante étrangeté) qui saisit le joueur dans sa praxis ludique, ou même lorsqu’il laisse ses pensées dériver autour du jeu.
Dans cette perspective « déréalisante », il convient de souligner cet « étrange désir » expérimenté par le joueur de Dostoïevski lorsqu’il ressent l’imminence de la provocation du destin, de donner « une chiquenaude » au destin… Mais aussi, bien sûr, le fait que le frisson (« thrill ») du jeu, cette sensation intense et frémissante éprouvée dans l’expectation fiévreuse de l’arrêt du sort, comporte aussi dans sa définition donnée par Bergler une touche d’insolite : « the enigmatic, mysterious thrill in gambling ».
Dette et relégitimation
Homo masochisticus, le joueur addicté se piquant des vertiges du jeu ? Certes, mais quid des faveurs du destin sollicitées ?… Car ces « praticiens de l’aléatoire » (selon une formule de JL. Chassaing, dans « Jeu, dette et répétition », 2005) en jouant à qui perd gagne, configurent une « modalité binaire d’une existence ». C’est que « l’aléa marque et révèle les faveurs du destin » (Roger Caillois), le joueur étant selon lui « l’homme de la providence » ! Ce qui pourrait confiner (Patrick Berthier) à une forme de délectation suprême : « Être l’élu au sein des réprouvés, sans raison, sans mérite, sans rien, par pur décret de la providence… ».
Bien sûr, être l’élu du Destin, c’est aussi abolir la dette symbolique… Ce qui nous ramène à la problématique addictive comme telle, c’est ainsi que dans cette perspective, Nestor Braunstein énonce qu’en tentant de substituer à l’Autre « un objet sans désirs ni caprices », « l’alcoolique, le toxicomane, conteste cette dette symbolique, dette éternelle et externe qu’il n’a pas contractée et qu’il ne veut pas payer. Car pour lui, elle est impayable ».
Somme toute, l’addiction au jeu ou tenter de réduire la question de la dette – intergénérationnelle – à une simple affaire d’argent ?… Mais par quel biais ?
Le jeu, « faute morale ». Le poids de la faute… Comment s’en acquitter ? En payant le prix… le prix fort, voire prohibitif. Crouler sous les dettes. Au demeurant, «
Schuld », en Allemand, désigne à la fois la faute et la dette. Payer, étymologiquement, c’est pacifier, et « s’acquitter de ses dettes, payer tout simplement, c’est renouveler sans cesse un processus de pacification, le paiement d’une dette infinie à laquelle on ne peut se soustraire » (Gori, 1992

).
Si ce n’est que « l’influence correctrice » du paiement est mise en échec dans le processus addictif « ludopathique », où précisément l’origine de la dette symbolique est interrogée à l’infini par le truchement d’un instrument, l’argent, qui tend à se substituer au langage.
Et la fascination pour le hasard, érigé en « Autre supposé savoir auquel il peut se fier, se confier », est donc fatale car il « ne sera jamais le lieu de la parole » (Tostain).
La dimension impérative de la passion prime sur la composante interrogative du jeu : défiant les « lois mécaniques » du hasard et leurs calculs, le joueur somme l’Autre de se manifester et de lui signifier son droit à l’existence, dévoilant ainsi les termes d’une mathématique terrifiante de la relation à l’Autre, sous le joug de la procédure ordalique.
Procédure dont la loi inflexible rend compte de la sollicitation répétitive de la chute : toucher le fond afin de « se refaire » et, partant, d’être relégitimé. Dans cet espace privilégié que représente le casino, à savoir selon un patient, « … un autre espace où, d’une seconde à l’autre, tout peut changer ».
La logique sous-tendant l’ordalie compulsive du joueur conduit Marc Valleur (1991

) à modifier l’équation freudienne de la compulsion à perdre du joueur : « s’il ne joue certes pas pour gagner, il ne joue pas non plus pour systématiquement perdre, mais pour les instants vertigineux où tout – le gain absolu, la perte ultime – devient possible ». Lorsque le hasard devient rencontre, «
tuchè »…
Un gain qui n’est pas un gain
L’argent, le pactole… certes, mais contrairement au spéculateur le joueur n’use ni n’abuse des mécanismes subtils du capitalisme pour s’enrichir. Il ne va même pas placer son gain, ce gain qui lui brûle les doigts, sur un compte d’une quelconque succursale bancaire, mais au contraire s’en débarrasser au plus vite, en rejouant ou en le dilapidant… Pourquoi une telle hâte à s’en défaire ?
Avec les dettes abyssales contractées, l’argent perd sa fonction d’équivalent général. Quelque chose de vertigineux dans ce tourbillon... Et le vertige, n’est-ce pas à la fois (Kundera) « l’ivresse de tomber » et « l’art de rester debout » ?...
Or, selon un jeune turfiste invétéré et désillusionné, « gagner ?… ce n’est pas un gain ! ». Se présentant tel une sorte de laissé-pour-compte ayant développé le sens du paradoxe au fil de ses déboires (« le jeu … un plaisir qui ne rend pas heureux »), il mettait en relief un point crucial, à savoir qu’il n’avait pas vraiment le sentiment d’être « propriétaire » de son gain… Ce qu’exemplifiait un autre patient, adepte du Rapido, en déclarant, n’avoir, quant à lui, « aucune utilité » du gain !
D’où la contrainte à la remise en jeu... jusqu’à perdre. Bien sûr, sous l’empire de la béatitude narcissique du gain confinant à l’hébétude, se fissure l’armature symbolique du sujet… ses repères se brouillent à la table de jeu, avec, à la clef, des prises de risque inconsidérées…
Cependant, plus fondamentalement, le pactole est entaché d’un soupçon d’irréalité. Il apparaît que le joueur ne s’éprouve qu’usufruitier de ce gain mirifique (Bucher, 2004

), et non pleinement propriétaire, en mesure de disposer de la chose… Ainsi, tout se passe comme s’il lui manquait, subjectivement parlant, le troisième attribut du droit de propriété sur une chose… au nom latin si évocateur, l’
abusus (« utilisation jusqu’à épuisement »).
En d’autres termes, pouvoir enfin disposer de ce bien, fruit du hasard... jusqu’à complète consomption comme pour mieux en attester la réalité improbable… et, partant, relancer de plus belle la spirale addictive ! Un gain qui n’est qu’artifice, leurre, au mieux artéfact biaisant la partie…
Et la sentence fameuse de Goethe (dans « Faust ») : « ce dont tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder » donne la mesure ou plutôt met en relief la démesure des embarras du joueur addicté aux prises avec cette manne céleste dont l’acquisition lui est trop problématique, subjectivement parlant, pour ne pas chercher à s’en débarrasser au plus vite !
Au demeurant, à l’aune de la relation au père, le processus initié par la pratique addictive des jeux de hasard et d’argent n’est pas sans évoquer cette phrase de Freud, au détour d’une lettre adressée à Romain Rolland (1936) : « Tout se passe comme si le principal dans le succès était d’aller plus loin que le père et comme s’il était toujours interdit que le père fut surpassé ».
En tant que « voie courte » vers la fortune, mais nécessairement infructueuse à mesure que la partie se prolonge, les jeux de hasard et d’argent constituent assurément un excellent dispositif en la matière. À visée destinale en quelque sorte...
Question du rapport du sujet à l’Autre
Par le truchement du dispositif de la cure psychanalytique, le sujet est placé en situation d’interroger les cartes qu’il a reçues du grand Autre. Quant au joueur s’adonnant aux jeux de hasard et d’argent, son positionnement est évidemment différent. Ainsi, selon Ch. Melman : « [...] on pourrait aussi y voir (dans le jeu de hasard) la réassurance prise dans l’existence de la réponse, en tant que telle, le jeu y figurant l’artifice qui permet d’interroger et de faire répondre un système opaque et sourd, celui du signifiant qui découpe et ordonne le réel dans sa structure de chaîne ».
Dimension artéfactuelle qui mène aussi le joueur compulsif à sa perte dans la sollicitation répétitive d’un tel dispositif, l’industrie du jeu ne laissant, elle, rien au hasard pour optimiser ses gains lorsque la partie se prolonge…
Au-delà de la question des joueurs pathologiques, c’est bien la question du rapport du sujet à l’Autre qui est posée par le truchement du jeu (Norbert Bon, « Les jeux sont mal faits » dans « Jeu, dette et répétition », 2005

). Défier le hasard et obtenir ainsi de l’Autre réponse et reconnaissance ! Si la chance de décrocher la timbale est infime, en revanche, « … si je gagne, c’est que je ne suis pas un quelconque au regard de l’Autre, c’est que j’y ai une place d’élection, qu’il m’envoie soudain un joker qui modifie radicalement la donne initiale ». Cette « maldonne » initiale que conteste le joueur avec obstination dans sa quête d’un joker !
Dans ses développements sur « La cure psychanalytique est-elle un jeu ? » (dans : « Jeu, dette et répétition », 2005

), Melman vient mettre en exergue cet élément essentiel de l’attitude du joueur : « récuser la donne que chacun de nous tient du grand Autre, rôle sur la scène du monde, identité sexuelle… ». Au demeurant, poursuit cet auteur, si l’on s’en tient au social, il est connu que ceux qui jouent le plus sont des chômeurs… ceux qui n’y ont – précisément – rien à perdre !
De quoi suggérer un rapprochement avec les « accidentés de la vie », où l’accession au statut de victime, entre dommage subi et reconnaissance du préjudice, s’effectue en quelque sorte par le passage du signe « moins » au signe « plus »…
Transgression et victimisation
Bien sûr, dans son combat contre le destin, le joueur compulsif cultive volontiers la transgression de la loi dans l’emphase et l’ostentation. Tricher, bluffer... jusqu’à jouer avec la loi pénale sur les marchés financiers. La spéculation est un domaine très proche des jeux de hasard et d’argent (ainsi, Bergler classe parmi les joueurs les spéculateurs effrénés ou « success hunters » et, plus récemment, on a pu parler de dérive addictive à propos de la trajectoire du « rogue trader » de Nick Leeson). Avec toutefois des nuances rapprochant davantage les spéculateurs des joueurs de poker (un rapport différent au temps et au gain, une stratégie en matière d’enchères, de mise en jeu, qui fait contraste avec la relation animiste à la chance des adeptes des jeux de hasard traditionnels).
Jouer, y compris à se faire interdire, jouer au plus fin... Se faire interdire… et… braver l’interdit. C’est le règne de la surenchère permanente, jusqu’à poursuivre le casinotier en justice (pallier la perte de chance, continuer la partie dans une autre cour à défaut de lui donner un autre cours…).
En contrepoint des avatars de la transgression : victimisation, voire survictimisation… Et certains joueurs vont jusqu’à développer des stratégies de « victimation vindicative » (Bucher, 2005

) lorsque la confrontation à la loi est intenable… Bref, changer les règles du jeu, nier le caractère autodestructeur de la conduite, avec le spectacle d’un meurtre signé plutôt que celui d’un suicide maquillé…
De quoi s’intéresser plus précisément aux problèmes judiciaires liés au jeu pathologique !
Problèmes judiciaires liés au jeu pathologique : un aperçu
Une étude exploratoire menée en France auprès des personnes consultant l’association « S.O.S. Joueurs » avait montré qu’une proportion majoritaire des joueurs interrogés avait été confrontée au surendettement, près de 20 % ayant commis des délits (notamment abus de confiance, vol, contrefaçon de chèques…).
Les données de cette enquête étaient du reste grosso modo concordantes avec les résultats des recherches nord-américaines sur une plus vaste échelle. En effet, selon Custer (cité par Valleur et Bucher, 2006

), un « joueur pathologique » sur quatre est amené à être confronté à la justice (si l’on totalise les comparutions civiles et pénales), ce qui dénote au passage l’ampleur du phénomène si l’on retient avec cet auteur une estimation globale du nombre des joueurs compulsifs adultes (aux États-Unis d’Amérique) à un million de personnes (il y a deux décennies).
Des données plus récentes dans «
Pathological Gambling : A critical review » (
Committee on the Social and Economic Impact of Pathological Gambling, 1999)
1
ont confirmé l’ampleur du phénomène qui reste à évaluer plus précisément (ainsi Blasczynski et Silove, 1996, avaient noté que les comportements délictueux étaient plus fréquents chez les adolescents). Et se redouble de conséquences sociales importantes en termes de pertes d’emploi (-Ladouceur et coll., 1994) : environ 25 à 33 % au sein d’une population de joueurs pris en charge par les Joueurs anonymes et de faillite personnelle…
La nature des liens entre jeu compulsif et délinquance est complexe : en premier lieu, l’apparition d’une délinquance « acquisitive » (et volontiers « astucieuse ») en vue de récupérer les sommes perdues afin de se procurer les moyens de continuer à jouer.
Mais aussi devenir secondaire éventuel de sujets marginaux ou délinquants en joueurs excessifs, voire aléas de la clandestinité (le monde du jeu en tant que lieu de croisement où se rencontrent délinquants et joueurs et, partant, source potentielle d’une telle addition de problématiques).
Au demeurant, le « passage » de la dépendance à la délinquance prête à réflexion : s’agit-il d’une causalité linéaire ? Le rapprochement du jeu d’argent et de certains délits, en particulier l’escroquerie, serait ainsi susceptible de faire affleurer dans certains cas la notion d’une manipulation ludique de la loi.
Dans un contexte de grande facilité d’obtention des crédits, favorisant les emprunts excessifs, le premier point est crucial : le jeu addictif faisant office, caricaturalement, de « problème et de solution du problème » en termes pécuniaires. La commission d’une infraction traduisant fréquemment la nécessité quasi inéluctable dans la trajectoire du joueur pathologique de recourir à des moyens illicites afin de se procurer l’argent du jeu.
D’où l’intérêt, en amont, pour les procédures de désendettement. Avec la spécificité de la faillite civile en Alsace-Moselle… Et la réplique d’un joueur invétéré à l’annonce de la mise en œuvre de cette procédure : « on efface tout et on recommence ! » ne doit pas, pour autant, invalider ce type d’approche…
Bibliographie
[1] adès j. Le jeu pathologique, de la passion à la dépendance.
Dépendances. 1991;
3:1
-2

[2] assoun p-l. Le préjudice et l’idéal. Pour une clinique sociale du trauma.
Anthropos Economica. Paris:1999;

[3] assoun p-l. Leçons psychanalytiques sur le masochisme.
Anthropos Economica. Paris:2003;

[4] bergler e. Basic neurosis.
Grune & Stratton;
NY:1949;
La névrose de base.
Payot;
Paris:1976;

[5] bergler e. The psychology of gambling.
International Universities Press;
New York:1957;

[6] bucher c. Le jeu pathologique, une conduite addictive : le jeu, le joueur et la loi.
Nervure. 1993;
6:15
-26

[7] bucher c. L’addiction au jeu, de l’aléa au vertige, via Bergler et Fenichel.
Le Trimestre Psychanalytique. 1997;
2:93
-108

[8] bucher c. Passions du jeu et leurs destins dans une société libérale « avancée », 11.10.2004 ; Site de l’Association Lacanienne Internationale, www.freud-lacan.com, dossier « toxicomanies ».

[9] bucher c. Jouer à se faire interdire.
Psychotropes. 2005;
11:87
-100

[10] bucher c,
chassaing j-l. Addiction au jeu, éléments psychopathologiques.
Psychotropes. 2007;
13:97
-116

[11] bucher c,
chassaing j-l,
melman c. Jeu, dette et répétition. Les rapports de la cure psychanalytique avec le jeu.
Éditions lacaniennes;
Paris:2005;

[12] caillois r. Les jeux et les hommes.
Gallimard;
Paris:1967;

[13] chassaing j-l,
petit p. Freud et Dostoïevski.
Le discours psychanalytique. 1995;
14:113
-142

[14] fenichel o. The psychoanalytic theory of neurosis.
New York, WW Norton:1945;
La théorie psychanalytique des névroses.
PUF;
Paris:1953;

[15] freud s. Einige Charaktertypen aus des psychoanalytischen Arbeit. 1916, Imago, tome 4 (6). Quelques types de caractères dégagés par le travail psychanalytique.
In : L’inquiétante étrangeté et autres essais, Folio. Gallimard;
1985;

[16] freud s. Dostojewski und die Vatertötung.
In : Die Urgestalt der Bruder Karamazov. In: fülop miller r, eckstein f (eds), editors.
R Piper Verlag & Co;
München:1928;

[17] freud s. Dostojewski und die Vatertötung.
Almanach der Psychoanalyse, International Psychoanalytischer Verlag. Wien:1930;
930

[18] freud s. Dostoïevski et la mise à mort du père.
L’Unebévue. Éditions Epel;
1993;
4 (suppl):

[19] gori r. S’acquitter.
Cliniques méditerranéennes. 1992;
33/34:13
-35

[20] valleur m. Dépendance, jeu, ordalie.
Dépendances. 1991;
3:2125

[21] valleur m. Les addictions sans drogue et les conduites ordaliques.
L’information psychiatrique. 2005;
81:423428

[22] valleur m,
bucher c. Le jeu pathologique.
Armand Colin;
Paris:2006;

Christian Bucher
Psychiatre des Hôpitaux, CH de Jury, Metz
De la passion des images à l’addiction : le cas des jeux vidéo
Quand on évoque la « dépendance » aux jeux vidéo, c’est aussitôt le modèle de la dépendance aux toxiques qui vient à l’esprit, qu’il s’agisse de l’alcool, du tabac ou du cannabis. Pourtant, les jeux vidéo imposent aux joueurs une forme de relation bien particulière, dans laquelle la recherche de la signification joue toujours un rôle important. Et c’est d’elle dont il nous faut partir.
Pouvoirs des images
Dans les relations que nous établissons avec elles, les images ont deux types de pouvoirs, celui d’enveloppement et celui de transformation.
Les pouvoirs d’enveloppement des images ont trois aspects complémentaires. Tout d’abord, ils contribuent à constituer chaque image en territoire à explorer qui crée, pour son spectateur, l’illusion de pouvoir le contenir. Cette illusion concerne le narcissisme individuel. Une image est toujours un espace que nous sommes invités à habiter, et, à la limite, un peu une seconde peau. Ensuite, toutes les images ont le pouvoir d’éveiller des expériences émotionnelles et sensorielles avec l’objet qu’elles représentent comme si celui-ci était présent en réalité. Cette illusion, fustigée depuis des siècles par la pensée occidentale comme « fétichiste » ou « idolâtrique », ne correspond certes pas à une réalité physique (il n’est pas question de dire que l’image contienne « en réalité » une partie de ce qu’elle représente), mais à un désir inscrit au cœur de notre rapport à toute image. Ce désir concerne encore le narcissisme, c’est-à-dire les investissements du corps, puisqu’il consiste à penser que l’autre est présent dans son image comme je le suis dans la mienne. Enfin, ce sont les pouvoirs d’enveloppement des images qui contribuent à créer l’illusion qu’une même image matérielle soit perçue de la même manière par tous ses spectateurs, passés, présents et à venir. Autrement dit, l’image ne nous enveloppe pas seul, mais avec l’ensemble de ses autres spectateurs, présents ou potentiels.
Heureusement, les images n’ont pas que ces pouvoirs d’enveloppement, elles ont aussi des pouvoirs de transformation. Ceux-ci, tout comme leurs pouvoirs de contenance, ont plusieurs aspects. Tout d’abord, ils participent à la constitution du symbole. Pour cela, l’image fait glisser le sens d’une représentation première à une représentation seconde qui évoque la première en son absence. Mais de même que les pouvoirs d’enveloppement des images ne se réduisent pas au désir et à l’illusion d’être « dans l’image », leurs pouvoirs de transformation ne se réduisent pas à la formation du symbole. La lecture d’une image peut provoquer un déplacement, une action ou un changement intérieur de son spectateur. Elle peut également agir sur les images elles-mêmes : toute image suscite d’autres images légèrement différentes (« transformées »), mais proches, avec lesquelles elle puisse entrer en « série ». Le pouvoir de transformation des images est capital. C’est en agissant sur les images que nous cessons d’être dans une relation narcissique à elles. Vous voyez que ce qui nous protège des pouvoirs d’enveloppement des images, c’est finalement leurs pouvoirs de transformation. C’est en transformant les images que nous évitons d’être transformés par elles.
Ces pouvoirs définissent des formes d’attachement aux images indépendantes de leurs contenus.
Espaces virtuels : à mi-chemin entre imaginaire et réel
Pour comprendre comment fonctionne une relation virtuelle, partons de la relation imaginaire qui nous est familière. Elle résulte de notre capacité à pouvoir nous représenter les absents. En même temps, cette capacité est limitée, comme nous le rappelle le dicton bien connu : « Loin des yeux, loin du cœur ». Il veut dire qu’une trop longue séparation laisse s’émousser le souvenir de la présence réelle de telle façon que la rencontre imaginaire est de plus en plus difficile à penser.
C’est pourquoi nous avons volontiers recours à des supports sensoriels pour rendre un semblant de présence à ceux dont nous sommes séparés. Par exemple, nous emportons avec nous un portrait, ou une photographie, de la personne aimée. Avoir un portrait de l’absent favorise la rencontre imaginaire avec lui. Et c’est encore mieux quand on a une lettre de sa main qu’on peut toucher, flairer – le succès des lettres parfumées ! – embrasser, voire utiliser comme support de pratiques érotiques ! Ces supports sont des leurres, nous le savons, mais ils participent puissamment à l’illusion de la rencontre. Du coup, si c’est l’aspect « leurre » que nous privilégions, ces objets s’avèrent évidemment frustrants : ils n’arrivent qu’à nous rendre l’absence charnelle de l’aimé(e) encore plus insupportable. Mais si, c’est leur aspect « rencontre » qui nous retient, ils constituent de puissants moyens pour lutter contre l’angoisse de séparation.
C’est exactement la même chose dans la relation virtuelle : les adjuvants qui rendent l’interlocuteur à la fois présent et absent peuvent engager soit sur le versant de la consolation, soit sur celui de la frustration.
Si c’est la consolation qui l’emporte, nous basculons vers une relation imaginaire nourrie de nos fantasmes. Et là, deux situations peuvent se présenter. Si nos interlocuteurs dans le virtuel acceptent de jouer les rôles que nous leur donnons, tout va bien. Mais si ce n’est pas le cas, nous avons le pouvoir d’en changer en quelques secondes… ou bien d’accepter la part de réalité que nous impose notre interlocuteur. C’est pourquoi une relation virtuelle est éminemment instable. Elle a constamment tendance à évoluer soit vers une relation imaginaire – où seuls les fantasmes comptent –, soit vers une relation réelle. Dans le premier cas, nous nous immergeons dans un monde de signes et d’images où la réalité finit par être oubliée. Dans le second cas, à l’inverse, nous cherchons à connaître « pour de vrai » les objets et les personnes que les images représentent
1
Ce flottement, s’il atteint avec le virtuel une importance nouvelle, n’est pourtant pas apparu avec lui. La télévision l’a produit au moment de son apparition. Je me souviens que lorsque j’étais enfant, certaines personnes âgées tenaient à être habillées correctement avant d’inviter le présentateur télévisé chez elles en allumant leur poste ! Ces personnes savaient bien que l’homme de l’écran ne venait pas réellement dans leur salon, mais elles décidaient de faire « comme si ».
. Toute situation virtuelle contient en germe – on est tenté de dire « virtuellement » – ces deux tendances opposées
2
C’est cette forme nouvelle de relation que ratent Miguel Benassayag et Angélique Del Rey, lorsqu’ils prennent « virtuel » comme synonyme d’imaginaire. benassayag m, del rey a. Plus jamais seul. Le phénomène du portable. Bayard, 2006
.
Nous comprenons pourquoi la nouvelle forme de relation créée par les technologies du virtuel passe encore si souvent inaperçue : elle est confondue tantôt avec une relation réelle, et tantôt avec une relation imaginaire, alors qu’elle constitue justement une porte d’entrée vers les deux. Une porte qu’il appartient à chacun de pousser d’un côté ou de l’autre car c’est chacun qui décide !
Cinq raisons (et façons) de jouer
Qu’ils se déroulent dans un monde fantaisiste ou réaliste, les jeux vidéo invitent toujours les joueurs à trouver trois types principaux de satisfaction.
S’enrober d’excitations
De tout temps, les adolescents ont aimé jouer avec des sensations nouvelles et extrêmes. Ils se sont adonnés à des sports périlleux, ont usé de drogues psychotropes et ont flirté avec de nombreuses formes de danger tout en rêvant de diriger des machines imposantes et de changer le cours du monde. Aujourd’hui, les jeux vidéo semblent avoir le pouvoir de permettre tout cela à la fois !
Mais l’excitation émotionnelle est souvent inséparable d’un travail de mise en sens : le joueur de jeu vidéo cherche moins un état d’excitation où s’immerger – comme le fait par exemple un danseur en boîte de nuit – qu’un état d’excitation à maîtriser et ordonner en permanence.
L’écran comme miroir d’interaction
Certains joueurs de jeu vidéo sont intarissables sur leur plaisir de voir leurs gestes suivis immédiatement de la réalisation de l’action correspondante par leur « avatar » (ce mot, qui désigne dans la religion hindouiste les diverses incarnations sur terre du dieu Vishnou, sert de terme générique pour les figurines chargées de nous représenter sur nos écrans. L’avatar peut être réduit à une sorte de logo ou enrichi d’un grand nombre de détails personnels, mais, dans tous les cas, il est aussi indispensable pour entrer et interagir dans les espaces virtuels que notre carte bancaire pour retirer de l’argent à un distributeur). Dans un jeu où l’ordinateur propose au joueur d’être dans une équipe, c’est même l’ensemble de celle-ci qui avance à son rythme et qui s’arrête si le joueur laisse son avatar immobile. Cette coïncidence est encore plus forte lorsque les manettes de commande invitent à accomplir des actes dans la réalité, comme c’est le cas avec la console
Wii3
En revanche, un casque de captation des influx nerveux (développé par la firme « Emotiv ») risque de s’avérer décevante de ce point de vue.
.
Manipuler et interagir : le petit théâtre des vivants et des morts
Certains joueurs privilégient le jeu avec les figurines de pixels. Ils utilisent alors les espaces virtuels comme des espaces potentiels au sens où Winnicott en parlait
4
winnicott dw. Jeu et réalité. Gallimard, Paris, 1971
. Ces figurines peuvent les représenter eux-mêmes, mais aussi leurs parents, leurs frères ou sœurs, et même parfois des personnages de la saga familiale dont ils ont seulement entendu parler. En plus, chacun engage son avatar dans des aventures uniques et se raconte d’innombrables histoires à son sujet. Autrement dit, la singularité des avatars est moins affaire d’aspect que de narrativité. Les rôles dévolus à un avatar sont en effet pratiquement infinis. Il peut incarner un fragment de soi, bien sûr, mais aussi un personnage qu’on a connu, admiré ou redouté, voire quelqu’un qu’on a imaginé à partir des récits qui l’entourent. Sur Internet, certains promènent de la même manière l’effigie d’un disparu, voire l’incarnation d’une légende familiale…
Mais si l’apparence de notre avatar est une porte ouverte sur notre monde intérieur caché, le parcours que nous lui imposons, et les scénarios que nous imaginons pour nos créatures virtuelles, en sont une autre.
Parfois, cette signification se dévoile au cours d’une psychothérapie. J’ai reçu un jour un jeune homme qui passait ses nuits à piloter un avion de chasse dans la guerre du Pacifique. En fait, ce garçon souffrait d’une relation défaillante à son propre père qui ne s’était jamais occupé de lui… sauf pour l’emmener, une fois par an, au Salon aéronautique du Bourget, assister aux performances des avions militaires ! Ce garçon, au cours de ses escapades virtuelles nocturnes, retrouvait donc le chemin des seuls bons souvenirs qu’il avait avec son père. Il faisait même un peu plus, car tous les autres pilotes de son escadrille étaient des hommes mariés, ayant une vie familiale, à tel point qu’ils s’étaient mis d’accord pour bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire ! Le samedi soir, leurs appareils ne décollaient pas pour des combats virtuels. Ils s’occupaient chacun de leur famille, excepté ce jeune homme qui vivait seul, et s’entraînait en solo en rêvant aux retrouvailles du lendemain. Inutile de préciser que le priver de ces parties aurait été catastrophique pour lui, puisqu’il y retrouvait à la fois le souvenir de son propre père, et un contact structurant avec divers pères qui, eux, savaient se rendre disponibles un soir par semaine pour s’occuper de leur progéniture. Là encore, la solution passait par le jeu lui-même. Avant d’imaginer les moyens pour faire en sorte que ce jeune joue moins, il fallait comprendre les raisons de sa passion de plus en plus envahissante, et lui permettre de consolider ses repères paternels dans la relation thérapeutique.
Quatre ressorts de la quête narcissique
Les jeux vidéo organisent aussi un système de gratifications redoutables. Certaines sont comparables à celles qu’on peut trouver dans les jeux d’argent : un geste amène une récompense, par exemple sous la forme de « pièces d’or » virtuelles. Mais d’autres relèvent d’une vie sociale réelle, même si elles se déroulent entre aficionados. En fait, c’est l’imbrication de ces deux formes de gratifications qui rend beaucoup d’adeptes rapidement captifs. En pratique, ces gratifications proviennent soit du logiciel lui-même, soit des autres joueurs présents dans le jeu, soit enfin de l’entourage proche, les pairs… et parfois la famille !
Commençons par les gratifications procurées par les logiciels. Si avancer dans un jeu est souvent frustrant, le joueur débutant est en effet accueilli avec beaucoup de sollicitude ! Dans World of Warcraft, par exemple, chaque coup d’épée (ou chaque sort) jeté sur un petit rongeur fait clignoter l’inscription : « Votre compétence en armes lourdes (ou en sorcellerie) a augmenté de 2 points ». On comprend qu’un enfant qui s’échine sur des opérations mathématiques en devant attendre le lendemain pour savoir s’il a « juste ou faux » préfère jouer à de tels jeux !
Une seconde source de gratification vient, dans les jeux en réseau, des autres joueurs eux-mêmes. Les parents en but à l’agressivité de leur adolescent n’imaginent pas à quel point leur monstre domestique peut se transformer dans son jeu, en chevalier altruiste ou en sorcier protecteur ! C’est un étonnement que de découvrir à quel point, dans des jeux en réseau comme Dark age of Camelots ou World of Warcraft, des inconnus vous viennent en aide et se montrent généreux avec vous. C’est que les aventures menées par chacun lui permettent de découvrir et d’amasser un nombre considérable d’objets dont une infime partie est utilisable par chacun. Vous ne pouvez en effet entrer dans ces jeux qu’en vous choisissant une identité, et celle-ci détermine la classe d’objets qui vous sera utile parmi tous ceux que vous trouverez ensuite. Par exemple, si votre avatar est un sorcier jeteur de sorts, les épées, cuirasses, et autres boucliers que vous trouverez tout au long de votre chemin ne vous serviront à rien. Vous pouvez bien sûr décider de les abandonner en cours de route, mais il est toujours préférable de se faire des amis, et, pour cela, de les donner par exemple à un jeune chevalier débutant à qui elles seront bien utiles. De la même façon, vous pouvez aider une créature moins expérimentée que vous à franchir rapidement les étapes de sa formation en l’aidant à tuer quelques monstres ou en lui faisant cadeau d’objets dont il a besoin pour monter une expédition. Mais n’en déduisons pas trop vite que ces jeux sont des écoles de compassion ! Les règles d’airain de la vraie vie s’y appliquent malheureusement aussi : trahisons et mensonges sont aussi aux rendez-vous du virtuel quotidien !
Enfin, une troisième source de gratifications vient de l’entourage des pairs. Réussir certains jeux difficiles, c’est être assuré de l’estime, voire de l’admiration de ses pairs. Alors que l’enfant qui a de bons résultats scolaires est volontiers traité de « fayot » ou de « lèche-cul » par les autres élèves, celui qui réussit des jeux difficiles suscite l’admiration de tous les autres joueurs. C’est que les élèves ne se vivent pas égaux devant le savoir scolaire car ils comprennent vite que certains d’entre eux bénéficient d’un soutien familial – voire extrascolaire – qui fait défaut à d’autres. En revanche, ils se vivent comme égaux devant les jeux vidéo où personne n’est aidé par ses parents !
Mais une gratification supplémentaire vient parfois de là où on l’attend le moins, la famille.
C’est le cas pour « Capitaine Blood ». Ce garçon de dix-neuf ans est lycéen en terminale, issu d’une famille de cadres supérieurs. Ses parents sont très absorbés par leur vie professionnelle et ne consacrent que peu de temps à leurs deux enfants, Christophe (c’est son nom) et sa sœur âgée de dix-sept ans. Il a été surnommé « Capitaine Blood » par ses camarades, du nom de son avatar dans un jeu en réseau où il passe plusieurs heures par jour. Depuis un an, ses résultats scolaires sont en baisse. Il n’a jamais été un élève brillant, mais il se maintenait jusque-là à la moyenne sans trop se dépenser. Puis son attention au travail a décliné, et ensuite ses résultats. Et chacun se demande dans sa famille, s’il se ressaisira à temps pour le baccalauréat. En outre, Christophe rencontre moins ses copains, sauf un qui passe le voir chaque mercredi après-midi et avec lequel il joue. Enfin, Christophe, qui sort de moins en moins, participe aussi de moins en moins à la vie domestique.
C’est la mère de Christophe qui relate cette situation et vient demander de l’aide. Elle s’inquiète de cette situation. Mais en même temps, elle se dit fière du grade élevé qu’a obtenu son fils dans ce jeu, et de la reconnaissance de ses camarades et autres joueurs : il élabore les stratégies de son groupe, passe des alliances, se comporte en fin stratège... Bref, cette mère s’est intégrée dans le système de gratifications qui désocialisent Christophe. C’est la famille qui a besoin d’être aidée !
Rencontre réelle apprivoisée
Il existe dans les jeux en réseau quatre niveaux successifs dans lesquels les rencontres sont de moins en moins « virtuelles » pour devenir de plus en plus « réelles ». Dans un premier temps, les joueurs entrent en contact entre eux à travers les caractéristiques de leur avatar. Ils se demandent par exemple, comment venir à bout d’un monstre ou d’un ennemi particulièrement redoutable, où trouver une armure ou une potion magique, comment se faire employer par une famille noble… Puis, dans un second temps, les joueurs commencent à parler de leurs problèmes réels en conservant l’identité de leur avatar : par exemple, des adultes jouant avec leur bébé sur les genoux parlent entre eux des réactions de leur enfant qu’ils tiennent devant eux, mais sans cesser pour autant d’être les uns pour les autres « un chevalier », « un sorcier » ou un « page ». Dans un troisième temps, ils peuvent en revanche commencer à évoquer leur identité réelle, leur âge, leur lieu d’habitation, ou leur mode de vie, mais de telle façon que chacun peut encore continuer à tromper les autres sur chacune de ces caractéristiques. Bref, nous ne sommes plus absolument dans le « virtuel » mais pas encore tout à fait dans le « réel » dans un espace qui est une sorte de « réel filtré par le virtuel ». Enfin, dans un quatrième temps, les joueurs peuvent décider de se rencontrer « pour de vrai » le plus souvent dans un café.
Du jeu normal au jeu pathologique
Comme tous les jeux, les jeux vidéo développent des compétences telles que la maîtrise des risques, l’adaptabilité dans un environnement mouvant, la gestion de l’inattendu, le traitement d’informations en parallèle... On y apprend aussi la socialisation et la communication, dans la mesure où, dans les jeux à plusieurs sur Internet, il n’est possible de progresser qu’en établissant des alliances. Les jeux canalisent aussi l’agressivité et permettent de lui donner une orientation vers la ténacité. Ils encouragent à savoir reprendre courage après chaque échec. Enfin, certains jeux fonctionnent comme des rites initiatiques pour des jeunes qui grandissent dans une société où il n’y en a plus. Cela peut éviter le recours à des pratiques initiatiques dans la réalité, avec les effets catastrophiques qui peuvent en résulter. En fait, les jeux vidéo peuvent constituer le support de bénéfices semblables à tous les autres jeux (Winnicott, 1942

). Mais le jeu vidéo peut aussi favoriser l’isolement et la déscolarisation. Il ne correspond plus à la tentative d’organiser des expériences anciennes et d’en vivre de nouvelles. Il n’est plus qu’une façon de tenter d’échapper à des angoisses plus ou moins catastrophiques. Certaines sont liées aux bouleversements propres à l’adolescence, mais la plupart datent de la petite enfance. Car l’ordinateur a le pouvoir de réactiver la relation première qu’un enfant a établie avec son environnement : que ses premières années aient été satisfaisantes, et il pourra profiter pleinement des jeux vidéo. Si au contraire, l’histoire précoce d’un jeune a été marquée par des sentiments de frustration narcissique et d’insécurité, le risque est qu’il tente d’en guérir avec les jeux vidéo, au risque de réduire de plus en plus son monde à son jeu, sans vraiment en tirer de véritable satisfaction, jusqu’à un isolement social qui peut être très grave (Tisseron, 2008).
L’écran peut en effet être utilisé pour tenter d’oublier ce qui fait souffrir. Il peut s’agir de souffrance physique
5
C’est ainsi que des enfants atteints de maladies graves, notamment des tumeurs, pensent moins à leurs douleurs quand on leur permet de jouer à des jeux vidéo. La preuve en est donnée par le fait que l’on peut alors diminuer considérablement leurs doses d’analgésiques !
, mais le plus souvent de souffrance psychique, notamment une tristesse ou une dépression.
En outre, pour l’enfant déprimé, les jeux vidéo offrent l’avantage de s’adapter à son rythme. La persévérance y compense largement la lenteur : à force de répéter les mêmes épreuves, l’enfant déprimé devient aussi performant que les enfants plus habiles et rapides, mais qui jouent moins. Le problème est que plus l’enfant passe du temps à jouer et plus ses performances scolaires s’effondrent. Et plus son jeu lui apporte des gratifications suffisamment nombreuses pour qu’il ne s’en soucie pas… C’est ainsi qu’un excès d’angoisse peut conduire à un jeu compulsif et répétitif. Le jeu proprement dit s’interrompt alors pour devenir une défense qui évoque la masturbation compulsive ou le refuge dans une rêverie éveillée coupée de tout prolongement réel.
Parfois aussi, le présent pénible que l’enfant cherche à oublier ne concerne pas sa vie psychique intime, mais sa vie familiale : un enfant qui vit l’attitude de ses parents comme intrusive peut ainsi préférer les jeux vidéo à toute autre activité parce qu’il sait que là au moins, ils ne le suivront pas !
Attachement insécurisé
L’enfant construit sa sécurité intérieure sur le modèle de celle qu’il trouve dans son environnement. Si celui-ci ne permet pas que s’établisse cette sécurité, il y a échec du processus normal d’attachement (Bowlby, 1978-1984

). Il en résulte l’insécurité, la peur et le sentiment d’abandon.
À l’adolescence, les espaces virtuels peuvent être mis à contribution pour réparer cet échec. Pour certains, il s’agit d’avoir un écran toujours connecté qui les assure de ne jamais se sentir abandonnés. Il s’agit pour le joueur excessif de trouver un partenaire toujours disponible. Un enfant me disait que lorsqu’il avait fini de jouer, la machine l’invitait à jouer encore en lui disant qu’elle était « ouverte ». En fait, cet enfant lisait sur l’écran « game over » qui signifie « joue encore » en anglais. Mais lui avait transposé cela dans l’idée que la « mère ordinateur » restait ouverte à toutes ses propositions.
Quelques-uns comparent la barre de téléchargement à un œil qui s’ouvre ou à un visage qui se tourne vers eux pour les regarder. D’autres se créent un avatar immortel qu’ils ne quittent jamais… et qui ne les quitte donc jamais non plus. Le corps réel de ces joueurs finit par perdre toute importance (on assiste à un déni du corps un peu comme dans l’anorexie). Seul compte leur double de pixels qu’ils ne doivent abandonner à aucun prix, jusqu’à s’en laisser dépérir. L’avatar devient seul chargé d’assurer le sentiment de cohérence et de continuité du soi. Cette attitude évoque aussi les défenses maniaques contre ce que Winnicott a appelé l’angoisse de l’effondrement consécutive à une séparation précocement vécue (1974

). L’adolescent laisse passer l’heure du repas, s’empêche d’aller aux toilettes, est à la limite de l’effondrement : mais son avatar, lui, ne s’effondre jamais !
Régulation de l’excitation
L’enfant est normalement aidé par son entourage adulte à gérer les stimulations excessives de son environnement. La faim, le froid, le chaud, font l’objet d’actions apaisantes de la part des parents. Mais l’adulte n’est pas seulement celui qui apaise les excitations excessives, il est aussi celui qui en communique, notamment au moment de la toilette. Paul Claude Racamier (1980) décrit la situation où une mère surexcite son bébé sous le nom de « séduction maternelle primaire ».
L’enfant qui a vécu cette forme de relation précoce peut s’engager à l’adolescence dans des interactions d’écran où il cherche à revivre un bombardement d’excitations intenses, visuelles, auditives et tactiles. Il est surexcité comme lorsqu’il était soumis à une mère excessivement excitante, mais, à la différence de ce qui se passait alors, il se rend finalement maître de la situation : il réussit là où, bébé, il a échoué. Et il se soigne parfois ainsi d’une passivité mortifère qu’il avait précocement intériorisée.
L’enfant sous stimulé peut aussi trouver dans l’ordinateur un support de stimulations adaptées à son rythme.
Enfin, les enfants qui ont vécu des traumatismes psychiques précoces – et notamment des situations de maltraitance – vivent souvent à l’adolescence une ambivalence extrême vis-à-vis de leurs émotions. Ils haïssent et aiment en même temps avec une intensité exceptionnelle leur père, leur mère, leur beau-père ou leur belle-mère. En même temps, ces traumatismes les ont rendus souvent incapables de contenir leurs propres émotions afin de pouvoir les élaborer. De tels adolescents ont une grande difficulté à dire et à exprimer leurs émotions, tout comme à percevoir celles d’autrui. C’est ce que Joyce Mac Dougall a appelé l’alexythymie (1982

). Le risque est alors que ces adolescents, qui ne peuvent ni contenir ni gérer leurs émotions, les remplacent par des sensations. Les sensations, en effet, sont toujours éprouvées et elles peuvent en outre être maîtrisées. L’adolescent qui est dans cette situation cherche alors à vivre des sensations de plus en plus extrêmes. Son engagement dans le jeu peut constituer une modalité de défense contre l’angoisse de ne rien éprouver et les sensations qu’il cherche sont un moyen pour lui de tenter de pallier à cette angoisse.
Accordage affectif
L’enfant trouve normalement chez les adultes qui l’entourent un miroir de ses attitudes et de ses comportements. Daniel Stern (1989

) a décrit cette situation sous le nom d’accordage affectif. Elle se caractérise par le fait que l’adulte interagit en empathie avec l’enfant en lui servant d’écho et de miroir. Mais l’accordage affectif est moins une forme d’imitation que de transmodalité. Daniel Stern cite par exemple la situation dans laquelle un bébé de neuf mois assis devant sa mère secoue de haut en bas un hochet, et où celle-ci se met à secouer la tête de haut en bas en suivant de près le rythme des mouvements du bras de son fils. Dans cette situation, la modalité d’expression utilisée par la mère – ou, si on préfère, le canal – est différent de celle qu’utilise le nourrisson. Ce qui est imité, ce n’est pas en soi le comportement de l’autre, mais plutôt son état émotionnel, qui se trouve traduit dans une autre modalité sensorielle. Un enfant qui n’a pas trouvé dans son environnement un accordage affectif suffisant peut tenter, à l’adolescence, de le construire par ordinateur interposé. Il se tourne alors vers celui-ci comme vers un espace qui lui procure un miroir de ses gestes, mais aussi de ses pensées et émotions. Il y cherche un miroir d’approbation. Il appuie par exemple de façon répétitive sur une touche, et le personnage qu’il anime bondit en rythme, ou bien il tire avec une arme bruyante de telle façon que le « bam-bam » des coups de feu correspond au mouvement de son doigt ou de sa main. Daniel Stern insiste sur le fait que la qualité d’un accordage contribue au sentiment de trouver un objet « nourrissant » susceptible de maintenir la vie psychique en organisant la résonance d’états affectifs.
Un enfant qui n’a pas trouvé dans son environnement un accordage affectif suffisant va éventuellement tenter, à l’adolescence, de le construire par ordinateur interposé. Il se tourne alors vers celui-ci comme vers un espace qui lui procure un miroir de ses gestes, mais aussi de ses pensées et émotions
6
La nouvelle console de jeu « Wii » pousse beaucoup plus loin que d’autres cette correspondance en prenant en compte à la fois l’intensité, le rythme et la forme des comportements du joueur : par exemple, en bougeant les mains d’une certaine façon et à une certaine vitesse, le joueur anime une créature sur l’écran qui court selon le même rythme.
.
À la poursuite de l’idéal
L’enfant reçoit normalement des adultes des réponses qui lui permettent de se construire une estime de soi adaptée. Mais lorsque l’environnement précoce n’a pas joué ce rôle – et notamment lorsqu’il a dévié les réussites de l’enfant pour soigner ses propres préoccupations dépressives – l’enfant reste fixé à des formes inadaptées du narcissisme.
À l’adolescence, il peut être tenté de donner forme à ces figures. Il utilise les espaces virtuels pour cultiver ce que Kohut
7
kohut h. Le Soi. PUF, Paris, 1974
appelle « un Soi grandiose idéalisé ». Il consacre par exemple toute son énergie à se fabriquer un avatar qui possède des armes et des vêtements exceptionnels qui le font remarquer et admirer. Il cultive une forme de représentation de lui-même sans rapport avec la réalité. Et le fossé se creuse progressivement entre la représentation de ses propres capacités dans le réel et cette image idéalisée de lui dans le virtuel.
Une autre forme pathologique de narcissisme à l’œuvre dans les jeux vidéo consiste dans ce que Heinz Kohut appelle le transfert idéalisant : le joueur crédite d’autres joueurs de pouvoirs extraordinaires. Il imagine notamment que ceux qui ont atteint un grade élevé sont des personnes respectables dont le statut est enviable qui peuvent en outre lui donner de bons conseils dans sa vie réelle. Le problème est que la plupart des joueurs qui atteignent des grades élevés dans les jeux vidéo en réseau sont des… chômeurs de longue durée ! En effet, comment pouvoir jouer de trois heures de l’après-midi à quatre heures du matin sans être dans cette situation là ? Car le joueur performant passe son après-midi à s’entraîner seul avant de jouer avec son équipe à partir de minuit… et de dormir à l’aube. Mais trop d’adolescents l’ignorent et s’engagent dans un transfert idéalisant des joueurs les plus performants qu’ils peuvent croiser dans leurs parties ou dont ils ont seulement entendu parler.
Risque de l’addiction et sa prise en charge
Nous voyons mieux maintenant la difficulté qu’il y a à parler « d’addiction » face à une fréquentation excessive des espaces virtuels. Les diverses situations que nous avons successivement évoquées ont en effet des significations et des conséquences bien différentes.
Tout d’abord, la capacité d’utiliser les mondes virtuels pour se construire un espace potentiel concerne des personnalités structurées. À travers la mise en scène de leur monde intérieur, elles parviennent d’ailleurs parfois à se guérir de difficultés passagères. C’est ainsi que la crise de l’adolescence est parfois surmontée grâce aux jeux vidéo : la possibilité d’y réaliser un théâtre de son monde intérieur et familial constitue pour beaucoup un puissant levier auto-thérapeutique. Une telle attitude n’a rien de comparable avec l’addiction à une substance toxique dans la mesure où c’est la mise en sens qui en est le moteur. Ainsi s’explique que la plupart des adolescents sont des joueurs excessifs pendant quelques mois ou quelques années, avant de se séparer totalement de cette activité. Ce serait les stigmatiser bien inutilement, et leur faire le plus grand mal, que de les qualifier d’addicts !
La posture dans laquelle l’écran est utilisé pour renforcer l’estime de soi est une fausse addiction : la preuve en est que certains adolescents en situation de garde alternée entre leur père et leur mère peuvent faire alterner des semaines où ils jouent sans discontinuer et d’autres où ils ne jouent pas du tout selon la relation qu’ils ont avec le parent qui les garde.
La posture dans laquelle l’écran est constitué en partenaire d’attachement ou en miroir d’interactions, est proche de ce qu’on appelle traditionnellement « addiction ». La souffrance narcissique y est centrale. Pourtant, la quête de sens y est importante, même si elle ne joue pas le rôle majeur qu’elle prend lorsque l’usager est capable de mettre les mondes virtuels au service de la création d’un espace potentiel personnel. La preuve en est que le joueur qui tente de faire de son écran un miroir de ses éprouvés cherche à deviner les intentions de son vis-à-vis, qu’il s’agisse de l’ordinateur envisagé comme un partenaire ou d’un autre joueur en réseau.
La quête de l’excitation est également très proche des conduites addictives traditionnelles usant de substances toxiques. Le joueur n’est pas engagé dans une mise en scène de son monde intérieur, comme c’est le cas lorsqu’il transforme les mondes virtuels en autant d’espaces potentiels. Il ne cherche pas non plus un écho narcissique, comme lorsqu’il se rend sensible à la merveilleuse interactivité des ordinateurs. Il se rend totalement dépendant d’une source d’excitation qui lui est extérieure, mais qui a le pouvoir de générer en lui des états extrêmes et sans équivalent dans sa vie quotidienne. Et il prétend à qui veut l’entendre en rester le maître, dans l’illusion du pouvoir d’abandonner à sa guise le levier qui lui dispense son plaisir.
Pourtant, là aussi, le rapprochement avec les addictions aux substances toxiques est artificiel. Cette posture est en effet rarement pure : il s’y mêle souvent des éléments liés aux deux premières, la construction d’un espace potentiel et la recherche d’un miroir
8
Pour un approfondissement de ces trois façons de jouer, auxquelles s’ajoute la recherche de contacts réels dans les jeux en réseau, on peut consulter : Tisseron S. (sous la direction de). L’enfant au risque du virtuel. Dunod, Paris, 2007
. Et c’est d’autant plus important de le savoir que c’est justement là que peut s’appuyer un éventuel thérapeute.
D’abord, soyons clair : les joueurs capables d’utiliser les mondes virtuels comme des espaces potentiels n’ont généralement pas besoin de thérapie. Même s’il leur arrive parfois de jouer beaucoup, ils s’en sortent très bien tout seuls. Ceux qui font de leur écran un miroir d’interactions nécessitent une prise en charge particulière : il faut tenter de se proposer soi-même dans ce rôle, sans hésiter à mettre en jeu ses mimiques et son corps en réponse aux mimiques et au corps du patient ! C’est le meilleur moyen de l’inviter à créer avec soi l’espace potentiel qu’il n’arrive pas à constituer dans son rapport à son jeu. Enfin, quand on a affaire à un joueur en quête d’excitation, il faut tenter de faire évoluer la relation vers un miroir d’interactions dans le vis-à-vis de la relation, bien que ce soit souvent plus difficile.
C’est avec ces personnalités qu’il peut être utile de proposer au patient de jouer à son jeu habituel pendant une tranche de temps de sa thérapie. Parfois, il est en effet impossible d’établir une situation propice à la thérapie avec de tels joueurs si on n’utilise pas ce moyen. C’est seulement ensuite que le dialogue peut s’établir avec eux, à partir de ce qu’ils ont mis en scène à leur insu, tout occupés qu’ils étaient à susciter et gérer des excitations. En clinique, l’utilisation d’un tel procédé s’appelle une « médiation thérapeutique ». La clé de son efficacité se trouve dans la forme particulière de transfert que cette technique mobilise : le fragment de partie joué pendant la séance prend peu à peu le statut d’espace potentiel, et cet espace se trouve ensuite, au fil des rencontres et des interactions avec le thérapeute, déplacé vers celui-ci. Une vraie relation peut alors se nouer, qui permet de travailler dans la relation au thérapeute ce qui était jusque-là cantonné à une relation muette à l’écran.
Enfin, dans certains cas de grande dépendance, la création de groupes thérapeutiques réunissant plusieurs joueurs peut s’avérer un excellent moyen. Chacun trouve en effet plus facilement à constituer un miroir d’interactions avec un autre joueur auquel il peut s’identifier qu’avec un thérapeute !
Disons encore que la tâche des thérapeutes de ces nouveaux malades du virtuel est ardue. Ils ont à comprendre chaque fois la place que joue la relation privilégiée à l’ordinateur comme moyen de tenter de guérir une relation précocement – ou tardivement ! – perturbée au monde. À condition toutefois de savoir éviter les poncifs de la mère « narcissique » ou « déprimée », qui aurait été incapable de constituer un miroir satisfaisant pour son enfant, le poussant ainsi à son engagement vers les miroirs d’écran. Cessons de culpabiliser les mères dans ce domaine comme dans d’autres ! Car bien des événements interviennent dans cette première relation, dont la mère n’est pas responsable, à commencer par les prises en charge par les nourrices et les crèches, mais aussi les éventuels déménagements multiples souvent subis par les familles, voire les décès des proches. Les troubles de la petite enfance peuvent provenir de parents peu disponibles, mais aussi d’expériences personnelles tragiques comme une rupture, une maltraitance, un deuil ou une humiliation, voire de catastrophes vécues par les générations précédentes qui ont porté leur ombre sur le développement de l’enfant. Dans tous les cas, le thérapeute doit réapprendre à ces prisonniers du virtuel le goût de l’engagement corporel et celui de la sublimation. Cela ne peut se faire qu’en encourageant l’enfant, puis l’adolescent, dans la création de son propre discours, de ses propres images, de ses propres mises en scène.
Quelle prévention ?
Cette distinction entre quatre centres d’intérêts différents de la part du joueur permet enfin d’établir les bases d’une prévention cohérente. Que doivent faire les parents et les pédagogues ? D’après ce qui précède, la réponse est assez simple : permettre d’éviter aux enfants de devenir des joueurs piégés dans l’excitation, et leur permettre le plus possible d’être des joueurs socialisés.
La prévention pourra être mise en place dans trois directions complé-mentaires.
Mise en place d’informations dans les écoles
Celle-ci pourra être réalisée par des associations de joueurs comme cela a été mis en place en Suisse avec Swissgamers network. Cette information permettra aux intervenants de bien maîtriser le vocabulaire et les questions des joueurs. Il permettra de les mettre en garde contre les risques des jeux vidéo et surtout d’insister sur le fait que le jeu vidéo soit une activité bien plus intéressante quand elle est partagée : le plaisir à échanger les astuces de jeux, à parler des émotions qu’on y éprouve et à raconter ses stratégies est un excellent moyen de lutter contre le risque de marginalisation dans les jeux vidéo. La socialisation à travers les jeux vidéo est la meilleure manière de lutter contre les dangers de désocialisation dans les jeux vidéo.
Établissement d’un « numéro vert »
L’établissement d’un « numéro vert » permettra aux joueurs de trouver des interlocuteurs pour évoquer leur solitude, leurs difficultés, leur souffrance et leurs questions. Là encore, comme pour les interventions dans les écoles, il est important que ce service soit assuré par des gens qui connaissent ces problèmes : l’association OMNSH (Observatoire des mondes numériques en sciences humaines
9
) pourrait jouer ce rôle.
Mise en place d’activités
Enfin, il est urgent de réfléchir à la mise en place d’activités qui donnent le goût du corps et du sens qu’il prend dans les relations sociales. Il est capital, de ce point de vue, de prévoir la mise en place, dès les écoles maternelles, d’activités de jeux de rôles. Celles-ci peuvent se faire à partir des contes racontés aux tout-petits, mais il serait également essentiel d’en organiser à partir des images qu’ils peuvent voir et qui les interrogent ou les malmènent.
En conclusion, rappelons que c’est parce que le joueur est constamment frustré dans ses attentes et ses aspirations qu’il joue et rejoue encore, au risque de s’engager dans des parties qui le marginalisent de plus en plus. Rompre ce cercle de la frustration ne peut se faire qu’en lui opposant une gratification sociale. Il n’y a pas d’autre issue au risque de marginalisation dans les jeux vidéo que celle d’une socialisation à partir des jeux vidéo.
C’est heureusement quelque chose que l’enfant fait le plus souvent spontanément. Quand il n’y parvient pas, c’est le rôle des parents et des pédagogues de l’y aider.
Bibliographie
[1] abraham n,
torok m. L’Écorce et le Noyau.
Flammarion;
Paris:1978;

[2] bergeret j. La violence fondamentale.
Dunod;
Paris:1984;

[3] bowlby j. Attachement et perte.
PUF;
Paris:1978-1984;
(3 tomes):

[4] kohut h. Le Soi.
PUF;
Paris:1974;

[5] mac dougall j. Théâtre du Je.
Gallimard;
Paris:1982;

[6] mauss m. Les techniques du corps (1936) 1
re version, Journal de Psychologie N° 32.
Sociologie et anthropologie. PUF;
Paris:1950;

[7] milner m. Rôle de l’illusion dans la formation du symbole.
Revue Française de Psychanalyse. 1977;
5
-6

[8] pragier g,
pragier sf. Au-delà du principe de réalité, le virtuel.
Revue Française de Psychanalyse. 2003;
1:63
-84

[9] roussillon r. La métapsychologie des processus de transitionnalité.
Revue Française de Psychanalyse. 1995;
5:1375
-1519

[10] stern dn. Le Monde interpersonnel du nourrisson, une perspective psychanalytique et développementale.
PUF;
Paris:1989;

[11] tisseron s. Psychanalyse de l’image, des premiers traits au virtuel.
Dunod;
Paris:1995;

[12] tisseron s. Comment l’esprit vient aux objets.
Aubier;
Paris:1999;

[13] tisseron s. Comment Hitchcock m’a guéri.
Albin Michel;
Paris:2003;

[14] turkle s. Life on the screen: Identity in the Age of the Internet.
Simon and Schuster;
New York:1995;

[15] winnicott dw. Pourquoi les enfants jouent-ils ? L’enfant et le monde extérieur.
Payot;
Paris:1942, 1997;

[16] winnicott dw. Jeu et réalité.
Gallimard;
Paris:1971;

[17] winnicott dw. La crainte de l’effondrement.
Nouvelle revue de Psychanalyse. Gallimard;
Paris:1974, 1975;
3544

Serge Tisseron
Laboratoire de psychopathologie des atteintes somatiques et identitaires
Université Paris XI, Nanterre
Dispositifs spécialisés et pratiques émergentes en Suisse1
Présentation orale transcrite avec la collaboration de Madame Antonella Luongo (Centre du jeu excessif, Lausanne), et de Madame Elisabeth Alimi (Centre d’expertise collective, Inserm, Paris)
Cette communication se déroule en sept points :
• un bref retour sur le contexte politique et législatif helvétique en matière de jeux d’argent et de hasard ;
• un aperçu des données épidémiologiques relatives aux comportements de jeux en Suisse ;
• une description des dispositifs spécialisés d’aide ;
• un aperçu du dispositif spécialisé de prévention ;
• un aperçu du dispositif de formation ;
• une discussion des enjeux de la recherche biomédicale dans le champ des jeux de hasard et d’argent dans le contexte romand et suisse ;
• l’exposé se termine par les questionnements actuels et les perspectives pour le dispositif suisse spécialisé.
Contexte politique et législatif suisse des jeux d’argent
Pour comprendre les spécificités du dispositif législatif suisse en matière de jeux d’argent, il faut rappeler quelques particularités du système politique helvétique ; il s’agit également de mettre ce dispositif en perspective avec les expériences politiques acquises dans le champ des politiques publiques de dépendances, et notamment de la politique fédérale de réduction des risques, dites des quatre piliers.
Particularités du système politique helvétique
La Suisse est une fédération constituée de 26 cantons qui sont autant d’États autonomes disposant de leur propre pouvoir exécutif et législatif, de leur propre système de santé. De plus, la Suisse est constituée de trois régions linguistiques, avec des différences culturelles sensibles sur des questions sociétales comme les jeux d’argent ou plus généralement les questions liées aux dépendances.
Politique fédérale de santé pour les problèmes de dépendance :
modèle dit des « quatre piliers » et modèle dit « du cube »
(en allemand « würfellmodell »)
Depuis 12 ans, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en charge de la question définit sa politique relative à la drogue par quatre piliers de la manière suivante :
• le pilier « prévention » contribue à la réduction de la consommation de substances psycho-actives en évitant que les gens ne se mettent à en consommer et ne développent une dépendance ;
• le pilier « thérapie » contribue à la réduction de la consommation de drogues en permettant de sortir d’une dépendance ou à en préserver la possibilité. Il contribue en outre à la promotion de l’intégration sociale et de la santé des personnes traitées ;
• le pilier « réduction des risques » contribue à minimiser les effets négatifs de la consommation de drogues sur les usagers et – indirectement – sur la société en rendant possible une consommation entraînant moins de problèmes individuels et sociaux ;
• le pilier « régulation du marché » (anciennement nommé pilier « répression ») contribue, par des mesures de régulation ou d’interdiction, à tenter de contrôler l’offre et la demande de substances psycho-actives (Office fédéral de la santé publique, 2005 ; Troisième programme de mesures de la Confédération en vue de réduire les problèmes de drogue (ProMeDro III) 2006-2011, Bern).
Le modèle dit « du cube » place le concept de réduction des risques au centre de la politique de santé publique. Ce modèle tend progressivement à s’imposer pour l’ensemble des questions liées aux dépendances. En 2006, les Commissions fédérales drogues, alcool et tabac se sont constituées en groupe de travail qui a aboutit au rapport psychoaktiv.ch
2
. Le groupe de travail a proposé de faire évoluer la politique des « quatre piliers » vers une représentation tridimensionnelle, d’où l’appellation de modèle « du cube », traduction non littérale de «
Würfellmodell » (littéralement modèle du dé).
Trois catégories de consommations sont définies selon ce modèle (figure 1

) :
• consommation peu ou pas problématique : consommation occasionnelle ou à faible dose contrôlée par l’individu ;
• consommation problématique : ce comportement de consommation inclut, d’une part, l’usage à risque et, de l’autre, l’usage nocif. Dans le premier cas, les problèmes sont latents, alors que le second se traduit par des problèmes physiques, psychiques ou sociaux concrets ;
• dépendance : consommation présentant les caractéristiques les plus graves comme celles, typiques, de la tolérance et du sevrage. L’individu perd le contrôle de sa consommation bien qu’il soit conscient des problèmes qu’elle engendre.
La question d’intégrer par la suite les addictions sans substance à ce modèle dit « du cube » reste ouverte.
Réseau addictologique spécialisé en Suisse romande
Chacun des deux hôpitaux universitaires de Lausanne et Genève disposent de services addictologiques différenciés, drogue-alcool-tabac et jeu. Dans chaque ville moyenne, sont implantées des consultations et antennes spécialisées et dans chaque canton se trouvent de nombreuses structures socio-éducatives spécialisées alcool-drogues (ateliers, foyers, post-cures). En matière d’addictologie en Suisse, la médecine de premier recours occupe une place historique. Il faut rappeler, en effet, que les médecins généralistes ont été les pionniers de la prescription de traitements de substitution par la méthadone, depuis la fin des années 1970. Aujourd’hui, les médecins de premier recours demeurent très largement les premiers prescripteurs en nombre de traitements de substitution, largement devant les services et consultations spécialisées.
De nombreuses associations professionnelles et interprofessionnelles font le lien entre les différents intervenants et les différents cantons : notamment le GREA (Groupement romand d’étude des addictions), la FORDD (Fédération des organismes romands de formation dans le domaine des dépendances), la SSAM (Société suisse de la médecine de l’addiction), CoRoMa (Collège romand de médecine de l’addiction). De plus, à l’intérieur de chaque canton, diverses associations regroupent les professionnels dans le domaine du traitement et de la prévention des addictions.
Place du jeu excessif au sein de la politique suisse en matière de dépendances
En 2004, l’Office fédéral de la santé publique, via un rapport intitulé « Une nouvelle politique en matière de dépendances pour la Suisse »
3
a remis en question la définition des priorités en matière de dépendances. Ce rapport considère, d’un côté, le nombre de personnes touchées et, de l’autre, l’acuité des difficultés que provoque le comportement. Ses conclusions sont les suivantes :
• parmi toutes les dépendances, celles qui devraient retenir en premier l’attention de l’État sont le tabac et l’alcool. Ces deux substances sont celles qui engendrent le plus de souffrances et le plus de coûts pour la société ;
• en seconde priorité, l’État devrait s’occuper des problèmes liés à l’héroïne, au cannabis et aux médicaments. Au même niveau, il doit placer des comportements, comme l’adiposité (obésité), la dépendance au jeu et les achats compulsifs ;
• les autres formes de dépendances sont données comme d’importance moindre.
Le tableau I

illustre la redéfinition des priorités de santé publique proposée par le rapport.
Tableau II Définition des priorités de santé publique (d’après Office fédéral de la santé publique, 2004)
| |
Acuité du problème
|
|
Nombre d’individus concernés
|
Élevée
|
Moyenne
|
Faible
|
|
400 000 – >1 million
| |
Consommation de tabac
|
Adiposité
|
|
100 000 – 270 000
|
Abus d’alcool
|
Dépendance à l’achat
Abus de médicaments
Dépendance au travail
|
Consommation de cannabis
|
|
20 000 – 45 000
|
Consommation d’héroïne
|
Dépendance au jeu
|
Dépendance à Internet
|
|
Moins de 10 000
| |
Consommation de cocaïne
Anorexie
Boulimie
|
Consommation d’ecstasy
|
Nécessité d’agir du point de vue des professionnels :  Élevée
Élevée  Faible
Faible  Moyenne
Moyenne
Législation suisse en matière de jeu d’argent
Les bouleversements de la politique des jeux en Suisse font suite au vote populaire de 1993 se prononçant à une large majorité pour une libéralisation du marché des jeux de hasard et d’argent de type casinos. Le but affiché était de combler les déficits des caisses de pensions. La législation suisse en matière de jeux d’argent possède la particularité de légiférer très différemment les maisons de jeu, relevant d’une loi donnant compétence à la confédération, d’une part, et, d’autre part, les loteries et paris professionnels (loteries, paris sportifs et paris mutuels), qui relèvent d’une loi spécifique datant des années 1920, donnant compétences aux cantons.
Législation sur les jeux de hasard et d’argent : casinos
La loi fédérale relative aux jeux de hasard et d’argent, dites « Loi sur les maisons de jeux » (LMJ) a été établie en 1998. Elle vise à assurer une exploitation des jeux sûre et transparente, empêcher la criminalité et le blanchiment d’argent et à prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu. L’article 14 al.2 décrète que « Dans le programme de mesures sociales, l’exploitant définit les mesures qu’il entend prendre pour prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu ou y remédier ».
L’Ordonnance sur les jeux de hasard et d’argent et les maisons de jeu (OLMJ) (2000), dans son article 37 al.2, stipule : « La maison de jeu collabore avec un centre de prévention des dépendances et avec un établissement thérapeutique pour la mise en œuvre du programme de mesures sociales (…) ».
C’est la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)
4
rattachée au Département justice/police qui est l’organe de surveillance.
Législation sur les jeux de hasard et d’argent : loteries et paris
L’ancienne Loi sur les loteries et paris (LLP, 1923) a été tout récemment complétée d’une Convention intercantonale (2006), qui « règle la surveillance de même que l’autorisation et l’affectation des bénéfices de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse ».
Dans son article 18, elle établit une taxe sur la dépendance au jeu. « Les entreprises de loteries et paris versent aux cantons une taxe de 0,5 % du revenu brut des jeux (RBJ) réalisé par les différents jeux sur leurs territoires cantonaux. Les cantons s’engagent à utiliser ces taxes pour la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu. Ils peuvent collaborer entre eux à cet effet ».
La surveillance est du ressort des ministères de l’économie des cantons, et d’une commission intercantonale des loteries et paris.
Législation relative aux jeux on-line
La loi fédérale sur les Maisons de jeux du 18 décembre 1998 interdit, dans son article 5, « l’utilisation d’un réseau de communication électronique tel qu’Internet pour l’exploitation de jeux de hasard ». Des dispositions pénales spécifiques ont été prévues à cet égard.
Pratiquement, celui qui, en Suisse, produit un logiciel de jeux de hasard, le vend ou le rend accessible depuis ce pays, exploite un serveur destiné aux jeux de hasard, opère des transactions financières en rapport avec un cybercasino, fait de la publicité pour un cybercasino ou gère et/ou finance un cybercasino est passible de poursuites.
Le fait de s’adonner, en tant que client, à des jeux d’argent on-line situés off-shore n’est pas en soi réprimé.
Du point de vue des jeux de loterie, il est en revanche possible en Suisse de vendre des tickets de loterie on-line via les monopoles d’État sur ce type de jeu.
Offre de jeu en Suisse et évolution du revenu brut des jeux
Il y a actuellement 19 casinos implantés en Suisse qui exploitent un total d’environ 250 tables et un peu plus de 3 000 machines à sous. Exploités uniquement en Suisse romande, on trouve environ 700 appareils distributeurs de loteries électroniques, appelés Tactilo, répartis par paires dans 350 cafés, en plus des offres de loteries et paris traditionnels. En avril 2005, les machines à sous qui étaient exploitées dans certains cantons en dehors des casinos ont été interdites au profit de jeux dits d’« adresse », qui sont en fait des jeux de hasard et d’argent comportant une phase d’adresse.
Le revenu brut des jeux (qui est la différence entre les mises des joueurs et les gains distribués) en Suisse romande a augmenté de plus de 630 % de 1995 à 2005 (Rapport du GREA, 2005) (figure 2

). La dépense par habitant était de l’ordre de 400 € en 2003 (à comparer avec 421,8 € en France selon les données 2002).
Données épidémiologiques suisses
Avec 19 casinos situés sur le territoire suisse, on se situe dans la fourchette haute en termes de densités de casino par habitant, en comparaison internationale. La densité la plus élevée est observée dans la région lémanique, due à la concurrence avec les casinos situés sur le territoire français, ceux-ci captant la clientèle suisse, avant la loi permettant d’ouvrir des casinos sur le territoire helvétique (1998). Les loteries subissent une forte concurrence des casinos. Elles développent de nouvelles offres, notamment sous forme de distributeurs de loteries électroniques (DLE). Le revenu des loteries suit ces dernières années une progression, parallèle à celle des casinos (figure 2

).
Au niveau international, les valeurs moyennes de prévalence du jeu pathologique se situent entre 0,5 et 2 % (figure 3

). Contrairement à ce qui est parfois avancé, il n’existe pas de corrélation claire entre la prévalence et l’offre de jeux de hasard et d’argent, selon les pays et la plus ou moins grande accessibilité de l’offre.
D’après l’enquête réalisée par Osiek et Bondolfi en 2005 sur un échantillon de 2 803 individus âgés de plus de 18 ans (Bondolfi et coll., 2008

), la prévalence sur la vie entière pour le jeu pathologique était de 1,1 % (SOGS
5
South Oaks Gambling Screen
5 critères et plus, ou niveau 3), et de 2,1 % pour le jeu problématique (SOGS 3 et 4 critères, ou niveau 2), soit des valeurs similaires à celles observées en 1998 (figure 3

et tableau II

). La prévalence à 12 mois en Suisse ne montre pas non plus de différences significatives entre 1998 et 2005, 0,24 % de joueurs pathologiques probables en 1998 et 0, 46 % en 2005.
Les variables analysées : sexe, état civil, temps de travail, niveau de scolarité, « joue de l’argent avant 21 ans » ne montrent pas de différences significatives entre 1998 et 2005 (tableau II

).
Tableau III Caractéristiques des joueurs au sein de l’échantillon de l’enquête épidémiologique suisse de 2005. Résultats pondérés sur 12 mois (d’après Bondolfi et coll., 2008 )
)
| |
Total 1998 (%)
|
Jpat+Jpb (%)
|
p
|
Total 2005 (%)
|
Jpat+Jpb (%)
|
p
|
|
Proportion d’hommes
|
48
|
66
|
ns
|
47
|
70
|
s
|
|
Mariés
|
56
|
44
|
ns
|
53
|
42
|
ns
|
|
Emploi plein temps
|
52
|
76
|
s
|
65
|
80
|
ns
|
|
Niveau scolarité Bac
|
32
|
20
|
ns
|
43
|
24
|
s
|
|
Joue de l’argent avant 21 ans
|
67
|
85
|
s
|
66
|
70
|
ns
|
Jpat+Jpb : Joueur pathologique + joueur problématique ; ns : Non significatif ; s : Significatif
Une comparaison avec la consommation d’alcool avait révélé en 1998 une forte relation entre le fait d’être joueur problématique ou pathologique et le fait de présenter une consommation problématique d’alcool. En 2005, cette relation n’a pas été retrouvée.
Évolution des consultations
La tendance est à l’augmentation du nombre de consultations. D’après le rapport Bass (Künzi et coll., 2004

), le nombre réel de personnes ayant consulté ou suivi un traitement pour un problème lié au jeu est estimé entre 1 000 et 1 500 consultations en 2003 (figure 4

). Le pourcentage de consultants pour des problèmes liés au jeu aurait quadruplé entre 1998 et 2003. Plus l’offre de jeux de hasard et d’argent dans une région est grande et plus le nombre de consultations serait élevé, selon cette enquête, réalisée toutefois sur un échantillon présentant un fort biais de recrutement. Les consultations se répartissent entre les joueurs et leurs proches. En 2003, pour environ 600 consultations de joueurs, il y avait un peu plus de 100 consultations de proches .
Profil des demandeurs d’aide
Dans ses statistiques d’activité, le Centre du jeu excessif
6
(CJE) à Lausanne a observé le profil suivant auprès de ses demandeurs d’aide (CJE, période 2002-2007 ; N=270 joueurs) :
• prédominance masculine, sujets jeunes, co-addictions ;
• parmi les 1 à 5 % des joueurs pathologiques qui consultent, il s’agit de joueurs de machines à sous et loteries électroniques dans plus de 80 % des cas ;
• jeu pathologique évoluant depuis 5 ans en moyenne ;
• les motifs de consultation financiers ou familiaux viennent au premier plan (plus de 50 % ont une dette médiane d’environ 50 000 CHF, soit environ 30 000 Euros) ;
• les motifs professionnels et/ou d’ordre judiciaire sont avancés dans un petit nombre de situations (<15 %) ;
• dans 2/3 des cas, aux problèmes de jeu sont associées des comorbidités psychiatriques ;
• au moins 13 % des patients qui consultent ont commis une ou plusieurs tentatives de suicide et pour 50 % d’entre eux la raison avancée était liée au problème de jeu. D’autre part, les idées suicidaires sont retrouvées chez environ un quart des patients qui consultent.
Groupes à risques
Diverses enquêtes ont été réalisées dans des populations vulnérables (patients hospitalisés, patients dépendant des substances, population carcérales…). Les données préliminaires dans le contexte suisse vont dans le même sens que celles rapportées par les enquêtes qui ont été publiées au niveau international, avec un risque relatif de l’ordre de trois à dix, par rapport à la population générale.
Données épidémiologiques relatives aux coûts sociaux
Les diverses offres de jeux de hasard et d’argent occasionnent des coûts sociaux directs évalués en 2003 à 100 millions de CHF, les coûts administratifs de la réglementation représentant 6 % de ces coûts. La plus grande part revient aux pertes consécutives au non remboursement de dettes de jeu, 70 millions de CHF. Les coûts restant sont ceux du chômage (17,5 millions de CHF soit 19 %), des traitements (2,7 millions de CHF) et les coûts des procédures devant les tribunaux (2,4 millions de CHF) (Rapport Bass, 2004).
Quelques priorités en matière de recherche épidémiologique
Aucune des données épidémiologiques obtenues en population générale ne permet à ce jour d’établir de manière fiable les comorbidités effectives entre le jeu excessif et d’autres problématiques addictives ou psychiatriques.
Il n’existe également pas encore d’études sérieuses relatives aux coûts sociaux générés par le jeu excessif, mais il a été montré que pour une personne présentant un diagnostic de jeu excessif, au moins une dizaine de personnes en moyenne étaient affectées dans l’entourage.
L’étude des comportements des joueurs directement sur les lieux de jeu reste très peu abordée, ce qui s’explique en partie par le peu d’empressement des industries concernées à collaborer à de telles études. En particulier, la contribution exacte des joueurs excessifs dans les recettes de l’industrie du jeu n’est pas étudiée, même si les rares données disponibles suggèrent des proportions proches de celles observées pour l’industrie des boissons alcoolisées, de l’ordre d’au moins 1/3 de la recette de l’industrie du jeu imputable au jeu excessif (Smith et coll., 2007

).
Enfin, la mortalité par suicidalité reste également très mal connue. Le croisement des sources épidémiologiques disponibles suggère une proportion de 5 à 20 % des suicides « réussis » qui pourraient être associés plus ou moins directement au jeu excessif.
Dispositifs spécialisés d’aide
L’expansion du marché des jeux d’argent en Suisse, ajoutée au contexte législatif et politique précité, a contribué au développement d’une offre de prise en charge spécialisée clairement identifiée, du moins pour les cantons romands, où, comme précédemment évoqué, l’offre est la plus dense, avec outre les casinos, les loteries électroniques de type Tactilo.
La loi sur l’assurance-maladie (LaMal) permet le remboursement des soins pour une pathologie reconnue par la Classification internationale des maladies (CIM).
En 2007, la Suisse romande compte une petite dizaine de lieux susceptibles d’offrir une aide spécialisée aux joueurs : en particulier, Santé bernoise à Bienne, le Centre du jeu excessif à Lausanne, l’association Rien ne va plus
7
et la Fondation Phénix à Genève ainsi que la Consultation NANT des Hôpitaux universitaires de Genève, la Ligue valaisanne contre les toxicomanies à Martigny et Sion, et l’Unité de traitement des addictions à Fribourg. Chacun de ces lieux accueille entre 5 à 10 nouveaux cas par an pour les plus petites structures, et de 60 à 100 pour les plus importantes.
Difficultés de mise en place des lieux d’aide spécialisés
Les débuts des lieux d’aide et antennes spécialisés furent à l’initiative de candidats à une concession de maison de jeu. Ainsi en 2000 sont créées l’association « Rien ne va plus » (RNVP), à Genève, financée par un des candidats à la concession de maison de jeu de Genève ainsi que la fondation Feodor avec la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (financement dans le cadre d’une candidature pour un casino à Saxon). En 2001, le Centre du jeu excessif (CJE) des hospices-CHUV est financé par la Loterie romande dans le cadre de sa candidature à concession pour ses projets de casino, notamment à Ouchy-Lausanne.
Fin 2001, les trois candidats échouent : le financement de RNVP est repris à titre précaire par les autorités genevoises, le subventionnement du CJE par la Loterie romande, au titre de sa politique de jeu responsable en matière de loteries électroniques. La fondation Feodor est mise en sommeil. En 2002-2003, un projet de fondation romande du jeu excessif est proposé par les hospices-CHUV. Un important travail de sensibilisation du réseau addictologique romand est développé pour permettre la survie de RNVP et du CJE.
En 2005-2006, un mandat est confié par la Class
8
Conférence latine des affaires sanitaires et sociales, réunit les ministres de la santé et du social des 6 cantons romands
à la principale organisation professionnelle, le Grea, pour faire des propositions de répartition de la taxe de 0,5 % prélevée sur le RBJ des loteries pour la prévention au titre de la convention intercantonale précédemment mentionnée. Des lieux de consultations médicalisés supplémentaires apparaissent à Genève, Neuchâtel, Fribourg et au printemps-été 2007, le RNVP et le CJE sont finalement stabilisés avec un financement pérenne, via les autorités de santé publique cantonales.
Dispositifs spécialisés de prévention
Au-delà de son acception biomédicale, en matière de jeux d’argent, le terme prévention renvoie à trois registres très différents. Premièrement, une vision qui renvoie à une forme de prohibition, fondée sur des considérations morales, associée à des considérations de justice et police ; deuxièmement, un registre qui renvoie à la notion de « jeu responsable », issue des milieux industriels et économiques ; et en troisième lieu, la notion de politique de « réduction des risques », issue des politiques de santé publique alcool-drogues.
Pour les besoins de l’exposé, nous distinguerons deux niveaux : d’une part la prévention spécifique sur les lieux de jeu (souvent qualifiée de mesures de « jeu responsable »), d’autre part une prévention plus générale, au sens où l’entendent traditionnellement les professions de santé, avec les niveaux de prévention primordiale ou structurelle, de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Prévention au sein des casinos
C’est la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) qui veille au respect et à l’application des dispositions légales relatives aux jeux de hasard et d’argent et aux maisons de jeu en Suisse. Elle contrôle la gestion des casinos et l’exploitation des jeux, vérifie que les maisons de jeu appliquent correctement les programmes de sécurité et de mesures sociales.
Les maisons de jeu doivent rendre accessibles à leur clientèle des informations compréhensibles concernant les risques du jeu, mettre à leur disposition des questionnaires d’auto-évaluation ainsi que des adresses de centres de consultation et de groupes d’entraide. Elles doivent exclure les personnes insolvables, celles qui engagent des mises sans rapport avec leur revenu ainsi que celles qui perturbent le bon déroulement des jeux. Les exclusions peuvent être volontaires ou imposées par la maison de jeu. Les auto-exclusions représentent actuellement environ 16 700 personnes au fichier des interdits pour 30 000 à 80 000 joueurs pathologiques supposés. À ces auto-exclusions qui portent sur l’ensemble des casinos de juridiction suisse, il faut ajouter le régime des dites « conventions de visites », qui permettent à un client de définir un nombre de passages et un montant de dépense mensuelle à ne pas dépasser pour un établissement donné.
Les maisons de jeu ont obligation légale de collaborer avec les centres spécialisés et de fournir des données à des fins de recherche sous l’égide de la Commission fédérale des maisons de jeu.
Pratiquement, on constate plusieurs difficultés. Pour en citer quelques unes : le plus souvent, le personnel de santé (psychologues) impliqué dans les programmes de mesures sociales est directement salarié par le casino. Les relations canton-confédération sont délicates ; s’ensuivent des difficultés de collaboration des casinos, qui dépendent de la Confédération, avec les lieux d’aide qui dépendent des cantons. Enfin, du point de vue clinique, la plupart des personnes interdites perçoivent leurs difficultés comme réglées par le seul fait de l’interdiction, et ne font pas suite aux propositions de consultation. Les outils de repérage ou de suivi des joueurs problématiques ne reposent pas sur des instruments et des procédures évalués scientifiquement.
Prévention dans les lieux où sont exploités des jeux de loteries
C’est depuis 1999 que la Loterie Romande offre le jeu « Tactilo » (loterie électronique) en plus de la loterie traditionnelle, et des paris sportifs. La formation des cafetiers (1/2 journée par an) est obligatoire. S’il n’y a pas à proprement parler d’obligations légales en matière de mesures sociales, 0,5 % du revenu brut des jeux doit être consacré à la prévention. Une charte stricte est à respecter avec contrôle des cafés par des « clients mystères » (sortes de détectives privés mandatés par la Loterie). Le retrait des « Tactilo » est décidé après un seul avertissement.
Une procédure judiciaire oppose cantons et Confédération, la CFMJ assimilant le Tactilo à une « machine à sous déguisée », dont le produit devrait être à ce titre taxé par la Confédération ; aux yeux des cantons au contraire, le Tactilo constitue la forme moderne de distribution des jeux de loterie (au même titre qu’un distributeur électronique de billets de train, en quelque sorte). La procédure judiciaire est toujours pendante, et le développement des « Tactilo » au-delà de la Suisse romande fait actuellement l’objet d’un moratoire.
Problèmes spécifiques posés par la prévention dans les café-restaurants
Outre la charte à respecter, les flyers de prévention à mettre en évidence dans le café, les cafetiers sont donc soumis à des cours de sensibilisation annuels obligatoires pour le maintien de la licence d’exploitation du Tactilo.
L’évaluation des mesures de prévention mise en place par la loterie est limitée par l’absence d’outils pour mesurer l’impact sur l’adressage des cas. Les joueurs les plus problématiques se plaignent de ne pas pouvoir se faire interdire, et les efforts en matière de modérateurs ne répondent pas à ce jour à un processus d’homologation par une instance indépendante. De fait, de par la proximité entre Loterie et Services économiques des cantons, les instances chargées de procéder à l’évaluation, fussent-elles dépendantes de l’Université, sont néanmoins suspectées de complaisance dans le cadre du conflit canton-Confédération pré-cité.
Autant que pour les casinos, la question de la part des joueurs pathologiques dans les recettes générées par les loteries est passée sous silence dans le débat public.
Autres actions de prévention
Citons notamment :
• les médias (nombreux débats dans le cadre de la mise en place de la nouvelle législation, notamment) ;
• la formation des intervenants socio-sanitaires ;
• les sites Internet : projet notamment de site « Stop-jeu » avec l’Institut de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de Genève sur le modèle du site international « Stop-tabac » ; projet de thérapie on-line (HUG) ; sites Internet de RNVP et du CJE, avec pour ce dernier l’existence d’un forum ;
• le développement d’une help-line avec mise en œuvre d’un numéro vert transfrontalier (RNVP) ;
• les groupes « Joueurs anonymes », mis en place avec le soutien de RNVP.
Dispositifs de formation
Les centres d’aide spécialisés mettent en place un certain nombre de formations en direction des croupiers, et des dépositaires de loterie électronique, afin de les sensibiliser à la problématique du jeu excessif. Par ailleurs, via des stages, des cours, des séminaires, les lieux spécialisés interviennent également dans la formation des intervenants socio-sanitaires, aux différents niveaux pré- ou post-gradués, et de formation continue.
Les besoins en termes d’information, sensibilisation et formation sont également importants pour d’autres professions que le socio-sanitaire ou les personnes intervenantes au sein de l’industrie du jeu. En Suisse romande, un certain nombre de projets ont été agendés pour une réalisation en 2008, dont une formation universitaire certifiante intitulée « Prévention du jeu excessif et action communautaire » organisée par le CJE et l’Université de Lausanne, ainsi que des actions de sensibilisation des milieux judiciaires et milieux scolaires mises en place dans le cadre de la coordination inter-cantonale Class-Grea
9
Rapport du GREA relatif au projet de coordination inter-cantonale sur le jeu excessif. Accessible sur le site Internet :
http://www.grea.ch/
.
Projets de recherche
Une politique de santé publique du jeu excessif crédible ne peut se concevoir sans bases scientifiques solides, notamment dans les domaines suivants :
• épidémiologie, coûts sociaux ;
• monitoring des demandes de soins (du type des enquêtes comme l’enquête européenne muti-ville pour les substances psycho-actives), permettant d’évaluer les actions de prévention secondaire et tertiaire ;
• validation des instruments psychométriques en français ;
• prévention de la suicidalité chez le joueur ;
• projets en pharmacologie et en neurosciences.
Cependant, les financements pour réaliser de telles études dans le contexte suisse demeurent insuffisants, non explicitement signalisés, du point de vue des fonds censés découler de la taxation des loteries. Par ailleurs, les instances affectées à la recherche scientifique (comme par exemple le Fonds national, ou encore d’autres fonds affectés à la recherche en milieu universitaire) sont réticentes à attribuer des fonds au jeu excessif, puisque le législateur en suisse s’est orienté vers un principe de taxation de l’industrie du jeu du type « pollueur-payeur ».
Questionnement et perspectives en matière de jeux d’argent dans le contexte romand et suisse
En matière clinique, on retient le décalage très important observé entre le fait de présenter un diagnostic de jeu pathologique d’une part, et le fait de se constituer effectivement demandeur de soins d’autre part. Il apparaît clairement que, plus encore peut-être que pour d’autres addictions, il y a lieu d’envisager de nouveaux canaux d’accès aux soins et à l’aide sociale, en sus du modèle de la traditionnelle consultation spécialisée.
En matière de prévention, un questionnement transversal concerne les conflits d’intérêts, entre opérateurs de jeux et intervenants politiques d’une part, et intervenants socio-sanitaires, d’autre part. Il apparaît particulièrement important d’avancer des mesures structurelles, susceptibles de contrecarrer des intérêts économiques, et de créer le contexte favorable au traitement de questions sensibles, comme celles liées aux limitations de la publicité, ou encore à la mise en place de procédure d’homologation des appareils de jeux.
Enfin, du point de vue du développement de l’addictologie, la question de fond de la nature « addictive » ou non du jeu excessif reste largement ouverte. Si l’offre socio-sanitaire en Suisse s’articule autour de la mobilisation des réseaux déjà actifs dans le champ des dépendances « traditionnelles », la question d’intégrer le jeu excessif à l’approche politique dite « des quatre piliers » est également en débat. À cet égard, les professionnels suisses attendent beaucoup du nouveau cadre de financement pérenne pour donner corps à l’émergence d’une politique de prévention du jeu excessif recentrée autour de la Santé publique, plutôt que autour des questions de police, ou encore des questions économiques.
Bibliographie
[1] bondolfi g,
osiek c,
ferrero f. Prevalence estimates of pathological gambling in Switzerland.
Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000;
101:473
-475

[2] bondolfi g,
osiek c,
ferrero f. Pathological gambling: An increasing and underestimated disorder.
Schweizer Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. 2002;
153:116
-122

[3] bondolfi g,
jermann f,
ferrero f,
zullino d,
osiek c. Prevalence of pathological gambling in Switzerland after the opening of casinos and the introduction of new preventive legislation.
Acta Psychiatrica Scandinavica. 2008;
117:236
-239

[4] besson j,
eap c,
rougemont-buecking a,
simon o,
nikolov c, et coll.. Addictions.
Revue Médicale Suisse. 2006;
2:479
-513

[5] davidson c,
maso p. La dépendance au jeu. Quand rien ne va plus.
Soins Infirmiers. 2003;
96:40
-43

[6] künzi k,
fritschi t,
egger t. Les jeux de hasard et la pathologie du jeu en Suisse : Étude empirique de la pratique et du développement des jeux de hasard, de la dépendance au jeu et de ses conséquences.
Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien. Bern:15 novembre;
2004;

[7] nau jy. Belle histoire entre dépendance et concurrence.
Revue Médicale. Suisse.
2006;
2: 2311p.

[8] petry nm. Pathological Gambling: Etiology, Comorbidity, and Treatments.
American Psychological Assoc. 2005;

[9] poenaru l,
simon o,
stücki s,
preisig m,
rihs m. Dépistage du jeu excessif par les professionnels de santé.
Alcoologie et addictologie. 2007;
29:155
-160

[10] simon o,
klila h,
besson h. Le point sur : les réponses médicales à l’addiction aux jeux d’argent.
Revue médicale. Suisse:2006;
2:S81S82

[11] smith g,
hodgins d,
williams d. Research and Measurement Issues in Gambling Studies.
Elsevier;
2007;

[12] stücki s,
rihs m. Prevalence of adult problem and pathological gambling between 2000 and 2005: An update.
J Gambl Stud. 2007;
23:245
-257

Olivier Simon
Centre du jeu excessif, Service de psychiatrie comunautaire,
Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne
Évaluation des approches de prévention
Avec la légalisation des jeux de hasard et d’argent dans la plupart des pays, plus d’individus jouent, plus d’individus joueront, plus d’individus développeront des problèmes de jeu. Les études révèlent qu’environ 80 % de la population générale s’est adonné à un jeu de hasard et d’argent au cours de la dernière année. Mais l’offre de jeu n’est pas le seul facteur qui influe sur le nombre de joueurs excessifs. Il s’agit d’un facteur en interaction avec plusieurs autres facteurs.
Prévalence du jeu pathologique ou excessif dans le monde
Aujourd’hui, il existe un consensus entre chercheurs pour évaluer à environ 1 % le taux de prévalence de joueurs pathologiques dans la population générale. Dans le monde, on trouve des taux de prévalence-année qui varient entre un peu moins de 1 % à 2 %.
Qu’en est-il en France ? Sur la base des données colligées dans les pays industrialisés, on pourrait s’attendre à trouver une prévalence qui se situerait autour de 1 à 2 % mais, aucune étude populationnelle n’a encore été menée. Il faudrait évaluer, non seulement la prévalence dans la population générale, mais également la prévalence en faisant une segmentation en fonction de :
• divers groupes spécifiques (les plus à risque) ;
• du type de jeux, car tous les jeux n’ont pas le même potentiel addictif.
Ces études doivent être faites dans une perspective longitudinale (4 ou 5 ans pour vérifier l’incidence). Actuellement, on constate que le jeu excessif est un phénomène transitoire et épisodique plutôt qu’un trouble chronique et progressif, tel que conceptualisé initialement.
Cause ou causes du jeu pathologique ou excessif
L’offre de jeu ou sa disponibilité a été souvent évoquée comme le facteur le plus significatif qui influence le nombre de joueurs excessifs. Si ce facteur est important, il n’est pas cependant le seul. Bien d’autres facteurs d’ordre personnel, environnemental et social interviennent en interaction avec l’offre de jeu. L’étude du jeu pathologique doit s’appuyer sur l’analyse des interactions entre ces facteurs.
Pièges cognitifs ou psychologie des jeux de hasard et d’argent
Un jeu de hasard et d’argent répond à plusieurs critères :
• l’individu doit réaliser qu’il mise de l’argent ou un objet de valeur ;
• cette mise est irréversible ;
• l’issue du jeu repose principalement (poker ou PMU) ou totalement (roulette) sur le hasard, un aspect totalement imprévisible. Tous les événements ont une probabilité égale d’être sélectionné. Il y a impossibilité de contrôler ou de prédire l’issue des événements.
Raisons qui motivent les joueurs à s’adonner à ces jeux
La première motivation est la possibilité de gagner de l’argent même si d’autres motivations interviennent comme l’excitation du jeu chez le joueur pathologique, liée à la vérification de la véracité de sa prédiction, qui lui donne le sentiment de sa puissance.
Mécanismes psychologiques à la base du jeu
Compte tenu que l’espérance de gain est toujours négative pour le joueur, pourquoi ces jeux sont-ils si populaires ? Plusieurs raisons sont souvent évoquées, mais la raison fondamentale est que pendant le jeu, la grande majorité des personnes perdent de vue, nient ou ne réalisent pas que l’issue du jeu repose sur la notion de hasard et de chance, sur la dimension d’aléatoire et de non prédiction.
Plusieurs facteurs viennent masquer la perception de la notion de hasard. Figurent entre autre le rôle actif du joueur, la perception de compétition, la fréquence de jeu, la complexité apparente du jeu.
Les joueurs entretiennent une perception erronée envers la notion de hasard (figure 5

). La principale erreur est de faire le lien entre des événements indépendants. L’analyse de ce que se disent les joueurs pendant le jeu montre qu’en majorité ils tentent de prédire le résultat. Mais comment peut-on prédire le hasard ?
Par exemple, après quatre lancers d’une pièce de monnaie, le cinquième lancer est totalement indépendant des quatre premiers car il y a à chaque lancer une chance sur deux d’avoir pile ou face. Or, les joueurs ont un dénominateur « cognitif » commun : pendant le jeu, ils tentent de prédire le résultat, ce qui est impossible car on ne peut pas prédire l’aléatoire. La différence majeure entre le joueur à faible risque et le joueur à haut risque, est que le premier va être capable de s’arrêter à un moment donné car il prend conscience qu’il ne peut contrôler le jeu tandis que le second a acquis la conviction de la véracité de ses pensées pourtant erronées.
Cette dimension de perception erronée n’est évidemment pas la seule mais elle est déterminante dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de prévention du jeu pathologique. Cette hypothèse est étayée par plusieurs études qui arrivent à la même conclusion.
Qu’est-ce qu’un joueur pathologique ?
Le joueur non problématique joue pour le plaisir, accepte de perdre l’argent misé, ne retourne pas se refaire et joue selon ses moyens. Le joueur pathologique a perdu le contrôle sur ses activités de jeu, ment, et à cause du jeu, rencontre des difficultés au travail, à la maison, avec ses amis, volera, et cherchera à se « refaire ». Un joueur excessif a perdu le contrôle de ses habitudes de jeu. De façon spécifique, il joue plus d’argent qu’il peut se permettre de perdre, plus longtemps qu’il peut se le permettre et plus souvent qu’il peut se le permettre.
Le jeu pathologique a été officiellement reconnu comme un trouble psychiatrique en 1980 (DSM-III).
Objectif pour les interventions en prévention
La base de la prévention du jeu excessif consiste à faire adopter une attitude responsable à l’égard du jeu et la prévention a pour cible les habitudes de jeu des individus.
Sur le plan conceptuel, la prévention du jeu excessif peut se faire par la réduction des méfaits associés à la pratique du jeu. L’objectif est de diminuer les conséquences négatives associées au jeu excessif ou pathologique. Cette approche ne concerne en aucune manière la modification du comportement individuel. Est-ce possible ? Nous ne le croyons pas.
Alex Blaszczynski (Université de Sydney), Howard Shaffer (Université Harvard) et moi-même avons développé un modèle dit « Modèle de Reno » qui constitue une base scientifique pour la prévention de l’apparition du jeu excessif (Blaszczynski et coll., 2004

). Ce modèle implique un « joueur responsable », soit il ne joue pas, soit il joue de manière modérée. Le jeu responsable est un ensemble de politiques et de mesures destinées à prévenir le développement d’habitudes de jeu excessives. L’objectif est d’une part de diminuer l’incidence du jeu excessif, c’est-à-dire l’apparition de nouveaux cas pendant une période donnée, d’autre part de cibler la prévalence de la prise en charge des gens « intoxiqués » par le jeu, domaine des spécialistes.
Un programme de jeu responsable doit considérer quatre catégories de joueurs (figure 6

) :
• ceux qui ne jouent pas sont à « faible risque » de développer une dépendance au jeu ;
• ceux qui jouent de façon récréative sont « à risque modéré » de développer une dépendance, la stratégie de jeu responsable doit insister sur le contrôle personnel ;
• les joueurs de la catégorie « risque modéré à risque élevé » sont des joueurs réguliers qui à terme jouent plus qu’ils n’en avaient l’intention, cependant ils n’ont pas encore le statut de joueur dépendant ;
• les joueurs à la droite de la catégorie « à haut risque » sont ceux qui ont développé une dépendance. Dans cette dernière catégorie, on trouve des joueurs qui ont de sérieux problèmes avec le jeu c’est-à-dire qui ont perdu le contrôle et dépensent de façon inconsidérée dans le jeu. Certains de ces joueurs entreprendront un traitement, stopperont ou réduiront volontairement leurs habitudes de jeu (« natural recovery process »). D’autres rejoindront des groupes d’entraide pour régler leur problème.
La stratégie du jeu responsable vise prioritairement les joueurs à haut risque avec comme objectif d’éviter qu’ils ne migrent vers la catégorie de joueurs dépendants. Un programme de jeu responsable reconnaît que ces joueurs ont besoin de l’aide d’un professionnel. Ce dernier doit d’abord évaluer le besoin d’assistance et diriger le joueur vers les spécialistes de la prise en charge car nombre de facteurs de risque entrent en interaction avec le jeu, ce qui nécessite un développement de mesures spécifiques pour prévenir ou traiter chaque sous-type de joueur.
S’il est démontré que la très large distribution des jeux dans la communauté a pour conséquence l’accessibilité et que cela contribue au développement de la dépendance, les différents partenaires se doivent de développer des mesures qui réduiront le risque de dépendance dans la communauté.
Responsabilité du joueur
Un programme visant à promouvoir le jeu responsable doit se fonder sur deux principes fondamentaux :
• la décision finale de jouer ou non appartient au joueur ;
• cette décision doit reposer sur un choix éclairé. L’individu doit avoir accès à toutes les informations pertinentes pour faire ce choix.
La signification première du jeu responsable prend racine dans le principe fondamental du choix éclairé. Une attitude coercitive est à proscrire si on veut promouvoir une pratique responsable d’une activité comme le jeu. Le choix de participer ou non est déterminé par une séquence de décisions prise par un individu qui a accès à une information appropriée et complète ; cette information lui fournissant les éléments nécessaires pour se faire une opinion.
Responsabilité de l’opérateur
L’opérateur a la responsabilité de fournir aux joueurs toutes les informations pertinentes pour leur permettre de faire un choix éclairé. L’opérateur (le gouvernement, une initiative privée…) doit donc participer activement à l’identification et à la diffusion de ces informations auprès du joueur. Fournir des informations sur les probabilités et le montant des gains n’est pas suffisant ; la recherche effectuée sur l’efficacité d’une prévention primaire, dans le champ de l’utilisation des substances nocives, indique que l’augmentation des connaissances et la prise de conscience sont insuffisantes pour changer le comportement. Ce qui doit être modifié ce sont les valeurs, les attitudes, les croyances influençant le comportement.
L’industrie du jeu n’a pas l’expertise du diagnostic et de la prise en charge des individus présentant une dépendance. En conséquence, elle doit avoir obligation d’établir des liens avec des services de support clinique. Pour garantir un choix informé, elle doit fournir le minimum d’informations nécessaires à une prise de décision du joueur en toute connaissance.
Cibles des interventions de prévention
Un programme de jeu responsable ou de prévention du risque a l’obligation de produire des effets significatifs chez les joueurs. L’intention pour un programme d’être responsable n’est pas suffisante. Il doit impérativement s’inscrire dans une perspective scientifique et bien définir la population ciblée :
• prévention primaire : diminution du nombre de nouveaux cas ou de l’incidence d’une maladie ;
• prévention secondaire : identification précoce et intervention efficace pour diminuer la prévalence de cas existants ;
• prévention tertiaire : accent mis sur la réhabilitation pour diminuer la sévérité des états négatifs associés à la maladie.
Le cadre conceptuel de la prévention primaire, secondaire et tertiaire inclut le traitement et la réhabilitation, ce qui conduit à beaucoup de confusion (Mrazek et Haggerty, 1994

). Nous avons choisi un cadre plus approprié pour la prévention et qui exclut les joueurs pathologiques. Ce programme se décline selon trois modalités en fonction de la population ciblée :
• les interventions préventives universelles : elles ciblent le public en général ou un groupe de la population qui n’a pas été identifié en fonction d’individus à risque ;
• les interventions préventives sélectives : elles intéressent les individus présentant des facteurs de risque (biologiques, psychologiques ou sociaux) qui les rendent plus vulnérables que la moyenne de la population de développer la maladie ;
• les interventions préventives dirigées : elles visent les individus à haut risque qui présentent certains symptômes de la maladie mais qui ne présentent pas encore tous les critères de la maladie pour le moment (Gordon, 1985

; Mrazek et Haggerty, 1994

).
Quelques exemples de programmes
Les programmes mis en place sont fonction de la population visée.
Interventions préventives universelles
• Semaine de sensibilisation (Awareness week) : elle est effectuée en partie avec des opérateurs ;
• Messages à la radio pour le public en général, précisant que le jeu peut être un problème ;
• « Spots » télévisés indiquant « Jouer dans la mesure de vos limites » en termes d’argent et de temps ;
• Articles dans les journaux expliquant que : « Le jeu est déterminé par le hasard, il est donc impossible de prédire l’issue » ;
• Programme « Lucky ».
Interventions préventives sélectives
• Mise sur pied d’un Centre du hasard au Casino de Montréal : le fonctionnement d’une machine à sous est expliqué en détails ;
• Programme de sensibilisation pour les employés de Casino ;
• Bars (bistrots) qui abritent des appareils de loterie-vidéo (ALV) (en France, le Rapido) ;
• Employés du PMU qui ne doivent pas inciter les joueurs à jouer plus.
Interventions préventives dirigées
• Services d’auto-exclusion (bonifié) qui accordent un suivi aux personnes concernées ;
• Repérage des patients qui présentent un autre trouble addictif (alcool, drogues) car ils sont plus à risque ;
• Ciblage des étudiants qui présentent un trouble de comportement grave à l’école.
Trois exemples de collaboration avec l’industrie du jeu
Trois exemples permettent d’illustrer la faisabilité d’un plan stratégique permettant d’obtenir des résultats et ayant une influence directe sur la politique publique, l’avancée de la science et la prise de décision dans l’industrie du jeu :
• les opérateurs de jeu engagent une étude pour proposer des changements dans la configuration des machines à sous (Blaszczynski, 2001

; Blaszczynski et coll., 2002

). Il s’agit de proposer des changements dans le design des machines de façon à diminuer la dépendance : réduction de la vitesse d’exécution des parties, mise en place d’accepteurs de billets de moins de 20 dollars, et d’accepteurs de pièces entre 1 et 10 dollars. Le changement n’a pas eu d’impact négatif sur les revenus des opérateurs de jeu et a reçu la satisfaction des joueurs ;
• programme de prévention « Au hasard du jeu » (Ladouceur et coll., 2004

). Sous forme d’un atelier de deux heures, il informe les détaillants sur la problématique du jeu excessif. Il répond aux questions suivantes : qu’est-ce que la chance et le hasard ? Y a-t-il un lien entre la non compréhension du concept de chance et le jeu excessif ? Comment reconnaître les symptômes de cette maladie ? Comment le détaillant peut-il intervenir ? Les résultats montrent que les détaillants développent une meilleure compréhension des problèmes de jeu, reconnaissent les principaux symptômes et se sentent plus capables d’intervenir auprès des joueurs excessifs en choisissant le moment le plus approprié. À long terme, les détaillants ayant suivi la formation rapportent qu’ils approchent plus souvent un joueur excessif et qu’ils discutent plus souvent des dispositifs d’aide qu’avant d’avoir suivi la formation ;
• projet d’étude sur la santé des employés de casino (Shaffer et coll., 1999

et 2002

). Réaliser une étude avec les employés de casino sur les problèmes de jeu permet de faire avancer la connaissance sur la prévention. Les employés de casino représentent une population qui a une très grande accessibilité au jeu et qui est très exposée au jeu. Ils jouent plus, fument et boivent plus et ont plus de troubles de l’humeur que la population générale. L’étude a montré que les employés changent leur comportement régulièrement ; de plus, ces changements tendent à diminuer le niveau du trouble plutôt qu’à l’augmenter ce qui est traditionnellement suggéré. Quelle est l’étendue de ce rétablissement et quels sont les déterminants qui influencent la transition d’un état problématique vers un état sans problème de jeu ou d’abstinence ? Y a-t-il une transition vers une association avec d’autres problèmes de santé ?
• À ma connaissance, en France, il y a peu de thérapeutes formés pour prendre en charge les joueurs pathologiques. Il importerait de mettre sur pied et de dispenser une formation spécialisée pour ces intervenants car le jeu présente des spécificités par rapport à d’autres addictions comme l’alcool, ou la drogue. Il serait urgent que le ministère de la Santé reconnaisse le jeu pathologique comme un trouble psychologique au même titre que l’alcoolisme et les autres dépendances et qu’il y accorde le soutien nécessaire.
En conclusion, il faut se poser plusieurs questions avant de développer et d’implanter un programme qui vise à réduire l’incidence du jeu pathologique :
• quel est l’objectif ? Que et qui voulons-nous atteindre ?
• comment évaluer le programme ?
• comment planifier la diffusion des résultats ?
• comment modifier la pratique et les méthodes de marketing selon les résultats obtenus (opérateurs), si un potentiel de gain est attendu pour les joueurs ?
• à qui s’adresse le programme ?
Bibliographie
[1] blaszczynski a. An evaluation of gaming machine design changes and gambling behaviour.
Gambling Industry Operators;
2001;

[2] blaszczynski a,
sharpe l,
walker m. Withdrawal and tolerance phenomenon in problem gambling.
Casino Community Benefit Fund;
2002;

[3] blaszczynski a, ladouceur
r, shaffer
hj. A science-based framework for responsible gambling: the Reno model.
J Gambl Stud. 2004;
20:301
-317

[4] ladouceur r,
boutin c,
doucet c,
dumont m,
provencher m, et coll.. Awareness promotion about excessive gambling among video lottery retailers.
J Gambl Stud. 2004;
20:181
-185

[5] gordon jr,
marlatt ga. Relapse Prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors.
Guilford Press;
New York:1985;

[6] mrazek pj,
haggerty rj. Reducing risks for mental disorders: Frontiers for preventive intervention research.
Washington:National Academy Press;
1994;

[7] shaffer hhj,
all mn. The natural history of gambling and drinking problems among casino employees.
J Soc Psychol. 2002;
142:405
-424

[8] shaffer hj,
vander bilt j, hall
mn. Gambling, drinking, smoking and other health risk activities among casino employees.
Am J Ind Med. 1999;
36:365
-378

[9] weissberg rp,
kumpfer kl,
seligman me. Prevention that works for children and youth. An introduction.
Am Psychol. 2003;
58:425
-432

Robert Ladouceur
Université Laval, Québec, Canada
Politique publique des jeux de hasard en Belgique
Exposer la meilleure manière de conduire une politique publique de jeux de hasard demanderait sans doute de longs développements. Aussi, cette présentation se limite-t-elle à deux aspects d’une politique efficace des jeux de hasard, même si la mise en place d’une politique cohérente, pertinente et efficiente des jeux de hasard nécessite une approche globale des autorités politiques.
Le premier point portera sur la procédure relative à la nouvelle saisine de la Commission des jeux de hasard par les victimes du jeu, nécessaire pour une meilleure protection du joueur et de leur entourage.
Le second traitera de la meilleure manière d’assurer à la Commission des jeux de hasard les moyens pour conduire une politique concrète de protection des joueurs du point de vue médical, juridique et social. Cette politique exige une indépendance effective de la Commission des jeux de hasard et une grande légitimité des décisions qu’elle prononce.
Nouvelle saisine
Le législateur a prévu plusieurs moyens pour protéger les joueurs des dangers de l’assuétude. Il a mis en place, entre autres, l’interdiction d’accéder aux salles de jeux, soit d’office, soit d’une manière volontaire, soit sur requête à l’égard des malades mentaux. L’interdiction légale vise les moins de 21 ans.
La loi interdit aux casinos et aux établissements de jeux de hasard de laisser l’accès aux policiers, huissiers, notaires et magistrats. Chaque semaine, les services publics fédéraux Intérieur et Justice actualisent les listes des personnes exerçant ces professions et les incorporent dans la banque de données Epis (Excluded Person Information System). Les exploitants ne connaissent pas les raisons d’un refus d’accès. Pour les policiers et les magistrats, cette interdiction d’accès a été imposée par le législateur afin que ces catégories professionnelles restent impartiales et insensibles à l’égard du monde du jeu et puissent remplir leurs obligations sans être soumises à une quelconque influence. Pour les notaires et les huissiers, la fréquentation des casinos et des salles de jeux paraît aux yeux du législateur une attitude contraire à la dignité de la profession. Mais il s’agit de protéger des dépositaires de fonds importants appartenant à des tiers. Cette obligation touchait 46 200 personnes en 2006.
Au 1er avril 2008, le nombre d’interdits judiciaires à l’égard des malades mentaux et d’interdits volontaires s’élève respectivement, à 30 614 pour les premiers et 7 978 pour les seconds. La progression annuelle des interdits volontaires est de 16 %.
En France, le nombre d’interdits volontaires est de 800 par mois environ. Mais il s’agit là d’une possibilité nouvelle inexistante auparavant
1
martignoni-hutin jp. Jeu pathologique, interdits de jeu, contrôle aux entrées dans les casinos… Spectaculaire augmentation du nombre « d’interdits de jeu » dans les casinos français. Note de recherche, Université Lumière Lyon France, 12 février 2007
.
Un facteur important de protection des joueurs est la possibilité de se faire interdire volontairement l’accès aux casinos et salles de jeux, en invoquant l’article 54§3 de la loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999. Cette interdiction d’accès est appelée à s’étendre aux jeux télévisés et aux jeux sur Internet. À terme, il faudrait une meilleure protection du joueur qui souvent apprend à jouer dans les débits de boissons.
Chaque fois qu’un client se présente dans un casino ou une salle de jeu, l’exploitant est obligé de consulter la banque de données Epis qui donne un feu vert ou rouge quant à la possibilité pour le candidat joueur de pénétrer ou non dans les lieux d’exploitation des jeux. Si l’exploitant laisse entrer une personne interdite dans son établissement et que la violation de cette interdiction est constatée par un contrôle des services de la Commission des jeux de hasard ou des polices locales, l’exploitant risque une sanction administrative qui pourrait être la suspension de l’effet de la licence ou le retrait de celle-ci.
En 2006, la banque Epis était chaque jour consultée 15 000 fois au moins, soit près de 500 000 fois par mois.
À titre d’indication, on constate 3 512 refus à l’égard des demandes d’accès dans les casinos et salles de jeux pour le mois de septembre 2007 :
• interdits volontaires (946 définitifs et 140 temporaires) ;
• malades mentaux ;
• 50 policiers en dehors de leur fonction ;
• 1 magistrat en dehors de sa fonction ;
• 51 moins de 21 ans.
Aussi, 1 893 personnes différentes se sont présentées dans ces lieux alors qu’elles y étaient interdites.
La différence entre le nombre de refus (3 512) et le nombre de personnes (1 893) qui se sont effectivement présentées à l’accueil d’un lieu de jeux s’explique par l’insistance des interdits à vouloir pénétrer dans les casinos. Aussi demandent-ils de réinterroger à nouveau la banque de données qui ne peut que confirmer le refus. On constate qu’en moyenne, la procédure de refus à l’entrée d’un casino exige 20 minutes de discussions entre l’exploitant des jeux et le candidat joueur avant que celui-ci ne quitte les lieux.
Pourquoi un tel système d’exclusion volontaire ?
La raison en est que le joueur se trouvant dans un état de profonde addiction, peut être qualifié de malade (qu’il suive ou non un traitement médical ou un accompagnement professionnel) et il accumule les dettes. Son addiction peut constituer un facteur de criminalité. En effet, devant une situation qui peut leur sembler inextricable ou insoluble, des joueurs désespérés peuvent être amenés à tuer pour s’emparer des sommes nécessaires pour continuer à jouer. Si cette solution de dernière extrémité est sans doute marginale, il est néanmoins fréquent que des escroqueries, vols ou autres soient commis pour jouer.
Les effets négatifs du jeu concernent certes le joueur mais également les créanciers et les membres de son entourage (parents, conjoints, voisins...). Les études estiment que chaque joueur à problèmes fait supporter les effets négatifs à une dizaine de personnes. Les chiffres cités par l’Institut Mat Talbot
2
Institut psychiatrique à Borgherout qui traite les joueurs compulsifs
qui estime que 20 000 joueurs sont gravement compulsifs et que ces joueurs ne sont pas intégrés dans la banque de données Epis, il faut alors estimer que c’est 200 000 personnes qui sont confrontées avec les difficultés occasionnées par des personnes qui sont poussées à jouer par une force intérieure à laquelle elles ne peuvent résister sans angoisse. Chacun connaît un voisin, un ami, un parent qui a aidé un joueur compulsif.
Le législateur pourrait introduire une nouvelle procédure pour tenter de compléter le système de base. On peut en effet identifier deux types de questions :
• le premier relatif aux personnes compétentes pour faire inscrire un joueur dans la base de donnée Epis ;
• le deuxième relatif à la réintégration du joueur dans le droit de jouer.
Les opérateurs français qui exploitent des casinos en Belgique (Barrière, Partouche) exécutent sans critique cet enregistrement des joueurs.
Les « clignotants »
Certains présidents, receveurs des CPAS
3
Centre public d’aide sociale : institution publique située dans chaque localité pour assurer l’aide sociale
et certains bourgmestres se sont inquiétés de la situation des personnes bénéficiaires d’une assistance financière ou d’une aide dans le cadre de la gestion de leur budget. Ils ont remarqué en effet que tout ou partie de l’argent destiné à subvenir aux besoins du joueur était en réalité affecté très souvent à la satisfaction de sa passion. Par voie de conséquence, l’argent public est en fait détourné des fins pour lesquelles il est censé être attribué.
Une autre source « d’alerte » est que les magistrats assortissent leurs conditions de libération de l’exigence que le délinquant sollicite son interdiction pour pouvoir bénéficier de la faveur d’un sursis probatoire, d’une libération provisoire conditionnelle alternative à un mandat d’arrêt, d’une libération conditionnelle, sans que cette condition d’interdiction d’accès ne puisse être imposée directement par l’autorité judiciaire. Très régulièrement, les compagnons, les époux, les parents, les enfants font des démarches auprès de la Commission pour que leurs amis, parents, esclaves du jeu soient interdits. Certains n’hésitent pas à imiter la signature d’une personne compulsive pour que celle-ci ne puisse plus entrer dans une salle de jeux. Ils le font sous la contrainte morale, parce qu’ils ne voient pas d’autres issues pour arrêter la dégringolade de leurs proches. Imiter une signature n’est pas une solution, car immanquablement, la confrontation survient avec le joueur ou avec la Commission. Fondamentalement, les relations sans doute déjà tendues entre les personnes concernées ne s’améliorent pas.
Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, il serait opportun que l’article 54§3 de la loi du 7 mai 1999 permette la saisine d’office ou sur plainte d’un tiers intéressé de la Commission des jeux de hasard en vue d’imposer une interdiction. Pour obtenir l’interdiction d’une personne compulsive, les proches, les bourgmestres, les CPAS, les médecins, les thérapeutes et l’autorité judiciaire devraient pouvoir saisir la Commission qui, avant de statuer d’une manière motivée, doit entendre l’intéressé.
La réintégration dans le droit de jouer
Les interdits volontaires de jeux peuvent à tout moment être réintégrés dans leurs droits de fréquenter une salle de jeux moyennant un préavis de trois mois. Très souvent, ils sont impatients de pouvoir replonger dans leur passion. Ils téléphonent pour être sûrs que leur demande est bien parvenue, pour se faire confirmer la date où ils pourront à nouveau accéder dans une salle de jeux. Ils piaffent devant la porte de leur établissement préféré et tentent d’y pénétrer parfois en se faisant passer pour un de leurs parents ou une autre personne. Bref, ils sont en état de manque et sont prêts à tout pour aboutir à leurs fins.
C’est à ce moment précisément qu’il serait opportun que la levée de l’interdiction soit examinée par la Commission qui devrait pouvoir s’entourer de tous les renseignements utiles y compris par un examen médical avant de statuer. Un examen médical peut se révéler utile. En effet, on observe fréquemment que des personnes, contre qui une procédure de protection a été diligentée – ne fussent que parce que, dans le passé, elles ont été gravement déprimées – s’étant présentées dans un établissement de jeux de classes I ou II, interrogent la Commission sur la raison du refus d’accès aux établissements. Ces personnes apprennent alors que le refus est une conséquence induite de la procédure menée par leurs proches pour les protéger, sur base d’un certificat rédigé par un homme de l’art.
Concurremment avec la procédure officielle décrite ci-dessus, les établissements de jeux gèrent des joueurs à problèmes qui bénéficient d’un plan d’accompagnement préconisé par l’exploitant. Ainsi, un joueur à problèmes est accompagné en fonction de son état par l’établissement. À titre d’exemple, le joueur est autorisé à entrer une fois par mois. Si son désir est fort, il est autorisé à pénétrer deux fois le premier mois mais il ne peut pas du tout entrer le mois suivant... Cette interdiction organisée sous des auspices commerciaux crée la confusion dans l’esprit des candidats interdits et dans l’esprit de leur famille qui s’imagine, à tort, que par cette démarche, les joueurs sont protégés sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit pas d’une interdiction totale et générale sur le territoire belge. Cette gestion de la compulsion des joueurs ne donne pas des résultats optimaux et est en quelque sorte le mariage de l’eau et du feu. Chacun doit rester dans son secteur d’activité.
En bref, l’article 54§3 pourrait être complété de la manière suivante :
« La commission prononce d’office ou sur requête de tout intéressé l’interdiction d’accès aux jeux de hasard des joueurs, après s’être entourée de tous renseignements utiles, y compris une audition. L’interdit peut demander la levée de l’interdiction à la commission qui se prononce après s’être entourée de tous renseignements utiles. Les deux décisions sont motivées et communiquées à l’intéressé et au requérant dans un délai de huit jours ».
Notons que d’autres améliorations de ce système de protection pourraient être envisagées comme l’échange des listes des interdits avec la France et les Pays-Bas. Un accord bilatéral suffit entre les États. En tout état de cause, les interdits volontaires peuvent étendre leur demande à un territoire plus vaste que celui de la Belgique et pour d’autres jeux que ceux offerts dans les casinos et les salles de jeux.
En outre, une saisine d’office pourrait également inclure l’interdiction d’accès des joueurs à l’égard desquels il existe des présomptions de tricherie. Actuellement, les tricheurs n’entrent pas en ligne de compte pour une interdiction dans le cadre de la banque Epis. Chaque accès est vérifié ; chaque jour, les informations relatives au fonctionnement des machines sont transmises à la Commission qui les examine actuellement par échantillon. Un traitement systématique informatisé s’imposerait aussi bien pour les machines que les jeux de table.
Besoin d’une réforme structurelle de la Commission des jeux de hasard et d’argent
La protection concrète au plan médical, juridique et social passe par une réforme structurelle de la Commission des jeux de hasard. L’article 61 de la loi du 7 mai 1999 stipule que « le Roi prend les mesures relatives à la rédaction d’un code de déontologie, à l’information du public des dangers inhérents au jeu ». Le principe d’une information active est acquis dans cet article qui contient les ferments d’une protection plus active du joueur par la mise en place de structures médicales, sociales et juridiques des victimes du jeu sous l’égide de la Commission des jeux de hasard.
Pour pouvoir mener une politique publique de jeu de hasard cohérente, il importe que l’autorité chargée de proposer et d’exécuter cette politique soit indépendante à l’égard de l’administration et puisse bénéficier d’une légitimité démocratique pour donner des avis sur la politique générale à suivre et prendre des décisions graves de conséquences dans les dossiers individuels. Les régulateurs sont en général de petites entités avec des compétences pointues qui s’accommodent mal des administrations géantes pour obtenir les moyens de fonctionnement et en personnel nécessaires pour remplir leurs tâches.
L’objectif est la recherche et le maintien d’équilibres requis entre l’intérêt général, y compris l’ordre public et le bon fonctionnement des opérateurs de jeux. Le régulateur a l’obligation d’assurer la mise en place d’un système qui garantisse une protection efficace des joueurs. Le régulateur apparaît à l’intersection de deux sources du droit économique – sources privées et sources publiques – et à la réaction des pouvoirs publics face aux pouvoirs privés. Aussi, le Parlement a-t-il souvent choisi de placer les régulateurs (Commission de la protection de la vie privée, Comité P
4
Comité P : Comité permanent de contrôle des services de police
, Comité R
5
Comité R : Comité permanent de contrôle des services de renseignements
, les notaires, le conseil supérieur de la Justice…) sous son autorité afin de pouvoir donner des impulsions, d’en assurer l’indépendance par rapport à la tutelle administrative et financière, tout en exerçant lui-même cette mission. Personne d’autre que le Parlement ne peut mieux contrôler l’usage des rétributions perçues par la Commission des jeux de hasard, versées sur un fonds budgétaire spécial réservé pour l’installation, le personnel et le fonctionnement de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat. Le fonctionnement de la Commission inclut la protection dynamique des victimes du jeu et donc l’affectation de moyens, sous un contrôle scientifique, pour parvenir à cet objectif. Ce fonds budgétaire a réuni plus de 10 millions d’euros de réserves qui doivent être affectées au bon fonctionnement de ce régulateur. Affecter cet argent à d’autres fins n’est pas possible, car les rétributions deviendraient alors des impôts. Or, la rétribution sert à couvrir des services rendus aux différents secteurs du jeu.
On doit considérer que, ne pas affecter ce montant au bon fonctionnement de la Commission constitue un détournement de la finalité de la perception de ces rétributions. Le Trésor bénéficie d’un prêt gratuit à charge des opérateurs. Compte tenu que le budget de la Commission des jeux de hasard ne bénéficie pas d’une gestion séparée, les mécanismes budgétaires généraux impliquent que les rétributions arrivent dans une manne commune, dont le gouvernement peut disposer, et ne sont donc pas directement consacrées à la politique des jeux. Ce mécanisme hypothèque une politique de contrôle strict des opérateurs, ainsi que la réussite des projets scientifiques de nature à donner une meilleure compréhension et une meilleure transparence du marché du jeu. Ce fonds financier doit être affecté à une amélioration de la politique du jeu et à une meilleure approche du traitement médical des joueurs lorsque ceux-ci ont touché le « fond ».
Qui d’autre que le Parlement peut être un meilleur garant d’une telle utilisation des rétributions votées par lui ?
En conclusion, la protection du joueur est essentielle pour le joueur compulsif qui a perdu son libre arbitre, pour son entourage direct qui supporte les effets collatéraux du jeu et pour la société qui supporte le coût social. Il ne faut pas perdre de vue non plus la criminalité (crimes, faux, détournement, vols...) induite pour satisfaire le besoin d’argent pour jouer.
Si le législateur veut renforcer cet aspect, la tâche est immense. Il existe une véritable attente du citoyen pour qu’un débat de société naisse devant l’explosion de l’offre de jeux de hasard. La protection du joueur est la clef de voûte de la politique cohérente et publique des jeux dont les volets éthiques, juridiques, économiques et techniques doivent être abordés avec des outils scientifiques. Il est impératif que la politique publique des jeux de hasard soit considérée comme une matière prioritaire aussi bien pour les autorités parlementaires, gouvernementales et judiciaires. Ce choix implique que le parlement légifère en matière de jeux, que le gouvernement propose et exécute un plan de sécurité nationale et que les autorités judiciaires tranchent les conflits générés par les initiatives qui ne rencontrent pas la politique définie par le parlement.
Etienne Marique
Magistrat, Président de la Commission des jeux de hasard, Belgique



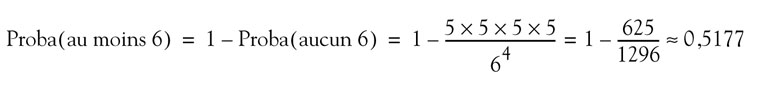



 façons de tremper trois doigts dans un pot de confiture.
façons de tremper trois doigts dans un pot de confiture.






 combinaisons dont : 260 624 combinaisons gagnantes soit environ :
combinaisons dont : 260 624 combinaisons gagnantes soit environ : chance(s) de gagner… comme à la Loterie Royale sous Louis XVI.
chance(s) de gagner… comme à la Loterie Royale sous Louis XVI.

 ), j’avais consacré une des deux parties de l’ouvrage à la drogue et à ses mutations, l’autre partie étant consacrée aux mutations de la télévision, elle-même objet hautement addictif, paraît-il. M’intéressaient tout particulièrement la crise de la loi via l’extension de la préoccupation aux médicaments psychotropes et les addictions sans drogues, c’est-à-dire centrées sur le comportement. Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de drogues, pas de substances, qu’il n’y a pas d’objet, ces comportements investissant justement sur toutes sortes d’objets, nourriture, jeux, sexe, sport… Progressivement, la toxicomanie a été redécrite sous un nouveau point de vue, celui des addictions (après que l’on eut parlé de « nouvelles addictions »), point de vue relativisant la dimension pénale de la drogue et la réification de l’interdit. Ce n’est plus la loi qui fait la différence pertinente. La loi interdisait la consommation de produits, pas les comportements addictifs. L’addiction, la toxicomanie, était seconde par rapport à l’interdit de l’acte.
), j’avais consacré une des deux parties de l’ouvrage à la drogue et à ses mutations, l’autre partie étant consacrée aux mutations de la télévision, elle-même objet hautement addictif, paraît-il. M’intéressaient tout particulièrement la crise de la loi via l’extension de la préoccupation aux médicaments psychotropes et les addictions sans drogues, c’est-à-dire centrées sur le comportement. Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de drogues, pas de substances, qu’il n’y a pas d’objet, ces comportements investissant justement sur toutes sortes d’objets, nourriture, jeux, sexe, sport… Progressivement, la toxicomanie a été redécrite sous un nouveau point de vue, celui des addictions (après que l’on eut parlé de « nouvelles addictions »), point de vue relativisant la dimension pénale de la drogue et la réification de l’interdit. Ce n’est plus la loi qui fait la différence pertinente. La loi interdisait la consommation de produits, pas les comportements addictifs. L’addiction, la toxicomanie, était seconde par rapport à l’interdit de l’acte. ). Dans les années 1970 dans la psychopathologie : addiction et dépression sont en relation causale ou, à tout le moins, comorbide, l’addiction étant conçue comme une autothérapie de la dépression. Une petite dizaine d’années plus tard, l’addiction devient une catégorie générale : on va parler d’addiction positive (c’est le support social) et d’addiction négative, la première favorisant l’autonomie individuelle, la seconde l’annihilant. L’extension du concept est telle qu’il ne désigne plus nécessairement une pathologie. Avec l’addiction, il me semble qu’il y a une double dimension à prendre en compte : le couple stimuler/calmer et le couple s’attacher/se désattacher.
). Dans les années 1970 dans la psychopathologie : addiction et dépression sont en relation causale ou, à tout le moins, comorbide, l’addiction étant conçue comme une autothérapie de la dépression. Une petite dizaine d’années plus tard, l’addiction devient une catégorie générale : on va parler d’addiction positive (c’est le support social) et d’addiction négative, la première favorisant l’autonomie individuelle, la seconde l’annihilant. L’extension du concept est telle qu’il ne désigne plus nécessairement une pathologie. Avec l’addiction, il me semble qu’il y a une double dimension à prendre en compte : le couple stimuler/calmer et le couple s’attacher/se désattacher. ). Le nombre de personnes touchées par ces maux et leurs coûts pour la société sont démesurés (dans le Livre vert, 3 à 4 % du PIB), ce qui en fait un domaine pathologique majeur aujourd’hui, à côté du cancer ou des maladies cardiovasculaires, mais en plus coûteux.
). Le nombre de personnes touchées par ces maux et leurs coûts pour la société sont démesurés (dans le Livre vert, 3 à 4 % du PIB), ce qui en fait un domaine pathologique majeur aujourd’hui, à côté du cancer ou des maladies cardiovasculaires, mais en plus coûteux. ).
). ). De quoi nous parle-t-on dans tous ces rapports sinon de nos idéaux sociaux ? Une vie réussie aujourd’hui implique la santé mentale : c’est ce qui fait le caractère consensuel de la notion (il n’y a pas de santé sans santé mentale).
). De quoi nous parle-t-on dans tous ces rapports sinon de nos idéaux sociaux ? Une vie réussie aujourd’hui implique la santé mentale : c’est ce qui fait le caractère consensuel de la notion (il n’y a pas de santé sans santé mentale). ). Les notions de prestige, de respect ou d’attente sont des concepts sociaux, ils impliquent des coutumes, des mœurs, des institutions, un esprit commun que j’entends sur le mode de l’esprit des lois de Montesquieu.
). Les notions de prestige, de respect ou d’attente sont des concepts sociaux, ils impliquent des coutumes, des mœurs, des institutions, un esprit commun que j’entends sur le mode de l’esprit des lois de Montesquieu. ).
). ). Dans le couple de partenaires que forment le psychanalyste et son patient, l’action se déroule de telle sorte que ce dernier soit non l’agent immédiat, mais l’agent principal de l’action, en l’occurrence de l’action de changer. Cela se voit parfaitement à la conception de la guérison que Freud explique à la dernière page des « Études sur l’hystérie » en caractérisant le genre de changement qui s’opère chez le patient : « Vous trouverez grand avantage, en cas de réussite, à transformer votre misère hystérique en malheur banal. Avec un psychisme devenu sain, vous pourrez lutter contre ce dernier »3
(Freud et Breuer, 1894
). Dans le couple de partenaires que forment le psychanalyste et son patient, l’action se déroule de telle sorte que ce dernier soit non l’agent immédiat, mais l’agent principal de l’action, en l’occurrence de l’action de changer. Cela se voit parfaitement à la conception de la guérison que Freud explique à la dernière page des « Études sur l’hystérie » en caractérisant le genre de changement qui s’opère chez le patient : « Vous trouverez grand avantage, en cas de réussite, à transformer votre misère hystérique en malheur banal. Avec un psychisme devenu sain, vous pourrez lutter contre ce dernier »3
(Freud et Breuer, 1894 ), vous pourrez être l’agent de votre propre changement.
), vous pourrez être l’agent de votre propre changement. ). C’est une condition pour ouvrir l’espace des possibles dans la socialité de l’autonomie. La contrainte physique, dans ce contexte, est un moyen d’offrir des possibilités.
). C’est une condition pour ouvrir l’espace des possibles dans la socialité de l’autonomie. La contrainte physique, dans ce contexte, est un moyen d’offrir des possibilités. ). Car c’est à une transformation de l’égalité à laquelle nous avons affaire, une égalité de l’autonomie qui ne consiste pas seulement à donner des chances égales dans une temporalité statique, mais à offrir des opportunités dans une temporalité dynamique, une temporalité de trajectoire, plaçant de multiples manières les individus dans des situations leur permettant ou les obligeant d’être les agents principaux de leur propre changement.
). Car c’est à une transformation de l’égalité à laquelle nous avons affaire, une égalité de l’autonomie qui ne consiste pas seulement à donner des chances égales dans une temporalité statique, mais à offrir des opportunités dans une temporalité dynamique, une temporalité de trajectoire, plaçant de multiples manières les individus dans des situations leur permettant ou les obligeant d’être les agents principaux de leur propre changement. ). Or, c’est justement à la généralisation de ces métiers, dont la pratique consiste à faire en sorte que chacun soit l’agent de son propre changement, à laquelle nous avons assisté en une trentaine d’années, et non à un affaiblissement du lien social, à mesure que les valeurs de l’autonomie imprégnaient l’ensemble de la vie sociale. Le changement de statut de la souffrance psychique bien au-delà de la psychopathologie, c’est-à-dire son érection en raison d’agir sur un problème qui est toujours relationnel, voilà l’épicentre de la généralisation de ces métiers où l’autonomie est à la fois le moyen et le but de l’action.
). Or, c’est justement à la généralisation de ces métiers, dont la pratique consiste à faire en sorte que chacun soit l’agent de son propre changement, à laquelle nous avons assisté en une trentaine d’années, et non à un affaiblissement du lien social, à mesure que les valeurs de l’autonomie imprégnaient l’ensemble de la vie sociale. Le changement de statut de la souffrance psychique bien au-delà de la psychopathologie, c’est-à-dire son érection en raison d’agir sur un problème qui est toujours relationnel, voilà l’épicentre de la généralisation de ces métiers où l’autonomie est à la fois le moyen et le but de l’action.







 ).
). ). Et ce, en tant que « la punition est plutôt connotée à la justice humaine : la loi punit, sanctionne un délit. Le châtiment, lui, est plutôt d’ordre moral. Il n’implique pas forcément la faute réelle ; il répond au contraire au sentiment de culpabilité qui, lui aussi, est moral ».
). Et ce, en tant que « la punition est plutôt connotée à la justice humaine : la loi punit, sanctionne un délit. Le châtiment, lui, est plutôt d’ordre moral. Il n’implique pas forcément la faute réelle ; il répond au contraire au sentiment de culpabilité qui, lui aussi, est moral ». ).
). ), l’expression « Spielsucht » – littéralement l’addiction au jeu – semble prendre le pas sur celles de « Spielzwang » (compulsion du jeu) et « Spielwut » (fureur du jeu, une expression un peu datée mais intéressante car renvoyant à la frénésie, au « craving »). En outre, en considérant (à partir d’une digression sur la nouvelle de S. Zweig, « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ») le jeu comme un succédané de la masturbation, cette addiction originaire (« Ursucht »), Freud le rapproche de facto des toxicomanies classiques, au sujet desquelles il avait émis cette hypothèse en 1897.
), l’expression « Spielsucht » – littéralement l’addiction au jeu – semble prendre le pas sur celles de « Spielzwang » (compulsion du jeu) et « Spielwut » (fureur du jeu, une expression un peu datée mais intéressante car renvoyant à la frénésie, au « craving »). En outre, en considérant (à partir d’une digression sur la nouvelle de S. Zweig, « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ») le jeu comme un succédané de la masturbation, cette addiction originaire (« Ursucht »), Freud le rapproche de facto des toxicomanies classiques, au sujet desquelles il avait émis cette hypothèse en 1897. . Il affiche de surcroît l’ambition de préciser les soubassements de la conduite de jeu et de dresser un constat des diverses variantes typologiques de joueurs.
. Il affiche de surcroît l’ambition de préciser les soubassements de la conduite de jeu et de dresser un constat des diverses variantes typologiques de joueurs. ), se définissant par la mise en acte d’une séquence toujours identique, où la rébellion contre la loi parentale se traduit directement, chez le joueur, par une « rébellion latente contre la logique ». Et, selon Bergler, le joueur est à considérer comme un névrosé animé par un désir inconscient de perdre (« désir de gagner dynamiquement sans effet »), gouverné par le masochisme moral, un besoin inconscient d’être puni après avoir fait montre d’une « pseudo-agressivité » teintée de mégalomanie infantile.
), se définissant par la mise en acte d’une séquence toujours identique, où la rébellion contre la loi parentale se traduit directement, chez le joueur, par une « rébellion latente contre la logique ». Et, selon Bergler, le joueur est à considérer comme un névrosé animé par un désir inconscient de perdre (« désir de gagner dynamiquement sans effet »), gouverné par le masochisme moral, un besoin inconscient d’être puni après avoir fait montre d’une « pseudo-agressivité » teintée de mégalomanie infantile. ). Lequel s’articule autour d’une séquence en trois temps : « je me créerai le désir inconscient d’être rejeté par la mère », « je ne serai pas conscient de mon désir d’être rejeté », « je m’apitoierai sur moi-même en un plaisir masochique ». Ces « masochistes psychiques » se caractérisent par une dilection particulière pour « l’humiliation, la défaite, le refus ».
). Lequel s’articule autour d’une séquence en trois temps : « je me créerai le désir inconscient d’être rejeté par la mère », « je ne serai pas conscient de mon désir d’être rejeté », « je m’apitoierai sur moi-même en un plaisir masochique ». Ces « masochistes psychiques » se caractérisent par une dilection particulière pour « l’humiliation, la défaite, le refus ». ). Grammaire renvoyant à la spécificité du masochiste de se mettre dans une position particulière… « se faire objet ».
). Grammaire renvoyant à la spécificité du masochiste de se mettre dans une position particulière… « se faire objet ». ; Assoun, 1999
; Assoun, 1999 ).
). ) que certains comportements impulsifs répétitifs se caractérisaient par une contrainte proche de celle retrouvée dans la dépendance à l’alcool et aux drogues. Pour Fenichel, les toxicomanies représentent du reste « les types les plus nets d’impulsions », le mot « addiction » faisant allusion pour lui à « l’urgence du besoin et à l’insuffisance finale de toute tentative de le satisfaire ». Il dispose les addictions à la drogue dans le cadre des « névroses impulsives », qu’il oppose aux névroses de compulsion. Et s’attache à différencier impulsions et compulsions, qui ont en commun le sentiment du patient d’être obligé d’exécuter l’action pathologique. Cependant, les impulsions sont – ou promettent d’être – plaisantes, elles ne sont pas vécues à l’instar des compulsions sur un mode pénible, mais comme « syntones » du moi et non pas étrangères à lui.
) que certains comportements impulsifs répétitifs se caractérisaient par une contrainte proche de celle retrouvée dans la dépendance à l’alcool et aux drogues. Pour Fenichel, les toxicomanies représentent du reste « les types les plus nets d’impulsions », le mot « addiction » faisant allusion pour lui à « l’urgence du besoin et à l’insuffisance finale de toute tentative de le satisfaire ». Il dispose les addictions à la drogue dans le cadre des « névroses impulsives », qu’il oppose aux névroses de compulsion. Et s’attache à différencier impulsions et compulsions, qui ont en commun le sentiment du patient d’être obligé d’exécuter l’action pathologique. Cependant, les impulsions sont – ou promettent d’être – plaisantes, elles ne sont pas vécues à l’instar des compulsions sur un mode pénible, mais comme « syntones » du moi et non pas étrangères à lui. ) : cette dimension d’égo-syntonie (où l’action est conforme au « désir conscient immédiat ») promue par Fenichel semble un peu approximative pour rendre compte du processus « ludopathique ». Et Bergler fait montre en la matière de davantage de subtilité, en décrivant le sentiment d’étrangeté (« feeling of uncanniness » se rapproche du Unheimlich freudien, de l’inquiétante étrangeté) qui saisit le joueur dans sa praxis ludique, ou même lorsqu’il laisse ses pensées dériver autour du jeu.
) : cette dimension d’égo-syntonie (où l’action est conforme au « désir conscient immédiat ») promue par Fenichel semble un peu approximative pour rendre compte du processus « ludopathique ». Et Bergler fait montre en la matière de davantage de subtilité, en décrivant le sentiment d’étrangeté (« feeling of uncanniness » se rapproche du Unheimlich freudien, de l’inquiétante étrangeté) qui saisit le joueur dans sa praxis ludique, ou même lorsqu’il laisse ses pensées dériver autour du jeu. ).
). ) à modifier l’équation freudienne de la compulsion à perdre du joueur : « s’il ne joue certes pas pour gagner, il ne joue pas non plus pour systématiquement perdre, mais pour les instants vertigineux où tout – le gain absolu, la perte ultime – devient possible ». Lorsque le hasard devient rencontre, « tuchè »…
) à modifier l’équation freudienne de la compulsion à perdre du joueur : « s’il ne joue certes pas pour gagner, il ne joue pas non plus pour systématiquement perdre, mais pour les instants vertigineux où tout – le gain absolu, la perte ultime – devient possible ». Lorsque le hasard devient rencontre, « tuchè »… ), et non pleinement propriétaire, en mesure de disposer de la chose… Ainsi, tout se passe comme s’il lui manquait, subjectivement parlant, le troisième attribut du droit de propriété sur une chose… au nom latin si évocateur, l’abusus (« utilisation jusqu’à épuisement »).
), et non pleinement propriétaire, en mesure de disposer de la chose… Ainsi, tout se passe comme s’il lui manquait, subjectivement parlant, le troisième attribut du droit de propriété sur une chose… au nom latin si évocateur, l’abusus (« utilisation jusqu’à épuisement »). ). Défier le hasard et obtenir ainsi de l’Autre réponse et reconnaissance ! Si la chance de décrocher la timbale est infime, en revanche, « … si je gagne, c’est que je ne suis pas un quelconque au regard de l’Autre, c’est que j’y ai une place d’élection, qu’il m’envoie soudain un joker qui modifie radicalement la donne initiale ». Cette « maldonne » initiale que conteste le joueur avec obstination dans sa quête d’un joker !
). Défier le hasard et obtenir ainsi de l’Autre réponse et reconnaissance ! Si la chance de décrocher la timbale est infime, en revanche, « … si je gagne, c’est que je ne suis pas un quelconque au regard de l’Autre, c’est que j’y ai une place d’élection, qu’il m’envoie soudain un joker qui modifie radicalement la donne initiale ». Cette « maldonne » initiale que conteste le joueur avec obstination dans sa quête d’un joker ! ), Melman vient mettre en exergue cet élément essentiel de l’attitude du joueur : « récuser la donne que chacun de nous tient du grand Autre, rôle sur la scène du monde, identité sexuelle… ». Au demeurant, poursuit cet auteur, si l’on s’en tient au social, il est connu que ceux qui jouent le plus sont des chômeurs… ceux qui n’y ont – précisément – rien à perdre !
), Melman vient mettre en exergue cet élément essentiel de l’attitude du joueur : « récuser la donne que chacun de nous tient du grand Autre, rôle sur la scène du monde, identité sexuelle… ». Au demeurant, poursuit cet auteur, si l’on s’en tient au social, il est connu que ceux qui jouent le plus sont des chômeurs… ceux qui n’y ont – précisément – rien à perdre ! ) lorsque la confrontation à la loi est intenable… Bref, changer les règles du jeu, nier le caractère autodestructeur de la conduite, avec le spectacle d’un meurtre signé plutôt que celui d’un suicide maquillé…
) lorsque la confrontation à la loi est intenable… Bref, changer les règles du jeu, nier le caractère autodestructeur de la conduite, avec le spectacle d’un meurtre signé plutôt que celui d’un suicide maquillé… ), un « joueur pathologique » sur quatre est amené à être confronté à la justice (si l’on totalise les comparutions civiles et pénales), ce qui dénote au passage l’ampleur du phénomène si l’on retient avec cet auteur une estimation globale du nombre des joueurs compulsifs adultes (aux États-Unis d’Amérique) à un million de personnes (il y a deux décennies).
), un « joueur pathologique » sur quatre est amené à être confronté à la justice (si l’on totalise les comparutions civiles et pénales), ce qui dénote au passage l’ampleur du phénomène si l’on retient avec cet auteur une estimation globale du nombre des joueurs compulsifs adultes (aux États-Unis d’Amérique) à un million de personnes (il y a deux décennies).










 ). Mais le jeu vidéo peut aussi favoriser l’isolement et la déscolarisation. Il ne correspond plus à la tentative d’organiser des expériences anciennes et d’en vivre de nouvelles. Il n’est plus qu’une façon de tenter d’échapper à des angoisses plus ou moins catastrophiques. Certaines sont liées aux bouleversements propres à l’adolescence, mais la plupart datent de la petite enfance. Car l’ordinateur a le pouvoir de réactiver la relation première qu’un enfant a établie avec son environnement : que ses premières années aient été satisfaisantes, et il pourra profiter pleinement des jeux vidéo. Si au contraire, l’histoire précoce d’un jeune a été marquée par des sentiments de frustration narcissique et d’insécurité, le risque est qu’il tente d’en guérir avec les jeux vidéo, au risque de réduire de plus en plus son monde à son jeu, sans vraiment en tirer de véritable satisfaction, jusqu’à un isolement social qui peut être très grave (Tisseron, 2008).
). Mais le jeu vidéo peut aussi favoriser l’isolement et la déscolarisation. Il ne correspond plus à la tentative d’organiser des expériences anciennes et d’en vivre de nouvelles. Il n’est plus qu’une façon de tenter d’échapper à des angoisses plus ou moins catastrophiques. Certaines sont liées aux bouleversements propres à l’adolescence, mais la plupart datent de la petite enfance. Car l’ordinateur a le pouvoir de réactiver la relation première qu’un enfant a établie avec son environnement : que ses premières années aient été satisfaisantes, et il pourra profiter pleinement des jeux vidéo. Si au contraire, l’histoire précoce d’un jeune a été marquée par des sentiments de frustration narcissique et d’insécurité, le risque est qu’il tente d’en guérir avec les jeux vidéo, au risque de réduire de plus en plus son monde à son jeu, sans vraiment en tirer de véritable satisfaction, jusqu’à un isolement social qui peut être très grave (Tisseron, 2008). ). Il en résulte l’insécurité, la peur et le sentiment d’abandon.
). Il en résulte l’insécurité, la peur et le sentiment d’abandon. ). L’adolescent laisse passer l’heure du repas, s’empêche d’aller aux toilettes, est à la limite de l’effondrement : mais son avatar, lui, ne s’effondre jamais !
). L’adolescent laisse passer l’heure du repas, s’empêche d’aller aux toilettes, est à la limite de l’effondrement : mais son avatar, lui, ne s’effondre jamais ! ). Le risque est alors que ces adolescents, qui ne peuvent ni contenir ni gérer leurs émotions, les remplacent par des sensations. Les sensations, en effet, sont toujours éprouvées et elles peuvent en outre être maîtrisées. L’adolescent qui est dans cette situation cherche alors à vivre des sensations de plus en plus extrêmes. Son engagement dans le jeu peut constituer une modalité de défense contre l’angoisse de ne rien éprouver et les sensations qu’il cherche sont un moyen pour lui de tenter de pallier à cette angoisse.
). Le risque est alors que ces adolescents, qui ne peuvent ni contenir ni gérer leurs émotions, les remplacent par des sensations. Les sensations, en effet, sont toujours éprouvées et elles peuvent en outre être maîtrisées. L’adolescent qui est dans cette situation cherche alors à vivre des sensations de plus en plus extrêmes. Son engagement dans le jeu peut constituer une modalité de défense contre l’angoisse de ne rien éprouver et les sensations qu’il cherche sont un moyen pour lui de tenter de pallier à cette angoisse. ) a décrit cette situation sous le nom d’accordage affectif. Elle se caractérise par le fait que l’adulte interagit en empathie avec l’enfant en lui servant d’écho et de miroir. Mais l’accordage affectif est moins une forme d’imitation que de transmodalité. Daniel Stern cite par exemple la situation dans laquelle un bébé de neuf mois assis devant sa mère secoue de haut en bas un hochet, et où celle-ci se met à secouer la tête de haut en bas en suivant de près le rythme des mouvements du bras de son fils. Dans cette situation, la modalité d’expression utilisée par la mère – ou, si on préfère, le canal – est différent de celle qu’utilise le nourrisson. Ce qui est imité, ce n’est pas en soi le comportement de l’autre, mais plutôt son état émotionnel, qui se trouve traduit dans une autre modalité sensorielle. Un enfant qui n’a pas trouvé dans son environnement un accordage affectif suffisant peut tenter, à l’adolescence, de le construire par ordinateur interposé. Il se tourne alors vers celui-ci comme vers un espace qui lui procure un miroir de ses gestes, mais aussi de ses pensées et émotions. Il y cherche un miroir d’approbation. Il appuie par exemple de façon répétitive sur une touche, et le personnage qu’il anime bondit en rythme, ou bien il tire avec une arme bruyante de telle façon que le « bam-bam » des coups de feu correspond au mouvement de son doigt ou de sa main. Daniel Stern insiste sur le fait que la qualité d’un accordage contribue au sentiment de trouver un objet « nourrissant » susceptible de maintenir la vie psychique en organisant la résonance d’états affectifs.
) a décrit cette situation sous le nom d’accordage affectif. Elle se caractérise par le fait que l’adulte interagit en empathie avec l’enfant en lui servant d’écho et de miroir. Mais l’accordage affectif est moins une forme d’imitation que de transmodalité. Daniel Stern cite par exemple la situation dans laquelle un bébé de neuf mois assis devant sa mère secoue de haut en bas un hochet, et où celle-ci se met à secouer la tête de haut en bas en suivant de près le rythme des mouvements du bras de son fils. Dans cette situation, la modalité d’expression utilisée par la mère – ou, si on préfère, le canal – est différent de celle qu’utilise le nourrisson. Ce qui est imité, ce n’est pas en soi le comportement de l’autre, mais plutôt son état émotionnel, qui se trouve traduit dans une autre modalité sensorielle. Un enfant qui n’a pas trouvé dans son environnement un accordage affectif suffisant peut tenter, à l’adolescence, de le construire par ordinateur interposé. Il se tourne alors vers celui-ci comme vers un espace qui lui procure un miroir de ses gestes, mais aussi de ses pensées et émotions. Il y cherche un miroir d’approbation. Il appuie par exemple de façon répétitive sur une touche, et le personnage qu’il anime bondit en rythme, ou bien il tire avec une arme bruyante de telle façon que le « bam-bam » des coups de feu correspond au mouvement de son doigt ou de sa main. Daniel Stern insiste sur le fait que la qualité d’un accordage contribue au sentiment de trouver un objet « nourrissant » susceptible de maintenir la vie psychique en organisant la résonance d’états affectifs.







 Élevée
Élevée  Faible
Faible  Moyenne
Moyenne ). La dépense par habitant était de l’ordre de 400 € en 2003 (à comparer avec 421,8 € en France selon les données 2002).
). La dépense par habitant était de l’ordre de 400 € en 2003 (à comparer avec 421,8 € en France selon les données 2002). ).
). ). Contrairement à ce qui est parfois avancé, il n’existe pas de corrélation claire entre la prévalence et l’offre de jeux de hasard et d’argent, selon les pays et la plus ou moins grande accessibilité de l’offre.
). Contrairement à ce qui est parfois avancé, il n’existe pas de corrélation claire entre la prévalence et l’offre de jeux de hasard et d’argent, selon les pays et la plus ou moins grande accessibilité de l’offre. ), la prévalence sur la vie entière pour le jeu pathologique était de 1,1 % (SOGS5
5 critères et plus, ou niveau 3), et de 2,1 % pour le jeu problématique (SOGS 3 et 4 critères, ou niveau 2), soit des valeurs similaires à celles observées en 1998 (figure 3
), la prévalence sur la vie entière pour le jeu pathologique était de 1,1 % (SOGS5
5 critères et plus, ou niveau 3), et de 2,1 % pour le jeu problématique (SOGS 3 et 4 critères, ou niveau 2), soit des valeurs similaires à celles observées en 1998 (figure 3 et tableau II
et tableau II ). La prévalence à 12 mois en Suisse ne montre pas non plus de différences significatives entre 1998 et 2005, 0,24 % de joueurs pathologiques probables en 1998 et 0, 46 % en 2005.
). La prévalence à 12 mois en Suisse ne montre pas non plus de différences significatives entre 1998 et 2005, 0,24 % de joueurs pathologiques probables en 1998 et 0, 46 % en 2005. ).
). )
) ), le nombre réel de personnes ayant consulté ou suivi un traitement pour un problème lié au jeu est estimé entre 1 000 et 1 500 consultations en 2003 (figure 4
), le nombre réel de personnes ayant consulté ou suivi un traitement pour un problème lié au jeu est estimé entre 1 000 et 1 500 consultations en 2003 (figure 4 ). Le pourcentage de consultants pour des problèmes liés au jeu aurait quadruplé entre 1998 et 2003. Plus l’offre de jeux de hasard et d’argent dans une région est grande et plus le nombre de consultations serait élevé, selon cette enquête, réalisée toutefois sur un échantillon présentant un fort biais de recrutement. Les consultations se répartissent entre les joueurs et leurs proches. En 2003, pour environ 600 consultations de joueurs, il y avait un peu plus de 100 consultations de proches .
). Le pourcentage de consultants pour des problèmes liés au jeu aurait quadruplé entre 1998 et 2003. Plus l’offre de jeux de hasard et d’argent dans une région est grande et plus le nombre de consultations serait élevé, selon cette enquête, réalisée toutefois sur un échantillon présentant un fort biais de recrutement. Les consultations se répartissent entre les joueurs et leurs proches. En 2003, pour environ 600 consultations de joueurs, il y avait un peu plus de 100 consultations de proches .
 ).
).










 ). La principale erreur est de faire le lien entre des événements indépendants. L’analyse de ce que se disent les joueurs pendant le jeu montre qu’en majorité ils tentent de prédire le résultat. Mais comment peut-on prédire le hasard ?
). La principale erreur est de faire le lien entre des événements indépendants. L’analyse de ce que se disent les joueurs pendant le jeu montre qu’en majorité ils tentent de prédire le résultat. Mais comment peut-on prédire le hasard ? ). Ce modèle implique un « joueur responsable », soit il ne joue pas, soit il joue de manière modérée. Le jeu responsable est un ensemble de politiques et de mesures destinées à prévenir le développement d’habitudes de jeu excessives. L’objectif est d’une part de diminuer l’incidence du jeu excessif, c’est-à-dire l’apparition de nouveaux cas pendant une période donnée, d’autre part de cibler la prévalence de la prise en charge des gens « intoxiqués » par le jeu, domaine des spécialistes.
). Ce modèle implique un « joueur responsable », soit il ne joue pas, soit il joue de manière modérée. Le jeu responsable est un ensemble de politiques et de mesures destinées à prévenir le développement d’habitudes de jeu excessives. L’objectif est d’une part de diminuer l’incidence du jeu excessif, c’est-à-dire l’apparition de nouveaux cas pendant une période donnée, d’autre part de cibler la prévalence de la prise en charge des gens « intoxiqués » par le jeu, domaine des spécialistes. ). Nous avons choisi un cadre plus approprié pour la prévention et qui exclut les joueurs pathologiques. Ce programme se décline selon trois modalités en fonction de la population ciblée :
). Nous avons choisi un cadre plus approprié pour la prévention et qui exclut les joueurs pathologiques. Ce programme se décline selon trois modalités en fonction de la population ciblée : ; Mrazek et Haggerty, 1994
; Mrazek et Haggerty, 1994 ).
). ; Blaszczynski et coll., 2002
; Blaszczynski et coll., 2002 ). Il s’agit de proposer des changements dans le design des machines de façon à diminuer la dépendance : réduction de la vitesse d’exécution des parties, mise en place d’accepteurs de billets de moins de 20 dollars, et d’accepteurs de pièces entre 1 et 10 dollars. Le changement n’a pas eu d’impact négatif sur les revenus des opérateurs de jeu et a reçu la satisfaction des joueurs ;
). Il s’agit de proposer des changements dans le design des machines de façon à diminuer la dépendance : réduction de la vitesse d’exécution des parties, mise en place d’accepteurs de billets de moins de 20 dollars, et d’accepteurs de pièces entre 1 et 10 dollars. Le changement n’a pas eu d’impact négatif sur les revenus des opérateurs de jeu et a reçu la satisfaction des joueurs ; ). Sous forme d’un atelier de deux heures, il informe les détaillants sur la problématique du jeu excessif. Il répond aux questions suivantes : qu’est-ce que la chance et le hasard ? Y a-t-il un lien entre la non compréhension du concept de chance et le jeu excessif ? Comment reconnaître les symptômes de cette maladie ? Comment le détaillant peut-il intervenir ? Les résultats montrent que les détaillants développent une meilleure compréhension des problèmes de jeu, reconnaissent les principaux symptômes et se sentent plus capables d’intervenir auprès des joueurs excessifs en choisissant le moment le plus approprié. À long terme, les détaillants ayant suivi la formation rapportent qu’ils approchent plus souvent un joueur excessif et qu’ils discutent plus souvent des dispositifs d’aide qu’avant d’avoir suivi la formation ;
). Sous forme d’un atelier de deux heures, il informe les détaillants sur la problématique du jeu excessif. Il répond aux questions suivantes : qu’est-ce que la chance et le hasard ? Y a-t-il un lien entre la non compréhension du concept de chance et le jeu excessif ? Comment reconnaître les symptômes de cette maladie ? Comment le détaillant peut-il intervenir ? Les résultats montrent que les détaillants développent une meilleure compréhension des problèmes de jeu, reconnaissent les principaux symptômes et se sentent plus capables d’intervenir auprès des joueurs excessifs en choisissant le moment le plus approprié. À long terme, les détaillants ayant suivi la formation rapportent qu’ils approchent plus souvent un joueur excessif et qu’ils discutent plus souvent des dispositifs d’aide qu’avant d’avoir suivi la formation ; et 2002
et 2002 ). Réaliser une étude avec les employés de casino sur les problèmes de jeu permet de faire avancer la connaissance sur la prévention. Les employés de casino représentent une population qui a une très grande accessibilité au jeu et qui est très exposée au jeu. Ils jouent plus, fument et boivent plus et ont plus de troubles de l’humeur que la population générale. L’étude a montré que les employés changent leur comportement régulièrement ; de plus, ces changements tendent à diminuer le niveau du trouble plutôt qu’à l’augmenter ce qui est traditionnellement suggéré. Quelle est l’étendue de ce rétablissement et quels sont les déterminants qui influencent la transition d’un état problématique vers un état sans problème de jeu ou d’abstinence ? Y a-t-il une transition vers une association avec d’autres problèmes de santé ?
). Réaliser une étude avec les employés de casino sur les problèmes de jeu permet de faire avancer la connaissance sur la prévention. Les employés de casino représentent une population qui a une très grande accessibilité au jeu et qui est très exposée au jeu. Ils jouent plus, fument et boivent plus et ont plus de troubles de l’humeur que la population générale. L’étude a montré que les employés changent leur comportement régulièrement ; de plus, ces changements tendent à diminuer le niveau du trouble plutôt qu’à l’augmenter ce qui est traditionnellement suggéré. Quelle est l’étendue de ce rétablissement et quels sont les déterminants qui influencent la transition d’un état problématique vers un état sans problème de jeu ou d’abstinence ? Y a-t-il une transition vers une association avec d’autres problèmes de santé ?


















