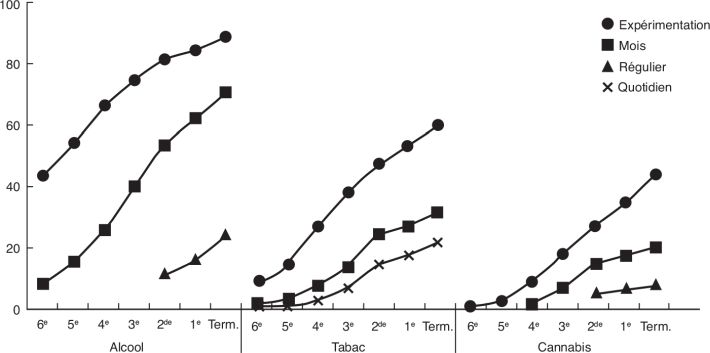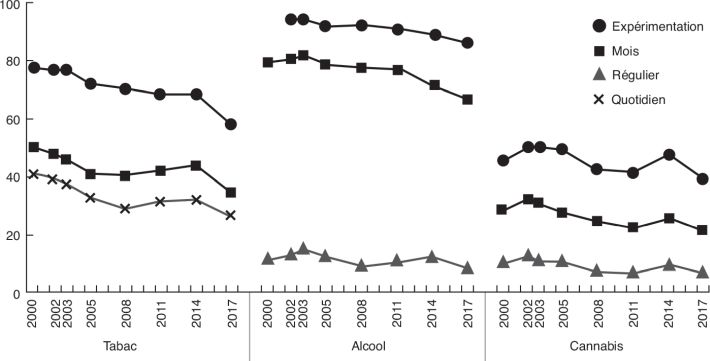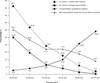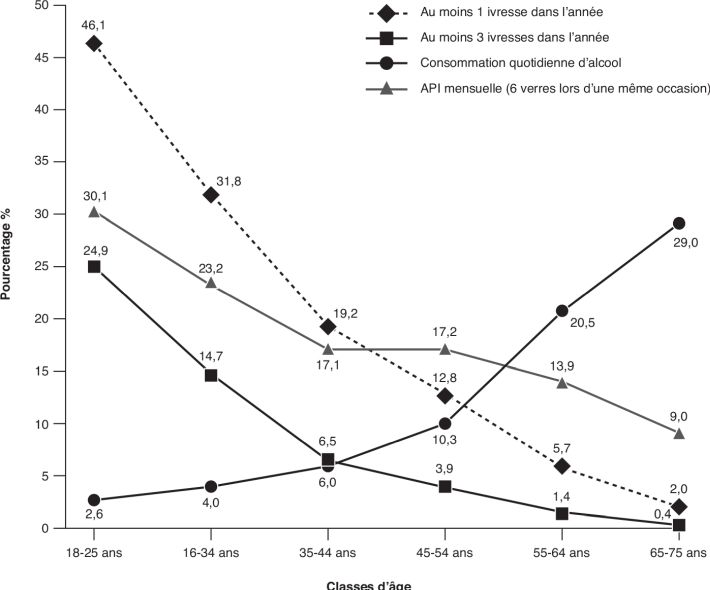Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool
I. Consommations d’alcool : les risques, les dommages et leur environnement
2021
| ANALYSE |
1-
Épidémiologie des consommations d’alcool : données récentes
Mesure de la consommation d’alcool :
éléments
méthodologiques
 ).
). ).
). ), deux
types de consommations problématiques étaient distingués : l’abus et la
dépendance à l’alcool. L’abus d’alcool était caractérisé par une
consommation engendrant des conséquences négatives sur la vie
professionnelle, familiale ou les liens avec la justice, ou encore un
comportement dangereux pour soi ou pour les autres sous l’emprise du
produit. Quant à la dépendance à l’alcool, elle était définie par au
moins trois symptômes parmi la tolérance au produit, les symptômes de
sevrage en cas de non-consommation, la perte de contrôle sur la
consommation et l’exclusion d’autres activités du fait de la
consommation.
), deux
types de consommations problématiques étaient distingués : l’abus et la
dépendance à l’alcool. L’abus d’alcool était caractérisé par une
consommation engendrant des conséquences négatives sur la vie
professionnelle, familiale ou les liens avec la justice, ou encore un
comportement dangereux pour soi ou pour les autres sous l’emprise du
produit. Quant à la dépendance à l’alcool, elle était définie par au
moins trois symptômes parmi la tolérance au produit, les symptômes de
sevrage en cas de non-consommation, la perte de contrôle sur la
consommation et l’exclusion d’autres activités du fait de la
consommation. ), a
remplacé les notions d’abus et de dépendance par celles de trouble lié à
l’usage d’un produit psychoactif – dont l’alcool. Ce trouble est
identifié par 11 symptômes et peut être léger (2-3 symptômes), modéré
(4-5), ou sévère/addiction (≥ 6) (encadré 1.1).
), a
remplacé les notions d’abus et de dépendance par celles de trouble lié à
l’usage d’un produit psychoactif – dont l’alcool. Ce trouble est
identifié par 11 symptômes et peut être léger (2-3 symptômes), modéré
(4-5), ou sévère/addiction (≥ 6) (encadré 1.1).|
Encadré 1.1 : Critères diagnostiques du trouble lié à
l’usage de l’alcool 1. L’alcool est souvent pris en quantité plus importante
ou pendant une période plus longue que prévu.
2. Désir persistant de diminuer ou de contrôler l’usage
d’alcool ou efforts infructueux.
3. Beaucoup de temps est consacré à des activités
nécessaires pour obtenir et utiliser l’alcool ou récupérer
de ses effets.
4. Envie, fort désir ou besoin de consommer de
l’alcool.
5. L’usage récurrent de l’alcool conduit à des
manquements à des obligations majeures, au travail, à
l’école ou à la maison.
6. Poursuite de l’utilisation d’alcool malgré des
problèmes sociaux ou interpersonnels, persistants ou
récurrents, causés ou exacerbés par les effets de
l’alcool.
7. Des activités sociales, professionnelles ou de
loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de
l’usage de l’alcool.
8. Usage récurrent d’alcool dans des situations où il
est physiquement dangereux (ex. avant de
conduire).
9. Usage d’alcool poursuivi bien que la personne sache
avoir un problème physique ou psychologique persistant ou
récurrent qui est susceptible d’avoir été causé ou exacerbé
par l’alcool.
10. Tolérance, telle que définie par l’un des éléments
suivants :
- Un besoin de quantités notablement plus
grandes d’alcool pour atteindre l’effet
désiré.
- Un effet notablement diminué avec
l’utilisation continue de la même quantité
d’alcool.
11. Sevrage, tel que manifesté par l’un des éléments
suivants :
- Syndrome de sevrage d’alcool
caractéristique.
- L’alcool (ou une substance très proche, comme
un médicament benzodiazépine tel que le Xanax
[liste]) est pris pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage.
|
Consommation d’alcool chez les adolescents en France
 ) (Spilka et
coll., 2019
) (Spilka et
coll., 2019 ).
). | Figure 1.1 : Usages d’alcool, de tabac et de cannabis
selon le niveau scolaire en 2018 (en %) (Source : EnClass 2018)
(d’après Spilka et coll., 2019* ) ) |
 ) qui montrent
qu’environ 86 % des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l’alcool (Spilka et
coll., 2018a
) qui montrent
qu’environ 86 % des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l’alcool (Spilka et
coll., 2018a ).
Ces deux enquêtes indiquent qu’à la fin de l’adolescence la consommation
régulière (≥ 10 fois dans le mois) concerne entre un jeune sur dix en
classe de seconde et un jeune sur quatre en terminale, et environ 8 %
des jeunes de 17 ans en France, tandis qu’entre 40 et 50 % déclarent
avoir eu au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) et 16 %
au moins trois API dans le mois précédant l’enquête (Spilka et coll.,
2018a
).
Ces deux enquêtes indiquent qu’à la fin de l’adolescence la consommation
régulière (≥ 10 fois dans le mois) concerne entre un jeune sur dix en
classe de seconde et un jeune sur quatre en terminale, et environ 8 %
des jeunes de 17 ans en France, tandis qu’entre 40 et 50 % déclarent
avoir eu au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) et 16 %
au moins trois API dans le mois précédant l’enquête (Spilka et coll.,
2018a ;
Spilka et coll., 2019
;
Spilka et coll., 2019 ). Ces chiffres, bien qu’élevés en valeurs
absolues et par rapport à ceux observés dans d’autres pays européens
(ESPAD Group et EMCDDA, 2016
). Ces chiffres, bien qu’élevés en valeurs
absolues et par rapport à ceux observés dans d’autres pays européens
(ESPAD Group et EMCDDA, 2016 ), sont en net recul par rapport à la période
2008-2014. Ainsi, entre 2014 et 2017, parmi les jeunes de 17 ans,
l’expérimentation de l’alcool a baissé d’environ 4 points (de 89,3 à
85,7 %), l’usage régulier d’environ 4 points (12,3 à 8,4 %), les
ivresses de 8 points (de 58,9 à 50,4 %) et les API de près de 5 points
(48,8 à 44,0 %). Ces baisses sont similaires à celles observées pour
d’autres produits (notamment le tabac et le cannabis), et nécessitent un
suivi au long cours.
), sont en net recul par rapport à la période
2008-2014. Ainsi, entre 2014 et 2017, parmi les jeunes de 17 ans,
l’expérimentation de l’alcool a baissé d’environ 4 points (de 89,3 à
85,7 %), l’usage régulier d’environ 4 points (12,3 à 8,4 %), les
ivresses de 8 points (de 58,9 à 50,4 %) et les API de près de 5 points
(48,8 à 44,0 %). Ces baisses sont similaires à celles observées pour
d’autres produits (notamment le tabac et le cannabis), et nécessitent un
suivi au long cours. ), tandis que parmi les jeunes qui ont une
consommation à risque environ 25 % poursuivent le même type de
consommation au moment de l’entrée dans la vie adulte (Yaogo et coll.,
2015
), tandis que parmi les jeunes qui ont une
consommation à risque environ 25 % poursuivent le même type de
consommation au moment de l’entrée dans la vie adulte (Yaogo et coll.,
2015 ;
Mahmood et coll., 2016
;
Mahmood et coll., 2016 ; Enstad et coll.,
2019
; Enstad et coll.,
2019 ).
). ).
Les jeunes qui déclarent boire de l’alcool le font majoritairement le
week-end (90 %), avec des amis (90 %), chez eux ou chez des amis (65 %).
La proportion de ceux qui déclarent consommer des boissons alcoolisées
dans un bar/restaurant ou en discothèque a nettement baissé au cours du
temps (entre 2005 et 2017, respectivement de 36 à 29 %, et de 32 à 19 %)
(Spilka, 2013
).
Les jeunes qui déclarent boire de l’alcool le font majoritairement le
week-end (90 %), avec des amis (90 %), chez eux ou chez des amis (65 %).
La proportion de ceux qui déclarent consommer des boissons alcoolisées
dans un bar/restaurant ou en discothèque a nettement baissé au cours du
temps (entre 2005 et 2017, respectivement de 36 à 29 %, et de 32 à 19 %)
(Spilka, 2013 ).
). ), en particulier
pour l’expérimentation (sex-ratio en 2017 = 1,02), l’usage dans l’année
(1,07), et l’usage dans le mois (1,11), ou encore l’API dans le dernier
mois (1,30). Les garçons ont, en revanche, toujours tendance à avoir des
niveaux plus élevés de consommation régulière, c’est-à-dire ≥ 10 fois
dans le mois (sex-ratio en 2017 = 2,62), ou de présenter des API
répétées, c’est-à-dire ≥ 3 fois dans le mois (1,99) ou régulières,
c’est-à-dire ≥ 10 fois dans le mois (4,28) (Spilka et coll.,
2018b
), en particulier
pour l’expérimentation (sex-ratio en 2017 = 1,02), l’usage dans l’année
(1,07), et l’usage dans le mois (1,11), ou encore l’API dans le dernier
mois (1,30). Les garçons ont, en revanche, toujours tendance à avoir des
niveaux plus élevés de consommation régulière, c’est-à-dire ≥ 10 fois
dans le mois (sex-ratio en 2017 = 2,62), ou de présenter des API
répétées, c’est-à-dire ≥ 3 fois dans le mois (1,99) ou régulières,
c’est-à-dire ≥ 10 fois dans le mois (4,28) (Spilka et coll.,
2018b ).
).
Tableau 1.I Niveaux d’usage de substances psychoactives à 17 ans en
2017 (Source : enquêtes ESCAPAD 2014, 2017 France métropolitaine,
OFDT) (d’après Spilka et coll.,
2018b )
)
|
Produits
Usage |
Garçons
2017 |
Filles
2017 |
Sex-ratio
|
Ensemble
2017 |
Ensemble
2014 |
Évolution
(en points) |
Évolution
(en %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcool
|
|||||||
|
Expérimentation
|
86,6
|
84,6
|
1,02 ***
|
85,7
|
89,3 ***
|
-3,6
|
-4,1
|
|
Actuel (au moins un usage dans
l’année)
|
80,1
|
75,2
|
1,07 ***
|
77,7
|
82,4 ***
|
-4,7
|
-5,7
|
|
Récent (au moins un usage dans le
mois)
|
69,9
|
62,9
|
1,11 ***
|
66,5
|
72,0 ***
|
-5,5
|
-7,7
|
|
Régulier (au moins 10 usages dans le
mois)
|
12,0
|
4,6
|
2,62 ***
|
8,4
|
12,3 ***
|
-3,8
|
-31,3
|
|
Quotidien ou 30 usages dans le
mois
|
2,1
|
0,5
|
4,04 ***
|
1,3
|
1,8 ***
|
-0,4
|
-24,9
|
|
Ivresse
|
|||||||
|
Expérimentation
|
55,1
|
45,6
|
1,21 ***
|
50,4
|
58,9 ***
|
-8,5
|
-14,4
|
|
Alcoolisation ponctuelle importante (API)
|
|||||||
|
Récente (au moins un usage dans le
mois)
|
49,6
|
38,1
|
1,30 ***
|
44,0
|
48,8 ***
|
-4,8
|
-9,9
|
|
Répétée (au moins 3 fois dans le
mois)
|
21,7
|
10,9
|
1,99 ***
|
16,4
|
21,8 ***
|
-5,4
|
-24,7
|
|
Régulière (au moins 10 fois dans le
mois)
|
4,3
|
1,0
|
4,28 ***
|
2,7
|
3,0 *
|
-0,3
|
-10,4
|
*, *** Test du chi-2 significatif respectivement au seuil 0,05 et 0,001.
Consommation d’alcool chez les adultes en France
 ), elle
est d’environ 27 g d’alcool pur (c’est-à-dire la quantité d’alcool
consommée indépendamment de la boisson) par personne/jour d’après les
dernières estimations (Hill et Laplanche,
2010
), elle
est d’environ 27 g d’alcool pur (c’est-à-dire la quantité d’alcool
consommée indépendamment de la boisson) par personne/jour d’après les
dernières estimations (Hill et Laplanche,
2010 ). On
estime qu’environ 23,3 % de la population aurait une consommation à
risque ponctuel selon le score AUDIT et environ 7,2 % une consommation à
risque chronique ou présentant la possibilité d’une dépendance
(Com-Ruelle, 2013
). On
estime qu’environ 23,3 % de la population aurait une consommation à
risque ponctuel selon le score AUDIT et environ 7,2 % une consommation à
risque chronique ou présentant la possibilité d’une dépendance
(Com-Ruelle, 2013 ). En 2014, les prévalences estimées de trouble de l’usage de l’alcool
dans la cohorte CONSTANCES en utilisant le score total à l’AUDIT en 10
questions étaient : chez les hommes : 19,8 % dans la catégorie à risque
dangereux (score total de 8 à 15) et 4,4 % dans la catégorie à risque
problématique ou de dépendance probable (score total > 15) ; chez les
femmes : 7,9 % dans la catégorie à risque dangereux et 1,1 % dans la
catégorie à risque problématique ou de dépendance probable. Les
prévalences de la consommation à risque de l’alcool étaient les plus
élevées pour les sujets de moins de 35 ans : chez les hommes de moins de
35 ans, 30,7 % d’entre eux avaient un usage dangereux de l’alcool, et
5,8 % d’entre eux avaient un usage problématique ou étaient probablement
dépendants ; chez les femmes de moins de 35 ans, 12,9 % d’entre elles
avaient un usage dangereux de l’alcool, et 1,6 % d’entre elles avaient
un usage problématique ou étaient probablement dépendantes. Chez les
hommes, les catégories professionnelles moins favorisées étaient
associées à des prévalences augmentées d’usage à risque (c.-à-d. un
usage dangereux et au-delà). Plus précisément, les prévalences d’usage à
risque étaient de 28,0 %, 30,6 %, 23 % et 19,2 %, respectivement pour
les ouvriers, employés, professions intermédiaires et les cadres. Chez
les femmes, ce gradient n’était pas retrouvé. Plus précisément, les
prévalences d’usage à risque étaient de 8,6 %, 7,8 %, 8,6 % et 11,7 %
respectivement pour les ouvrières, employées, professions intermédiaires
et les cadres. Chez les hommes comme chez les femmes, l’état dépressif
était associé à des prévalences plus élevées d’usage à risque. Plus
précisément, en l’absence d’état dépressif, les prévalences d’usage à
risque étaient de 22,5 % chez les hommes et de 8,1 % chez les femmes. En
présence d’un état dépressif, ces prévalences étaient respectivement de
37,4 % et de 12,5 %.
). En 2014, les prévalences estimées de trouble de l’usage de l’alcool
dans la cohorte CONSTANCES en utilisant le score total à l’AUDIT en 10
questions étaient : chez les hommes : 19,8 % dans la catégorie à risque
dangereux (score total de 8 à 15) et 4,4 % dans la catégorie à risque
problématique ou de dépendance probable (score total > 15) ; chez les
femmes : 7,9 % dans la catégorie à risque dangereux et 1,1 % dans la
catégorie à risque problématique ou de dépendance probable. Les
prévalences de la consommation à risque de l’alcool étaient les plus
élevées pour les sujets de moins de 35 ans : chez les hommes de moins de
35 ans, 30,7 % d’entre eux avaient un usage dangereux de l’alcool, et
5,8 % d’entre eux avaient un usage problématique ou étaient probablement
dépendants ; chez les femmes de moins de 35 ans, 12,9 % d’entre elles
avaient un usage dangereux de l’alcool, et 1,6 % d’entre elles avaient
un usage problématique ou étaient probablement dépendantes. Chez les
hommes, les catégories professionnelles moins favorisées étaient
associées à des prévalences augmentées d’usage à risque (c.-à-d. un
usage dangereux et au-delà). Plus précisément, les prévalences d’usage à
risque étaient de 28,0 %, 30,6 %, 23 % et 19,2 %, respectivement pour
les ouvriers, employés, professions intermédiaires et les cadres. Chez
les femmes, ce gradient n’était pas retrouvé. Plus précisément, les
prévalences d’usage à risque étaient de 8,6 %, 7,8 %, 8,6 % et 11,7 %
respectivement pour les ouvrières, employées, professions intermédiaires
et les cadres. Chez les hommes comme chez les femmes, l’état dépressif
était associé à des prévalences plus élevées d’usage à risque. Plus
précisément, en l’absence d’état dépressif, les prévalences d’usage à
risque étaient de 22,5 % chez les hommes et de 8,1 % chez les femmes. En
présence d’un état dépressif, ces prévalences étaient respectivement de
37,4 % et de 12,5 %. ), la
consommation globale est dans la moyenne européenne (Palle et coll.,
2017
), la
consommation globale est dans la moyenne européenne (Palle et coll.,
2017 ; WHO,
2019
; WHO,
2019 ). Ces
tendances séculaires peuvent en partie être observées en examinant la
prévalence de différentes formes de consommation selon le groupe d’âge
(figure 1.3
). Ces
tendances séculaires peuvent en partie être observées en examinant la
prévalence de différentes formes de consommation selon le groupe d’âge
(figure 1.3 ). En effet, si les
18-25 ans continuent majoritairement à consommer de l’alcool de manière
comparable aux adolescents (30 % déclarent une API dans le dernier mois
et près de 25 % rapportent au moins 3 ivresses dans l’année, 2,6 %
seulement déclarent boire de l’alcool de manière quotidienne), les
personnes âgées de plus de 55 ans sont celles qui ont la probabilité la
plus élevée de rapporter une consommation quotidienne (21 % chez les
55-64 ans, 29 % chez les 65-75 ans), ce qui correspond à un mode
« traditionnel » de consommation d’alcool en France et dans les pays du
Sud de l’Europe où le vin est la principale boisson alcoolisée
consommée. Entre ces deux groupes d’âge extrêmes, les adultes de 35 à
54 ans ont des niveaux intermédiaires d’API mensuelle (environ 17 %) et
de consommation quotidienne (6 à 10 %) (Richard et coll.,
2015
). En effet, si les
18-25 ans continuent majoritairement à consommer de l’alcool de manière
comparable aux adolescents (30 % déclarent une API dans le dernier mois
et près de 25 % rapportent au moins 3 ivresses dans l’année, 2,6 %
seulement déclarent boire de l’alcool de manière quotidienne), les
personnes âgées de plus de 55 ans sont celles qui ont la probabilité la
plus élevée de rapporter une consommation quotidienne (21 % chez les
55-64 ans, 29 % chez les 65-75 ans), ce qui correspond à un mode
« traditionnel » de consommation d’alcool en France et dans les pays du
Sud de l’Europe où le vin est la principale boisson alcoolisée
consommée. Entre ces deux groupes d’âge extrêmes, les adultes de 35 à
54 ans ont des niveaux intermédiaires d’API mensuelle (environ 17 %) et
de consommation quotidienne (6 à 10 %) (Richard et coll.,
2015 ; Grant
et coll., 2017
; Grant
et coll., 2017 ).
). ) et se
maintient pour une fraction non négligeable d’entre eux, avec des
conséquences en termes de risque d’addiction et d’impact sur la santé
(WHO, 2019
) et se
maintient pour une fraction non négligeable d’entre eux, avec des
conséquences en termes de risque d’addiction et d’impact sur la santé
(WHO, 2019 ). En
France, alors qu’on observe une baisse de 12 points de la consommation
quotidienne d’alcool entre 2000 et 2014 (passée de 22 à 10 %) (Beck et
coll., 2015
). En
France, alors qu’on observe une baisse de 12 points de la consommation
quotidienne d’alcool entre 2000 et 2014 (passée de 22 à 10 %) (Beck et
coll., 2015 ), la
fréquence des API a en parallèle augmenté, portée notamment par
l’augmentation des consommations importantes d’alcool chez les jeunes
adultes. En effet, entre 2005 et 2014, les ivresses et les API chez les
18-25 ans ont significativement augmenté (Beck et coll.,
2015
), la
fréquence des API a en parallèle augmenté, portée notamment par
l’augmentation des consommations importantes d’alcool chez les jeunes
adultes. En effet, entre 2005 et 2014, les ivresses et les API chez les
18-25 ans ont significativement augmenté (Beck et coll.,
2015 ; Richard
et coll., 2015
; Richard
et coll., 2015 ),
et depuis semblent relativement stables. Néanmoins les consommations
importantes (au moins 10 ivresses et au moins 1 API hebdomadaire dans
les 12 mois précédents) ont très légèrement baissé (Richard et coll.,
2015
),
et depuis semblent relativement stables. Néanmoins les consommations
importantes (au moins 10 ivresses et au moins 1 API hebdomadaire dans
les 12 mois précédents) ont très légèrement baissé (Richard et coll.,
2015 ). En
2014, parmi les 18-25 ans, 57 % déclaraient au moins 1 API dans les 12
mois précédents, 29 % au moins 3 ivresses7
.
). En
2014, parmi les 18-25 ans, 57 % déclaraient au moins 1 API dans les 12
mois précédents, 29 % au moins 3 ivresses7
. ). Comme chez les adolescents, chez les jeunes
adultes, la consommation d’alcool des femmes a augmenté et le sex-ratio
a diminué en conséquence, ce qui est concordant avec les résultats
d’études menées dans d’autres pays industrialisés (Alati et coll.,
2014
). Comme chez les adolescents, chez les jeunes
adultes, la consommation d’alcool des femmes a augmenté et le sex-ratio
a diminué en conséquence, ce qui est concordant avec les résultats
d’études menées dans d’autres pays industrialisés (Alati et coll.,
2014 ; Windle,
2016
; Windle,
2016 ).
). ; Richard et coll., 2015
; Richard et coll., 2015 ).
). ). Par
exemple, en Israël ou au Canada, environ 17 % des adolescents/jeunes
adultes rapportent avoir consommé de l’alcool mélangé avec des boissons
énergisantes cafféinées (Magnezi et coll.,
2015
). Par
exemple, en Israël ou au Canada, environ 17 % des adolescents/jeunes
adultes rapportent avoir consommé de l’alcool mélangé avec des boissons
énergisantes cafféinées (Magnezi et coll.,
2015 ; Reid
et coll., 2015
; Reid
et coll., 2015 ).
En parallèle, la consommation d’alcool mélangé à des sodas light
semble s’être répandue, notamment aux États-Unis (Stamates et coll.,
2016
).
En parallèle, la consommation d’alcool mélangé à des sodas light
semble s’être répandue, notamment aux États-Unis (Stamates et coll.,
2016 ). Ce
type de mélange pose des risques particuliers, les boissons énergisantes
masquant le goût de l’alcool et diminuant ses effets somnifères, ce qui
peut entraîner une augmentation de la consommation. Il est à noter qu’en
France ce type de pratique n’est pas renseigné dans les enquêtes en
population générale et on ne dispose pas de chiffres concernant sa
fréquence.
). Ce
type de mélange pose des risques particuliers, les boissons énergisantes
masquant le goût de l’alcool et diminuant ses effets somnifères, ce qui
peut entraîner une augmentation de la consommation. Il est à noter qu’en
France ce type de pratique n’est pas renseigné dans les enquêtes en
population générale et on ne dispose pas de chiffres concernant sa
fréquence. ). Chez
les hommes, c’est parmi les 65-75 ans que la probabilité de consommer
plus de 10 verres d’alcool par semaine est la plus importante (23 %).
Ces chiffres rejoignent des tendances observées dans d’autres pays,
montrant qu’au cours du temps les niveaux de consommation d’alcool des
personnes de plus de 50 ans ont augmenté (Ilomaki et coll.,
2013
). Chez
les hommes, c’est parmi les 65-75 ans que la probabilité de consommer
plus de 10 verres d’alcool par semaine est la plus importante (23 %).
Ces chiffres rejoignent des tendances observées dans d’autres pays,
montrant qu’au cours du temps les niveaux de consommation d’alcool des
personnes de plus de 50 ans ont augmenté (Ilomaki et coll.,
2013 ; Wilson
et coll., 2014
; Wilson
et coll., 2014 ;
Gell et coll., 2015
;
Gell et coll., 2015 ; Nuevo et coll., 2015
; Nuevo et coll., 2015 ; Bosque-Prous et coll.,
2017
; Bosque-Prous et coll.,
2017 ), et
notamment les niveaux d’API (23 % de prévalence aux États-Unis en
2012-2013) (Wilson et coll., 2014
), et
notamment les niveaux d’API (23 % de prévalence aux États-Unis en
2012-2013) (Wilson et coll., 2014 ; Han et coll., 2017
; Han et coll., 2017 ) et de troubles liés à
l’alcool (5 % de prévalence aux États-Unis) (Grant et coll.,
2017
) et de troubles liés à
l’alcool (5 % de prévalence aux États-Unis) (Grant et coll.,
2017 ). La
consommation des personnes de plus de 50 ans pose des problèmes
spécifiques, notamment en raison de la présence de comorbidités et de
traitements médicamenteux (ex. : des traitements cardiovasculaires,
métaboliques ou psychotropes) (Ilomaki et coll.,
2013
). La
consommation des personnes de plus de 50 ans pose des problèmes
spécifiques, notamment en raison de la présence de comorbidités et de
traitements médicamenteux (ex. : des traitements cardiovasculaires,
métaboliques ou psychotropes) (Ilomaki et coll.,
2013 ;
Breslow et coll., 2015
;
Breslow et coll., 2015 ; LaRose et Renner,
2016
; LaRose et Renner,
2016 ; Tevik
et coll., 2017
; Tevik
et coll., 2017 ;
Wolf et coll., 2017
;
Wolf et coll., 2017 ). Si la tendance concernant la transformation des modalités de
consommation d’alcool en France – avec une évolution de la consommation
quotidienne vers une pratique plus ponctuelle, mais marquée par un
niveau de consommation qui peut être important – se confirme, la
surveillance des consommations d’alcool des personnes de plus de 50 ans
et leurs effets éventuels sur la santé, sera à renforcer.
). Si la tendance concernant la transformation des modalités de
consommation d’alcool en France – avec une évolution de la consommation
quotidienne vers une pratique plus ponctuelle, mais marquée par un
niveau de consommation qui peut être important – se confirme, la
surveillance des consommations d’alcool des personnes de plus de 50 ans
et leurs effets éventuels sur la santé, sera à renforcer. ; Parikh et coll.,
2015
; Parikh et coll.,
2015 ; Beard
et coll., 2017
; Beard
et coll., 2017 ;
Daw et coll., 2017
;
Daw et coll., 2017 ) ou le cannabis (Redonnet et coll.,
2012
) ou le cannabis (Redonnet et coll.,
2012 ;
Haardörfer et coll., 2016
;
Haardörfer et coll., 2016 ; O’Hara et coll.,
2016
; O’Hara et coll.,
2016 ;
Weinberger et coll., 2016
;
Weinberger et coll., 2016 ).
).Conclusion
Références














































→ Aller vers SYNTHESE