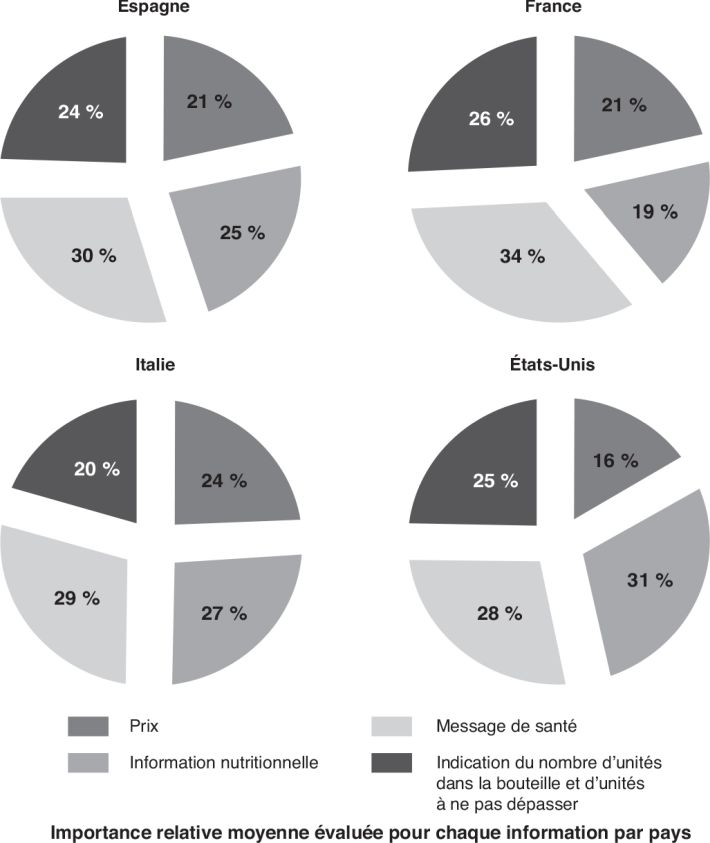Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool
II. Actions de prévention des consommations
2021
9-
Politiques de lutte
contre la consommation d’alcool
Face aux chiffres concernant l’évolution de la consommation d’alcool, son
coût social, son impact sur la mortalité (cf. chapitres précédents), la
majorité des travaux existants permet de quantifier l’ampleur du
problème soulevé par la consommation d’alcool. Certains dénoncent les
inégalités de traitement des différents produits des dépendances,
mettant en avant que les politiques publiques ne sont pas le reflet de
la dangerosité des produits. Souvent, le poids économique du secteur et
la force du lobbying alcoolier (cf. chapitre « Le lobbying de la filière
alcool ») sont mis en avant pour expliquer cette spécificité de
l’alcool : le marché français n’y échappe pas, que ce soit sur le marché
intérieur ou à l’exportation. Ainsi, selon l’OFDT, en 2011, le chiffre
d’affaires des boissons alcoolisées s’élevait à 10,7 milliards d’euros
pour les ventes sur le marché intérieur et à 11,4 milliards d’euros pour
les ventes à l’export. Toujours en 2011, les ménages français ont
dépensé 16,7 milliards en achats d’alcool, générant 3,2 milliards
d’euros de droits indirects sur l’alcool pour l’État. Mais, pour les
spiritueux et le vin, la contribution aux recettes fiscales n’est pas
proportionnelle aux volumes consommés (tableau 9.I

).
Tableau 9.I Contribution des différents types d’alcool aux recettes
fiscales comparée à leur consommation (d’après
l’OFDT*)
| |
Part des recettes fiscales sur
l’alcool
(hors TVA)
|
Répartition des volumes consommés
exprimés
en équivalent d’alcool
pur
|
|
Spiritueux
|
82 %
|
22 %
|
|
Bières
|
11 %
|
17 %
|
|
Vins
|
4 %
|
58 %
|
|
Produits intermédiaires
|
3 %
|
3 %
|
| | | |
| | | |
* https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/alcool/#prod
Par ailleurs, l’OFDT indiquait au début des années 2010 que « la filière
vitivinicole représenterait, selon les syndicats professionnels et le
ministère de l’Agriculture, 250 000 emplois directs, dont 142 000 dans
la viticulture et près de 70 000 dans la distribution et la vente du vin
(coopératives viticoles, courtage et négoce, grande distribution et
cavistes, etc.). Le nombre d’emplois indirects est évalué à 300 000
(tonnelage, chaudronnerie, verre, logistique, etc.). En ce qui concerne
la bière, l’Association des brasseurs de France revendique un peu plus
de 71 000 emplois, dont 6 000 emplois directs. La Fédération française
des spiritueux indique de son côté 100 000 emplois générés dans cette
branche »
1
. Il semble cependant qu’aujourd’hui, le secteur ne soit
plus aussi florissant (cf. chapitre « Efficacité des mesures visant à
restreindre l’offre et la demande de boissons alcoolisées », section
« Régime fiscal des boissons alcooliques en France »).
On voit alors se dessiner l’un des obstacles majeurs au développement
d’une politique publique de lutte contre les dommages liés à l’alcool :
le clivage entre santé publique et économie, qui, poussé aux extrêmes,
oppose les partisans d’une vision davantage hygiéniste et les défenseurs
de la culture française et de la tradition viticole notamment, pouvant
tendre au déni des méfaits de l’alcool, ou à les reporter sur la
responsabilité individuelle plutôt que collective. Une politique
nationale ambitieuse et cohérente entre ces deux extrêmes est-elle
possible ? Pour dépasser cette opposition, nombreux sont ceux qui
avancent une approche en termes de réduction des risques (Bourdillon
2019

), comme
résumé ainsi par le Conseil Économique Social et Environnemental
(CESE) : « une voie existe entre le déni des méfaits de l’alcool et les
discours prônant l’abstinence, rassurants mais peu efficaces. Cette voie
est celle de la réduction des risques et des dommages, sanitaires bien
sûr mais aussi des violences liées aux consommations excessives
d’alcool. Elle n’ignore ni les dangers ni le plaisir que l’on peut
trouver dans une consommation raisonnable mais modérée. Mais elle exige
plus de cohérence et de continuité dans les politiques publiques ainsi
que davantage de mobilisation et de coordination » (CESE, 2019

,
p. 11-12).
Ce sont les principales politiques publiques de réduction des dommages
liés à l’alcool ainsi que les recommandations en la matière que ce
chapitre se propose d’étudier à travers une lecture critique de la
littérature (grise et académique) française et internationale sur le
sujet
2
N’étant pas une revue systématique, celle-ci ne
saurait être exhaustive.
. Nous restituons celle-ci sous plusieurs aspects, plus
ou moins significatifs.
Nous avons d’abord relevé tout ce qui a trait à la construction d’un
ensemble cohérent de mesures afin de maximiser leur impact, avec la
construction du consensus social et politique, avec les aspects
culturels, les croyances et les représentations liées à l’alcool, avec
les questions de la volonté politique, avec l’effectivité de la mise en
œuvre, avec une réflexion sur le système de soins, et les professionnels
de première ligne, et, dans une bien moindre mesure, l’impact de ces
politiques publiques par rapport à d’autres déterminants.
Ensuite, nous listons les mesures évaluées les plus coût-efficaces
(baisse du nombre de points de vente, restrictions de leurs heures
d’ouverture, instauration d’un prix minimum, augmentation du prix
notamment par une augmentation des taxes sur l’alcool, interdiction de
vente aux mineurs, régulation du marketing), les repères de
consommation, les messages sanitaires (inscription de messages de santé
publique sur les emballages et les publicités d’alcool) et les
recommandations déjà existantes pour protéger des risques dus à
l’alcool, émises notamment par des acteurs de santé. Nous avons aussi
repéré d’autres dimensions, moins traitées et/ou moins consensuelles
mais récurrentes, comme le type d’approche à privilégier (spécifique à
l’alcool ou générale sur les addictions, ciblée ou universelle,
individuelle ou collective) ou la pertinence à s’inspirer d’autres
politiques publiques menées sur d’autres addictions (le tabac
notamment).
La construction des politiques
publiques
La fabrique d’un
consensus
Au niveau de la littérature internationale, peu de publications
s’interrogent sur les frontières de l’intervention de l’État
(jusqu’où doit intervenir l’État ? cf. Nicholls et Greenaway
2015

; Mold 2016

), des fonctions sociales de l’alcool
dans nos sociétés modernes occidentales. C’est pourtant un axe
essentiel sur lequel devraient s’interroger les acteurs de santé
(Couteron, 2018

), mais aussi les chercheurs et les
hommes et femmes politiques : que peut et doit faire l’État face
aux besoins d’inhibition et d’ivresse, à un souci de l’image de
soi qui passe parfois la préservation de sa santé (par exemple
l’intégration au groupe chez les jeunes), aux dynamiques
sociales incitatives et très ancrées dans nos pratiques
collectives, etc. ? Cette question est nettement moins présente
mais pourtant essentielle, notamment pour la construction d’un
compromis politique. Face à ces interrogations, certains en
appellent à la mise en place des conditions d’une véritable
réflexion éthique préalablement au choix des politiques
publiques qui « affectent une grande partie de la population,
voire son ensemble, et contribuent à définir de nouvelles
manières d’être, d’agir et de vivre. Ils peuvent orienter plus
justement les stratégies et contribuer à favoriser leur
acceptabilité et leur efficacité auprès des populations »
(Pagani et coll., 2018

, p. 330).
Ce manque de réflexion dans les sciences humaines et sociales
a-t-il une influence sur l’absence de consensus en matière de
réduction des dommages liés à l’alcool ? Cette absence de
consensus est souvent soulignée (Cour des comptes, 2016

;
Couteron, 2018

), moins la nécessité de mener « un
débat plus politique » rassemblant le maximum d’acteurs et de
professionnels, en orientant ce débat d’une part vers
l’impératif de santé et les consommateurs (méfaits connus et
bienfaits attendus de l’alcool) et d’autre part, vers
l’impératif économique et la régulation des consommations
(Couteron, 2018

). On rejoint aussi la question de
disposer de plus de recherches et de résultats plus solides sur
les politiques publiques (mesures les plus efficaces, question
sur l’évaluation des politiques publiques), les tendances de
consommations et les dommages selon l’âge, le genre, le niveau
de revenu, nécessaires en amont de la construction du consensus
public et politique (Rice, 2019

).
L’alcool comme problème
culturel
De nombreuses voix mettent en avant la question culturelle,
notamment en France, où l’on entend qu’il faut défendre les
métiers de l’emploi, « petit caviste », « courageux vignerons »,
« brasseur artisanal » (Couteron,
2018

,
p. 443), « défendre » l’art de vivre, des habitudes
alimentaires, le bien boire, l’image « responsable »
(autorégulation, prévention, messages volontaires avec un
« packaging sémantique « inclusif et bienveillant » [avec]
« modération », « dégustation », « de consommation responsable »
ouvrant des « plaisirs qui se partagent » » (Couteron,
2018

,
p. 443). Face à un lobby (analysé dans un chapitre spécifique de
cette expertise) qui serait « au service des profits issus d’un
marché qui se veut sans limite », les acteurs de santé doivent
« dénoncer » la posture de « défense de la tradition et de la
qualité », le secteur étant dicté par l’impératif de vendre plus
en produisant de nombreuses boissons appétantes (par
l’adjonction de sucres, d’arômes artificiels et/ou un marketing
bien travaillé, également décrit dans cette expertise) bien plus
que par un impératif œnologique de qualité. « Il n’y a pas plus
« d’alcool doux » qu’il n’y avait de cigarettes «
light »
[...] L’entrée en pente douce piège l’usager » (Couteron,
2018

,
p. 444) : ce point est mis en avant à propos de la bière,
souvent considérée de la sorte et moins dangereuse que les
autres alcools, notamment par les jeunes (OFDT,
2013

)
3
D’ailleurs, les vins et les bières plus
faibles en alcool s’accompagneraient d’une consommation
plus importante (Vasiljevic et coll., 2018
a

.), et ceux faisant apparaître
« Low » et « Super Low » auraient moins d’attrait que
les boissons « Regular » (Vasiljevic et coll., 2018
b

).
. Face à cette pratique culturelle objet d’un
lobbying intensif et puissant, c’est donc une approche globale,
ambitieuse et cohérente qui doit être développée, et qui ne doit
pas négliger d’agir
aussi sur les représentations liées à
l’alcool. C’est aussi dans cette perspective que doivent être
envisagées les recommandations déjà évoquées, comme la
communication sur les repères de consommation, les messages de
prévention, bref au sens large, l’éducation à la santé, qui est
pour Cohn (2015) la mesure à la fois la plus juste et la plus
efficace. Il faut selon lui développer une approche
interactionniste, utiliser des comparaisons culturelles pour
développer une construction collective de la consommation
excessive comme problème culturel, afin de ne pas appréhender
l’alcool en soi (la substance), mais penser plutôt au monde
social dans lequel les gens boivent (le comportement). Autrement
dit, bien comprendre le problème culturel, c’est mieux contrôler
la consommation d’alcool.
La volonté politique et la cohérence des
messages face au lobbying
et au marketing
alcooliers
Le poids économique du secteur est majoritairement considéré
comme l’un des principaux obstacles aux évolutions de la
législation et des représentations sociales sur l’alcool. Les
enjeux de santé publique (comme les questions écologiques) ne
semblent pas être prioritaires face à l’impératif économique. La
contradiction des intérêts économiques et des enjeux de santé
publique est souvent pointée (IRDES, 2016 ; Santé publique
France et l’Institut national du cancer,
2017

; Benyamina et Samitier,
2017

; Couteron, 2018

). Les enjeux économiques semblent
prioritaires sur les enjeux de santé publique et cela participe
des contradictions entre les messages : la volonté politique
apparaît incertaine ou mitigée, le pilotage interministériel est
flou (Cour des comptes, 2016

), l’encadrement des groupes
d’intérêt concernés est peu contraignant, les leviers
disponibles et avérés efficaces sont sous-utilisés, d’où le fait
que les pouvoirs publics français peinent à modifier les
comportements à risque (Cour des comptes, 2016

). Deux exemples
l’illustrent : premièrement, le « détricotage » continu de la
loi Évin depuis son adoption en 1991 (cf. chapitre « Marketing
des produits alcoolisés »), alors que cette loi était saluée
auparavant comme un « cadre exemplaire » et a inspiré d’autres
pays. Un recul notable par rapport à la loi Évin a été observé
avec la loi de modernisation du système de santé qui lève les
restrictions publicitaires au nom de la défense des terroirs et
de l’œnotourisme. On trouve une seconde illustration dans le
compte-rendu de la Journée inter associative « Plan National
Alcool » publié dans Addiction et Addictologie (Naassila,
2018

)
qui rapporte les déclarations du Président de la République
E. Macron au salon de l’Agriculture 2018 (« pendant mon mandat,
aucun durcissement de la loi Évin ») et le fait que l’Élysée ait
demandé en juillet de la même année aux alcooliers un rapport
pour préparer le plan gouvernemental de lutte contre les
conduites addictives : « les dommages individuels et sociaux
liés à la consommation d’alcool ne sont donc plus seulement un
enjeu de santé publique, mais aussi et surtout un enjeu
politique. Il s’agit pour les tenants de la santé publique de
lutter contre le lobby alcoolier qui est maintenant présent au
plus haut niveau de l’État ». Notons qu’à l’étranger,
l’importance du lobbying alcoolier est aussi avancé pour
expliquer l’échec de la mise en place de politiques publiques
fondées sur les évidences scientifiques. Autrement dit,
l’adoption des mesures les plus coût-efficaces peut s’avérer
difficile, comme en Angleterre et aux Pays de Galles où la
fenêtre d’opportunité ouverte en 2010 s’est vite refermée
(Nicholls et Greenaway, 2015

) en raison du lobbying industriel,
mais aussi du manque de cadrage des propositions, du manque de
synergie ministérielle, des tensions idéologiques, du manque de
cohérence dans la communication des preuves. Au Royaume-Uni, le
gouvernement avait adopté en 2011 un plan, le
Responsibility
Deal, co-construit avec, entre autres les représentants
des alcooliers. Ce plan comportait un volet alcool, censé
promouvoir un « boire responsable » respectant les repères de
consommation, agrandir l’étiquetage sur les contenants
comportant des messages de santé, sur les calories, des repères
de consommation, des risques associés à une consommation
excessive. Une attention particulière était portée à réduire et
prévenir la consommation des jeunes. En termes de publicité et
de marketing, les alcooliers étaient incités à promouvoir le
« boire responsable ». Pour beaucoup (Knai et coll.
2018

par exemple), le
Responsibility Deal, reposant notamment
sur des actions volontaires des industriels, a été un échec (en
termes d’efficacité, de résultats) parce qu’il était trop
déterminé par les intérêts économiques (et leur était donc peu
contraignant).
La durée, l’effectivité – et la difficulté – de
la mise en œuvre
En France, dès 2007, la Cour des comptes pointait les
défaillances de l’action publique en termes de lutte contre les
consommations dommageables d’alcool : dans son rapport public
annuel (2007), la Cour jugeait les pouvoirs publics
insuffisamment mobilisés sur le sujet. Neuf ans plus tard, dans
son rapport de 2016, elle soulignait que les comportements de
consommation n’avaient pas été modifiés et appelait le
gouvernement à faire des consommations nocives d’alcool une
priorité de santé publique. En 2019, c’est le CESE qui fait le
constat de « la difficulté de mettre en œuvre, dans la durée,
des politiques publiques cohérentes centrées prioritairement sur
des objectifs de santé publique » et montre également que « si
la législation et la réglementation sont indispensables, elles
ne suffisent pas » (2019

, p. 12), renvoyant à l’exemple de la
loi Évin. Or le temps long semble souvent indispensable pour
voir pleinement les effets positifs des politiques publiques
alcool, notamment sur le niveau de consommation (Raninen et
coll., 2016

; Dumont et coll., 2017

; Foster et coll.,
2019

).
Au-delà de la pérennité, l’effectivité de la mise en œuvre est un
point essentiel. En France, cela est particulièrement visible
avec la loi de 2009 et l’interdiction de la vente d’alcool aux
mineurs. Malgré le manque d’enquêtes avec des « clients
mystères » permettant d’évaluer de façon objective le respect de
cette mesure (tendant probablement à une surestimation), le
rapport de l’OFDT de 2013

montre à partir d’enquêtes
déclaratives une faible application de l’interdiction de vente
aux mineurs prévue par la loi HPST (hôpital, patients, santé,
territoire) de 2009. Alors que les débats parlementaires avaient
souligné l’insuffisance des mesures d’interdiction pour protéger
les mineurs, des politiques de prévention et d’éducation, et des
moyens alloués à la bonne application des mesures, aux contrôles
et à l’effectivité des sanctions, alors que l’adhésion des
Français interrogés était massive, la mise en œuvre de la loi
faisait apparaître une réalité très décevante avec d’abord la
gêne fréquente ressentie par le vendeur pour un mineur proche de
la majorité ; par ailleurs, le fait que 92 % des vendeurs
connaissent la loi (ainsi que les sanctions, relativement
connues mais sous estimées), mais ne se sentent pas forcément
légitimes pour demander une pièce d’identité. Le
tableau 9.II

montre
les différences selon les types de lieux de vente d’alcool du
contrôle de la pièce d’identité.
Tableau 9.II Demande de la pièce d’identité en 2012 (en %)
(d’après OFDT 2013 )
)
|
Demande de la pièce
d’identité (en
2012)
|
Cafés et bars
(%)
|
Stations-services
(%)
|
Épiceries et supérettes (%)
|
Grandes et moyennes surfaces
(%)
|
|
Oui
|
38,4
|
52,5
|
80
|
90,5
|
|
Non, rarement
|
18,8
|
11,2
|
5,9
|
4,1
|
|
Non, jamais
|
41,4
|
34,9
|
14,1
|
5,1
|
|
Ne sait pas
|
1,4
|
1,3
|
0
|
0,3
|
L’OFDT montre un impact nul de la loi HPST sur l’évolution des
consommations des mineurs de 16 ans, et même une augmentation de
celles des mineurs de 17 ans.
Cela pose la question de la mise en place d’équipements de
vérification automatique en caisse. Le fait que le législateur
n’ait pas prévu une autorité de contrôle avec des moyens (police
judiciaire et agents de la force publique) rend la faisabilité
du constat de l’infraction très difficile voire impossible,
alors que les contrôles répétés sont préconisés par la
littérature internationale qui montre que cela améliore le
respect de l’interdiction de la vente aux mineurs (tout comme
les contrôles routiers d’alcoolémie aléatoires améliorent les
mesures prises en matière de conduite en état d’ivresse et
d’accidents de la route).
À quel échelon déployer les politiques
publiques ?
L’échelle européenne est-elle un échelon pertinent ? L’échelle
municipale est-elle un bon échelon de mise en œuvre ?
Concernant le niveau européen, les mises en œuvre de la stratégie
de l’OMS en Europe sont très variables car très dépendantes des
circonstances locales. Mais pour que les priorités de l’OMS
aient une influence, il faut nécessairement la combinaison d’une
véritable volonté politique et d’une préoccupation de réduire
les dommages liés à l’alcool (Rice,
2019

). On peut aisément imaginer la difficulté de construire une
volonté politique ferme autour des 27 États-membres aux intérêts
économiques forts dans le secteur, quoique variables.
Au niveau des régions françaises, le partage de la gouvernance
entre le Préfet et les agences régionales de santé (ARS) donne
lieu à des manques de coordination (Cour des comptes, 2016

,
p. 118-122) : en effet, depuis 2009 et la loi HPST, les ARS
déclinent les priorités nationales au niveau régional, mais ce
de manière variable, nouant différents partenariats, coordonnant
différents schémas d’offres de soins ainsi que l’offre
médico-sociale, le tout assuré par des modes de financement
multiples mais une coordination interministérielle (la Mildeca)
qualifiée de « sommaire et fragilisée par la rotation des chefs
de projets » (Cour des comptes, 2016

, p. 119). De l’autre côté,
les Préfets de départements coordonnent les politiques
nationales autres que ce versant santé, et animent les
différentes instances territoriales (essentiellement pour la
sécurité routière), avec les interventions possibles des
municipalités, départements et de la région.
Cependant, d’autres qualifient l’effet des politiques qui se
déploient à l’échelon municipal d’incertain (Anderson et coll.,
2018

),
là où des travaux insistent au contraire sur l’effet positif de
l’implication de tous les acteurs pour une action régionale
concertée (sur le Canada, Giesbrecht et coll.,
2016

). L’Écosse avec ses
Alcohol Licensing Boards au niveau
local (Wright, 2019

; voir aussi le chapitre de cette
expertise sur l’effectivité des mesures visant à restreindre
l’accès aux boissons alcooliques) suggère qu’une décision
top-down est insuffisante mais que les mécanismes de
responsabilité entre le local et le national doivent être bien
définis en amont de la mise en œuvre pour que l’autonomie locale
ne contrevienne pas aux objectifs nationaux.
Le système de soins et les professionnels de
première ligne au cœur
des politiques publiques
Depuis plusieurs années, de nombreuses voix réclament de mieux
associer et coordonner les professionnels de santé, proches des
consommateurs, pour la prévention et l’accompagnement. Le plan
gouvernemental 2004-2008 préconisait déjà un système de soins
plus accessible et plus efficace, le renforcement de l’offre et
de la coordination des soins. Le plan gouvernemental suivant
(2008-2011) en appelait à la diversification du dispositif de
prise en charge sanitaire et sociale des addictions en ciblant
les populations exposées et vulnérables, tandis que la Cour des
comptes (2016

) dénonçait une trop grande dispersion des prises
en charge dans le secteur médico-social et associatif. Le plan
gouvernemental de lutte contre les addictions en cours
(2018-2022) énonce parmi ses axes prioritaires de structurer le
parcours de santé en addictologie.
Impact de ces politiques publiques par rapport à
d’autres déterminants
Nombreuses sont les études qui mettent en évidence que les
politiques publiques ne font pas tout : elles interagissent avec
des facteurs socio-économiques (urbanisation, tertiarisation,
vieillissement – les hommes notamment –, revenu, éducation
féminine, taux d’emploi des femmes, âge des mères) et qu’en
conséquence, elles ne peuvent avoir que des effets partiels sur
le niveau de consommation et les dommages. Par exemple, dans une
étude sur la France depuis 1960, Cogordan et coll.
(2014

) montrent l’effet de certaines politiques publiques (baisse
du taux d’alcoolémie au volant, taxation, interdiction de la
publicité, âge minimum pour acheter de l’alcool) sur la baisse
de la consommation d’alcool avec l’effet conjoint d’événements
socio-économiques (augmentation du travail des femmes,
augmentation du revenu, phénomène d’urbanisation). De la même
manière, plusieurs études portent sur le poids relatif des
politiques de contrôle et de facteurs socio-économiques entre
les années 1960 et les années 2000 (portant sur la Finlande, la
Norvège, la Pologne, la Suisse, l’Espagne, l’Italie [Allamani et
coll., 2014

] ; sur les trajectoires différenciées des pays du Nord
[Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, Pologne] et
des pays plus au Sud [France, Italie, Espagne, Suisse], voir
Voller et coll., 2014

; Voller et Allamani,
2014

). Au-delà de l’évidence contextuelle (toute politique se
déploie dans un contexte pétri d’interactions avec de multiples
acteurs, de nombreuses mesures, etc.), les conclusions à en
tirer en termes de recommandations n’ont rien d’évident.
Evidence-based policies et mesures démontrées
les plus
coût-efficaces
Une grande partie de la littérature internationale étudie
l’efficacité des politiques de réduction des risques alcool. Sans
reprendre longuement ce qui est détaillé dans le chapitre de cette
expertise sur l’efficacité des mesures visant à restreindre l’accès
aux boissons alcooliques, signalons que les mesures les plus
coût-efficaces sont :
• la mise en place d’un prix minimum et de la réduction des
points de vente (en Irlande, cf. Daroven et coll.,
2018

) ;
• l’augmentation des prix de l’alcool notamment
via
l’augmentation de la taxe d’accise et la restriction de la
disponibilité d’alcool sont hautement coût-efficaces pour
réduire les dommages (Anderson et coll.,
2009

; Baccini et Carreras,
2014

; Chisholm et coll.,
2018

; OMS,
2018

) ;
• les restrictions de commercialisation notamment avec
l’augmentation de l’âge minimum légal pour acheter de
l’alcool
4
Une étude portant sur la
Nouvelle-Zélande montre que l’abaissement de l’âge
minimum légal pour acheter de l’alcool a été suivi
de hausses à long terme des dommages sur la route
attribués à des conducteurs alcoolisés entre 15 et
19 ans (Kypri et coll., 2016).
(Baccini et Carreras,
2014

; Chisholm et coll.,
2018

).
Dans cette perspective, on peut saluer le fait qu’un meilleur
encadrement de la vente des boissons alcoolisées soit un axe
prioritaire du plan gouvernemental entamé en 2018 et programmé
jusqu’en 2022, mais celui-ci devra se traduire par des actions
concrètes.
Sans développer ce qui l’est dans un chapitre dédié dans cette
expertise, la régulation du marketing pour l’alcool est aussi une
approche coût-efficace (Anderson et coll.,
2009

;
OMS, 2018

).
Pour les jeunes, la contradiction entre l’interdiction de leur
vendre de l’alcool, l’injonction à ne pas consommer et
l’omniprésence de la publicité sur l’alcool semblent constituer un
frein pédagogique à la cohérence et la compréhension du message
(OFDT, 2013

). Dans le plan gouvernemental en cours (Mildeca,
2018

),
l’une des ambitions est de réduire l’exposition des jeunes au
marketing des producteurs d’alcool.
À partir d’une revue de littérature internationale, l’OFDT a évalué
les stratégies complémentaires à l’interdiction de vente aux
mineurs, classées par niveau d’efficacité (efficacité démontrée –
résultats prometteurs – efficacité non démontrée) et par niveau de
preuve (fort – bon – faible). Les mesures combinant à la fois une
efficacité démontrée et un fort niveau de preuve pour réduire la
consommation d’alcool chez les jeunes sont les suivantes :
• les interventions auprès des familles pour prévenir l’abus
d’alcool chez les moins de 18 ans ;
• les interventions utilisant le web auprès des étudiants
universitaires et des jeunes en général ;
• les interventions motivationnelles (individuelles) auprès des
adolescents pour les consommations à faible risque ;
• la taxation de l’alcool.
Les mesures de lutte contre l’alcool au volant, comme la limite du
taux d’alcoolémie pour les conducteurs (
Blood Alcohol
Concentration ou BAC) et les contrôles d’alcoolémie
aléatoires, sont aussi coût-efficaces (Anderson et coll.,
2009

). De
ce point de vue, la France devrait continuer à faire ce qu’elle met
déjà en œuvre. Cependant, notons qu’une comparaison de l’Écosse qui,
en 2014, a baissé sa BAC de 0,08 à 0,05, avec l’Angleterre et le
Pays de Galles (qui l’ont laissée inchangée), montre que les effets
sur le niveau de consommation et les accidents de la route n’ont pas
été aussi importants qu’escomptés : l’efficacité est conditionnée à
l’effectivité de la mise en œuvre avec des contrôles routiers
d’alcoolémie, et que cela s’accompagne de mesures d’éducation à la
santé, de restrictions sur la publicité et d’avertissements (Lewsey
et coll., 2019

).
Enfin, auprès des buveurs les plus à risque, ce sont les
interventions individuelles qui seraient coût-efficaces (Anderson et
coll., 2009

).
Pour conclure cette partie, notons qu’en Russie, l’introduction à
partir du milieu des années 2000 de plusieurs des mesures précitées
pour réduire la consommation d’alcool (un prix minimum pour la
vodka, la baisse de la disponibilité de l’alcool avec la restriction
des heures de ventes, la lutte contre l’ivresse au volant, ainsi que
la restriction de la publicité) et de mesures de lutte contre
l’alcool non recensées ici, s’est accompagnée d’une chute de la
mortalité liée à l’alcool de 25 % entre 2004 et 2014 (Rice,
2019

).
Repères de consommation
Les repères de consommation d’alcool (
guidelines en
anglais) correspondent au seuil maximum de consommation
recommandé à une population pour réduire les risques et ne font
pas l’objet d’un consensus dans la littérature. La situation
varie d’un pays à l’autre : certains n’en ont pas adopté ;
d’autres, comme la Namibie ou l’île Maurice, émettent des
repères de consommation d’alcool compris dans une stratégie de
lutte contre les maladies non transmissibles, tandis que
d’autres pays, comme les États-Unis et les Pays-Bas (IARD,
2017

)
les ont intégrés dans des recommandations nutritionnelles plus
larges ou encore que la Suisse traite de la consommation
d’alcool dans une stratégie nationale et globale des addictions.
La Grande-Bretagne dispose quant à elle de repères de
consommation d’alcool « en soi », qui ne sont ni partie d’un
plan addictions, nutrition ou maladie. Les États-Unis, la
Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Australie émettent aussi des
recommandations adaptées pour les plus de 65 ans, en raison de
leur vulnérabilité particulière aux effets de l’alcool (« le
vieillissement amène des modifications physiologiques
aboutissant à une moindre tolérance aux effets de l’alcool (...)
la polypathologie et son corollaire, la polymédicamentation
fréquente chez le sujet âgé, (...) le rendent particulièrement
sensible aux effets toxiques de l’alcool [et] ces effets sont
majorés par la coexistence de troubles cognitifs », Paille,
2014

,
p. 62).
Afin qu’elles aient un impact, la nécessité de communiquer sur
les raisons d’application des repères de consommation et
notamment sur le lien entre la consommation d’alcool et un
certain nombre de risques est mise en avant (Rosenberg et coll.,
2017

). Une étude de la couverture médiatique des
guidelines
dans les journaux gratuits montre que celle-ci est très faible
et souligne le manque de communication (Wolfaardt et coll.,
2018

), le manque de transparence et d’objectivité des repères
fondant une recommandation pour les améliorer (Holmes et coll.,
2018).
En France, Santé publique France et l’Institut national du cancer
ont adopté en 2017 les repères et les recommandations
suivants :
• faire connaître les nouveaux repères (maximum 10 verres
standards par semaine et maximum 2 verres par jour et
pas tous les jours) ;
• faire figurer sur les bouteilles le nombre contenu de
verres standards à 10 grammes ainsi que le nombre de
calories par verre standard.
Pour que ces repères aient une plus grande efficacité, ces
instituts ont aussi recommandé d’unifier le discours sur les
risques et les repères entre les différents ministères et les
institutions publiques, ainsi que de créer, avec les taxes, un
fonds dédié aux actions publiques de prévention et à la
recherche sur l’alcool.
Avertissements sanitaires apposés sur les
publicités et les contenants d’alcool
Le plan gouvernemental en cours de lutte contre les addictions
(2018-2022) reprend dans ses axes prioritaires une mesure du
plan priorité prévention : l’augmentation de la visibilité et de
la lisibilité du pictogramme sur le SAF sur les bouteilles
d’alcool (Mildeca, 2018

). Mais que dit la littérature
internationale concernant l’efficacité de ces messages
sanitaires apposés sur les contenants et les publicités pour les
boissons alcooliques ? De nombreux chercheurs en appellent à des
recherches supplémentaires jugées trop rares, afin d’avoir un
avis plus précis sur l’impact des différents messages
(Martin-Moreno et coll., 2013

; Miller et coll.,
2016

; Al-Hamdani et Smith, 2017

; Robertson et coll.,
2017

; Wettlaufer, 2018

), et de développer en outre les
travaux avec des approches qualitatives (Dossou et coll.,
2017

).
Sans détailler ici ce qui est développé ailleurs dans cette
expertise (cf. chapitre « Actions de prévention : messages et
comportements », section « Avertissements sanitaires »), les
messages généraux auraient une efficacité limitée, contrairement
aux messages spécifiques (comme ceux à destination des femmes
enceintes par exemple) : beaucoup de travaux insistent sur la
nécessité d’avoir des messages plus spécifiques sur les risques
santé encourus, notamment en fonction du sexe et selon les types
d’alcool (Hassan et Shiu, 2018

). Une étude sur des étudiants italiens
a conclu à un impact différencié selon les buveurs, les messages
ayant plus d’impact sur les consommateurs modérés et moins sur
les consommateurs à risque (Annunziata et coll.,
2016b

.). L’échec à toucher les buveurs à haut risque a aussi été
mis en avant à partir d’un panel d’un millier d’Australiens de
18 à 45 ans (Coomber et coll.,
2016

).
Les comparaisons avec ce qui se pratique pour le tabac pourraient
enrichir les réflexions (Hassan et Shiu,
2018

). En ce qui concerne le tabac justement, la stratégie
d’étiquetage n’était pas isolée mais appartenait à un programme
large et cohérent (à côté de l’éducation à la santé notamment).
Autrement dit, pour les chercheurs, le
labeling n’est pas
envisagé comme une stratégie autosuffisante, et doit notamment
être assorti de campagnes de communication dans les médias :
alors seulement l’inscription de ces messages peut s’avérer
efficace, et même plus efficace que de faire figurer le taux
d’alcool (Hobin et coll., 2017

). D’ailleurs, une étude en France
auprès de femmes enceintes ou en situation
post-partum a
montré que l’avertissement introduit en 2007 est bien connu,
mais que les risques associés à la consommation de vin et de
bière pendant la grossesse, eux, sont plutôt méconnus (Dumas et
coll., 2018

), d’où la nécessité d’accompagner le pictogramme de campagne
de prévention pour faire connaître les risques (Toutain,
2017

; cf. aussi chapitre : « Syndrome d’alcoolisation fœtale et
consommation d’alcool dans la période périnatale : fréquences et
facteurs associés »).
Sinon, la taille et l’emplacement des messages gagneraient à être
changés pour avoir plus d’impact (l’étude de Pham et coll.,
2018

,
fait apparaître que le
design optimal pour capter
l’attention est grand et rouge), tandis qu’une étude menée sur
des étudiantes britanniques montre que la consommation serait
plus lente quand le contenant fait figurer un message ou un
pictogramme (Stafford et Salmon,
2017

). En outre, les messages choquants seraient efficaces pour
réduire les consommations d’alcool, y compris chez les jeunes
buveurs (
ibid.). D’ailleurs, une expérience menée sur 60
étudiantes britanniques conclut que le pictogramme a un impact
plus important que l’avertissement écrit sur les intentions de
réduire sa consommation (Wigg et Stafford,
2016

).
Pictogramme ou message écrit d’avertissement, il n’y a pas de
consensus car trop peu d’études ont comparé ces différents
formats. Mais bon nombre de travaux proposent de nouvelles
options, qui seraient également nécessaires pour mieux informer
les consommateurs sur l’alcool : faire figurer la liste des
ingrédients, le nombre de calories (Martin-Moreno et coll.,
2013

). Ces informations sont même globalement souhaitées par les
consommateurs de différents pays (sur le Canada : Hobin et
coll., 2017

et Vallance et coll. 2018

; sur l’Italie, la France, l’Espagne
et les États-Unis : Annunziata et coll.,
2016a

). Mais selon leurs habitudes de consommation et leurs
attitudes par rapport aux informations nutritionnelles, ce que
les consommateurs voudraient voir apparaître sur les bouteilles
varie : autrement dit, les consommateurs n’ont pas les mêmes
préférences entre voir figurer le prix, les informations
nutritionnelles, un message de santé et l’indication du nombre
d’unités d’alcool dans le contenant et du nombre d’unités à ne
pas dépasser (figure 9.1

pour
une étude sur l’Italie, la France, l’Espagne et les États-Unis ;
Annunziata et coll., 2016a

).
Par ailleurs, les différents travaux insistent sur la nécessité
d’une rotation fréquente des messages de santé pour éviter que
les consommateurs ne s’y habituent et que, ce faisant, l’effet
du message diminue (Annunziata et coll.,
2016b

; Coomber et coll., 2017

; Dossou et coll.,
2017

). Quelques études soulignent des voies d’amélioration pour le
labelling, les consommateurs prêtant une attention
minimum aux avertissements (Kersbergen et Field,
2017

) : par exemple, des expérimentations montrent que des
messages plus détaillés notamment sur le risque de cancer
auraient un impact supérieur (Miller et coll.,
2016

)
sachant par ailleurs que l’acceptabilité des mesures est plus
forte chez les personnes conscientes du lien entre alcool et
cancer (Bates et coll., 2018

).
Enfin, notons que plusieurs voix s’élèvent contre le fait que
l’inscription de messages sur les contenants soit décidée par
les industriels de l’alcool (volontariat comme en Australie en
2011 [Coomber et coll., 2018

] ou en Nouvelle-Zélande [Tinawi et
coll., 2018

]) et préfèrent qu’elle s’inscrive dans une loi rendant la
mesure obligatoire. C’est pourtant le choix fait par l’Union
européenne. En effet, les États-membres ont approuvé la mise en
place d’un étiquetage sur les boissons alcoolisées fondé sur le
volontariat des industriels suite au plan d’action 2012-2020 de
l’OMS Europe visant à réduire l’usage nocif d’alcool. Un rapport
de la Commission européenne de 2017 conclut à une mise en œuvre
volontaire et s’en remet à l’autoréglementation du secteur
(Commission européenne, 2017

; voir aussi Vaqué,
2017

). Un rapport récent de l’OMS, faisant un état des lieux des
pratiques en Europe, recommande notamment une réglementation
obligatoire (plutôt que de s’en remettre au volontariat de
l’industrie alcoolière) qui permet notamment de contrôler que
les messages étiquetés sont en phase avec les recommandations
scientifiques et de surveiller la mise en œuvre (OMS,
2020

).
Principales recommandations déjà
existantes
Ce qui est frappant dans les littératures grise et scientifique,
française et internationale, c’est qu’il existe déjà de
nombreuses recommandations, largement disponibles et
récurrentes. À titre d’exemples, se trouvent ci-dessous, pour
l’échelle internationale, les priorités d’actions de l’OMS
Europe pour 2012-2020 et pour le niveau français, les
recommandations formulées en 2016 par la Cour des comptes (que
l’on retrouve dans nombre de publications)
(tableau 9.III

).
Tableau 9.III Principaux domaines d’action et recommandations
de l’OMS 2012-2020 et la Cour des comptes
(2016 )
)
|
Priorités d’action OMS
2012-2020
|
Recommandations Cour des comptes
2016 
|
|
Guidance, sensibilisation et
engagement
Réponse des services de
santé
Actions dans les communautés et lieux
de travail
Contre-mesures et politiques pour
l’alcool au volant
Disponibilité de l’alcool
Marketing des boissons
alcoolisées
Politiques de prix
Réduire les conséquences négatives de
la
consommation et de l’intoxication à
l’alcool
Réduire l’impact sur la santé publique
de l’alcool illicite
et de l’alcool produit
informellement
Surveillance et suivi
|
Adapter, à partir de programmes de
recherche renforcés,
les messages en
direction des consommateurs à risque
Développer la prévention et la
communication vers les
publics les plus
fragiles
Supprimer l’autorisation d’introduction
et de
consommation sur le lieu de
travail
Renforcer la formation initiale et
continue à l’addictologie, développer
l’implication des personnels de santé dans le
repérage précoce des consommateurs à risque,
inclure le RPIB (repérage précoce et intervention
brève) dans la ROSP (rémunération sur objectifs de
santé publique)
Relever la fiscalité sur les boissons
alcoolisées pour diminuer les consommations à
risque et préparer la mise en place d’un prix
minimum
Appliquer à tous les supports
numériques les restrictions de publicité en faveur
des boissons alcooliques
Accroître la probabilité des contrôles
et des sanctions immédiates en ayant recours à un
seul appareil portatif homologué de mesure de
l’alcoolémie contraventionnelle et délictuelle, en
augmentant le montant des amendes forfaitaires et
en appliquant un régime de contraventions
immédiates jusqu’à une alcoolémie de 1,2 g par
litre de sang
|
L’enseignement, la recherche et la prévention en matière
d’alcool, sous-dotés, doivent avoir plus de moyens : le rapport
de la Cour des comptes (2016

) se basant sur une enquête de la
Fondation pour la recherche en alcoologie (FRA), estimait à 3,5
millions d’euros annuels la recherche – publique et privée – sur
l’alcool (soit 0,53 €/habitant), un budget 27 fois inférieur au
seul budget d’un organisme public américain de recherche sur
l’alcool. Si plus de moyens doivent leur être accordés, ceux-ci
doivent être indépendants de l’industrie alcoolière : « chacun
doit être à sa place. Il est irréaliste de penser possible un
consensus entre celles et ceux dont le métier est de vendre de
l’alcool et les logiques de santé publique » (CESE, 2019

,
p. 27).
Il ne faut pas opter pour une autorégulation du secteur (pourtant
choisie par l’UE). Il est même question de financer les
alcooliers pour la promotion de la consommation d’alcool
responsable (CR de la Journée interassociative « Plan National
Alcool » publié dans Addiction et Addictologie,
2018
5
). Or dans les régulations volontaires, les
lobbies prônent la « modération », concept confus et
inefficace.
L’approche globale avec la combinaison de mesures : à partir de
la littérature internationale, l’OFDT (2013

) avance qu’élever
l’âge pour la vente d’alcool au-delà de 18 ans (comme l’ont fait
les États-Unis dans les années 1970 et 1980) est une mesure
ayant un impact positif sur la réduction du nombre d’accidents
de la route et les prévalences de consommations ; cette mesure
doit cependant être inscrite dans une politique plus large
comprenant à la fois des mesures d’éducation et des mesures de
contrôle.
En matière de consommation des mineurs, et pour mieux faire
respecter l’interdiction de vente d’alcool aux moins de 18 ans,
l’OFDT a recommandé les actions éducatives et la formation des
débitants, des mineurs, de l’entourage des jeunes, pour
dénormaliser les pratiques, ainsi que les approches
communautaires et participatives (OFDT, 2013

).
La formation des professionnels de santé (sur ce point, voir plus
précisément le chapitre dédié de cette expertise), et en premier
lieu, des médecins généralistes au repérage précoce et à
l’intervention brève (RPIB) (selon la Cour des comptes, 2016

,
seuls 2 % l’utilisent), ce qui est également préconisé par le
CESE (2019

).
Points en débat dans la littérature
internationale
Quel type d’approche ?
Sans que cela ne puisse aujourd’hui faire l’objet de
recommandations claires, signalons qu’un point en débat dans la
littérature porte sur le type d’approche, c’est-à-dire faut-il
une approche ciblée sur l’alcool ou l’intégrer dans une approche
générale des addictions, faut-il une approche ciblée sur
certaines catégories (âge, sexe, CSP, type de buveurs etc.) ou
universelle, faut-il une approche individuelle ou
collective ?
L’institut de recherche et de documentation en économie de la
santé (IRDES) rappelle dans son rapport de 2016 qu’en France,
l’action publique contre l’alcoolisme a oscillé « entre une
approche ciblée sur l’alcool » et « un traitement global des
addictions ». Aujourd’hui, la littérature montre que le débat
reste ouvert : si certains pensent qu’une approche globale des
addictions serait peut-être plus pertinente (CESE, 2019

),
d’autres pensent au contraire qu’une approche par produit serait
plus appropriée, avec notamment un Plan National Alcool
(Naassila, 2018

). Dans son plan pour 2018-2022, le
gouvernement français actuel semble avoir opté pour l’approche
générale, en intégrant l’alcool dans une stratégie globale de
lutte contre les addictions (Mildeca,
2018

).
La Cour des comptes recommandait dans son rapport de 2016

« une
politique unifiée de lutte contre les consommations nocives
ayant pour but d’infléchir les comportements des consommateurs à
risque, qui doivent être responsabilisés dans leur rapport
individuel à l’alcool, tout en sensibilisant l’ensemble de la
population aux risques des consommations nocives ». La
Grande-Bretagne écartait en 2016 d’avoir des recommandations
spécifiques pour différents âges ou groupes sociaux (et adoptait
comme repère de consommation pour tous 14 unités par semaine,
Department of Health,
2016

), tandis qu’en France, les plans gouvernementaux depuis 2008
prônent plutôt le ciblage des populations les plus exposées et
vulnérables, et ce même si la régulation publicitaire, les
avertissements sanitaires, les campagnes dans les médias sont
plutôt populationnelles (mises à part les actions ciblées sur
les femmes enceintes).
Pour dépasser l’opposition classique entre mesures en population
générale et mesures ciblées, Rice
(2019

) propose le concept « d’universalisme proportionné » soit des
mesures qui peuvent être destinées à l’ensemble de la population
mais dont l’intensité de l’effet doit être plus importante parmi
ceux en ayant le plus besoin. Mais comment définir « les
catégories en ayant le plus besoin » ? Dans la littérature, on
trouve d’abord la nécessité d’adapter les messages selon les
buveurs : Com-Ruelle et Célant
(2013

) ont montré l’évolution de la prévalence des profils
d’alcoolisation des buveurs adultes français entre 2002 et 2010,
et plus précisément des risques différenciés selon le sexe,
l’âge et la catégorie socio-professionnelle :
• risque ponctuel : si les hommes sont 2,6 fois plus
touchés par les API (alcoolisations ponctuelles
importantes), ces dernières concernent aussi beaucoup
les jeunes et sont moins nombreuses à mesure du
vieillissement. Sur la période, l’accroissement du
risque ponctuel est marqué pour les jeunes femmes et
pour certaines CSP (catégories socio-professionnelles).
Les cadres et professions intellectuelles ainsi que les
professions intermédiaires, hommes et femmes, sont
proportionnellement les plus touchés par le risque
ponctuel. Les chômeurs comme les chômeuses arrivent en
troisième position des plus touchés par le risque
ponctuel ;
• risque chronique : les âges intermédiaires sont les plus
touchés par le risque chronique. Chez les hommes, le
risque chronique touche en premier lieu les chômeurs,
puis les employés de commerce et les agriculteurs, et
chez les femmes, les artisanes-commerçantes et les
cadres et professions intellectuelles.
Une étude portant sur la Suisse met en évidence les inégalités
socio-économiques qui font que les politiques de contrôle n’ont
pas le même impact selon le niveau d’éducation, et en appelle
donc à des interventions ciblées (Sandoval et coll.,
2019

).
Beaucoup d’études portent spécifiquement sur les jeunes.
Plusieurs étudient les milieux universitaires (Kypri et coll.,
2018

; Jernigan et coll., 2019

), et appellent à développer des
politiques de prévention sur les campus, préconisant souvent la
participation des étudiants à la co-construction des mesures
(Van Hal et coll., 2018

; Larsen et coll.,
2016

).
Let it hAPYN (Peloza et coll.,
2016

)
par exemple fait le point sur les meilleures pratiques
(tableau 9.IV

).
Tableau 9.IV Principaux domaines des politiques de prévention
de l’alcool et leurs meilleures pratiques selon le projet
Let it hAPYN (2013-2016) (d’après Peloza et
coll., 2016 )
)
|
Politiques
|
Meilleures pratiques
|
|
Taxes sur l’alcool et autres contrôles
du prix
|
Taxes sur l’alcool
augmentées
|
|
Réguler l’accessibilité physique par
des restrictions des horaires et des lieux de
vente et la densité des points de
vente
|
Interdiction des ventes, âge minimum
légal pour l’achat, rationnement, monopole
gouvernemental des ventes de détail, restrictions
des heures et jours de vente, restriction de la
densité des détaillants, modifier la
disponibilité
|
|
Réguler les publicités et le marketing
des produits alcoolisés
|
Restrictions de l’exposition par la
loi : une interdiction des publicités de l’alcool
et du marketing autre
|
|
Modifier le contexte de
consommation
|
Augmenter la mise en application de
politiques sur lieu et des exigences
légales
|
|
Mesures sur l’alcool au
volant
|
Contrôles de non-consommation,
alcotests au hasard, abaisser les taux limites de
l’alcoolémie, suspension de permis, taux
alcoolémie zéro pour jeunes conducteurs, permis
progressif pour les conducteurs
novices
|
|
Éducation et persuasion : donner
l’information aux adultes et aux jeunes
particulièrement par les médias de masse et les
programmes d’éducation à l’alcool en milieu
scolaire
|
Devrait être mise en œuvre comme un
supplément aux autres politiques efficaces de
contrôle de l’alcool atteignant des buts
spécifiques
|
|
Conduire des ciblages et des
interventions brèves dans des actions de santé ;
rendre plus disponible des programmes de
traitement
|
Interventions brèves des buveurs à
risque, désintoxication, thérapies verbales, aide
mutuelle/auto
|
En arrière-plan grisé, selon les résultats de
Inchley et coll. (2016 ), les 3 approches politiques les
plus efficaces.
), les 3 approches politiques les
plus efficaces.
Concernant plus particulièrement les adolescents, des chercheurs
ont analysé leur comportement dans plusieurs pays d’Amérique du
Nord et d’Europe entre 2002 et 2014 afin de comprendre pourquoi
dans certains pays européens il existe une proportion croissante
d’adolescents abstinents sur cette période et montrent que c’est
concomitant à l’augmentation des dépenses publiques pour la
santé et les familles (Vieno et coll.,
2018

). D’autres, analysant les adolescents de 13-15 ans de 37 pays
soutiennent que la consommation hebdomadaire est liée aux
politiques de contrôle, et que les états d’ébriété sont liés aux
modes de consommation des adultes. C’est pourquoi ils
recommandent d’une part, de diminuer la disponibilité de
l’alcool et d’interdire la publicité (stratégies efficaces pour
réduire l’alcoolisation fréquente) et d’autre part, de changer
les normes et les modes de consommation dans la population
adulte pour réduire la prévalence de l’ivresse (Bendtsen et
coll., 2014

).
Quid de l’éducation à la santé ? Cette mesure est en débat (et un
chapitre de cette expertise y est consacré). Certains la
recommandent prioritaire (Cohn, 2015), de nombreux travaux
l’évoquent en complément d’autres mesures, ou encore certains
jugent son effet très limité sur les habitudes de consommation
(Mold, 2016

).
Approches alternatives ou faut-il s’inspirer
d’autres luttes ?
Dans cette réflexion, à savoir peut-on s’inspirer de politiques
publiques mises en œuvre dans la réduction de dommages liés à
d’autres substances que l’alcool, c’est le tabac qui est, pour
certains, source d’inspiration. On a d’abord trouvé l’idée
d’utiliser le concept d’« alcoolisation passive » (Naassila,
2018

), dans la même veine que les études qui utilisent le concept
de «
Alcohol Harm To Others » (AHTO), pour souligner que
les dommages liés à l’alcool ne concernent pas (forcément) que
le consommateur et peuvent affecter son entourage (Warpenius et
Tigersteedt, 2016

). En ce sens, l’idée est similaire au
concept de « tabagisme passif ». Selon certains, cela pourrait
faciliter une prise de conscience plus grande de la population
sur les dommages liés à l’alcool et, peut-être, avoir plus de
potentiel pour créer la volonté politique (Warpenius et
Tigersteedt, 2016

), alors que ne pas faire de la
réduction des AHTO un objectif de santé publique empêchera
d’appréhender le problème autrement que par une approche
curative individuelle, consistant notamment à fournir un
traitement aux dépendants à l’alcool (Karriker-Jaffe et coll.,
2018

).
Par ailleurs, faudrait-il adopter une convention internationale
comme pour le tabac ? Certains préconisent de développer une
stratégie internationale graduelle, en commençant avec des
instruments non contraignants plutôt que d’attaquer d’emblée
avec une convention internationale, alternative politiquement
moins réaliste (Taylor et Dhillon,
2012

). Pouvant fournir un argument en ce sens, Gneiting et Schmitz
(2016

), comparant les cas du tabac et de l’alcool, ont mis en
évidence une différence majeure : la coalition en faveur de plus
de contrôle du tabac a réussi à créer et maintenir un consensus
sur les solutions, alors que le champ de l’alcool est au
contraire très divisé.
De manière plus isolée, quelques pistes mériteraient d’être
creusées : par exemple, un article propose de baisser la
quantité d’éthanol contenue à quantité égale de produit fini
(Anderson et coll., 2018

), mais il faut voir si cela ne
reviendrait pas à créer un équivalent pour l’alcool des paquets
«
light » pour le tabac. Plus nombreuses, d’autres
études préconisent de changer d’approche pour se focaliser sur
le nombre de grammes d’alcool à ne pas dépasser (plutôt que ce
qui pratique aujourd’hui autour d’un nombre de verres, plus
sujet à interprétation individuelle, le contenant pouvant être
en lui-même variable mais la recommandation être aussi fonction
du type d’alcool consommé). Il s’agirait donc de s’inspirer de
ce qui se fait pour le poids corporel avec les recommandations
caloriques journalières pour un homme ou une femme faisant ou
non de l’exercice, car cela permettrait des repères plus clairs
et sans stigmatisation de l’addiction ou la dépendance (Nutt et
Rehm, 2014

).
Enfin, on a trouvé une comparaison avec le cannabis qui posait la
question suivante : quid de la tolérance zéro pour l’alcool au
volant comme pour le cannabis et comme l’a introduit la
République Tchèque
6
En 1953, mais la mise en œuvre et le
système de sanction ont pêché jusqu’en 2010 où sont
introduits des contrôles d’alcoolémie
systématique.
? Mais la solution ne semble pas évidente, les
pays ayant les limites de concentration d’alcool dans le sang
les plus strictes n’ayant pas de meilleurs résultats en termes
de sécurité routière (Castillo-Manzano et coll.
2017

).
Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons analysé la littérature internationale
disponible à l’aune des politiques publiques de réduction des
dommages liés à l’alcool. En France, dans un contexte de baisse de
la consommation depuis la seconde guerre mondiale, plusieurs faits
marquants s’imposent aux décideurs : un phénomène de binge
drinking, des consommations à risque encore importantes, un
coût social particulièrement important comparé à d’autres substances
et d’autres pays, l’alcool comme deuxième cause de mortalité. En
face, une filière qui pèse de tout son poids économique, avec un
lobbying actif et puissant pour défendre ses intérêts économiques,
quitte à brouiller la cohérence des messages publics et à faire
passer les enjeux de santé publique au second plan.
Ceci étant posé, nous avons vu qu’il y avait dans la littérature un
certain nombre de thèmes très étudiés et (plus ou moins)
consensuels. Premièrement, les mesures les plus coût-efficaces sont
les politiques de réduction des risques (prix minimum, augmentation
des taxes, réduction des points de vente et de leurs heures
d’ouverture etc.), ainsi que les interdictions de la publicité, les
politiques de lutte contre l’alcool au volant et des mesures
complémentaires spécifiquement à destination des mineurs.
Deuxièmement, la situation des pays concernant l’adoption de repères
de consommation est très variable selon les pays (en avoir ou non,
spécifiques à l’alcool ou englobés dans une approche plus générale
des addictions ou de la nutrition, etc.) mais il semble que leur
impact soit d’autant plus important qu’il y ait une communication
importante sur les raisons qui les motivent et notamment le lien
entre alcool et cancer.
Troisièmement, la littérature sur l’étiquetage est assez consensuelle
sur le manque d’études d’impact sur le fait de mettre des messages
ou des pictogrammes de prévention sur les contenants et qu’il
faudrait développer les recherches en la matière. Au-delà de ce
fait, les résultats sont contrastés par exemple sur la question de
savoir s’il vaut mieux un texte qu’un pictogramme. Néanmoins, on
peut retenir que ces inscriptions doivent s’inscrire dans une
stratégie globale et cohérente, avec les quelques éléments
suivants : l’étiquetage semble échouer à toucher les buveurs les
plus à risque ; les messages spécifiques (par risque, par type
d’alcool, par sexe, etc.) seraient plus efficaces que les messages
universels ; dans tous les cas, une rotation des messages est
nécessaire pour éviter l’accoutumance et la perte d’efficacité ; la
taille, l’emplacement, voire la couleur mériteraient d’être à
nouveau étudiés. La perspective d’un étiquetage nutritionnel est à
envisager également. Enfin, cet étiquetage ne doit pas être laissé
au volontariat de l’industrie alcoolière mais doit être l’objet
d’une politique publique contraignante, obligatoire et uniforme.
Quatrièmement, des recommandations déjà existantes foisonnent :
développer un plan global qui combine de manière cohérente plusieurs
types de mesures coût-efficaces ; augmenter les moyens de la
recherche, de l’enseignement et de la prévention sur l’alcool ; une
régulation obligatoire et non une autorégulation (volontariat) en
matière de prévention et d’étiquetage ; une formation de tous les
types de professionnels concernés, et notamment au repérage précoce
et intervention brève (RPIB).
En revanche, nous avons vu que les débats restaient ouverts sur le
type d’approche la plus pertinente (ciblée sur l’alcool ou générale
pour différentes addictions, ciblée sur certains groupes ou en
population générale, individuelle ou collective), ainsi que sur
l’intérêt de s’inspirer de ce qui se fait pour d’autres substances
et en premier lieu pour le tabac avec la construction d’un consensus
large, l’implication de tous les professionnels de santé, l’idée
d’« alcoolisme passif », une convention internationale, etc.
Enfin, nous avons pu trouver un certain nombre d’éléments relatifs à
la construction de ces politiques de réduction des dommages liés à
l’alcool, comme le fait de mener un large débat social et politique
et de chercher à agir sur les aspects cognitifs et culturels, la
nécessaire volonté politique pour maintenir la cohérence des
messages et des politiques publiques face à un lobby puissant, le
fait à la fois d’inscrire les mesures dans la durée et de trouver
les moyens de rendre leur mise en œuvre effective et le fait de
construire cette approche globale en mettant le système de soins et
les professionnels au cœur de la réflexion et de l’action
publique.
Références
[1] Al-Hamdani M, Smith S. Alcohol warning label perceptions:
emerging evidence for alcohol policy.
Can J Public Health. 2015;
106:e395
-400

[2] Al-Hamdani M, Smith SM. Alcohol warning label perceptions: do
warning sizes and plain packaging
matter?.
J Stud Alcohol Drugs. 2017;
78:79
-87

[3] Allamani A, Olimpi N, Pepe P, et al . Trends in consumption of alcoholic
beverages and policy interventions in Europe: an
uncertainty “associated” perspective.
Subst Use Misuse. 2014;
49:1531
-45

[4] Anderson P, Chisholm D, Fuhr DC. Effectiveness and cost-effectiveness of
policies and programmes to reduce the harm caused by
alcohol.
Lancet. 2009;
373:2234
-2246

[5] Anderson P, Jane-Llopis E, Hasan OSM, et al . City-based action to reduce harmful
alcohol use: review of reviews.
F1000Res. 2018;
7: 120p.

[6] Annunziata A, Pomarici E, Vecchio R, et al . Do consumers want more nutritional and
health information on wine labels? Insights from the EU
and USA.
Nutrients. 2016;
8: E416p.

[7] Annunziata A, Pomarici E, Vecchio R, et al . Nutritional information and health
warnings on wine labels : exploring consumer interest
and preferences.
Appetite. 2016;
106:58
-69

[8] Baccini M, Carreras G. Analyzing and comparing the association
between control policy measures and alcohol consumption
in Europe.
Subst Use Misuse. 2014;
49:1684
-91

[9] Bates S, Holmes J, Gavens L, et al . Awareness of alcohol as a risk factor for
cancer is associated with public support for alcohol
policies.
BMC Public Health. 2018;
18:1
-11

[10] Bendtsen P, Damsgaard MT, Huckle T, et al . Adolescent alcohol use: a reflection of
national drinking patterns and
policy?.
Addiction. 2014;
109:1857
-68

[11] Benyamina A, Samitier MP. Comment l’alcool détruit la
jeunesse.
Paris:Albin Michel;
2017.

[12] Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’alcool en
France en 2015.
Bull Épidemiol Hebd. 2019;
n
o 5-6:97
-108

[13] Bourdillon F. Alcool et réduction des
risques.
Bull Épidemiol Hebd. 2019;
n
o 5-6:88
-9

[14] Caniard E, Augé-Caumon MJ. Les addictions au tabac et à
l’alcool.
Paris:CESE;
janvier 2019.

[15] Castillo-Manzano JI, Castro-Nuno M, Fageda X, et al . An assessment of the effects of alcohol
consumption and prevention policies on traffic fatality
rates in the enlarged EU. Time for zero alcohol
tolerance?.
Transp Res Part F Traffic Psychol
Behav. 2017;
50:38
-49

[16] Chisholm D, Moro D, Bertram M, et al . Are the “best buys” for alcohol control
still valid? An update on the comparative
cost-effectiveness of alcohol control strategies at the
global level.
J Stud Alcohol Drugs. 2018;
79:514
-22

[17] Fairbairn CE, Sayette MA, Wright AGC, et al . Extraversion and the rewarding effects of
alcohol in a social context.
J Abnorm Psychol. 2015;
124:660
-73

[18] Com-Ruelle L, Célant N. Évolution de la prévalence des différents
profils d’alcoolisation chez les adultes en France de
2002 à 2010.
Bull Épiidemiol Hebd. 2013;
n
o 16-18:185
-90

[19]Commission Européenne. Rapport de la commission au parlement
européen et au conseil concernant la mention obligatoire
de la liste des ingrédients et de la déclaration
nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons
alcoolisées.
Bruxelles: 2017.

[20] Coomber K, Hayley A, Giorgi C, et al . A Qualitative investigation of Australian
young adult responses to pictorial and graphic alcohol
product warnings.
J Drug Issues. 2017;
47:622
-37

[21] Coomber K, Hayley A, Miller PG. Unconvincing and ineffective : young
adult responses to current Australian alcohol product
warnings.
Aust J Psychol. 2018;
70:131
-8

[22] Coomber K, Jones SC, Martino F, et al . Predictors of awareness of standard drink
labelling and drinking guidelines to reduce negative
health effects among Australian
drinkers.
Drug Alcohol Rev. 2017;
36:200
-9

[23] Cogordan C, Kreft-Jaïs C, Guillemont J. Effects of alcoholic beverage control
policies and contextual factors on alcohol consumption
and its related harms in France from 1960 to
2000.
Subst Use Misuse. 2014;
49:1633
-45

[24]Cour des comptes. La mise en œuvre du plan cancer. Rapport
public thématique.
Paris: 2008.

[25]Cour des comptes. Les politiques de lutte contre les
consommations nocives d’alcool. Rapport public
thématique.
Paris: juin 2016.

[26] Couteron JP. Pour une politique de santé publique
adaptée aux consommateurs et à leurs consommations
d’alcool.
Santé Publique. 2018;
30: 443p.

[27] Daroven MP, Lane D, Kirby J, et al . Support for evidence-based alcohol policy
in Ireland: results from the community action on alcohol
pilot project.
J Public Health Policy. (published online 31 October 2018);

[28]Departement of Health. Alcohol guidelines review – Report from the
guidelines development group to the UK Chief medical
officers.
UK.
Departement of
Health;
2016;
144

[29] Díaz Gómez C, Lermenier A, Milhet M. Évaluation de l’interdiction de vente
d’alcool et de tabac aux mineurs.
Paris:OFDT;
2013;
1134

[30] Dossou G, Gallopel-Morvan K, Diouf JF. The effectiveness of current French
health warnings displayed on alcohol advertisements and
alcoholic beverages.
Eur J Public Health. 2017;
27:699
-704

[31] Dumas A, Toutain S, Hill C, et al . Warning about drinking during pregnancy:
lessons from the French experience.
Reprod Health. 2018;
15:1
-9

[32] Dumont S, Marques-Vidal P, Favrod-Coune T, et al . Alcohol policy changes and 22-year trends
in individual alcohol consumption in a Swiss adult
population: a 1993-2014 cross-sectional population-based
study.
BMJ Open. 2017;
7: e014828p.

[33] Foster S, Gmel G, Mohler-Kuo M. Light and heavy drinking in jurisdictions
with different alcohol policy
environments.
Int J Drug Policy. 2019;
65:86
-96

[34] Gallopel-Morvan K, Spilka S, Mutatayi C, et al . France’s Évin Law on the control of
alcohol advertising: content, effectiveness and
limitations.
Addiction. 2017;
112(suppl 1):86
-93

[35] Giesbrecht N, Wettlaufer A, Simpson S, et al . Strategies to reduce alcohol-related
harms and costs in Canada: a comparison of provincial
policies.
Int J Alcohol Drug Res. 2016;
5:33
-45

[36] Gneiting U, Schmitz HP. Comparing global alcohol and tobacco
control efforts: network formation and evolution in
international health governance.
Health Policy Plan. 2016;
31(suppl 1):i98
-109

[37] Hassan LM, Shiu E. A systematic review of the efficacy of
alcohol warning labels: insights from qualitative and
quantitative research in the new
millennium.
J Soc Mark. 2018 (1);

[38] Hobin E, Vallance K, Zuo F, et al . Testing the efficacy of alcohol labels
with standard drink information and national drinking
guidelines on consumers’ ability to estimate alcohol
consumption.
Alcohol Alcohol. 2018;
53:3
-11

[39]IARD. National drinking
guidelines.
Washington: 2017.

[40]INCa, Santé publique
France. Avis d’experts relatif à l’évolution du
discours public en matière de consommation d’alcool en
France.
Saint Maurice:INCa/Santé publique
France;
2017;
1153

[41] Inchley J, Currie D, Young T, et al . Growing up unequal: gender and
socioeconomic differences in young people’s health and
well-being: health behaviour in school-aged children
(HBSC) study. International report from the 2013/2014
survey.
Copenhagen: Denmark.
World Health Organisation, Regional
Office for Europe;
2016;
292 pp.

[42] Jernigan DH, Shields K, Mitchell M, Arria AM. Assessing campus alcohol policies:
measuring accessibilité, clarity, and
effectiveness.
Alcohol Clin Exp Res. 2019;
43:1007
-15

[43] Karriker-Jaffe KJ, Room R, Giesbrecht N, et al . Alcohol’s harm to others: opportunities
and challenges in a public health
framework.
J Stud Alcohol Drugs. 2018;
79:239
-43

[44] Kersbergen I, Field M. Alcohol consumers’ attention to warning
labels and brand information on alcohol packaging:
findings from cross-sectional and experimental
studies.
BMC Public Health. 2017;
17: 123p.

[45] Knai C, Petticrew M, Douglas N, et al . The public health responsibility deal:
using a systems-level analysis to understand the lack of
impact on alcohol, food, physical activity, and
workplace health sub-systems.
Int J Environ Res Public
Health. 2018;
15: 2895p.

[46] Kremer P, Crooks N, Rowland B, et al . Underage alcohol sales in community
sporting clubs.
Drug Alcohol Rev. 2018;
37:879
-86

[47] Kypri K, Maclennan B, Cousins K, et al . Hazardous drinking among students over a
decade of university policy change: controlled
before-and-after evaluation.
Int J Environ Res Public
Health. 2018;
15: 2137p.

[48] Larsen EL, Smorawski GA, Kragbak KL, et al . Students’ drinking behavior and
perceptions towards introducing alcohol policies on
university campus in Denmark: a focus group
study.
Subst Abuse Treat Prev Policy. 2016;
11:1
-11

[49] Lewsey J, Haghpanahan H, Mackay D, et al . Impact of legislation to reduce the
drink-drive limit on road traffic accidents and alcohol
consumption in Scotland: a natural experiment
study.
Public Health Res. 2019;
7 (12):

[50] Madureira-Lima J, Galea S. Alcohol control policies and alcohol
consumption: an international comparison of 167
countries.
J Epidemiol Community Health. 2018;
72:54
-60

[51] Martin-Moreno JM, Harris ME, Breda J, et al . Enhanced labelling on alcoholic drinks:
reviewing the evidence to guide alcohol
policy.
Eur J Public Health. 2013;
23:1082
-7

[52]Mildeca. Plan national de mobilisation contre les
addictions 2018-2022.
Paris: 2018.

[53] Miller ER, Ramsey IJ, Baratiny GY, et al . Message on a bottle: are alcohol warning
labels about cancer appropriate?.
BMC Public Health. 2016;
16: 139p.

[54] Mold A. “Everybody likes a drink, nobody likes a
drunk”. Alcohol, health education and the public in
1970s Britain.
Soc Hist Med. 2017; Epub 2016 Dec 22;
30:612
-36

[55] Naassila M. Journée interassociative de la Fédération
française d’addictologie, Plan National Alcool-PNA :
pour une réduction des risques et des
dommages.
Addiction Addictologie. 2018;
40:261
-7

[56] Nicholls J, Greenaway J. What is the problem? Evidence, politics
and alcohol policy in England and Wales,
2010-2014.
Drugs Educ Prev Policy. 2015;
22:135
-42

[57] Nutt DJ, Rehm J. Doing it by numbers: a simple approach to
reducing the harms of alcohol.
J Psychopharmacol. 2014;
28:3
-7

[58]OMS (Organisation mondiale de la
santé). Global Status report on alcohol and
health.
Genève: 2018.

[59]OMS (Organisation mondiale de la
santé). What is the current alcohol labelling
practice in the WHO European region and what are
barriers and facilitators to development and
implementation of alcohol labelling policy? Health
evidence network synthesis report 68.
Genève: 2020.

[60] Pagani V, Alla F, Cambon L, et al . Élaboration des normes de prévention :
une réflexion éthique nécéssaire.
Santé Publique. 2018;
30:321
-31

[61] Paille F.SFA.SFGG. Personnes âgées et consommation
d’alcool.
Alcoologie Addictologie. 2014;
36:6172

[62] Peloza J, Liutkute V, Galkus L, et al . LET it hAPYN: preventing and reducting
alcohol related harm in youth organizations in Europe:
final publication.
In: Drobne M, Peloza J (eds), editors.
Ljubljana:Alcohol Policy Youth Network, Dutch
Institute for Alcohol PolicyEuro
Care;
2016;
152

[63] Pham C, Rundle-Thiele S, Parkinson J, et al . Alcohol warning label awareness and
attention: a multi-method study.
Alcohol Alcohol. 2018;
53:39
-45

[64] Philippon A, Le Nézet O, Janssen E, et al . Consommation et approvisionnement en
alcool à 17 ans en France : résultats de l’enquête
ESCAPAD 2017.
Bull Épidemiol Hebd. 2019;
5-6:109
-15

[65] Raninen J, Harkonen J, Landberg J. Long-term effects of changes in Swedish
alcohol policy: can alcohol policies effective during
adolescence impact consumption during
adulthood?.
Addiction. 2016;
111:1021
-6

[66] Rice P. Plus ça change, plus c’est la même chose:
a review of recent alcohol policy developments in
Europe.
Alcohol Alcohol. 2019;
54:123
-7

[67] Richard JB, Palle C, Guignard R, et al . La consommation d’alcool en France en
2014, INPES.
Évolutions. 2015;
n
o 32:

[68] Richard JB, Beck F, Spilka S. La consommation d’alcool des 18-25 ans en
2010 en France : spécificités et évolutions depuis
2005.
Bull Épiidemiol Hebd. 2013;
n
o 16-18:176
-9

[69] Robertson K, Thyne M, Hibbert S. Drinkers perceived negative
alcohol-related expectancies: informing alcohol warning
messages.
Drugs Educ Prev Policy. 2017;
24:197
-205

[70] Rosenberg G, Bauld L, Hooper L, et al . New national alcohol guidelines in the
UK: public awareness, understanding and behavioural
intentions.
J Public Health. 2017;
40:549
-56

[71] Sandoval JL, Leão T, Theler J, et al . Alcohol control policies and
socioeconomic inequalities in hazardous alcohol
consumption: a 22-year cross-sectional study in a Swiss
urban population.
BMJ Open. 2019;

[72] Stafford LD, Salmon J. Alcohol health warnings can influence the
speed of consumption.
J Public Health. 2017;
25:147
-54

[73] Taylor AL, Dhillon IS. An international legal strategy for
alcohol control: not a framework convention: at least
not yet.
Addiction. 2013; Epub 2012 Jun 20;
108:450
-5

[74] Tinawi G, Gray T, Knight T, et al . Highly deficient alcohol health warning
labels in a high-income country with a voluntary
system.
Drug Alcohol Rev. 2018;
37:616
-26

[75] Toutain S. Concilier « Zéro alcool pendant la
grossesse » et alcoolisation ponctuelle importante des
premières semaines. Une enquête qualitative sur des
forums de discussion.
Bull Épidemiol Hebd. 2017;
n
o 11:207
-12

[76] Vallance K, Romanovska I, Stockwell T, et al . “We have a right to know”: exploring
consumer opinions on content, design and acceptability
of enhanced alcohol labels.
Alcohol Alcohol. 2018;
53:20
-5

[77] Van Hal G, Tavolacci MP, Stock C, et al . European university students’ experiences
and attitudes toward campus alcohol policy : a
qualitative study.
Subst Use Misuse. 2018;
53:1539
-48

[78] Vaqué LG. Self-regulation of the labelling of the
list of ingredients of alcoholic beverages: a long-term
solution?.
Eur Food Feed Law Rev. 2017;
12:413
-21

[79] Vasiljevic MA, Couturier DL, Frings D, et al . Impact of lower strength alcohol labeling
on consumption: a randomized controlled
trial.
Health Psychol. 2018;
37:658
-67

[80] Vasiljevic MB, Couturier DL, Marteau TM. Impact on product appeal of labeling wine
and beer with (a) lower strength alcohol verbal
descriptors and (b) percent alcohol by volume (%ABV) :
an experimental study.
Psychol Addict Behav. 2018;
32:779
-91

[81] Vieno A, Altoe G, Kuntsche E, et al . Do public expenditures on health and
families relate to alcohol abstaining in adolescents?
Multilevel study of adolescents in 24
countries.
Drug Alcohol Rev. 2018;
37:S120
-8

[82] Voller F, Allamani A. Contextual factors and alcohol
consumption control policy measures: the AMPHORA study
background.
Subst Use Misuse. 2014;
49:1508
-14

[83] Voller F, Maccari F, Pepe P, et al . Changing trends in European alcoholic
beverage drinking: selected social, demographic,
economic factors, drinking’s related harms, and
prevention control policies between the 1960s and
2000s.
Subst Use Misuse. 2014;
49:1515
-30

[84] Warpenius K, Tigerstedt C. Positioning alcohol’s harm to others
(AHTO) within alcohol research: a reinvented perspective
with mixed policy implications.
Nordic Stud Alcohol Drugs. 2016;
33:487
-502

[85] Wettlaufer A. Can a label help me drink in moderation?
a review of the evidence on standard drink
labelling.
Subst Use Misuse. 2018;
53:585
-95

[86] Wigg S, Stafford LD. Health warnings on alcoholic beverages:
perceptions of the health risks and intentions towards
alcohol consumption.
PLoS One. 2016;
11: e0153027p.

[87] Wolfaardt BM, Brownbill AL, Mahmood MA, et al . The Australian NHMRC guidelines for
alcohol consumption and their portrayal in the print
media: a content analysis of Australian
newspapers.
Aust NZ J Public Health. 2018;
42:43
-5

[88] Wright A. Local alcohol policy implementation in
scotland: understanding the role of accountability
within licensing.
Int J Environ Res Public
Health. 2019;
16p.

→ Aller vers SYNTHESE
 ).
). ), comme
résumé ainsi par le Conseil Économique Social et Environnemental
(CESE) : « une voie existe entre le déni des méfaits de l’alcool et les
discours prônant l’abstinence, rassurants mais peu efficaces. Cette voie
est celle de la réduction des risques et des dommages, sanitaires bien
sûr mais aussi des violences liées aux consommations excessives
d’alcool. Elle n’ignore ni les dangers ni le plaisir que l’on peut
trouver dans une consommation raisonnable mais modérée. Mais elle exige
plus de cohérence et de continuité dans les politiques publiques ainsi
que davantage de mobilisation et de coordination » (CESE, 2019
), comme
résumé ainsi par le Conseil Économique Social et Environnemental
(CESE) : « une voie existe entre le déni des méfaits de l’alcool et les
discours prônant l’abstinence, rassurants mais peu efficaces. Cette voie
est celle de la réduction des risques et des dommages, sanitaires bien
sûr mais aussi des violences liées aux consommations excessives
d’alcool. Elle n’ignore ni les dangers ni le plaisir que l’on peut
trouver dans une consommation raisonnable mais modérée. Mais elle exige
plus de cohérence et de continuité dans les politiques publiques ainsi
que davantage de mobilisation et de coordination » (CESE, 2019 ,
p. 11-12).
,
p. 11-12). ; Mold 2016
; Mold 2016 ), des fonctions sociales de l’alcool
dans nos sociétés modernes occidentales. C’est pourtant un axe
essentiel sur lequel devraient s’interroger les acteurs de santé
(Couteron, 2018
), des fonctions sociales de l’alcool
dans nos sociétés modernes occidentales. C’est pourtant un axe
essentiel sur lequel devraient s’interroger les acteurs de santé
(Couteron, 2018 ), mais aussi les chercheurs et les
hommes et femmes politiques : que peut et doit faire l’État face
aux besoins d’inhibition et d’ivresse, à un souci de l’image de
soi qui passe parfois la préservation de sa santé (par exemple
l’intégration au groupe chez les jeunes), aux dynamiques
sociales incitatives et très ancrées dans nos pratiques
collectives, etc. ? Cette question est nettement moins présente
mais pourtant essentielle, notamment pour la construction d’un
compromis politique. Face à ces interrogations, certains en
appellent à la mise en place des conditions d’une véritable
réflexion éthique préalablement au choix des politiques
publiques qui « affectent une grande partie de la population,
voire son ensemble, et contribuent à définir de nouvelles
manières d’être, d’agir et de vivre. Ils peuvent orienter plus
justement les stratégies et contribuer à favoriser leur
acceptabilité et leur efficacité auprès des populations »
(Pagani et coll., 2018
), mais aussi les chercheurs et les
hommes et femmes politiques : que peut et doit faire l’État face
aux besoins d’inhibition et d’ivresse, à un souci de l’image de
soi qui passe parfois la préservation de sa santé (par exemple
l’intégration au groupe chez les jeunes), aux dynamiques
sociales incitatives et très ancrées dans nos pratiques
collectives, etc. ? Cette question est nettement moins présente
mais pourtant essentielle, notamment pour la construction d’un
compromis politique. Face à ces interrogations, certains en
appellent à la mise en place des conditions d’une véritable
réflexion éthique préalablement au choix des politiques
publiques qui « affectent une grande partie de la population,
voire son ensemble, et contribuent à définir de nouvelles
manières d’être, d’agir et de vivre. Ils peuvent orienter plus
justement les stratégies et contribuer à favoriser leur
acceptabilité et leur efficacité auprès des populations »
(Pagani et coll., 2018 , p. 330).
, p. 330). ;
Couteron, 2018
;
Couteron, 2018 ), moins la nécessité de mener « un
débat plus politique » rassemblant le maximum d’acteurs et de
professionnels, en orientant ce débat d’une part vers
l’impératif de santé et les consommateurs (méfaits connus et
bienfaits attendus de l’alcool) et d’autre part, vers
l’impératif économique et la régulation des consommations
(Couteron, 2018
), moins la nécessité de mener « un
débat plus politique » rassemblant le maximum d’acteurs et de
professionnels, en orientant ce débat d’une part vers
l’impératif de santé et les consommateurs (méfaits connus et
bienfaits attendus de l’alcool) et d’autre part, vers
l’impératif économique et la régulation des consommations
(Couteron, 2018 ). On rejoint aussi la question de
disposer de plus de recherches et de résultats plus solides sur
les politiques publiques (mesures les plus efficaces, question
sur l’évaluation des politiques publiques), les tendances de
consommations et les dommages selon l’âge, le genre, le niveau
de revenu, nécessaires en amont de la construction du consensus
public et politique (Rice, 2019
). On rejoint aussi la question de
disposer de plus de recherches et de résultats plus solides sur
les politiques publiques (mesures les plus efficaces, question
sur l’évaluation des politiques publiques), les tendances de
consommations et les dommages selon l’âge, le genre, le niveau
de revenu, nécessaires en amont de la construction du consensus
public et politique (Rice, 2019 ).
). ,
p. 443), « défendre » l’art de vivre, des habitudes
alimentaires, le bien boire, l’image « responsable »
(autorégulation, prévention, messages volontaires avec un
« packaging sémantique « inclusif et bienveillant » [avec]
« modération », « dégustation », « de consommation responsable »
ouvrant des « plaisirs qui se partagent » » (Couteron,
2018
,
p. 443), « défendre » l’art de vivre, des habitudes
alimentaires, le bien boire, l’image « responsable »
(autorégulation, prévention, messages volontaires avec un
« packaging sémantique « inclusif et bienveillant » [avec]
« modération », « dégustation », « de consommation responsable »
ouvrant des « plaisirs qui se partagent » » (Couteron,
2018 ,
p. 443). Face à un lobby (analysé dans un chapitre spécifique de
cette expertise) qui serait « au service des profits issus d’un
marché qui se veut sans limite », les acteurs de santé doivent
« dénoncer » la posture de « défense de la tradition et de la
qualité », le secteur étant dicté par l’impératif de vendre plus
en produisant de nombreuses boissons appétantes (par
l’adjonction de sucres, d’arômes artificiels et/ou un marketing
bien travaillé, également décrit dans cette expertise) bien plus
que par un impératif œnologique de qualité. « Il n’y a pas plus
« d’alcool doux » qu’il n’y avait de cigarettes « light »
[...] L’entrée en pente douce piège l’usager » (Couteron,
2018
,
p. 443). Face à un lobby (analysé dans un chapitre spécifique de
cette expertise) qui serait « au service des profits issus d’un
marché qui se veut sans limite », les acteurs de santé doivent
« dénoncer » la posture de « défense de la tradition et de la
qualité », le secteur étant dicté par l’impératif de vendre plus
en produisant de nombreuses boissons appétantes (par
l’adjonction de sucres, d’arômes artificiels et/ou un marketing
bien travaillé, également décrit dans cette expertise) bien plus
que par un impératif œnologique de qualité. « Il n’y a pas plus
« d’alcool doux » qu’il n’y avait de cigarettes « light »
[...] L’entrée en pente douce piège l’usager » (Couteron,
2018 ,
p. 444) : ce point est mis en avant à propos de la bière,
souvent considérée de la sorte et moins dangereuse que les
autres alcools, notamment par les jeunes (OFDT,
2013
,
p. 444) : ce point est mis en avant à propos de la bière,
souvent considérée de la sorte et moins dangereuse que les
autres alcools, notamment par les jeunes (OFDT,
2013 )3
. Face à cette pratique culturelle objet d’un
lobbying intensif et puissant, c’est donc une approche globale,
ambitieuse et cohérente qui doit être développée, et qui ne doit
pas négliger d’agir aussi sur les représentations liées à
l’alcool. C’est aussi dans cette perspective que doivent être
envisagées les recommandations déjà évoquées, comme la
communication sur les repères de consommation, les messages de
prévention, bref au sens large, l’éducation à la santé, qui est
pour Cohn (2015) la mesure à la fois la plus juste et la plus
efficace. Il faut selon lui développer une approche
interactionniste, utiliser des comparaisons culturelles pour
développer une construction collective de la consommation
excessive comme problème culturel, afin de ne pas appréhender
l’alcool en soi (la substance), mais penser plutôt au monde
social dans lequel les gens boivent (le comportement). Autrement
dit, bien comprendre le problème culturel, c’est mieux contrôler
la consommation d’alcool.
)3
. Face à cette pratique culturelle objet d’un
lobbying intensif et puissant, c’est donc une approche globale,
ambitieuse et cohérente qui doit être développée, et qui ne doit
pas négliger d’agir aussi sur les représentations liées à
l’alcool. C’est aussi dans cette perspective que doivent être
envisagées les recommandations déjà évoquées, comme la
communication sur les repères de consommation, les messages de
prévention, bref au sens large, l’éducation à la santé, qui est
pour Cohn (2015) la mesure à la fois la plus juste et la plus
efficace. Il faut selon lui développer une approche
interactionniste, utiliser des comparaisons culturelles pour
développer une construction collective de la consommation
excessive comme problème culturel, afin de ne pas appréhender
l’alcool en soi (la substance), mais penser plutôt au monde
social dans lequel les gens boivent (le comportement). Autrement
dit, bien comprendre le problème culturel, c’est mieux contrôler
la consommation d’alcool. ; Benyamina et Samitier,
2017
; Benyamina et Samitier,
2017 ; Couteron, 2018
; Couteron, 2018 ). Les enjeux économiques semblent
prioritaires sur les enjeux de santé publique et cela participe
des contradictions entre les messages : la volonté politique
apparaît incertaine ou mitigée, le pilotage interministériel est
flou (Cour des comptes, 2016
). Les enjeux économiques semblent
prioritaires sur les enjeux de santé publique et cela participe
des contradictions entre les messages : la volonté politique
apparaît incertaine ou mitigée, le pilotage interministériel est
flou (Cour des comptes, 2016 ), l’encadrement des groupes
d’intérêt concernés est peu contraignant, les leviers
disponibles et avérés efficaces sont sous-utilisés, d’où le fait
que les pouvoirs publics français peinent à modifier les
comportements à risque (Cour des comptes, 2016
), l’encadrement des groupes
d’intérêt concernés est peu contraignant, les leviers
disponibles et avérés efficaces sont sous-utilisés, d’où le fait
que les pouvoirs publics français peinent à modifier les
comportements à risque (Cour des comptes, 2016 ). Deux exemples
l’illustrent : premièrement, le « détricotage » continu de la
loi Évin depuis son adoption en 1991 (cf. chapitre « Marketing
des produits alcoolisés »), alors que cette loi était saluée
auparavant comme un « cadre exemplaire » et a inspiré d’autres
pays. Un recul notable par rapport à la loi Évin a été observé
avec la loi de modernisation du système de santé qui lève les
restrictions publicitaires au nom de la défense des terroirs et
de l’œnotourisme. On trouve une seconde illustration dans le
compte-rendu de la Journée inter associative « Plan National
Alcool » publié dans Addiction et Addictologie (Naassila,
2018
). Deux exemples
l’illustrent : premièrement, le « détricotage » continu de la
loi Évin depuis son adoption en 1991 (cf. chapitre « Marketing
des produits alcoolisés »), alors que cette loi était saluée
auparavant comme un « cadre exemplaire » et a inspiré d’autres
pays. Un recul notable par rapport à la loi Évin a été observé
avec la loi de modernisation du système de santé qui lève les
restrictions publicitaires au nom de la défense des terroirs et
de l’œnotourisme. On trouve une seconde illustration dans le
compte-rendu de la Journée inter associative « Plan National
Alcool » publié dans Addiction et Addictologie (Naassila,
2018 )
qui rapporte les déclarations du Président de la République
E. Macron au salon de l’Agriculture 2018 (« pendant mon mandat,
aucun durcissement de la loi Évin ») et le fait que l’Élysée ait
demandé en juillet de la même année aux alcooliers un rapport
pour préparer le plan gouvernemental de lutte contre les
conduites addictives : « les dommages individuels et sociaux
liés à la consommation d’alcool ne sont donc plus seulement un
enjeu de santé publique, mais aussi et surtout un enjeu
politique. Il s’agit pour les tenants de la santé publique de
lutter contre le lobby alcoolier qui est maintenant présent au
plus haut niveau de l’État ». Notons qu’à l’étranger,
l’importance du lobbying alcoolier est aussi avancé pour
expliquer l’échec de la mise en place de politiques publiques
fondées sur les évidences scientifiques. Autrement dit,
l’adoption des mesures les plus coût-efficaces peut s’avérer
difficile, comme en Angleterre et aux Pays de Galles où la
fenêtre d’opportunité ouverte en 2010 s’est vite refermée
(Nicholls et Greenaway, 2015
)
qui rapporte les déclarations du Président de la République
E. Macron au salon de l’Agriculture 2018 (« pendant mon mandat,
aucun durcissement de la loi Évin ») et le fait que l’Élysée ait
demandé en juillet de la même année aux alcooliers un rapport
pour préparer le plan gouvernemental de lutte contre les
conduites addictives : « les dommages individuels et sociaux
liés à la consommation d’alcool ne sont donc plus seulement un
enjeu de santé publique, mais aussi et surtout un enjeu
politique. Il s’agit pour les tenants de la santé publique de
lutter contre le lobby alcoolier qui est maintenant présent au
plus haut niveau de l’État ». Notons qu’à l’étranger,
l’importance du lobbying alcoolier est aussi avancé pour
expliquer l’échec de la mise en place de politiques publiques
fondées sur les évidences scientifiques. Autrement dit,
l’adoption des mesures les plus coût-efficaces peut s’avérer
difficile, comme en Angleterre et aux Pays de Galles où la
fenêtre d’opportunité ouverte en 2010 s’est vite refermée
(Nicholls et Greenaway, 2015 ) en raison du lobbying industriel,
mais aussi du manque de cadrage des propositions, du manque de
synergie ministérielle, des tensions idéologiques, du manque de
cohérence dans la communication des preuves. Au Royaume-Uni, le
gouvernement avait adopté en 2011 un plan, le Responsibility
Deal, co-construit avec, entre autres les représentants
des alcooliers. Ce plan comportait un volet alcool, censé
promouvoir un « boire responsable » respectant les repères de
consommation, agrandir l’étiquetage sur les contenants
comportant des messages de santé, sur les calories, des repères
de consommation, des risques associés à une consommation
excessive. Une attention particulière était portée à réduire et
prévenir la consommation des jeunes. En termes de publicité et
de marketing, les alcooliers étaient incités à promouvoir le
« boire responsable ». Pour beaucoup (Knai et coll.
2018
) en raison du lobbying industriel,
mais aussi du manque de cadrage des propositions, du manque de
synergie ministérielle, des tensions idéologiques, du manque de
cohérence dans la communication des preuves. Au Royaume-Uni, le
gouvernement avait adopté en 2011 un plan, le Responsibility
Deal, co-construit avec, entre autres les représentants
des alcooliers. Ce plan comportait un volet alcool, censé
promouvoir un « boire responsable » respectant les repères de
consommation, agrandir l’étiquetage sur les contenants
comportant des messages de santé, sur les calories, des repères
de consommation, des risques associés à une consommation
excessive. Une attention particulière était portée à réduire et
prévenir la consommation des jeunes. En termes de publicité et
de marketing, les alcooliers étaient incités à promouvoir le
« boire responsable ». Pour beaucoup (Knai et coll.
2018 par exemple), le Responsibility Deal, reposant notamment
sur des actions volontaires des industriels, a été un échec (en
termes d’efficacité, de résultats) parce qu’il était trop
déterminé par les intérêts économiques (et leur était donc peu
contraignant).
par exemple), le Responsibility Deal, reposant notamment
sur des actions volontaires des industriels, a été un échec (en
termes d’efficacité, de résultats) parce qu’il était trop
déterminé par les intérêts économiques (et leur était donc peu
contraignant). , p. 12), renvoyant à l’exemple de la
loi Évin. Or le temps long semble souvent indispensable pour
voir pleinement les effets positifs des politiques publiques
alcool, notamment sur le niveau de consommation (Raninen et
coll., 2016
, p. 12), renvoyant à l’exemple de la
loi Évin. Or le temps long semble souvent indispensable pour
voir pleinement les effets positifs des politiques publiques
alcool, notamment sur le niveau de consommation (Raninen et
coll., 2016 ; Dumont et coll., 2017
; Dumont et coll., 2017 ; Foster et coll.,
2019
; Foster et coll.,
2019 ).
). montre à partir d’enquêtes
déclaratives une faible application de l’interdiction de vente
aux mineurs prévue par la loi HPST (hôpital, patients, santé,
territoire) de 2009. Alors que les débats parlementaires avaient
souligné l’insuffisance des mesures d’interdiction pour protéger
les mineurs, des politiques de prévention et d’éducation, et des
moyens alloués à la bonne application des mesures, aux contrôles
et à l’effectivité des sanctions, alors que l’adhésion des
Français interrogés était massive, la mise en œuvre de la loi
faisait apparaître une réalité très décevante avec d’abord la
gêne fréquente ressentie par le vendeur pour un mineur proche de
la majorité ; par ailleurs, le fait que 92 % des vendeurs
connaissent la loi (ainsi que les sanctions, relativement
connues mais sous estimées), mais ne se sentent pas forcément
légitimes pour demander une pièce d’identité. Le
tableau 9.II
montre à partir d’enquêtes
déclaratives une faible application de l’interdiction de vente
aux mineurs prévue par la loi HPST (hôpital, patients, santé,
territoire) de 2009. Alors que les débats parlementaires avaient
souligné l’insuffisance des mesures d’interdiction pour protéger
les mineurs, des politiques de prévention et d’éducation, et des
moyens alloués à la bonne application des mesures, aux contrôles
et à l’effectivité des sanctions, alors que l’adhésion des
Français interrogés était massive, la mise en œuvre de la loi
faisait apparaître une réalité très décevante avec d’abord la
gêne fréquente ressentie par le vendeur pour un mineur proche de
la majorité ; par ailleurs, le fait que 92 % des vendeurs
connaissent la loi (ainsi que les sanctions, relativement
connues mais sous estimées), mais ne se sentent pas forcément
légitimes pour demander une pièce d’identité. Le
tableau 9.II montre
les différences selon les types de lieux de vente d’alcool du
contrôle de la pièce d’identité.
montre
les différences selon les types de lieux de vente d’alcool du
contrôle de la pièce d’identité. )
) ). On peut aisément imaginer la difficulté de construire une
volonté politique ferme autour des 27 États-membres aux intérêts
économiques forts dans le secteur, quoique variables.
). On peut aisément imaginer la difficulté de construire une
volonté politique ferme autour des 27 États-membres aux intérêts
économiques forts dans le secteur, quoique variables. ,
p. 118-122) : en effet, depuis 2009 et la loi HPST, les ARS
déclinent les priorités nationales au niveau régional, mais ce
de manière variable, nouant différents partenariats, coordonnant
différents schémas d’offres de soins ainsi que l’offre
médico-sociale, le tout assuré par des modes de financement
multiples mais une coordination interministérielle (la Mildeca)
qualifiée de « sommaire et fragilisée par la rotation des chefs
de projets » (Cour des comptes, 2016
,
p. 118-122) : en effet, depuis 2009 et la loi HPST, les ARS
déclinent les priorités nationales au niveau régional, mais ce
de manière variable, nouant différents partenariats, coordonnant
différents schémas d’offres de soins ainsi que l’offre
médico-sociale, le tout assuré par des modes de financement
multiples mais une coordination interministérielle (la Mildeca)
qualifiée de « sommaire et fragilisée par la rotation des chefs
de projets » (Cour des comptes, 2016 , p. 119). De l’autre côté,
les Préfets de départements coordonnent les politiques
nationales autres que ce versant santé, et animent les
différentes instances territoriales (essentiellement pour la
sécurité routière), avec les interventions possibles des
municipalités, départements et de la région.
, p. 119). De l’autre côté,
les Préfets de départements coordonnent les politiques
nationales autres que ce versant santé, et animent les
différentes instances territoriales (essentiellement pour la
sécurité routière), avec les interventions possibles des
municipalités, départements et de la région. ),
là où des travaux insistent au contraire sur l’effet positif de
l’implication de tous les acteurs pour une action régionale
concertée (sur le Canada, Giesbrecht et coll.,
2016
),
là où des travaux insistent au contraire sur l’effet positif de
l’implication de tous les acteurs pour une action régionale
concertée (sur le Canada, Giesbrecht et coll.,
2016 ). L’Écosse avec ses Alcohol Licensing Boards au niveau
local (Wright, 2019
). L’Écosse avec ses Alcohol Licensing Boards au niveau
local (Wright, 2019 ; voir aussi le chapitre de cette
expertise sur l’effectivité des mesures visant à restreindre
l’accès aux boissons alcooliques) suggère qu’une décision
top-down est insuffisante mais que les mécanismes de
responsabilité entre le local et le national doivent être bien
définis en amont de la mise en œuvre pour que l’autonomie locale
ne contrevienne pas aux objectifs nationaux.
; voir aussi le chapitre de cette
expertise sur l’effectivité des mesures visant à restreindre
l’accès aux boissons alcooliques) suggère qu’une décision
top-down est insuffisante mais que les mécanismes de
responsabilité entre le local et le national doivent être bien
définis en amont de la mise en œuvre pour que l’autonomie locale
ne contrevienne pas aux objectifs nationaux. ) dénonçait une trop grande dispersion des prises
en charge dans le secteur médico-social et associatif. Le plan
gouvernemental de lutte contre les addictions en cours
(2018-2022) énonce parmi ses axes prioritaires de structurer le
parcours de santé en addictologie.
) dénonçait une trop grande dispersion des prises
en charge dans le secteur médico-social et associatif. Le plan
gouvernemental de lutte contre les addictions en cours
(2018-2022) énonce parmi ses axes prioritaires de structurer le
parcours de santé en addictologie. ) montrent l’effet de certaines politiques publiques (baisse
du taux d’alcoolémie au volant, taxation, interdiction de la
publicité, âge minimum pour acheter de l’alcool) sur la baisse
de la consommation d’alcool avec l’effet conjoint d’événements
socio-économiques (augmentation du travail des femmes,
augmentation du revenu, phénomène d’urbanisation). De la même
manière, plusieurs études portent sur le poids relatif des
politiques de contrôle et de facteurs socio-économiques entre
les années 1960 et les années 2000 (portant sur la Finlande, la
Norvège, la Pologne, la Suisse, l’Espagne, l’Italie [Allamani et
coll., 2014
) montrent l’effet de certaines politiques publiques (baisse
du taux d’alcoolémie au volant, taxation, interdiction de la
publicité, âge minimum pour acheter de l’alcool) sur la baisse
de la consommation d’alcool avec l’effet conjoint d’événements
socio-économiques (augmentation du travail des femmes,
augmentation du revenu, phénomène d’urbanisation). De la même
manière, plusieurs études portent sur le poids relatif des
politiques de contrôle et de facteurs socio-économiques entre
les années 1960 et les années 2000 (portant sur la Finlande, la
Norvège, la Pologne, la Suisse, l’Espagne, l’Italie [Allamani et
coll., 2014 ] ; sur les trajectoires différenciées des pays du Nord
[Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, Pologne] et
des pays plus au Sud [France, Italie, Espagne, Suisse], voir
Voller et coll., 2014
] ; sur les trajectoires différenciées des pays du Nord
[Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, Pologne] et
des pays plus au Sud [France, Italie, Espagne, Suisse], voir
Voller et coll., 2014 ; Voller et Allamani,
2014
; Voller et Allamani,
2014 ). Au-delà de l’évidence contextuelle (toute politique se
déploie dans un contexte pétri d’interactions avec de multiples
acteurs, de nombreuses mesures, etc.), les conclusions à en
tirer en termes de recommandations n’ont rien d’évident.
). Au-delà de l’évidence contextuelle (toute politique se
déploie dans un contexte pétri d’interactions avec de multiples
acteurs, de nombreuses mesures, etc.), les conclusions à en
tirer en termes de recommandations n’ont rien d’évident. ) ;
) ; ; Baccini et Carreras,
2014
; Baccini et Carreras,
2014 ; Chisholm et coll.,
2018
; Chisholm et coll.,
2018 ; OMS,
2018
; OMS,
2018 ) ;
) ; ; Chisholm et coll.,
2018
; Chisholm et coll.,
2018 ).
). ;
OMS, 2018
;
OMS, 2018 ).
Pour les jeunes, la contradiction entre l’interdiction de leur
vendre de l’alcool, l’injonction à ne pas consommer et
l’omniprésence de la publicité sur l’alcool semblent constituer un
frein pédagogique à la cohérence et la compréhension du message
(OFDT, 2013
).
Pour les jeunes, la contradiction entre l’interdiction de leur
vendre de l’alcool, l’injonction à ne pas consommer et
l’omniprésence de la publicité sur l’alcool semblent constituer un
frein pédagogique à la cohérence et la compréhension du message
(OFDT, 2013 ). Dans le plan gouvernemental en cours (Mildeca,
2018
). Dans le plan gouvernemental en cours (Mildeca,
2018 ),
l’une des ambitions est de réduire l’exposition des jeunes au
marketing des producteurs d’alcool.
),
l’une des ambitions est de réduire l’exposition des jeunes au
marketing des producteurs d’alcool. ). De
ce point de vue, la France devrait continuer à faire ce qu’elle met
déjà en œuvre. Cependant, notons qu’une comparaison de l’Écosse qui,
en 2014, a baissé sa BAC de 0,08 à 0,05, avec l’Angleterre et le
Pays de Galles (qui l’ont laissée inchangée), montre que les effets
sur le niveau de consommation et les accidents de la route n’ont pas
été aussi importants qu’escomptés : l’efficacité est conditionnée à
l’effectivité de la mise en œuvre avec des contrôles routiers
d’alcoolémie, et que cela s’accompagne de mesures d’éducation à la
santé, de restrictions sur la publicité et d’avertissements (Lewsey
et coll., 2019
). De
ce point de vue, la France devrait continuer à faire ce qu’elle met
déjà en œuvre. Cependant, notons qu’une comparaison de l’Écosse qui,
en 2014, a baissé sa BAC de 0,08 à 0,05, avec l’Angleterre et le
Pays de Galles (qui l’ont laissée inchangée), montre que les effets
sur le niveau de consommation et les accidents de la route n’ont pas
été aussi importants qu’escomptés : l’efficacité est conditionnée à
l’effectivité de la mise en œuvre avec des contrôles routiers
d’alcoolémie, et que cela s’accompagne de mesures d’éducation à la
santé, de restrictions sur la publicité et d’avertissements (Lewsey
et coll., 2019 ).
). ).
). ).
). )
les ont intégrés dans des recommandations nutritionnelles plus
larges ou encore que la Suisse traite de la consommation
d’alcool dans une stratégie nationale et globale des addictions.
La Grande-Bretagne dispose quant à elle de repères de
consommation d’alcool « en soi », qui ne sont ni partie d’un
plan addictions, nutrition ou maladie. Les États-Unis, la
Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Australie émettent aussi des
recommandations adaptées pour les plus de 65 ans, en raison de
leur vulnérabilité particulière aux effets de l’alcool (« le
vieillissement amène des modifications physiologiques
aboutissant à une moindre tolérance aux effets de l’alcool (...)
la polypathologie et son corollaire, la polymédicamentation
fréquente chez le sujet âgé, (...) le rendent particulièrement
sensible aux effets toxiques de l’alcool [et] ces effets sont
majorés par la coexistence de troubles cognitifs », Paille,
2014
)
les ont intégrés dans des recommandations nutritionnelles plus
larges ou encore que la Suisse traite de la consommation
d’alcool dans une stratégie nationale et globale des addictions.
La Grande-Bretagne dispose quant à elle de repères de
consommation d’alcool « en soi », qui ne sont ni partie d’un
plan addictions, nutrition ou maladie. Les États-Unis, la
Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Australie émettent aussi des
recommandations adaptées pour les plus de 65 ans, en raison de
leur vulnérabilité particulière aux effets de l’alcool (« le
vieillissement amène des modifications physiologiques
aboutissant à une moindre tolérance aux effets de l’alcool (...)
la polypathologie et son corollaire, la polymédicamentation
fréquente chez le sujet âgé, (...) le rendent particulièrement
sensible aux effets toxiques de l’alcool [et] ces effets sont
majorés par la coexistence de troubles cognitifs », Paille,
2014 ,
p. 62).
,
p. 62). ). Une étude de la couverture médiatique des guidelines
dans les journaux gratuits montre que celle-ci est très faible
et souligne le manque de communication (Wolfaardt et coll.,
2018
). Une étude de la couverture médiatique des guidelines
dans les journaux gratuits montre que celle-ci est très faible
et souligne le manque de communication (Wolfaardt et coll.,
2018 ), le manque de transparence et d’objectivité des repères
fondant une recommandation pour les améliorer (Holmes et coll.,
2018).
), le manque de transparence et d’objectivité des repères
fondant une recommandation pour les améliorer (Holmes et coll.,
2018). ). Mais que dit la littérature
internationale concernant l’efficacité de ces messages
sanitaires apposés sur les contenants et les publicités pour les
boissons alcooliques ? De nombreux chercheurs en appellent à des
recherches supplémentaires jugées trop rares, afin d’avoir un
avis plus précis sur l’impact des différents messages
(Martin-Moreno et coll., 2013
). Mais que dit la littérature
internationale concernant l’efficacité de ces messages
sanitaires apposés sur les contenants et les publicités pour les
boissons alcooliques ? De nombreux chercheurs en appellent à des
recherches supplémentaires jugées trop rares, afin d’avoir un
avis plus précis sur l’impact des différents messages
(Martin-Moreno et coll., 2013 ; Miller et coll.,
2016
; Miller et coll.,
2016 ; Al-Hamdani et Smith, 2017
; Al-Hamdani et Smith, 2017 ; Robertson et coll.,
2017
; Robertson et coll.,
2017 ; Wettlaufer, 2018
; Wettlaufer, 2018 ), et de développer en outre les
travaux avec des approches qualitatives (Dossou et coll.,
2017
), et de développer en outre les
travaux avec des approches qualitatives (Dossou et coll.,
2017 ).
). ). Une étude sur des étudiants italiens
a conclu à un impact différencié selon les buveurs, les messages
ayant plus d’impact sur les consommateurs modérés et moins sur
les consommateurs à risque (Annunziata et coll.,
2016b
). Une étude sur des étudiants italiens
a conclu à un impact différencié selon les buveurs, les messages
ayant plus d’impact sur les consommateurs modérés et moins sur
les consommateurs à risque (Annunziata et coll.,
2016b .). L’échec à toucher les buveurs à haut risque a aussi été
mis en avant à partir d’un panel d’un millier d’Australiens de
18 à 45 ans (Coomber et coll.,
2016
.). L’échec à toucher les buveurs à haut risque a aussi été
mis en avant à partir d’un panel d’un millier d’Australiens de
18 à 45 ans (Coomber et coll.,
2016 ).
). ). En ce qui concerne le tabac justement, la stratégie
d’étiquetage n’était pas isolée mais appartenait à un programme
large et cohérent (à côté de l’éducation à la santé notamment).
Autrement dit, pour les chercheurs, le labeling n’est pas
envisagé comme une stratégie autosuffisante, et doit notamment
être assorti de campagnes de communication dans les médias :
alors seulement l’inscription de ces messages peut s’avérer
efficace, et même plus efficace que de faire figurer le taux
d’alcool (Hobin et coll., 2017
). En ce qui concerne le tabac justement, la stratégie
d’étiquetage n’était pas isolée mais appartenait à un programme
large et cohérent (à côté de l’éducation à la santé notamment).
Autrement dit, pour les chercheurs, le labeling n’est pas
envisagé comme une stratégie autosuffisante, et doit notamment
être assorti de campagnes de communication dans les médias :
alors seulement l’inscription de ces messages peut s’avérer
efficace, et même plus efficace que de faire figurer le taux
d’alcool (Hobin et coll., 2017 ). D’ailleurs, une étude en France
auprès de femmes enceintes ou en situation post-partum a
montré que l’avertissement introduit en 2007 est bien connu,
mais que les risques associés à la consommation de vin et de
bière pendant la grossesse, eux, sont plutôt méconnus (Dumas et
coll., 2018
). D’ailleurs, une étude en France
auprès de femmes enceintes ou en situation post-partum a
montré que l’avertissement introduit en 2007 est bien connu,
mais que les risques associés à la consommation de vin et de
bière pendant la grossesse, eux, sont plutôt méconnus (Dumas et
coll., 2018 ), d’où la nécessité d’accompagner le pictogramme de campagne
de prévention pour faire connaître les risques (Toutain,
2017
), d’où la nécessité d’accompagner le pictogramme de campagne
de prévention pour faire connaître les risques (Toutain,
2017 ; cf. aussi chapitre : « Syndrome d’alcoolisation fœtale et
consommation d’alcool dans la période périnatale : fréquences et
facteurs associés »).
; cf. aussi chapitre : « Syndrome d’alcoolisation fœtale et
consommation d’alcool dans la période périnatale : fréquences et
facteurs associés »). ,
fait apparaître que le design optimal pour capter
l’attention est grand et rouge), tandis qu’une étude menée sur
des étudiantes britanniques montre que la consommation serait
plus lente quand le contenant fait figurer un message ou un
pictogramme (Stafford et Salmon,
2017
,
fait apparaître que le design optimal pour capter
l’attention est grand et rouge), tandis qu’une étude menée sur
des étudiantes britanniques montre que la consommation serait
plus lente quand le contenant fait figurer un message ou un
pictogramme (Stafford et Salmon,
2017 ). En outre, les messages choquants seraient efficaces pour
réduire les consommations d’alcool, y compris chez les jeunes
buveurs (ibid.). D’ailleurs, une expérience menée sur 60
étudiantes britanniques conclut que le pictogramme a un impact
plus important que l’avertissement écrit sur les intentions de
réduire sa consommation (Wigg et Stafford,
2016
). En outre, les messages choquants seraient efficaces pour
réduire les consommations d’alcool, y compris chez les jeunes
buveurs (ibid.). D’ailleurs, une expérience menée sur 60
étudiantes britanniques conclut que le pictogramme a un impact
plus important que l’avertissement écrit sur les intentions de
réduire sa consommation (Wigg et Stafford,
2016 ).
). ). Ces informations sont même globalement souhaitées par les
consommateurs de différents pays (sur le Canada : Hobin et
coll., 2017
). Ces informations sont même globalement souhaitées par les
consommateurs de différents pays (sur le Canada : Hobin et
coll., 2017 et Vallance et coll. 2018
et Vallance et coll. 2018 ; sur l’Italie, la France, l’Espagne
et les États-Unis : Annunziata et coll.,
2016a
; sur l’Italie, la France, l’Espagne
et les États-Unis : Annunziata et coll.,
2016a ). Mais selon leurs habitudes de consommation et leurs
attitudes par rapport aux informations nutritionnelles, ce que
les consommateurs voudraient voir apparaître sur les bouteilles
varie : autrement dit, les consommateurs n’ont pas les mêmes
préférences entre voir figurer le prix, les informations
nutritionnelles, un message de santé et l’indication du nombre
d’unités d’alcool dans le contenant et du nombre d’unités à ne
pas dépasser (figure 9.1
). Mais selon leurs habitudes de consommation et leurs
attitudes par rapport aux informations nutritionnelles, ce que
les consommateurs voudraient voir apparaître sur les bouteilles
varie : autrement dit, les consommateurs n’ont pas les mêmes
préférences entre voir figurer le prix, les informations
nutritionnelles, un message de santé et l’indication du nombre
d’unités d’alcool dans le contenant et du nombre d’unités à ne
pas dépasser (figure 9.1 pour
une étude sur l’Italie, la France, l’Espagne et les États-Unis ;
Annunziata et coll., 2016a
pour
une étude sur l’Italie, la France, l’Espagne et les États-Unis ;
Annunziata et coll., 2016a ).
). ; Coomber et coll., 2017
; Coomber et coll., 2017 ; Dossou et coll.,
2017
; Dossou et coll.,
2017 ). Quelques études soulignent des voies d’amélioration pour le
labelling, les consommateurs prêtant une attention
minimum aux avertissements (Kersbergen et Field,
2017
). Quelques études soulignent des voies d’amélioration pour le
labelling, les consommateurs prêtant une attention
minimum aux avertissements (Kersbergen et Field,
2017 ) : par exemple, des expérimentations montrent que des
messages plus détaillés notamment sur le risque de cancer
auraient un impact supérieur (Miller et coll.,
2016
) : par exemple, des expérimentations montrent que des
messages plus détaillés notamment sur le risque de cancer
auraient un impact supérieur (Miller et coll.,
2016 )
sachant par ailleurs que l’acceptabilité des mesures est plus
forte chez les personnes conscientes du lien entre alcool et
cancer (Bates et coll., 2018
)
sachant par ailleurs que l’acceptabilité des mesures est plus
forte chez les personnes conscientes du lien entre alcool et
cancer (Bates et coll., 2018 ).
).
 )
) ] ou en Nouvelle-Zélande [Tinawi et
coll., 2018
] ou en Nouvelle-Zélande [Tinawi et
coll., 2018 ]) et préfèrent qu’elle s’inscrive dans une loi rendant la
mesure obligatoire. C’est pourtant le choix fait par l’Union
européenne. En effet, les États-membres ont approuvé la mise en
place d’un étiquetage sur les boissons alcoolisées fondé sur le
volontariat des industriels suite au plan d’action 2012-2020 de
l’OMS Europe visant à réduire l’usage nocif d’alcool. Un rapport
de la Commission européenne de 2017 conclut à une mise en œuvre
volontaire et s’en remet à l’autoréglementation du secteur
(Commission européenne, 2017
]) et préfèrent qu’elle s’inscrive dans une loi rendant la
mesure obligatoire. C’est pourtant le choix fait par l’Union
européenne. En effet, les États-membres ont approuvé la mise en
place d’un étiquetage sur les boissons alcoolisées fondé sur le
volontariat des industriels suite au plan d’action 2012-2020 de
l’OMS Europe visant à réduire l’usage nocif d’alcool. Un rapport
de la Commission européenne de 2017 conclut à une mise en œuvre
volontaire et s’en remet à l’autoréglementation du secteur
(Commission européenne, 2017 ; voir aussi Vaqué,
2017
; voir aussi Vaqué,
2017 ). Un rapport récent de l’OMS, faisant un état des lieux des
pratiques en Europe, recommande notamment une réglementation
obligatoire (plutôt que de s’en remettre au volontariat de
l’industrie alcoolière) qui permet notamment de contrôler que
les messages étiquetés sont en phase avec les recommandations
scientifiques et de surveiller la mise en œuvre (OMS,
2020
). Un rapport récent de l’OMS, faisant un état des lieux des
pratiques en Europe, recommande notamment une réglementation
obligatoire (plutôt que de s’en remettre au volontariat de
l’industrie alcoolière) qui permet notamment de contrôler que
les messages étiquetés sont en phase avec les recommandations
scientifiques et de surveiller la mise en œuvre (OMS,
2020 ).
). ).
). )
) ) se basant sur une enquête de la
Fondation pour la recherche en alcoologie (FRA), estimait à 3,5
millions d’euros annuels la recherche – publique et privée – sur
l’alcool (soit 0,53 €/habitant), un budget 27 fois inférieur au
seul budget d’un organisme public américain de recherche sur
l’alcool. Si plus de moyens doivent leur être accordés, ceux-ci
doivent être indépendants de l’industrie alcoolière : « chacun
doit être à sa place. Il est irréaliste de penser possible un
consensus entre celles et ceux dont le métier est de vendre de
l’alcool et les logiques de santé publique » (CESE, 2019
) se basant sur une enquête de la
Fondation pour la recherche en alcoologie (FRA), estimait à 3,5
millions d’euros annuels la recherche – publique et privée – sur
l’alcool (soit 0,53 €/habitant), un budget 27 fois inférieur au
seul budget d’un organisme public américain de recherche sur
l’alcool. Si plus de moyens doivent leur être accordés, ceux-ci
doivent être indépendants de l’industrie alcoolière : « chacun
doit être à sa place. Il est irréaliste de penser possible un
consensus entre celles et ceux dont le métier est de vendre de
l’alcool et les logiques de santé publique » (CESE, 2019 ,
p. 27).
,
p. 27). ) avance qu’élever
l’âge pour la vente d’alcool au-delà de 18 ans (comme l’ont fait
les États-Unis dans les années 1970 et 1980) est une mesure
ayant un impact positif sur la réduction du nombre d’accidents
de la route et les prévalences de consommations ; cette mesure
doit cependant être inscrite dans une politique plus large
comprenant à la fois des mesures d’éducation et des mesures de
contrôle.
) avance qu’élever
l’âge pour la vente d’alcool au-delà de 18 ans (comme l’ont fait
les États-Unis dans les années 1970 et 1980) est une mesure
ayant un impact positif sur la réduction du nombre d’accidents
de la route et les prévalences de consommations ; cette mesure
doit cependant être inscrite dans une politique plus large
comprenant à la fois des mesures d’éducation et des mesures de
contrôle. ).
). ,
seuls 2 % l’utilisent), ce qui est également préconisé par le
CESE (2019
,
seuls 2 % l’utilisent), ce qui est également préconisé par le
CESE (2019 ).
). ),
d’autres pensent au contraire qu’une approche par produit serait
plus appropriée, avec notamment un Plan National Alcool
(Naassila, 2018
),
d’autres pensent au contraire qu’une approche par produit serait
plus appropriée, avec notamment un Plan National Alcool
(Naassila, 2018 ). Dans son plan pour 2018-2022, le
gouvernement français actuel semble avoir opté pour l’approche
générale, en intégrant l’alcool dans une stratégie globale de
lutte contre les addictions (Mildeca,
2018
). Dans son plan pour 2018-2022, le
gouvernement français actuel semble avoir opté pour l’approche
générale, en intégrant l’alcool dans une stratégie globale de
lutte contre les addictions (Mildeca,
2018 ).
). « une
politique unifiée de lutte contre les consommations nocives
ayant pour but d’infléchir les comportements des consommateurs à
risque, qui doivent être responsabilisés dans leur rapport
individuel à l’alcool, tout en sensibilisant l’ensemble de la
population aux risques des consommations nocives ». La
Grande-Bretagne écartait en 2016 d’avoir des recommandations
spécifiques pour différents âges ou groupes sociaux (et adoptait
comme repère de consommation pour tous 14 unités par semaine,
Department of Health,
2016
« une
politique unifiée de lutte contre les consommations nocives
ayant pour but d’infléchir les comportements des consommateurs à
risque, qui doivent être responsabilisés dans leur rapport
individuel à l’alcool, tout en sensibilisant l’ensemble de la
population aux risques des consommations nocives ». La
Grande-Bretagne écartait en 2016 d’avoir des recommandations
spécifiques pour différents âges ou groupes sociaux (et adoptait
comme repère de consommation pour tous 14 unités par semaine,
Department of Health,
2016 ), tandis qu’en France, les plans gouvernementaux depuis 2008
prônent plutôt le ciblage des populations les plus exposées et
vulnérables, et ce même si la régulation publicitaire, les
avertissements sanitaires, les campagnes dans les médias sont
plutôt populationnelles (mises à part les actions ciblées sur
les femmes enceintes).
), tandis qu’en France, les plans gouvernementaux depuis 2008
prônent plutôt le ciblage des populations les plus exposées et
vulnérables, et ce même si la régulation publicitaire, les
avertissements sanitaires, les campagnes dans les médias sont
plutôt populationnelles (mises à part les actions ciblées sur
les femmes enceintes). ) propose le concept « d’universalisme proportionné » soit des
mesures qui peuvent être destinées à l’ensemble de la population
mais dont l’intensité de l’effet doit être plus importante parmi
ceux en ayant le plus besoin. Mais comment définir « les
catégories en ayant le plus besoin » ? Dans la littérature, on
trouve d’abord la nécessité d’adapter les messages selon les
buveurs : Com-Ruelle et Célant
(2013
) propose le concept « d’universalisme proportionné » soit des
mesures qui peuvent être destinées à l’ensemble de la population
mais dont l’intensité de l’effet doit être plus importante parmi
ceux en ayant le plus besoin. Mais comment définir « les
catégories en ayant le plus besoin » ? Dans la littérature, on
trouve d’abord la nécessité d’adapter les messages selon les
buveurs : Com-Ruelle et Célant
(2013 ) ont montré l’évolution de la prévalence des profils
d’alcoolisation des buveurs adultes français entre 2002 et 2010,
et plus précisément des risques différenciés selon le sexe,
l’âge et la catégorie socio-professionnelle :
) ont montré l’évolution de la prévalence des profils
d’alcoolisation des buveurs adultes français entre 2002 et 2010,
et plus précisément des risques différenciés selon le sexe,
l’âge et la catégorie socio-professionnelle : ).
). ; Jernigan et coll., 2019
; Jernigan et coll., 2019 ), et appellent à développer des
politiques de prévention sur les campus, préconisant souvent la
participation des étudiants à la co-construction des mesures
(Van Hal et coll., 2018
), et appellent à développer des
politiques de prévention sur les campus, préconisant souvent la
participation des étudiants à la co-construction des mesures
(Van Hal et coll., 2018 ; Larsen et coll.,
2016
; Larsen et coll.,
2016 ). Let it hAPYN (Peloza et coll.,
2016
). Let it hAPYN (Peloza et coll.,
2016 )
par exemple fait le point sur les meilleures pratiques
(tableau 9.IV
)
par exemple fait le point sur les meilleures pratiques
(tableau 9.IV ).
). )
) ), les 3 approches politiques les
plus efficaces.
), les 3 approches politiques les
plus efficaces. ). D’autres, analysant les adolescents de 13-15 ans de 37 pays
soutiennent que la consommation hebdomadaire est liée aux
politiques de contrôle, et que les états d’ébriété sont liés aux
modes de consommation des adultes. C’est pourquoi ils
recommandent d’une part, de diminuer la disponibilité de
l’alcool et d’interdire la publicité (stratégies efficaces pour
réduire l’alcoolisation fréquente) et d’autre part, de changer
les normes et les modes de consommation dans la population
adulte pour réduire la prévalence de l’ivresse (Bendtsen et
coll., 2014
). D’autres, analysant les adolescents de 13-15 ans de 37 pays
soutiennent que la consommation hebdomadaire est liée aux
politiques de contrôle, et que les états d’ébriété sont liés aux
modes de consommation des adultes. C’est pourquoi ils
recommandent d’une part, de diminuer la disponibilité de
l’alcool et d’interdire la publicité (stratégies efficaces pour
réduire l’alcoolisation fréquente) et d’autre part, de changer
les normes et les modes de consommation dans la population
adulte pour réduire la prévalence de l’ivresse (Bendtsen et
coll., 2014 ).
). ).
). ), dans la même veine que les études qui utilisent le concept
de « Alcohol Harm To Others » (AHTO), pour souligner que
les dommages liés à l’alcool ne concernent pas (forcément) que
le consommateur et peuvent affecter son entourage (Warpenius et
Tigersteedt, 2016
), dans la même veine que les études qui utilisent le concept
de « Alcohol Harm To Others » (AHTO), pour souligner que
les dommages liés à l’alcool ne concernent pas (forcément) que
le consommateur et peuvent affecter son entourage (Warpenius et
Tigersteedt, 2016 ). En ce sens, l’idée est similaire au
concept de « tabagisme passif ». Selon certains, cela pourrait
faciliter une prise de conscience plus grande de la population
sur les dommages liés à l’alcool et, peut-être, avoir plus de
potentiel pour créer la volonté politique (Warpenius et
Tigersteedt, 2016
). En ce sens, l’idée est similaire au
concept de « tabagisme passif ». Selon certains, cela pourrait
faciliter une prise de conscience plus grande de la population
sur les dommages liés à l’alcool et, peut-être, avoir plus de
potentiel pour créer la volonté politique (Warpenius et
Tigersteedt, 2016 ), alors que ne pas faire de la
réduction des AHTO un objectif de santé publique empêchera
d’appréhender le problème autrement que par une approche
curative individuelle, consistant notamment à fournir un
traitement aux dépendants à l’alcool (Karriker-Jaffe et coll.,
2018
), alors que ne pas faire de la
réduction des AHTO un objectif de santé publique empêchera
d’appréhender le problème autrement que par une approche
curative individuelle, consistant notamment à fournir un
traitement aux dépendants à l’alcool (Karriker-Jaffe et coll.,
2018 ).
). ). Pouvant fournir un argument en ce sens, Gneiting et Schmitz
(2016
). Pouvant fournir un argument en ce sens, Gneiting et Schmitz
(2016 ), comparant les cas du tabac et de l’alcool, ont mis en
évidence une différence majeure : la coalition en faveur de plus
de contrôle du tabac a réussi à créer et maintenir un consensus
sur les solutions, alors que le champ de l’alcool est au
contraire très divisé.
), comparant les cas du tabac et de l’alcool, ont mis en
évidence une différence majeure : la coalition en faveur de plus
de contrôle du tabac a réussi à créer et maintenir un consensus
sur les solutions, alors que le champ de l’alcool est au
contraire très divisé. ), mais il faut voir si cela ne
reviendrait pas à créer un équivalent pour l’alcool des paquets
« light » pour le tabac. Plus nombreuses, d’autres
études préconisent de changer d’approche pour se focaliser sur
le nombre de grammes d’alcool à ne pas dépasser (plutôt que ce
qui pratique aujourd’hui autour d’un nombre de verres, plus
sujet à interprétation individuelle, le contenant pouvant être
en lui-même variable mais la recommandation être aussi fonction
du type d’alcool consommé). Il s’agirait donc de s’inspirer de
ce qui se fait pour le poids corporel avec les recommandations
caloriques journalières pour un homme ou une femme faisant ou
non de l’exercice, car cela permettrait des repères plus clairs
et sans stigmatisation de l’addiction ou la dépendance (Nutt et
Rehm, 2014
), mais il faut voir si cela ne
reviendrait pas à créer un équivalent pour l’alcool des paquets
« light » pour le tabac. Plus nombreuses, d’autres
études préconisent de changer d’approche pour se focaliser sur
le nombre de grammes d’alcool à ne pas dépasser (plutôt que ce
qui pratique aujourd’hui autour d’un nombre de verres, plus
sujet à interprétation individuelle, le contenant pouvant être
en lui-même variable mais la recommandation être aussi fonction
du type d’alcool consommé). Il s’agirait donc de s’inspirer de
ce qui se fait pour le poids corporel avec les recommandations
caloriques journalières pour un homme ou une femme faisant ou
non de l’exercice, car cela permettrait des repères plus clairs
et sans stigmatisation de l’addiction ou la dépendance (Nutt et
Rehm, 2014 ).
). ).
).