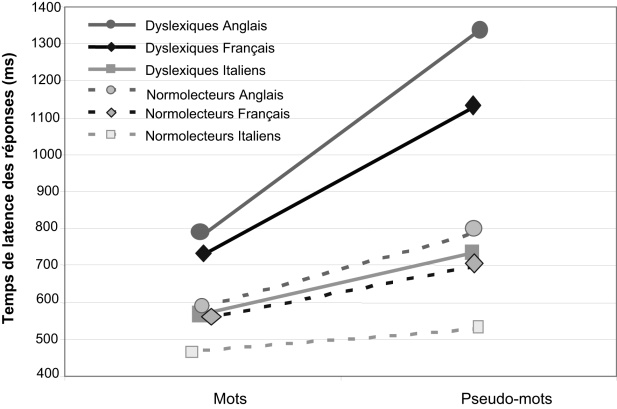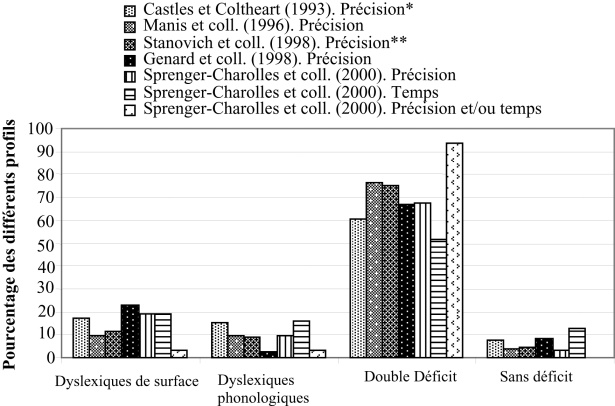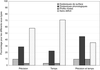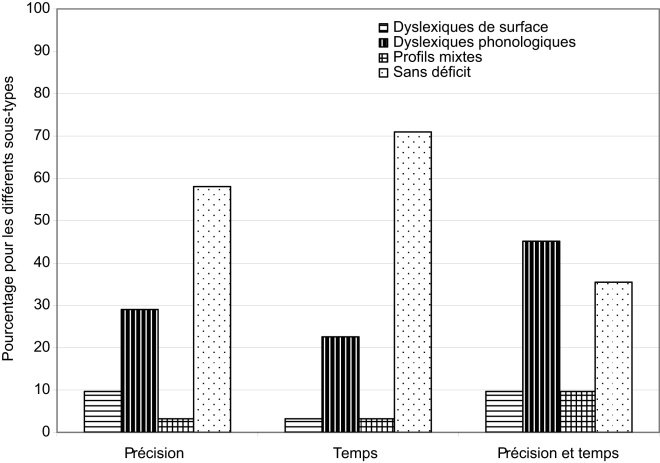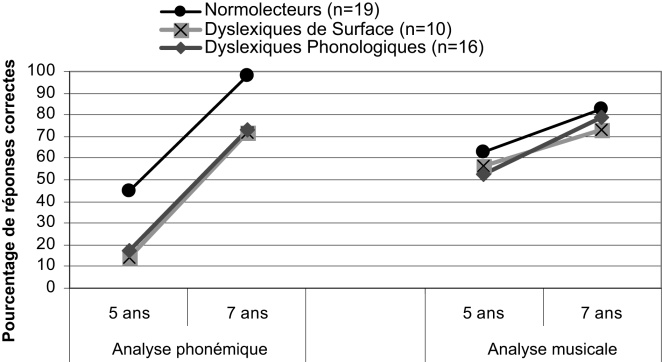Troubles spécifiques des apprentissages
2007
9-
Dyslexie : études de groupes et de cas multiples
Les difficultés d'apprentissage de la lecture peuvent avoir des origines diverses : un environnement social peu stimulant, une scolarisation non assidue ou une mauvaise maîtrise de la langue. La présence de troubles psychologiques, de déficits intellectuels ou encore de déficiences de la vision ou de l'audition peut également gêner cet apprentissage. C'est seulement face à une difficulté sévère d'apprentissage de la lecture, et après avoir éliminé les causes potentielles d'échec évoquées, que l'on peut parler de troubles spécifiques d'acquisition de la lecture, c'est-à-dire de dyslexie (Critchley, 1970

;
World Health Organization, 1993

).
Ce chapitre présente une synthèse de l'état actuel des connaissances dans le domaine. Pour comprendre ce qui dysfonctionne chez le dyslexique, il faut toutefois avoir une idée du fonctionnement normal de la lecture et de son apprentissage. Le présent chapitre s'appuie donc sur les travaux présentés dans le chapitre 2, dans lequel ont été examinés les résultats des études sur les processus cognitifs mis en jeu dans la lecture chez celui qui sait lire (le lecteur dit « expert ») ainsi que ceux provenant des études sur l'apprentissage normal de la lecture.
Ces travaux ont montré que ce sont les mécanismes qui permettent d'identifier les mots écrits qui sont spécifiques à la lecture, le processus de compréhension étant largement amodal, c'est-à-dire similaire quel que soit le mode de présentation des informations linguistiques, écrit ou oral. En effet, chez le lecteur qui a développé des procédures d'identification des mots écrits efficientes, les corrélations entre compréhension écrite et orale sont très élevées. Ces travaux ont également montré que le lecteur expert a recours à des procédures d'identification des mots écrits très rapides et fortement indépendantes du contexte. De plus, ce lecteur a accès quasi-immédiatement non seulement à l'image visuelle des mots écrits, mais aussi à leur forme sonore. C'est le développement de telles procédures de lecture qui permet à l'enfant d'atteindre un niveau de compréhension écrite égal à celui de sa compréhension orale, en le dégageant du poids d'un décodage lent et laborieux. Les travaux de recherche suggèrent également que, dans une écriture alphabétique, la maîtrise du décodage est le sine qua non de l'apprentissage de la lecture. Les bons décodeurs précoces sont en effet ceux qui progressent le mieux, et le plus vite. En outre, la « transparence » de l'orthographe facilite cet apprentissage. Ainsi, les enfants espagnols apprennent à lire plus vite que les petits français qui eux-mêmes apprennent plus vite que les petits anglais. Les travaux de recherche signalent enfin que les capacités phonologiques (capacités d'analyse phonémique, de mémoire phonologique à court terme et de dénomination rapide) sont les prédicteurs les plus fiables de l'apprentissage de la lecture. En comparaison, le poids des habiletés non verbales, tout comme celui des facteurs socioculturels, est moindre.
Le présent chapitre est centré sur deux principales questions : comment fonctionnent les procédures d'identification des mots écrits chez les dyslexiques et quelles sont, en dehors de la lecture, les compétences déficientes chez eux ? Auparavant, les principaux problèmes que posent les études portant sur ce type de population sont examinés.
Quelques problèmes méthodologiques
C'est face à une difficulté sévère d'apprentissage de la lecture, et après avoir éliminé les causes potentielles d'échec évoquées dans l'introduction, que l'on peut parler de dyslexie. Cette définition n'est toutefois pas opérationnelle d'un point de vue diagnostic. Elle ne fournit en effet aucun indice permettant de caractériser la dyslexie. La seule définition basée sur des critères non exclusionnaires s'appuie sur l'examen des performances en lecture des dyslexiques. Elle part du fait que, pour pouvoir comprendre des textes, l'enfant doit acquérir un haut niveau d'automaticité dans l'identification des mots écrits. C'est le développement d'une telle compétence qui lui permettra d'atteindre un niveau de compréhension écrite égal à celui de sa compréhension orale. Dans ce contexte, ce qui caractérise la dyslexie est l'incapacité de développer des procédures automatiques d'identification des mots écrits, cette difficulté, inattendue vu l'âge et les autres habiletés cognitives des dyslexiques, n'étant pas la conséquence de troubles sensori-moteurs. Cette définition est celle retenue par l'
International Dyslexia Association (2005

).
Une autre question est de savoir à partir de quand on peut dire d'un enfant qu'il est dyslexique. Si on accepte un critère souvent retenu (2 ans de retard), ce n'est qu'après deux ans d'échec qu'il est possible de faire un bilan de dyslexie, et donc d'apporter les aides nécessaires. Un meilleur critère est de tenir compte de l'écart par rapport à la moyenne des performances d'un groupe de lecteurs ne présentant pas de difficultés. On qualifie alors de déviantes les performances qui se situent, par exemple, à plus de 1,65 écart-type de la norme, ce qui, dans une distribution normale, correspond aux 5 % des sujets qui ont les scores les plus faibles.
Pour évaluer un déficit, il faut toutefois disposer de normes. Si on admet que le déficit principal des dyslexiques concerne les procédures d'identification des mots écrits, les tests doivent évaluer cette compétence. De tels tests existent dans les pays anglo-saxons (WRAT-R, Jastak et Wilkinson, 1984

; Woodcock, 1987

). Ces tests, utilisés aussi bien par les cliniciens que par les chercheurs, comportent des épreuves de lecture de mots et de pseudo-mots, qui ne prennent toutefois en compte que la précision de la réponse (pas le temps de réponse), ce qui a pu conduire à sous-estimer les déficits des dyslexiques les plus âgés (Shaywitz et Shaywitz, 2005

). De telles batteries existent en France, la Belec (Mousty et Leybaert, 1999

), l'Odedys et l'Evalec (Sprenger-Charolles et coll., 2005

). Seule la dernière présente des données normatives pour le niveau CP qui tiennent compte à la fois de la précision et du temps de latence des réponses correctes.
Une question cruciale, pour ceux qui cherchent à mettre en relief un possible « génotype » de la dyslexie, est de savoir s'il y a un « phénotype ». En d'autres termes, est-ce que les manifestations de la dyslexie se retrouvent de façon identique chez la plupart des sujets. D'après les modèles de référence dans le domaine (Plaut et coll., 1996

; Coltheart et coll., 2001

), pour identifier les mots, le lecteur peut utiliser une procédure lexicale (ou visuo-orthographique) ou une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), ce qui renvoie, dans la terminologie utilisée dans le domaine de l'enseignement, à la lecture globale de mot, par opposition à son décodage. Dans ce contexte, la question est de savoir s'il y a des troubles des procédures d'identification des mots écrits qui prévalent chez les dyslexiques (c'est-à-dire qui se retrouvent de façon convergente à travers les études et qui caractérisent la majorité des cas) ou si, au contraire, il y a différents types de dyslexie. Cette question a des implications pour la prise en charge des enfants, qui doit s'adapter à la nature du trouble. Dans les parties suivantes, après avoir présenté la première étude dans laquelle la question de l'homogénéité des profils de dyslexie a été évaluée, sont explicités quelques problèmes méthodologiques à la source d'incohérences dans la littérature sur la dyslexie.
De l'étude princeps de Boder (1973) aux modèles issus de la neuropsychologie
La question de savoir s'il y a ou non homogénéité dans les manifestations de la dyslexie du développement était au cœur de l'étude de Boder (1973

) qui a porté sur une centaine d'enfants de 8 à 16 ans. Dans un premier temps, des mots étaient présentés durant une seconde. Ceux qui n'ont alors pas été reconnus ont été représentés pendant 10 secondes. Les items reconnus dans la première condition sont supposés faire partie du vocabulaire « visuel » des enfants et ceux lus dans la seconde, supposés avoir été décodés. La dernière étape de l'étude comportait une épreuve d'écriture portant sur les mots reconnus visuellement et sur ceux décodés. La typologie a été établie sur la base des résultats de cette épreuve. La plupart des dyslexiques (60 %) ont des troubles phonologiques sélectifs. Ces dyslexiques, dits dysphonétiques, n'écrivent correctement que les mots qu'ils connaissent par cœur. Les 10 % de dyslexiques dits dyseidétiques ont des problèmes spécifiques de mémorisation de la forme visuelle des mots : ils écrivent les mots comme ils les prononcent. Un troisième groupe inclut les enfants les plus sévèrement handicapés, qui souffrent à la fois de troubles visuels et phonologiques. D'après cette étude, les troubles phonologiques se retrouvent donc dans la majorité des cas de dyslexie. Cette étude a eu une large influence dans la pratique clinique. Elle est toutefois biaisée par le fait que la classification des dyslexiques était basée sur leurs habiletés d'écriture. Cette approche a été remplacée dès la fin des années 1970 par les travaux issus de la neuropsychologie.
La neuropsychologie s'est intéressée au traitement de l'information chez des patients qui ont perdu certaines habiletés suite à un accident cérébral. On parle alors de troubles acquis, par opposition aux troubles du développement. Les dyslexies acquises surviennent chez des adultes qui ont normalement appris à lire : l'architecture cognitive sous-tendant cette compétence était donc en place chez eux. En général, certains aspects de la lecture sont préservés et les dissociations fonctionnelles relevées permettent d'émettre des hypothèses sur les différentes composantes impliquées dans le processus de lecture. Ainsi, certains patients ne peuvent lire que les mots réguliers sur le plan des correspondances grapho-phonémiques, qu'ils soient ou non fréquents, et produisent des erreurs de régularisation sur les mots irréguliers, même très fréquents (« sept » lu comme « septembre »). D'autres présentent le profil inverse : ils ne peuvent lire que les mots fréquents, qu'ils soient ou non réguliers, et s'avèrent incapables de lire des mots nouveaux. Les patients du premier type sont dits avoir une dyslexie de surface (Coltheart et coll., 1983

) et ceux du second type une dyslexie phonologique (Beauvois et Derouesné, 1979

). Ces doubles dissociations, à la base du modèle à double voie de lecture (Coltheart, 1978

; Coltheart et coll., 1993

et 2001

), indiquent qu'il existerait deux procédures fonctionnellement distinctes : une procédure lexicale, s'appuyant sur la forme « globale » des mots et une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), s'appuyant sur les correspondances grapho-phonémiques.
Ces modèles ne sont pas forcément les plus adéquats pour rendre compte de la dyslexie du développement. En effet, chez ces dyslexiques, le déficit lexique ne résulte pas d'une lésion cérébrale acquise après l'apprentissage de la lecture : il se manifeste au cours de cet apprentissage. C'est la raison pour laquelle des modèles développementaux ont été élaborés (Marsh et coll., 1981

; Frith, 1985

et 1986

; Harris et Coltheart, 1986

; Morton, 1989

). Si on admet que, d'une part, les procédures de lecture se mettent en place progressivement, en suivant une trajectoire développementale spécifique, la maîtrise de la procédure sublexicale (par médiation phonologique) conditionnant la mise en place de la procédure lexicale (voir le chapitre 2) et que, d'autre part, les dyslexiques présentent des déficiences dans les traitements impliquant la phonologie (Ramus, 2003), la procédure sublexicale ne devrait pas se mettre correctement en place chez eux, ni par voie de conséquence, la procédure lexicale. On ne devrait donc pas rencontrer de profils dissociés de type dyslexie phonologique (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure phonologique de lecture) ou dyslexie de surface (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure lexicale de lecture) dans la dyslexie du développement.
Apport et limites des différents types d'études
Deux types d'études ont occupé une place prépondérante dans la recherche sur la dyslexie jusqu'à une période récente : les études de groupes et celles de cas uniques. Les études de cas uniques visent à mettre en relief des profils extrêmes, représentatifs d'un type particulier de symptôme (Coltheart, 2004

), alors que les études de groupes visent à déterminer ce qui caractérise le comportement moyen des dyslexiques, à partir de l'examen d'une large population supposée représentative de ce qu'est la dyslexie.
Dans les études de groupe, les scores d'un groupe de dyslexiques sont comparés à ceux d'un groupe de normolecteurs. Les différences sont dites robustes quand les mêmes résultats sont reproduits dans différentes études. Ces études neutralisent toutefois les individus. Or, les participants d'un même groupe n'ont pas tous le même comportement. Une différence significative peut en effet n'être due qu'à un petit nombre de dyslexiques, par exemple, autour de 50 %, comme dans une étude de Tallal (1980

). Dans ce cas, il est illégitime de dire que le déficit observé est prévalent.
Les études de cas uniques ne s'intéressent en revanche qu'aux individus, leur objectif étant de mettre en relief l'existence de profils dissociés dans la dyslexie. On définit comme dyslexique phonologique celui qui a un déficit sélectif de la procédure par médiation phonologique et comme dyslexique de surface celui qui a un déficit sélectif de la procédure lexicale de lecture. Cette typologie est le plus souvent fondée sur la comparaison entre les scores en lecture de mots irréguliers fréquents (qui peuvent être traités par la procédure lexicale) et ceux en lecture de pseudo-mots (traités par la procédure par médiation phonologique). Le dyslexique phonologique a des performances normales en lecture de mots irréguliers fréquents alors que ses performances en lecture de pseudo-mots sont en dessous de la norme, et vice versa pour la dyslexie de surface. Ce type d'étude pose deux problèmes. D'une part, lorsque l'on n'examine que des profils dissociés, sont exclus les dyslexiques qui ont un double déficit. D'autre part, on ne peut rendre compte de la prévalence des différents profils.
Pour connaître cette prévalence, il faut s'appuyer sur l'examen de séries de cas. Ce type d'études permet de surmonter les difficultés respectives des deux méthodes précédentes. Ces études utilisent en effet la méthode des cas uniques, sauf qu'elles prennent en compte plusieurs cas non sélectionnés pour leur typicité. De plus, comme les études de groupes, elles portent sur une large population supposée représentative de la population des dyslexiques. Elles peuvent donc permettre de connaître la prévalence des profils de type dyslexie phonologique et de surface. Elles permettent également de cerner la proportion des profils mixtes que les études de cas uniques ont toujours négligés. Une méthode de plus en plus utilisée s'appuie sur l'examen de séries de cas de dyslexiques émanant d'une vaste cohorte suivie pendant plusieurs années depuis une période précédant l'apprentissage de la lecture. Ce type d'études permet d'évaluer les différences entre de futurs dyslexiques et de futurs normolecteurs avant l'apprentissage de la lecture ainsi que la stabilité des profils de dyslexie dans le temps.
Limites des comparaisons avec des enfants de même âge
Les performances des dyslexiques sont souvent comparées à celles de normolecteurs de même âge, ce qui est discutable. En effet, le niveau de lecture a une incidence sur les capacités langagières, entre autres, le vocabulaire et les capacités d'analyse phonémique. En conséquence, une différence entre dyslexiques et normolecteurs de même âge chronologique dans ces domaines peut simplement s'expliquer par le niveau de lecture des dyslexiques. D'autre part, il y a des changements au cours de l'apprentissage dans les procédures de lecture utilisées. Ainsi, l'effet de la régularité (la différence entre la lecture de mots réguliers, comme « table » et irréguliers, comme « sept ») est plus notable chez les jeunes enfants (7-8 ans) que chez les plus âgés (à 10 ans). En conséquence, il est problématique de comparer les compétences en lecture de normolecteurs de 10 ans à celles de dyslexiques de même âge mais ayant un niveau de lecture d'enfants de 8 ans.
Bryant et Impey (1986

) ont été les premiers à avoir mis en relief le caractère crucial d'une comparaison entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture. Ce type de comparaison, à la différence de celles avec des normolecteurs de même âge chronologique, permet en effet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard d'apprentissage. Pour donner une image, on peut se figurer une balance avec deux plateaux et des poids sur chacun d'eux, les poids sur le plateau de gauche et sur celui de droite indiquant respectivement l'efficience des procédures sublexicale et lexicale de lecture. Le poids global de ces deux procédures est identique chez les dyslexiques et les normolecteurs. Si les plateaux s'équilibrent de la même façon chez les dyslexiques et les normolecteurs plus jeunes, les dyslexiques ont un simple retard d'apprentissage. Les plateaux peuvent toutefois ne pas se positionner de façon identique dans les deux populations. Dans ce cas, comme le soulignent Bryant et Impey (1986

), les dyslexiques présentent un profil atypique, non observé chez des enfants qui ont le même niveau global de lecture qu'eux : leur trajectoire développementale est donc déviante.
Limites dues aux mesures utilisées pour caractériser les déficits lexiques des dyslexiques
Les effets les plus souvent manipulés sont ceux de lexicalité, de fréquence et de régularité. La manifestation d'effets de fréquence ou de lexicalité est considérée comme étant la signature de la procédure lexicale. En effet, cette procédure doit permettre de mieux lire les mots fréquents que les rares, leur adresse étant plus facilement accessible parce que plus souvent sollicitée. La lexicalité n'est que la limite extrême de la fréquence, les pseudo-mots ne pouvant avoir d'adresse dans le lexique interne d'un sujet, vu qu'ils n'existent pas. D'un autre côté, une supériorité de la lecture de mots réguliers par rapport à des mots irréguliers (effet de régularité) est l'indicateur du recours à la procédure sublexicale (par médiation phonologique), les mots irréguliers ne pouvant être correctement lus par cette procédure.
L'efficience d'un comportement doit se mesurer par sa précision et sa rapidité. La rapidité de la réponse ne peut cependant être utilisée que si le nombre de réponses correctes est suffisamment élevé (plus de 50 % pour les épreuves de lecture à haute voix de mots ; Olson et coll., 1994

). Cela permet de comprendre pourquoi, dans les études effectuées avec des dyslexiques anglophones, il n'a le plus souvent été tenu compte que de la précision. En effet, le nombre moyen de réponses correctes est souvent très bas, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues, comme en espagnol ou en allemand, dans lesquelles les bilans de dyslexie se basent sur le temps de traitement. Ce n'est également pas le cas en français bien que le temps de réponse ne soit que rarement pris en compte, ce qui a pu conduire à des erreurs de diagnostic. En effet, il n'est pas possible de dire que les capacités de lecture d'un sujet dyslexique sont préservées quand ce sujet est aussi précis que des normolecteurs mais plus lent.
Ces questions sont examinées dans ce chapitre qui présente d'abord les études sur le fonctionnement des procédures d'identification des mots écrits dans la dyslexie, puis celles sur les compétences déficitaires, en dehors de la lecture, chez ces sujets. Ce chapitre s'appuie sur les résultats d'études de groupes et de séries de cas. De plus, les manifestations de la dyslexie étant supposées être influencées par la transparence de l'orthographe, aussi souvent que possible sont présentés les résultats d'études inter-langues, et ceux d'études impliquant des non-anglophones. Une attention particulière est portée, d'une part, aux études s'appuyant sur des comparaisons entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture, d'autre part, aux liens entre l'exactitude de la réponse et la vitesse de traitement et, enfin, aux études comportant des données longitudinales, en particulier celles recueillies avant l'apprentissage de la lecture chez de futurs dyslexiques.
Procédures d'identification des mots écrits dans la dyslexie
Cette section présente des résultats émanant d'études de groupes et de séries de cas individuels de dyslexiques. Les études de groupes permettent de caractériser le phénotype de la dyslexie, en mettant en relief la spécificité des procédures d'identification des mots écrits utilisées par ces sujets, en tant que groupe, alors les études de séries de cas permettent d'évaluer le nombre de sujets qui ont un déficit spécifique, quel qu'il soit. Les résultats des études de groupe sont dits robustes s'ils se retrouvent de façon convergente dans différentes études ; les déficits sont dits prévalents s'ils se retrouvent dans la majorité des cas.
Études de groupes
Les premiers travaux sur la dyslexie ont mis en relief des difficultés supposées visuelles. Par exemple, les dyslexiques lisent « p » à la place de « b » (Orton et Samuel, 1937

). Cette hypothèse encore très populaire a été rejetée.
Pour être sûr que les confusions entre p-b (ou entre b-d) sont visuelles, il faudrait que ces erreurs ne concernent que ces deux lettres, et non leur équivalent phonologique t-d (ou p-t) ; ce qui n'est pas le cas. En effet, les dyslexiques (Fischer et coll., 1978

; Vellutino, 1979

), comme les lecteurs débutants (Liberman et coll., 1971

; Cossu et coll., 1995

; Sprenger-Charolles et Siegel, 1997

), font autant de confusion entre p et b qu'entre t et d, ce qui suggère, comme le soulignent les auteurs, que les erreurs entre p et b sont plutôt phonologiques que visuelles.
Les études ultérieures sur la dyslexie ont pour la majeure partie d'entre elles été basées sur le modèle à double voie de lecture (Coltheart, 1978

; Coltheart et coll., 1993

et 2001

) et/ou sur les modèles développementaux (Frith, 1985

; Harris et Coltheart, 1986

; Seymour, 1986

; Morton, 1989

), l'objectif étant de vérifier si le déficit des dyslexiques concerne plutôt la procédure sublexicale que la procédure lexicale de lecture.
Dans le cadre de ces études, on utilise les items supposés être la meilleure signature de la mise en œuvre de l'une des deux procédures de lecture, des mots irréguliers fréquents pour la procédure lexicale, et des pseudo-mots non-analogues de mots de la langue
1
C'est-à-dire des pseudo-mots qui ne ressemblent pas à des mots de la langue, ni sur le plan orthographique, ni sur le plan phonologique. En effet, des pseudo-mots proches de mots de la langue (comme « mable » ou « lorte », analogues de « table » et de « porte ») peuvent être partiellement lus par une procédure lexicale.
pour la procédure sublexicale (ou par médiation phonologique). Si la procédure sublexicale des dyslexiques est déficiente, leur déficit devrait surtout ressortir en lecture de pseudo-mots, parce qu'aucune stratégie lexicale n'est alors disponible (il n'est en effet pas possible de « reconnaître » un mot qui n'a jamais été rencontré). L'effet de la lexicalité, c'est-à-dire la différence entre la lecture de mots et de pseudo-mots, devrait donc être plus important chez eux que chez des normolecteurs. À l'inverse, l'effet de la régularité, c'est-à-dire la différence entre des mots réguliers comme « table » et des mots irréguliers comme « sept », devrait être plus faible chez eux que chez des normolecteurs. Cette dernière hypothèse est fondée sur le fait que l'utilisation normale de la voie sublexicale de lecture facilite la lecture de mots réguliers au détriment des mots irréguliers, au moins dans les étapes initiales de l'acquisition de lecture (voir pour des résultats en anglais ou en français : Backman et coll., 1984

; Waters et coll., 1984

; Sprenger-Charolles et coll., 1998 et 2003

).
Déficit des dyslexiques en lecture de pseudo-mots : analyse des études de groupes anglophones
La présence d'un déficit en lecture de pseudo-mots chez les dyslexiques, y compris par rapport à des normolecteurs plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture (appelés normolecteurs de même âge lexique ; NLAL), est un indicateur du fait que leur trajectoire développementale est déviante. Cette question a été évaluée dans la revue de la littérature de Rack et coll. (1992

) et dans la méta-analyse de Van Ijzendoorn et Bus (1994

).
Rack et coll. (1992

) ont séparé les études en deux ensembles : celles où les dyslexiques se sont avérés plus faibles que les NLAL et les autres. Le premier ensemble comporte dix études impliquant 428 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Snowling, 1981

; Baddeley et coll., 1982

; Siegel et Ryan, 1988

). Les dyslexiques ont de 5 à 1,3 ans de plus que les NLAL (médiane : 2,5 ans). Les différences pour l'exactitude de la réponse en lecture de pseudo-mots varie de 43 % (Snowling, 1981

) à 9 % (Baddeley et coll., 1982

) avec une médiane de 19 %. L'autre ensemble inclut six études impliquant 276 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Beech et Harding, 1984

; Treiman et Hirsh-Pasek, 1985

; Szeszulski et Manis, 1987

). Les différences d'âge entre groupes varient entre 4 et 1 ans (médiane : 3) et celles pour les scores en lecture de pseudo-mots entre 15 et 0 % (médiane : 4 %), les deux scores extrêmes ayant été relevés chez les enfants qui avaient le niveau de lecture le plus bas et le plus élevé dans l'étude de Szeszulski et Manis (1987

). Le résultat nul observé dans le dernier cas peut donc provenir d'effets plafonds pour la précision de la réponse. Rack et coll. (1992

) postulent que les différences entre ces deux ensembles peuvent être dues soit aux tests employés pour apparier les groupes, soit au type de pseudo-mots utilisé. En effet, les différences non significatives émergent, d'une part, dans les études dans lesquelles les dyslexiques ont été appariés aux NLAL sur la base d'un test impliquant la lecture de mots en contexte, ou celle de mots simples. D'autre part, elles se retrouvent surtout dans les études qui ont utilisé des pseudo-mots simples (courts ou peu complexes).
La validité de ces explications a été évaluée par Van Ijzendoorn et Bus (1994

) dans une méta-analyse des études prises en compte par Rack et coll. (1992

). La population entière comporte 1 183 sujets, la moitié étant dyslexiques. Van Ijzendoorn et Bus ont calculé la taille de la différence entre les scores des dyslexiques et ceux des NLAL en nombre d'écarts-type. Pour estimer la force d'un effet, les valeurs proposées par Cohen (1988

) ont été utilisées : un effet de 0,20 est considéré faible, à partir de 0,50, il est dit modéré, et à partir de 0,80, fort. Pour la totalité des études passées en revue par Van Ijzendoorn et Bus, la taille de l'effet varie de 0 à 1,03 (moyenne : 0,48). La taille de l'effet est de 0,66 pour les études dans lesquelles la différence entre dyslexiques et NLAL était significative. Toutefois, la combinaison des scores des études qui, individuellement, n'avaient pas permis de mettre en relief un déficit des dyslexiques en lecture de pseudo-mots montre que ce déficit est présent : bien qu'étant plus faible que pour les autres études (0,27), la différence entre dyslexiques et NLAL est significative (p < 0,005).
Van Ijzendoorn et Bus ont ensuite examiné l'impact des facteurs qui, selon Rack et coll. (1992

), ont pu biaiser les résultats. En fait, le type de pseudo-mots (longueur ou degré de similitude par rapport à des mots) n'a pas d'incidence sur la taille d'effet. En revanche, la nature du test utilisé pour apparier les groupes influe sur la taille de l'effet, qui est plus faible dans les études qui ont utilisé un test de lecture de mots en contexte ou facile à lire (0,23) que dans celles fondées sur la lecture de mots complexes (0,62).
Cette méta-analyse corrobore les conclusions de Rack et coll. (1992

), à savoir que le déficit systématiquement relevé en lecture de pseudo-mots chez les dyslexiques comparativement à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture, est un argument fort à l'appui de l'hypothèse qu'un déficit phonologique est au cœur de la dyslexie, ce déficit traduisant un développement déviant de leurs compétences phonologiques de lecture. Elle signale aussi les biais introduits par un appariement fait sur la base d'un test non adéquat.
Effet de la régularité dans la dyslexie : méta-analyse des études de groupes anglophones
L'effet de la régularité fournit un index de l'utilisation de la procédure sublexicale de lecture. Si les dyslexiques n'utilisent que peu cette procédure, l'effet de la régularité devrait être plus faible chez eux que chez des normolecteurs (Manis et coll., 1990

). En dépit de la validité apparente de cette prédiction, un effet de régularité de même amplitude a été relevé entre dyslexiques et normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture (NLAL) dans les études anglophones (Olson et coll., 1985

; Bruck, 1988

; Stanovich et coll., 1988

; Snowling et coll., 1996a

). Metsala et coll. (1998

) ont effectué une méta-analyse de 17 études (en tout, plus de 1 000 participants : 536 dyslexiques et 580 NLAL).
Comme dans les analyses de Van Ijzendoorn et Bus (1994

), la taille de l'effet de la régularité a été évaluée en fonction de l'écart-type entre les groupes, pondéré cette fois par l'effectif. La taille de cet effet est globalement de 0,63 (non pondéré : 0,74), et, contrairement aux prédictions, elle est de même amplitude pour les dyslexiques (0,58 ; non pondéré : 0,64) et les NLAL (0,68 ; non pondéré : 0,85). Y compris dans les huit études qui avaient montré une infériorité de cet effet chez les dyslexiques (Frith et Snowling, 1983

; Szeszulski et Manis, 1987

; Murphy et Pollatsek, 1994

), la taille de l'effet n'est pas pour eux différente de celle observée pour les NLAL. En outre, la fréquence des mots a un impact sur l'importance de l'effet, son amplitude diminuant en fonction de la fréquence des mots. Cependant, y compris dans les études qui ont employé des mots de haute fréquence, la taille moyenne de l'effet est au-dessus de zéro, en conformité avec les résultats rapportés par Jared (1997

) montrant que la régularité affecte même la lecture de mots de haute fréquence.
Effets de lexicalité et de régularité dans la dyslexie : autres exemples (anglais et français)
Un premier exemple permettant d'apporter des éléments nouveaux à propos du déficit de la procédure par médiation phonologique chez les dyslexiques vient d'une étude longitudinale dans laquelle les effets de lexicalité et de régularité ont été évalués en même temps chez eux et chez des normolecteurs qui, au départ, avaient un même niveau de lecture (Snowling et coll., 1996a

). Au début de l'étude, les scores des dyslexiques en lecture ne différaient pas de ceux des NLAL. Toutefois, ils deviennent inférieurs à ceux des NLAL au temps 2 (soit deux ans après la première évaluation), particulièrement pour la lecture de pseudo-mots (15 % d'amélioration contre 42 % pour les NLAL, soit une différence de 27 %). La différence de progression entre sessions pour ces deux groupes est moins marquée pour les mots réguliers (16 %) et les mots irréguliers (12 %). Ainsi, même lorsqu'un déficit en lecture de pseudo-mots n'a pas été observé chez des dyslexiques comparativement à des NLAL, les différences de progression dans le temps montrent que les dyslexiques ont des difficultés majeures quand ils doivent utiliser les correspondances grapho-phonémiques sans pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances lexicales. En revanche, l'effet de la régularité, significatif pour les deux groupes et pour les deux sessions de test, ne permettait pas de différencier les dyslexiques des NLAL, ce qui est conforme aux résultats rapportés par Metsala et coll. (1998

).
Les effets de lexicalité et de régularité ont également été examinés simultanément dans une étude francophone (Casalis, 1995

) qui a impliqué des dyslexiques dont le niveau de lecture était inférieur de deux ans à leur âge chronologique. Ces enfants dyslexiques (QI normal, absence de déficit linguistique ou sensori-moteur) ont été appariés à des NLAL. Les deux groupes ont eu à lire des pseudo-mots ainsi que des mots réguliers et irréguliers. L'exactitude et la latence de la réponse vocale ont été mesurées. Comme relevé dans les études anglophones (Metsala et coll., 1998

), l'effet de la régularité est significatif et également fort dans les deux groupes. En revanche, et toujours comme en anglais (Rack et coll., 1992

; Van Ijzendoorn et Bus, 1994

), l'effet de la lexicalité est plus fort chez les dyslexiques que chez les NLAL.
Des résultats similaires ont été rapportés dans d'autres études impliquant des enfants français (Casalis, 2003

; Grainger et coll., 2003

). Dans l'étude de Bosse et Valdois (2003

), bien que les performances en lecture de deux groupes de 10 dyslexiques (âge entre 9 et plus de 15 ans), l'un présentant un déficit visuo-attentionnel, l'autre un déficit phonologique, soient similaires à celles de normolecteurs de même niveau de lecture, quel que soit le test (lecture de mots réguliers ou irréguliers et lecture de pseudo-mots) et la mesure (précision ou rapidité), l'examen des données montre que les dyslexiques ont systématiquement des scores inférieurs à ceux des normolecteurs de même niveau de lecture, en lecture de pseudo-mots. Ainsi, le groupe des dyslexiques phonologiques est moins précis que le groupe témoin plus jeunes (28,4 réponses correctes contre 30,2 ; écarts-types : 6,4 et 3,9) et plus lent (2,3 secondes contre 1,7 ; écarts-types : 0,8 et 0,6). Les mêmes tendances ont été relevées chez les 10 dyslexiques souffrant d'un déficit visuo-attentionnel, chez lesquels les différences sont surtout marquées pour le temps de traitement (plus d'une seconde de différence avec les normolecteurs de même niveau de lecture : 3,3 secondes contre 2,2 ; écarts-types : 1,7 et 0,4), pas pour la précision de la réponse (28,8 réponses correctes contre 29,1 ; écarts-types : 5,9 et 3,8).
Ces différentes études indiquent que les dyslexiques souffrent d'une déficience sélective de leur procédure phonologique de lecture qui est sévère puisqu'elle se retrouve même dans les comparaisons avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture.
Comparaisons entre dyslexiques anglophones et non-anglophones
Les études impliquant des dyslexiques anglophones et non-anglophones sont rares. À notre connaissance, la première a été effectuée par Lindgren et coll. (1985

). Elle a inclus plus de 1 500 enfants de 11 ans, environ 1 000 anglophones et 500 italophones. Le niveau de lecture a été évalué à l'aide des tests de compréhension : 50 questions à choix multiple portant sur 8 textes (
International Evaluation of Educational Achievement, Thorndike, 1973

). Les enfants ayant un QI supérieur ou égal à 85 et un score de compréhension en lecture avec un écart-type en dessous de leur QI ont été dits dyslexiques. Sur cette base, la dyslexie paraît sensiblement plus prévalente aux États-Unis (7,3 %) qu'en Italie (3,6 %). Les capacités de décodage ont été également évaluées. En raison des différences entre les tests anglais et italiens, il n'a pas été possible de comparer les résultats des deux groupes nationaux. Les scores de 59 % des dyslexiques anglophones sont à au moins un écart-type en dessous des normes nationales en lecture de pseudo-mots, contre seulement ceux de 25 % des dyslexiques italophones. Les déficits des dyslexiques en lecture de pseudo-mots ont toutefois pu être sous-estimés, seule l'exactitude de la réponse ayant été prise en compte. De plus, comme le soulignent les auteurs, les différences entre dyslexiques et normolecteurs se retrouvent principalement dans des tests impliquant le traitement du langage. En particulier, les capacités verbales (entre autres, capacités de dénomination, de répétition de phrases et d'analyse phonémique) permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs, mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. Ainsi, bien que les déficits des dyslexiques anglophones semblent plus graves que ceux des dyslexiques italophones, les similitudes entre les deux groupes sont plus fortes que les différences. Toutefois, comme le soulignent encore les auteurs, l'irrégularité de l'orthographe de l'anglais pourrait conduire les anglophones à s'appuyer plus que les italophones sur des procédures « visuelles » (ou lexicales) de lecture.
La même conclusion ressort d'une étude de Landerl et coll. (1997

) qui ont examiné les capacités de lecture de dyslexiques anglophones et germanophones de 11-12 ans qui avaient un retard en lecture d'environ 3-4 ans. Chaque groupe a été comparé à un groupe de normolecteurs plus jeunes (8 ans) mais de même âge lexique (NLAL). Des mots proches ont été utilisés dans les deux langues («
boat-boot »). Des pseudo-mots ont été créés en changeant les débuts des mots («
brind » pour «
blind »). La longueur des items variait de 1 à 3 syllabes. Les scores des dyslexiques germanophones sont meilleurs que ceux des anglophones, même quand on compare la lecture des items les plus difficiles (pseudo-mots de 3 syllabes) à celle des items les plus faciles (mots de 1 syllabe). L'augmentation des erreurs en fonction de la longueur des items est plus importante pour les dyslexiques anglophones que pour les germanophones, surtout pour les pseudo-mots : 70 % d'erreurs sur les pseudo-mots de 3 syllabes pour les anglais contre 20 % pour les allemands. De plus, les différences entre les deux groupes de dyslexiques concernent surtout la lecture des voyelles (324 prononciations incorrectes de la première voyelle d'un mot chez les dyslexiques anglophones contre 20 chez les germanophones), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'en anglais – mais pas en allemand – les correspondances graphème-phonème pour les voyelles sont très inconsistantes. Enfin, comparativement à leurs pairs NLAL, les dyslexiques, quelle que soit leur langue, font plus d'erreurs sur les pseudo-mots. Ces résultats reflètent l'impact de la consistance de l'orthographe sur les performances en lecture des dyslexiques. Ils indiquent également que, quel que soit le degré d'opacité de l'orthographe, les déficits des dyslexiques sont principalement relevés en lecture de pseudo-mots, y compris par rapport à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture.
Une autre étude a impliqué des dyslexiques anglais et allemands de 1011 ans (Ziegler et coll., 2003

) moins sévèrement atteints (la différence avec les NLAL est d'un peu plus de 2 ans contre 34 ans dans l'étude de Landerl et coll., 1997

). Ces enfants ont eu à lire des items simples (mots et pseudo-mots d'une syllabe). La précision de la réponse et le temps de latence ont été pris en compte. Une nouvelle fois, un déficit des dyslexiques par rapport aux NLAL est relevé en lecture de pseudo-mots, mais seulement sur le temps de réponse, ce déficit étant de même amplitude dans les deux langues. Ces résultats suggèrent que, tout au moins quand les pseudo-mots ne sont pas trop difficiles et quand le retard en lecture des dyslexiques n'est pas trop sévère, même les dyslexiques anglais peuvent utiliser les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit se manifestant seulement sur le temps qu'il leur faut pour réaliser la tâche.
Des résultats similaires ont été rapportés dans une étude qui a impliqué des adultes dyslexiques et des normolecteurs de même âge anglais, français et italiens (Paulesu et coll., 2001

). Le temps de latence de la réponse vocale a été évalué pour des mots et des pseudo-mots. Afin de permettre une comparaison avec l'italien, uniquement des mots réguliers ont été utilisés en français et en anglais. Ces items étaient en plus très fréquents. Des pseudo-mots ont été créés à partir des mots, en changeant les consonnes internes. Quand les tailles relatives des effets (z-scores) ont été comparées, le déficit en lecture des dyslexiques anglais n'est pas plus marqué que celui des dyslexiques français ou italiens, en dépit de la plus grande inconsistance de l'orthographe de l'anglais. Ce n'est pas le même tableau qui ressort des scores bruts, comme le montre la figure 9.1

: plus l'orthographe est opaque, plus sévère est le déficit des dyslexiques. Le plus surprenant est que les performances des dyslexiques italiens se situent entre celles des normolecteurs anglais et français. On peut en conclure que la dyslexie est simplement la manifestation d'une difficulté linguistique spécifique, s'expliquant par l'opacité des relations grapho-phonémiques. Toutefois, un examen approfondi de cette figure permet de relever que, dans chaque groupe linguistique, l'écart entre les performances des dyslexiques et celles des normolecteurs est important. Surtout, et quel que soit le degré d'opacité des relations grapho-phonémiques, le déficit le plus notable se retrouve en lecture de pseudo-mots. En plus des investigations comportementales, des données de neuro-imagerie ont permis de relever un dysfonctionnement commun dans les trois groupes de dyslexiques comparativement aux normolecteurs, ce qui signale que le déficit de lecture des dyslexiques, qui concerne principalement la procédure phonologique de lecture, aurait une origine neurale commune.
D'autres études n'impliquant pas des anglophones indiquent également que le déficit des dyslexiques se manifeste surtout par la lenteur de la réponse en lecture de pseudo-mots, y compris par rapport à des normolecteurs de même niveau de lecture (en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000

; en allemand : Wimmer, 1993

; Wimmer, 1995

; en français : Casalis, 1995

et 2003

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Grainger et coll., 2003

).
Ces études indiquent donc qu'un déficit spécifique et sévère de la procédure phonologique de lecture caractérise les dyslexiques. Toutefois, l'opacité de l'orthographe est un facteur environnemental aggravant.
Explication non phonologique des déficits de lecture des dyslexiques non-anglophones
Certains chercheurs postulent que les problèmes de lenteur relevés chez les dyslexiques non-anglophones s'expliqueraient par leurs difficultés à mémoriser la forme visuelle des mots, alors que le déficit de précision relevé chez les anglophones proviendrait d'une déficience phonologique. En d'autres termes, les dyslexiques non-anglophones souffriraient d'une dyslexie de surface et les anglophones d'une dyslexie phonologique. Cette interprétation a été proposée pour expliquer des résultats observés en allemand (Wimmer et Mayringer, 2002

; Hutzler et Wimmer, 2004

) et en italien (Zoccolotti et coll., 1999

; Judica et coll., 2002

).
Une première étude (Wimmer et Mayringer, 2002

) a pris en compte deux groupes de germanophones souffrant de dissociations entre leurs capacités de lecture et d'écriture. La logique qui sous-tend cette étude est que l'allemand se caractérise par une plus forte consistance des relations grapho-phonémiques (utilisées pour lire) que des relations phono-graphémiques (utilisées pour écrire). Il faut donc avoir des représentations orthographiques bien spécifiées pour écrire correctement les mots, alors qu'il suffit d'avoir une bonne maîtrise des relations grapho-phonémiques pour bien les lire. Le niveau de lecture a été évalué par la lecture d'une histoire courte et de deux listes de mots. Un score composite de fluence, exprimé en nombre de syllabes lues par minute, a été calculé sur la base des résultats aux trois tests de lecture. Les mots choisis pour le test d'écriture ne pouvaient pas être correctement orthographiés en utilisant les correspondances phonème-graphème. Les enfants ont eu aussi à lire des pseudo-mots, la précision et la rapidité de la réponse ont été prises en compte. Trois ans auparavant (1
re année de primaire), leurs capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que la rapidité de dénomination de mots fréquents, avaient été évaluées.
Le premier groupe incluait 415 enfants et le second 230. Les enfants ayant des troubles de lecture et/ou d'écriture ont été répartis en 3 sous-groupes : ceux qui ont un déficit sélectif en lecture (scores au-dessous du 16e percentile pour la fluence en lecture et au-dessus du 25e pour la précision en écriture) ou en écriture (scores au-dessous du 16e percentile pour la précision en écriture et au-dessus du 25e pour la fluence en lecture) et ceux qui ont des capacités faibles dans les deux domaines. Dans le premier groupe, 83 des 415 enfants ont des difficultés de lecture et/ou d'écriture. Dans 51 % des cas, il s'agit d'un double déficit, dans 28 % des cas d'un déficit sélectif en lecture, les 22 % restant manifestant un déficit sélectif en écriture. Parmi les 230 enfants du second groupe, 54 ont un déficit de lecture et/ou d'écriture. Pour 37 % d'entre eux, il s'agit d'un double déficit, les autres sujets ayant un déficit sélectif de lecture (35 %) ou d'écriture (28 %).
Dans les sous-groupes souffrant d'un trouble spécifique de la lecture, ont été relevés des déficits précoces de dénomination rapide. En revanche, chez ceux souffrant d'un trouble spécifique de l'écriture, les déficits précoces émergeaient en analyse et en mémoire phonologique. Toutefois, dans la mesure où le temps de traitement pour les tests d'analyse et de mémoire phonologique n'a pas été pris en compte, tandis qu'uniquement le temps de traitement a été évalué dans le test de dénomination rapide, les différences observées peuvent s'expliquer par le type de mesure utilisé (précision versus temps) et non par le type de tâche. En effet, c'est sur la base du temps de traitement que le groupe supposé avoir un trouble spécifique de la lecture a été établi, ce déficit allant de pair avec une déficience de temps de traitement dans la tâche de dénomination rapide, alors que le groupe souffrant d'un déficit sélectif d'écriture a été constitué en fonction de la précision de la réponse, ce déficit étant accompagné de difficultés au niveau de la précision de la réponse en analyse et en mémoire phonologique.
Les autres études qui ont évalué l'hypothèse selon laquelle les problèmes typiques de lenteur relevés chez les dyslexiques non-anglophones proviendraient de difficultés de mémorisation de la forme visuelle des mots ont utilisé les mouvements oculaires (en italien : De Luca et coll., 1999

; De Luca et coll., 2002

; Judica et coll., 2002

; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004

; Hawelka et Wimmer, 2005

). Comme Rayner l'expliquait (1998

), il n'est pas possible d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans toutes les études ci-dessus citées, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique, à la différence de celles qui ont évalué les déficits phonologiques en lecture (excepté Lindgren et coll., 1985

; Paulesu et coll., 2001

). De plus, certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. Ainsi, comme le soulignent Hutzler et Wimmer (2004

), l'opacité de l'orthographe semble avoir une incidence sur la durée moyenne de fixation, qui est plus courte chez les dyslexiques italiens que chez les germanophones. Par exemple, lors de la lecture d'un passage, cette durée est de 290 ms chez des dyslexiques italiens de 12 ans (56 ms de plus que chez les normolecteurs ; De Luca et coll., 1999

). Dans une tâche identique, la durée moyenne des fixations est de 360 ms pour des dyslexiques allemands plus âgés (soit plus de 175 ms que chez les normolecteurs ; Hutzler et Wimmer, 2004

). Enfin, les différences les plus notables entre dyslexiques italiens et allemands sont encore trouvées en lecture de pseudo-mots.
La méthodologie utilisée dans ces études n'est pas la même, ce qui limite la portée des comparaisons. Toutefois, comme Hutzler et Wimmer le suggèrent (2004

), les résultats de ces études ne permettent pas de corroborer l'hypothèse que les dyslexiques non-anglophones auraient un profil de type surface, ce d'autant plus que le patron atypique des mouvements oculaires relevé chez eux comparativement aux normolecteurs (nombre plus élevé de fixations et durée prolongée de ces fixations) a été non seulement trouvé en lecture de mots, comme attendu chez les dyslexiques de surface, mais aussi, et de façon encore plus marquée, en lecture de pseudo-mots, comme attendu chez les dyslexiques phonologiques. De plus, des déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (en particulier : répétition de pseudo-mots, détection de rimes et dénomination rapide) ont été relevés avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs de l'étude Hawelka et Wimmer (2005

).
Les données à l'appui de la nouvelle explication, selon laquelle les troubles lexiques des dyslexiques non-anglophones seraient dus au fait qu'ils n'arrivent pas à bien mémoriser la forme globale des mots, sont donc ambiguës. Il est surtout difficile de les réconcilier avec les résultats provenant de différentes études, effectuées dans différentes écritures alphabétiques, qui indiquent tous de façon convergente qu'un déficit phonologique sévère et spécifique de lecture est la caractéristique principale de la dyslexie développementale, y compris dans les langues qui ont une orthographe relativement transparente, ce déficit émergeant même dans les comparaisons avec des enfants plus jeunes qu'eux, mais de même niveau de lecture, ce qui est clairement le signe d'une déviance développementale.
Discussion sur les études de groupe
La présence d'un déficit sévère en lecture de pseudo-mots s'accompagnant d'effets équivalents de la régularité chez des dyslexiques comparativement à des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture signale clairement que la procédure phonologique de lecture des dyslexiques est déficiente. Etant donné que ce sont pratiquement les mêmes études qui ont été passées en revue par Rack et coll. (1992

), Van Ijzendoorn et Bus (1994

), et Metsala et coll. (1998

), et que, dans les autres études examinées (Casalis, 1995

; Snowling et coll., 1996a

), les effets de lexicalité et de régularité ont été évalués avec les mêmes enfants, ces résultats ne peuvent pas être attribués à des différences de population. Comme le soulignent Metsala et coll. (1998

) les résultats des simulations effectuées avec le réseau connexionniste de Seidenberg et McClelland (1989) peuvent expliquer pourquoi les dyslexiques ont des difficultés spécifiques en lecture de pseudo-mots. En effet, ces simulations, qui ont permis de reproduire l'effet classique de la régularité, amplifient celui de la lexicalité : les performances du réseau en lecture de pseudo-mots étant plus faibles que celles de lecteurs experts (Besner et coll., 1990). L'échec de ce réseau pour la lecture de pseudomots a été attribué à la nature des codes utilisés pour mettre en correspondance les unités sublexicales écrites avec les unités sublexicales orales, à savoir des triplets de lettres. Comme suggéré par des recherches ultérieures, il est possible d'améliorer les performances de ce réseau en utilisant un codage plus approprié entre les unités d'entrée et de sortie, en l'occurrence, les correspondances graphème-phonème (Plaut et coll., 1996

). Le fait que, pour la lecture de pseudomots, les performances des dyslexiques soient similaires à celles relevées dans les premières simulations de Seidenberg et McClelland (1989) pourrait donc provenir de l'inadéquation de leurs représentations phonologiques.
Ces études indiquent qu'un déficit spécifique et sévère de la procédure phonologique de lecture caractérise les dyslexiques et que l'opacité de l'orthographe est un facteur environnemental aggravant. Elles ne permettent toutefois pas de savoir quelle est la prévalence, dans la population des dyslexiques, de ce type de déficit.
Études de séries de cas de dyslexiques (ou études de cas multiples)
Les premières études de cas multiples ont été effectuées par Seymour (1986

). Ces études ont été choisies parce qu'elles ont pris en compte la précision et la rapidité dans différentes évaluations des capacités phonologiques de lecture des dyslexiques et de leurs capacités visuelles. Cinq autres études sont également décrites parce qu'elles ont utilisé une méthodologie identique et qu'elles comportent des comparaisons avec des normolecteurs de même âge chronologique et de même niveau de lecture. Environ 300 dyslexiques ont été examinés dans ces études : 196 anglophones et 108 francophones. L'analyse de ces données devrait permettre de cerner de façon relativement fiable la prévalence des profils de dyslexie
2
Il n'a pas été tenu compte de 4 autres études de cas multiples : trois pour l'absence de comparaison avec des normolecteurs de même niveau de lecture (Castles et coll., 1999

; Zabell et Everatt, 2002

; Milne et coll., 2003

), un parce que la typologie ne s'appuie pas sur la lecture de pseudo-mots (McDougall et coll., 2004

).
.
Capacités phonologiques et visuelles des dyslexiques : étude de Seymour (1986)
L'objectif de l'étude très documentée de Seymour (265 pages) était d'examiner la prévalence des déficits de la procédure phonologique de lecture ainsi que celle des déficits visuels chez des dyslexiques. Seymour a examiné 21 dyslexiques qui, en raison de problèmes sévères de lecture, avaient été adressés à différents organismes en charge des dyslexiques dans le district de Tayside, en Écosse. En fonction des critères exclusionnaires, deux de ces dyslexiques n'auraient pas dus être intégrés dans la cohorte, l'un parce qu'il est issu d'un milieu socioéconomique très défavorisé et qu'il a un faible QI verbal (67, QI performance : 96), l'autre en raison de son faible QI performance (73, QI verbal : 80). Le niveau de lecture de la majorité de ces dyslexiques (14) est comparable à celui des témoins plus jeunes qu'eux. Ces 14 dyslexiques peuvent donc être considérés comme étant appariés aux témoins sur la base de leur âge lexique.
Les participants ont eu à effectuer de nombreux tests, les uns ayant pour but d'évaluer l'efficience des traitements phonologiques en lecture, les autres celle des traitements visuels. Une première série de tâches de lecture impliquait des items de 3 à 7 lettres, des mots réguliers et irréguliers de haute fréquence ainsi que des pseudo-mots se prononçant comme des mots (homophones) ou non (non homophones). Les tâches visuelles comportaient des comparaisons de chaînes de lettres sur lesquelles les sujets devaient effectuer un jugement de similitude (même ou différent). L'une incluait deux suites de 3, 7 ou 11 lettres (« AAA... »), l'autre deux suites de 5 lettres qui pouvaient ou non se prononcer (« slart » versus « rtblj »). Dans la condition « différent », soit toutes les lettres étaient différentes, soit une seule. Dans le dernier cas, la lettre différente était en début, en milieu ou en fin de séquence (« rtblj-rzblj », « slart-spart »). Ce protocole permet d'examiner l'exactitude et la vitesse de traitement, ainsi que de comparer les effets de longueur et de position, dans différents contextes. Selon Seymour, les dyslexiques souffrant d'un problème phonologique spécifique à la lecture devraient moins bien lire les pseudo-mots que les mots irréguliers fréquents, en revanche, leurs performances ne devraient être influencées ni par la longueur des chaînes, ni par la position de la lettre différente, dans les tâches visuelles. Le pattern inverse est attendu chez les dyslexiques souffrant de troubles visuels spécifiques.
Pour les témoins, les résultats présentés par Seymour, ainsi que ceux qu'il a été possible de calculer à partir des données incluses dans son livre (moyennes et écarts-types pour les tâches de lecture à haute voix) sont présentés dans les tableaux 9.I

et 9.II

. Ces tableaux présentent également les scores de chacun des 21 dyslexiques. Les cellules grisées indiquent un fonctionnement efficient. Sont qualifiées d'efficientes les compétences qui sont à moins de 1 écart-type (pour les tâches de lecture, tableau 9.I

) ou entre les deux limites extrêmes (pour les tâches visuelles, tableau 9.II

) de celles des normolecteurs.
Les scores obtenus en lecture par les dyslexiques sont présentés dans le tableau 9.I

. Les dyslexiques chez qui l'effet de la lexicalité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de pseudo-mots et celle de mots) est plus fort que chez les témoins, mais pas celui de la régularité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de mots réguliers et irréguliers), sont dits souffrir d'un trouble phonologique en lecture.
Le temps moyen de la réponse vocale est à plus de 1 écart-type de celui des témoins pour 19 et 18 dyslexiques en lecture de mots et de pseudo-mots, respectivement. Pour les erreurs, seulement 10 dyslexiques ont des performances à plus de 1 écart-type de celles des témoins en lecture de mots, contre 14 en lecture de pseudo-mots. Ces données signalent l'importance de la prise en compte de la précision et du temps de traitement. Selon Seymour, 18 de ces dyslexiques ont des troubles phonologiques en lecture qui, pour 10 de ces sujets sont spécifiques, les 8 autres cas souffrant également de troubles visuels. Les 3 cas restant ont, toujours selon Seymour, un déficit visuel sélectif. Quatorze des 21 dyslexiques ont, d'après un test de lecture standardisé, le même niveau de lecture que les normolecteurs plus jeunes (NLAL). Seulement 3 d'entre eux n'ont pas de troubles phonologiques en lecture. La majorité des dyslexiques (11 sur 14) ayant le même niveau de lecture que les NLAL souffrent donc d'un trouble sévère de la procédure phonologique de lecture. Reste à voir si l'efficience du processeur visuel, évaluée par les effets de longueur et de position, permet de différencier ces dyslexiques.
Les scores relevés dans les tâches visuelles sont présentés dans le tableau 9.II

. Comparativement à la proportion de dyslexiques ayant des troubles phonologiques en lecture (18/21), ceux ayant des troubles visuels sont très peu nombreux. En effet, seulement 9 des 21 dyslexiques ont des troubles dans les tâches visuelles d'après le temps de traitement et seulement 3 d'après la précision de la réponse.
Tableau 9.I Tâches de lecture (erreurs et temps), les cellules grisées signalent des performances dans les normes (d'après Seymour, 1986 )
)
| |
Âge chronologique
|
Niveau cognitif
|
Âge lexique
|
Lecture de mots fréquents (réguliers/irréguliers)
|
Lecture de pseudo-mots
|
Effet de la lexicalité
|
| | |
Verbal
|
Non Verbal
|
Schonell
|
Erreur %
|
Temps
(ms)
|
Erreur %
|
Temps
(ms)
|
Erreur %
|
Temps
(ms)
|
|
Groupe témoins de normolecteurs
|
|
M
ET
Rang
+ 1ET
+ 1,65ET
|
11,7
0,6
10,9-12,3
| | |
12,3
0,4
11,4-12,6
|
2,2
2,7
< 4,9
< 6,7
|
685,5
102
< 787,5
853,8
|
9,8
6,3
< 16,1
< 20,2
|
1223
507
< 1730
< 2060
|
7,6
5,7
< 11,0
< 13,2
|
258
310
< 568
< 770
|
|
Dyslexiques
|
Cellules grisées: performances dans les normes
|
|
SS
|
25,03
|
125
|
130
|
12,06+
|
1,2
|
783 (179)
|
23,8
|
1953 (1056)
|
22,6
|
1170
|
|
MP
|
22,06
|
85
|
64
|
11,08
|
3,0
|
1594 (962)
|
17,4
|
3453 (1434)
|
14,4
|
1859
|
|
SE
|
21,07
|
108
|
99
|
12,06+
|
4,8
|
1466 (1805)
|
14,8
|
2903 (1889)
|
10,0
|
1437
|
|
LT
|
19,00
|
99
|
123
|
11,05
|
7,7
|
1247 (1362)
|
31,1
|
3858 (2467)
|
23,4
|
2611
|
|
AD
|
17,07
|
106
|
132
|
12,06+
|
0,6
|
723 (150)
|
27,5
|
1004 (395)
|
26,9
|
281
|
|
DT
|
17,03
|
105
|
147
|
12,06+
|
1,8
|
1383 (493)
|
14,8
|
2279 (1012)
|
13,0
|
896
|
|
RO
|
16,10
|
126
|
?
|
12,06+
|
1,2
|
838 (142)
|
4,7
|
1336 (580)
|
3,5
|
498
|
|
DP
|
16,01
|
104
|
114
|
12,02
|
2,4
|
1132 (398)
|
12,3
|
1795 (1007)
|
9,9
|
663
|
|
MT
|
14,11
|
100
|
107
|
12,02
|
5,9
|
1437 (770)
|
29,7
|
4018 (2721)
|
23,8
|
2581
|
|
MF
|
14,08
|
106
|
126
|
12,03
|
1,2
|
932 (337)
|
8,9
|
1743 (1063)
|
7,7
|
811
|
|
FM
|
14,07
|
102
|
117
|
10,07
|
2,4
|
1087 (484)
|
22,1
|
2607 (1594)
|
19,7
|
1520
|
|
AR
|
14,06
|
117
|
121
|
11,00
|
5,4
|
1117 (540)
|
13,0
|
1653 (748)
|
7,6
|
536
|
|
JM
|
14,02
|
112
|
90
|
11,04
|
10,2
|
1209 (743)
|
30,5
|
2288 (1275)
|
20,3
|
1079
|
|
GS
|
13,05
|
121
|
83
|
9,09
|
9,5
|
1695 (782)
|
13,1
|
2292 (1063)
|
3,6
|
597
|
|
SB
|
13,04
|
113
|
132
|
10,00
|
16,7
|
1031 (648)
|
44,1
|
3055 (3107)
|
27,4
|
2024
|
|
SM
|
13,02
|
94
|
117
|
10,05
|
6,0
|
1490 (775)
|
27,1
|
2023 ( 819)
|
21,1
|
533
|
|
CE
|
13,00
|
114
|
106
|
11,10
|
3,0
|
1194 (520)
|
18,2
|
2440 (1707)
|
15,2
|
1246
|
|
LA
|
12,11
|
122
|
118
|
11,06
|
4,8
|
1399 (1200)
|
22,5
|
1910 (2700)
|
17,7
|
511
|
|
JB
|
12,06
|
94
|
102
|
9,00
|
14,9
|
1612 (874)
|
41,9
|
5298 (3027)
|
27,0
|
3686
|
|
PS
|
12,03
|
94
|
103
|
9,06
|
11,3
|
2209 (2098)
|
29,7
|
5856 (4043)
|
18,4
|
3647
|
|
LH
|
11,02
|
67
|
96
|
8,07
|
21,4
|
2205 (2206)
|
25,4
|
2566 (1411)
|
4
|
361
|
Tableau 9.II Scores relevés dans les tâches visuelles : erreurs et temps pour les effets de la longueur et de la position, les cellules grisées signalent des performances dans les normes (d'après Seymour, 1986 )
)
| |
1re tâche de jugement de similitude (SIM1)
|
2e tâche de jugement de similitude (SIM2)
|
Effet de la longueur (ms par lettre)
|
Effet de la position et de la légalité
(ms par position)
| |
| |
Erreur %
|
Temps (ms)
|
Erreur %
|
Temps (ms)
|
SIM1
|
Mots fréquents
|
Pseudo-mots
|
SIM2 Position
|
SIM2 Légalité
| |
1Sauf 2 sujets qui ont des effets de longueur entre 18 et 28 ms/l (Seymour, 1986  )
2Sauf 2 sujets qui ont des effets de longueur entre 31 et 48 ms/l (Seymour, 1986  )
3Sauf 4 sujets qui ont des effets de longueur de 74, 107, 148 et 396 ms/l (Seymour, 1986  )
|
|
Groupe témoin : Caractéristiques des performances dites efficientes
| |
|
M (rang)
ET (rang)
|
0 à 8
|
690 à 1300
130 à 360
|
2 à 18
|
1050 à 1850
290 à 580
| |
|
|
|
16 à 245
| |
|
Dyslexiques. Cellules grisées: performances dans les normes (* effet significatif ; abs : absence d'effet)
|
Nature des troubles des dyslexiques (selon Seymour, 1986  ) |
|
SS
|
1,7
|
978 (222)
|
3
|
1610 (415)
|
12
|
35*
|
169*
|
68
|
260*
|
Phonologique
| |
|
MP
|
0,8
|
961 (308)
|
4
|
2613 (849)
|
19*
|
196*
|
340*
|
331*
|
300*
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
SE
|
0,8
|
857 (205)
|
3
|
1912 (639)
|
27*
|
362*
|
413*
|
166*
|
Abs
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
LT
|
5,0
|
543 (116)
|
13
|
760 (180)
|
7*
|
196*
|
288*
|
27
|
Abs
|
Phonologique
| |
|
AD
|
2,5
|
657 (126)
|
6
|
1006 (297)
|
13*
|
20*
|
73*
|
100*
|
200*
|
Phonologique
| |
|
DT
|
0,8
|
851 (302)
|
1
|
1299 (507)
|
11
|
113*
|
299*
|
53
|
Abs
|
Phonologique
| |
|
RO
|
2,5
|
1281 (388)
|
2
|
2545 (736)
|
54*
|
26*
|
221*
|
103
|
600
| |
Visuelle
|
|
DP
|
1,7
|
735 (256)
|
4
|
1099 (427)
|
6
|
70*
|
328*
|
165*
|
Abs
|
Phonologique
| |
|
MT
|
6,7
|
1160 (676)
|
26
|
2801 (1683)
|
-5
|
81
|
785*
|
159
|
1500
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
MF
|
0,8
|
1107 (367)
|
0
|
2139 (667)
|
28*
|
55*
|
266*
|
153*
|
300
| |
Visuelle
|
|
FM
|
1,7
|
826 (238)
|
2
|
1321 (406)
|
20*
|
136*
|
621*
|
77
|
NS
|
Phonologique
| |
|
AR
|
1,7
|
1004 (460)
|
4
|
2261 (1019)
|
32*
|
133*
|
191*
|
127
|
Abs
| |
Visuelle
|
|
JM
|
2,5
|
739 (191)
|
10
|
1388 (375)
|
10
|
164*
|
474*
|
36
|
300
|
Phonologique
| |
|
GS
|
0,8
|
825 (248)
|
10
|
1735 (489)
|
15*
|
264*
|
389*
|
229*
|
300
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
SB
|
13,3
|
573 (104)
|
25
|
778 (238)
|
4
|
131*
|
707*
|
-2
|
Abs
|
Phonologique
| |
|
SM
|
2,5
|
812 (228)
|
8
|
1499 (453)
|
18*
|
243*
|
361*
|
287*
|
200
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
CE
|
0,0
|
1648 (890)
|
5
|
3597 (2838)
|
38
|
68*
|
427*
|
289
|
Abs
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
LA
|
8,3
|
606 (126)
|
23
|
1011 (320)
|
1
|
96
|
278
|
100*
|
Abs
|
Phonologique
| |
|
JB
|
0,8
|
918 (263)
|
7
|
1255 (378)
|
12
|
161*
|
548*
|
49
|
Abs
|
Phonologique
| |
|
PS
|
0,0
|
1038 (260)
|
4
|
2148 (481)
|
21*
|
206
|
951*
|
95
|
360*
|
Phonologique
|
Visuelle
|
|
LH
|
0,0
|
1131 (365)
|
2
|
3163 (1182)
|
21*
|
539*
|
368*
|
-93
|
700*
|
Phonologique
|
Visuelle
|
| |
D'après Seymour, la tâche de jugement de similitude portant sur deux des suites de 3, 7 ou 11 lettres (« AAA/AAA ou AAA/AZA », épreuve de jugement de similitude 1, SIM1) requiert un traitement parallèle. Par conséquent, aucun effet de longueur n'est attendu quand les deux chaînes de lettres sont identiques (« AAA/AAA » ou « AAAAAAA/AAAAAAA »). Comme pour la lecture de mots irréguliers fréquents de 3 à 7 lettres (qui requiert également un traitement parallèle), le temps de réaction ne doit pas augmenter en fonction du nombre de lettres. C'est le résultat opposé qui est attendu pour la lecture de pseudo-mots (également de 3 à 7 lettres), supposés être traités sériellement. L'effet de la longueur sur les chaînes de lettres, les mots et les pseudo-mots a été évalué en calculant la relation linéaire entre le temps de traitement et la longueur des items, et exprimé en millisecondes par lettre (ms/l). Si la longueur des items influe sur les performances, cela signale un traitement sériel.
Le même raisonnement a été utilisé pour l'effet de la position de la lettre différente dans des suites de 5 caractères qui étaient ou non prononçables (« rtblj » ou « slart »). La lettre différente était soit en début, soit en milieu soit en fin de séquence (par exemple, « rtblj-rzblj », « slart-spart », épreuve de jugement de similitude 2, SIM2). Le temps de réaction a été exprimé en fonction de la position de la lettre différente. Des performances qui varient en fonction de la position de la lettre différente sont le signe d'un traitement sériel.
La seconde épreuve de jugement de similitude (SIM2) ne permet pas de différencier les dyslexiques des normolecteurs. La position de la lettre différente induit un effet qui varie de 16 à 245 ms chez les témoins (sauf 1), les scores de 16 des 21 dyslexiques étant dans les normes. De même, dans la première épreuve de jugement de similitude (SIM1), les scores de la plupart des dyslexiques sont dans les normes (-5 à 15 ms/l) ou juste au-dessus (18 à 21 ms/l). Un fort effet de longueur (27 à 54 ms/l) est observé chez 5 dyslexiques, 3 qui selon Seymour ont un trouble visuel sélectif (RO, MF et AR), les 2 autres souffrant aussi d'un déficit phonologique en lecture (CE et SE).
L'effet de longueur sur les mots fréquents varie de -2 ms/l à 23 ms/l chez les témoins (sauf 2) et seulement un dyslexique a des scores dans les normes. L'effet de la longueur est non significatif chez la plupart des témoins alors qu'il est significatif chez la plupart des dyslexiques. De plus, chez 13 dyslexiques, cet effet est 5 fois supérieur à celui relevé chez les normolecteurs. C'est toutefois en lecture de pseudo-mots que les groupes se différencient le plus fortement. Ainsi, l'effet de la longueur se situe entre 28 et 42 ms/l chez les témoins ou juste au-dessus (48 ms/l). Tous les scores des dyslexiques sont hors normes et, pour 18 d'entre eux, l'effet de longueur est 5 fois supérieur à celui relevé chez les témoins. Seize de ces 18 dyslexiques avaient également un déficit phonologique en lecture.
La plupart des dyslexiques de cette étude ont un trouble phonologique en lecture (18/21), y compris dans la comparaison avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture (11/14). La proportion de dyslexiques ayant un déficit visuel supposé spécifique est faible (3 sujets). Les performances de ces 3 dyslexiques (RO, MF et AR) sont toutefois plus fortement affectées par les effets de longueur dans les tâches de lecture de pseudo-mots que dans celles qui impliquent un jugement de similitude entre des suites de lettres, ce qui est difficile à concilier avec l'idée qu'ils souffriraient d'une déficience visuelle sélective.
Les indicateurs de mise œuvre de stratégies compensatoires ont été relevés chez les dyslexiques. Ainsi, RO et MF tirent profit des effets de légalité dans l'épreuve de jugement de similitude entre des suites de lettres (leurs scores sont meilleurs quand les items sont prononçables), ce qui peut leur permettre de suppléer la déficience de leurs habiletés visuelles. De même, un effet de l'homophonie a été relevé en lecture de pseudo-mots chez 11 des dyslexiques souffrant de troubles phonologiques en lecture, ce qui signale que, quand c'est possible, ils utilisent leurs connaissances lexicales pour lire les pseudo-mots (ils lisent mieux ceux qui se prononcent comme des mots) sans doute pour suppléer la faiblesse de leurs habiletés phonologiques.
Tous les cas présentés par Seymour (1986

) souffrent ou ont souffert d'un déficit phonologique, certains l'ayant surmonté dans le temps probablement grâce à l'aide de stratégies compensatoires. À l'appui de cette hypothèse, on peut noter que, parmi les trois cas n'ayant pas de déficit phonologique d'après les évaluations de leurs compétences de lecture effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans, deux ont eu des troubles du développement précoce de leur langage oral (RO et MF), l'autre présentait à 10 ans un profil de dyslexie mixte, et donc un déficit phonologique (Seymour et Porpodas, 1980

).
Enfin, les deux dyslexiques qui n'auraient pas dus être intégrés en raison de leur faible QI (MP et LH), ne sont jamais ressortis comme ayant un profil atypique. Ce résultat est consistant avec les données qui suggèrent qu'il n'y a pas de différence majeure quant à la nature des déficits en lecture manifestés par les mauvais lecteurs tout-venant (qui ont à la fois un QI et un niveau de lecture faible) et les dyslexiques (Vellutino et coll., 2000

; Stuebing et coll., 2002

).
Études de cas multiples anglophones et francophones
Dans trois études anglophones (Castles et Coltheart, 1993

; Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

) et deux francophones (Génard et coll., 1998

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

), 283 dyslexiques (175 anglophones, 108 francophones) ont été comparés à 401 normolecteurs de même âge chronologique (NLAC : 151 anglophones, 250 francophones) et à 342 de même âge lexique (NLAL : 67 anglophones, 275 francophones). Ces études ont utilisé, entre autres, la méthode classique pour typologiser les dyslexiques. Dans cette méthode, on tient compte d'un déficit absolu de l'une des procédures de lecture, l'autre étant préservée. On définit comme dyslexique phonologique l'enfant qui a des performances normales en lecture de mots irréguliers mais dont les performances en lecture de pseudo-mots sont en dessous de la norme, et vice versa pour la dyslexie de surface. La typologie a été effectuée en tenant compte de la précision de la réponse en lecture à haute voix de mots irréguliers et de pseudo-mots. Dans l'étude de Sprenger-Charolles et coll. (2000

), le temps de latence des réponses correctes a également été examiné. Le tableau 9.III

présente les données descriptives de ces études.
Tableau 9.III Études de cas multiples
|
Références
|
Dyslexiques
Sex-ratio (garçons/filles)
Âge chronologique moyen
|
Enfants de même âge chronologique
Sex-ratio (garçons/filles)
|
Enfants de même niveau de lecture
Sex-ratio (garçons/filles)
|
Castles et Coltheart, 1993 
Anglophones |
56 enfants (56 garçons)
11 ans (8½ à 15 ans)
|
56 enfants
56 garçons
|
|
Manis et coll., 1996 
Anglophones |
51 enfants (37 garçons-14 filles)
12 ans (9 à 15 ans)
|
51 enfants
35 garçons-16 filles
|
27 enfants
18 garçons-9 filles
|
Stanovich et coll., 1997 
Anglophones |
68 enfants (29 garçons-39 filles)
9 ans (11 mois d'écart)
|
44 enfants
16 garçons-28 filles
|
23 enfants
13 garçons-10 filles
|
Génard et coll., 1998 
Francophones |
75 enfants (50 garçons-25 filles)
10 ans (9 à 12 ans)
|
231 enfants
99 garçons-132 filles
|
256 enfants
109 garçons-147 filles
|
Sprenger-Charolles et coll., 2000  Francophones |
31 enfants (20 garçons-11 filles)
10 ans (11 mois d'écart)
|
19 enfants
11 garçons-8 filles
|
19 enfants
11 garçons-8 filles
|
1Analyses effectuées par Stanovich et coll. (1997 ) incluant 40 des 56 dyslexiques ) incluant 40 des 56 dyslexiques
|
Comparativement à des normolecteurs de même âge, la majorité des dyslexiques souffre d'un double déficit, la proportion des profils dissociés étant faible (figure 9.2

). De plus, si on trouve à peu près autant de dyslexiques phonologiques que de dyslexiques de surface dans les trois études anglaises qui s'appuient toutes sur la précision de la réponse, cela n'est vrai en français que quand on se fonde sur le temps de latence (Sprenger-Charolles et coll., 2000

). En revanche, quand en français on utilise la précision de la réponse, le nombre de dyslexiques phonologiques est plus faible que celui des dyslexiques de surface (Génard et coll., 1998

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

). Ces résultats ne prennent en compte qu'un seul indicateur, soit la précision, soit le temps. Quand on tient compte de ces deux mesures (Sprenger-Charolles et coll., 2000

), pratiquement tous les sujets ont un double déficit. Enfin, une faible proportion d'entre eux n'a aucun déficit, tout au moins d'après la précision de la réponse (16 sur les 283 dyslexiques), ce qui confirme que la plupart souffrent d'une déficience des procédures d'identification des mots écrits. C'est le cas pour tous quand la classification est effectuée sur la base de la précision et de la rapidité (Sprenger-Charolles et coll., 2000

).
Dans la mesure où la méthode classique (score à un écart-type) ne fait ressortir qu'une très faible proportion de dyslexiques ayant un profil dissocié, une autre méthode, qui s'appuie sur la présence d'un déficit relatif de l'une des procédures de lecture par rapport à l'autre a été développée. Cette méthode prend comme référence les performances des normolecteurs en lecture de mots irréguliers, en regard de celles pour les pseudo-mots, ou l'inverse, ce qui permet de tracer deux droites de régression avec leurs intervalles de confiance (IC). La première droite permet de repérer les enfants qui ont un déficit de la procédure phonologique de lecture, c'est-à-dire ceux dont les performances en lecture de pseudo-mots sont hors de l'IC et la seconde ceux qui ont un déficit de la procédure lexicale, en l'occurrence ceux dont les performances sont hors de l'IC pour les mots irréguliers. Les enfants qui se situent, dans les deux cas, hors de l'IC présentent un double déficit alors que ceux qui sont uniquement hors de l'IC dans l'une des comparaisons présentent une dyslexie phonologique ou de surface. Dans 4 des 5 études examinées, la comparaison entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture a été effectuée avec cette méthode mais en ne tenant compte que de la précision de la réponse (Castles et Coltheart, 1993

; Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

; Génard et coll., 1998

). Cette comparaison permet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard développemental. Les résultats sont présentés dans le tableau 9.IV

.
Tableau 9.IV Différents profils de dyslexie en comparaison avec des normolecteurs de même niveau de lecture (méthode des régressions : précision de la réponse)
|
Études
|
Dyslexiques phonologiques (%)
|
Dyslexiques de surface (%)
|
Profils mixtes (%)
|
Absence de déficit (%)
|
Intervalle de confiance (%)
|
Castles et Coltheart, 1993 
|
|
|
|
|
90
|
Manis et coll., 1996 
|
29,4
|
2,0
|
0,0
|
68,6
|
95
|
Stanovich et coll., 1997 
|
25,0
|
1,5
|
0,0
|
73,5
|
90
|
Génard et coll., 1998 
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
92,0
|
95
|
1Analyse effectuée par Stanovich et coll. (1997 ) incluant 40 des 56 dyslexiques ) incluant 40 des 56 dyslexiques
|
Dans les 4 études examinées, les profils de type surface disparaissent presque complètement (4 cas au total), mais pas ceux de type phonologique (53 cas). De plus, la proportion des dyslexiques phonologiques, qui varie de 38 % à 25 % pour les études anglaises, est très faible en français (8 %, Génard et coll., 1998

). La majeure partie des dyslexiques (177 cas, soit 75,5 %) se comporte donc comme les normolecteurs plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture. La trajectoire développementale de la plupart des dyslexiques apparaît donc comme n'étant pas déviante, au moins quand il n'est tenu compte que de la précision de la réponse.
Dans l'étude de Sprenger-Charolles et coll. (2000

), la précision et le temps de traitement ont été évalués. Il est à signaler que tous les enfants de 21 classes de grande section de maternelle qui répondaient aux critères exclusionnaires classiques ont été intégrés dans cette étude. L'accord parental a été obtenu pour environ 400 enfants, 373 ont pu être suivis jusqu'à 8 ans. Les dyslexiques sont issus d'un groupe de 52 enfants qui avaient à 8 ans des scores de lecture à plus de 1 écart-type de la norme (d'après la Batelem ; Savigny, 1974

). La plupart de ces enfants en difficulté de lecture (45) ont pu être revus à 10 ans. Les 33 enfants de 10 ans dits dyslexiques sont ceux qui présentaient alors un déficit sévère en lecture (plus de 2 écarts-types de la norme d'après l'Analec A2 ; Inizan, 1995

). Cette population peut donc être supposée représentative de ce qu'est un dyslexique français « tout-venant ».
Ces dyslexiques ont été appariés à des normolecteurs plus jeunes (8 ans) de même niveau de lecture. Les résultats indiquent la proportion de dyslexiques de surface (souffrant d'un déficit sélectif de la procédure lexicale de lecture évalué par la lecture de mots irréguliers fréquents), celle de dyslexiques phonologiques (ayant un déficit sélectif de la procédure sublexicale de lecture évalué par la lecture de pseudo-mots), ainsi que celle des dyslexiques ayant un double déficit ou une absence de déficit de l'une ou l'autre des deux procédures de lecture (figure 9.3

). Les performances sont dites déficitaires quand elles se situent à moins de 1 écart-type (pour la précision) ou à plus de 1 écart-type (pour la rapidité de la latence de la réponse vocale) de celles des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture.
Quand seulement un des deux indicateurs de l'efficience des procédures de lecture est examiné, la majorité des dyslexiques se comporte comme les normolecteurs plus jeunes (entre 60 et 70 % d'entre eux pour la précision ou la rapidité). Ce n'est le cas que pour un peu plus d'un tiers d'entre eux quand il est tenu compte d'un déficit sur l'une ou l'autre de ces mesures. Toutefois, quelle que soit la mesure, la proportion des dyslexiques présentant un profil de type surface est faible (moins de 10 %). En revanche, la proportion des dyslexiques phonologiques est élevée. Un déficit de la procédure phonologique de lecture est même relevé dans plus de la moitié des cas de dyslexie lorsque les analyses s'appuient à la fois sur la précision et sur la rapidité. Partant de ce constat, on peut supposer que les études qui n'ont pas examiné le temps de traitement ont sous-estimé la proportion des dyslexiques ayant des troubles sévères de la procédure phonologique de lecture.
Discussion sur les études de groupe et de séries de cas
Les études de groupe indiquent que les performances en lecture des dyslexiques sont particulièrement détériorées quand ils ne peuvent pas s'appuyer sur leurs connaissances lexicales pour lire, en l'occurrence en lecture de pseudomots. Ce déficit est systématiquement observé dans les comparaisons avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture, ce qui suggère que le développement des compétences phonologiques de lecture est déviant chez les dyslexiques (par exemple, en anglais : Rack et coll., 1992

; Van Ijzendoorn et Bus, 1994

; Snowling et coll., 1996a

; en français : Casalis, 1995

; Grainger et coll., 2003

; en allemand : Wimmer, 1993

et 1995

; Landerl et coll., 1997

; Ziegler et coll., 2003

; en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000

). En outre, ce déficit est plus notable quand les dyslexiques sont confrontés à une écriture peu transparente, comme c'est le cas en anglais (Lindgren et coll., 1985

; Landerl et coll., 1997

; Paulesu et coll., 2001

) comparativement au français (Paulesu et coll., 2001

), à l'allemand (Landerl et coll., 1997

), ou à l'italien (Lindgren et coll., 1985

; Paulesu et coll., 2001

). Toutefois, quand l'orthographe est transparente, le déficit de la procédure sublexicale des dyslexiques se note principalement par leur lenteur en lecture de pseudomots (en allemand : Wimmer, 1993

et 1995

; Ziegler et coll., 2003

; en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000

; en français : Sprenger-Charolles et coll., 2000

).
Quelques chercheurs postulent que les problèmes typiques de fluence des dyslexiques non-anglophones s'expliqueraient par leurs difficultés à mémoriser la forme visuelle des mots, alors que le déficit de précision de la réponse des dyslexiques anglophones proviendrait d'une déficience phonologique (par exemple, pour l'allemand, Wimmer et Mayringer, 2002

; Hutzler et Wimmer 2004

; pour l'italien, De Luca et coll., 1999

et 2002

; Zoccolotti et coll., 1999

; Judica et coll., 2002

). En d'autres termes, les dyslexiques non-anglophones souffriraient d'une dyslexie de surface et les anglophones d'une dyslexie phonologique. Il est toutefois difficile d'imaginer que le phénotype de la dyslexie puisse fortement différer en fonction de la transparence de l'orthographe et de la mesure utilisée. Les évidences à l'appui de l'hypothèse d'une spécificité des déficits des dyslexiques non anglophones viennent principalement de l'examen des mouvements oculaires au cours de tâche de lecture (en italien : De Luca et coll., 1999

et 2002

; Judica et coll., 2002

; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004

; Hawelka et Wimmer, 2005

). Comme Rayner l'expliquait dans une revue de la littérature (1998

), il est difficile d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans ces études, à la différence de celles qui ont mis en relief les déficits phonologiques, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique. En plus, comme Hutzler et Wimmer le signalent (2004

), certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. C'est le cas, par exemple, pour l'impact négatif de l'opacité de l'orthographe, tout comme pour celui de la lexicalité, sur la durée des fixations oculaires (les différences les plus notables entre dyslexiques et normolecteurs concernent la lecture de pseudomots). C'est également ce que suggère la présence, avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs, de déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (répétition de pseudomots, détection de rimes et dénomination rapide, cf. Hawelka et Wimmer, 2005

).
Les études de séries de cas indiquent qu'un déficit des deux procédures d'identification des mots écrits se retrouve chez la plupart des dyslexiques comparativement à des enfants de même âge chronologique. Ainsi, dans 5 études de ce type, trois avec des enfants anglophones (Castles et Coltheart, 1993

; Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

) et deux avec des francophones (Génard et coll., 1998

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

) par rapport aux témoins de même âge, la méthode classique a mis en relief surtout des profils mixtes, avec un double déficit, concernant à la fois la procédure phonologique de lecture et la procédure lexicale. C'est quasi-systématiquement le cas quand il est tenu compte de la précision et du temps de latence des réponses correctes (Sprenger-Charolles et coll., 2000

).
La proportion des profils dissociés est donc très faible. En plus, elle varie en fonction des études. Ainsi, il y a moins de dyslexiques phonologiques que de dyslexiques de surface en français, tout au moins quand on ne tient compte que de la précision (Génard et coll., 1998

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

). Par contre, quand la classification des dyslexiques français est élaborée sur la base de la rapidité (Sprenger-Charolles et coll., 2000

), on observe autant de dyslexiques phonologiques que dans les études anglaises s'appuyant sur la précision (Castles et Coltheart, 1993

; Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

). Les différences entre les études francophones et anglophones sont probablement dues à des facteurs linguistiques. Les correspondances grapho-phonémiques étant plus régulières en français, les dyslexiques francophones peuvent plus facilement que les anglophones surmonter les difficultés de mise en œuvre de la procédure sublexicale. Ces données, comme celles relevées dans les études de groupes, suggèrent que les dyslexiques francophones pourraient utiliser à peu près correctement les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit phonologique se manifestant surtout par la lenteur de cette opération.
La seule étude qui a pris en compte la précision et le temps de réponse (Sprenger-Charolles et coll., 2000

), suggère en plus que presque tous les dyslexiques ont un déficit phonologique sévère, qui se manifeste systématiquement quand ils doivent lire des mots nouveaux sur l'une ou l'autre, voire sur les deux mesures. Partant de ce constat, on peut supposer que, dans les études qui n'ont pas examiné le temps de traitement, la proportion des dyslexiques présentant des troubles phonologiques sévères est sous-estimée (Zabell et Everatt, 2002

).
Les résultats précédents portaient sur des enfants de même âge. En comparaison avec des normolecteurs de même niveau de lecture, quand seulement un des deux indicateurs de l'efficience des procédures de lecture est examiné (précision ou temps), la majorité des dyslexiques se comporte comme les normolecteurs. Ce n'est le cas que pour un tiers d'entre eux quand il est tenu compte d'un déficit de précision et/ou de rapidité. Quels que soient l'étude ou l'indicateur considérés, la proportion des dyslexiques présentant un profil de type surface est faible. Par contre, toujours quels que soit l'étude ou l'indicateur, la proportion des dyslexiques phonologiques reste élevée. Un déficit de la procédure phonologique de lecture est même relevé dans plus de la moitié des cas de dyslexie lorsque les analyses s'appuient à la fois sur la précision et sur la rapidité. Il est possible de rendre compte de ce phénomène par un chassé-croisé entre précision et rapidité, certains dyslexiques privilégiant la précision au détriment du temps, d'autres adaptant la stratégie inverse.
Dans l'ensemble, les résultats des études de cas multiples anglophones (Seymour, 1986

; Castles et Coltheart, 1993

; Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

; Zabell et Everatt, 2002

), francophones (Génard et coll., 1998

; Sprenger-Charolles et coll., 2000

; voir également pour des résultats en espagnol Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana, 2002

) indiquent que le déficit de la procédure phonologique de lecture est prévalent dans la dyslexie. Ce déficit est aussi sévère puisqu'il se retrouve chez la plupart des dyslexiques dans la comparaison avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture, tout au moins quand il est tenu compte de la précision et de la rapidité. Comme le soulignait Seymour lui-même (1986

), les 21 dyslexiques de sa cohorte présentaient tous des troubles phonologiques qui se manifestaient en lecture de pseudo-mots par la faible précision et/ou la lenteur de leurs réponses ainsi que par les effets de longueur, ce pattern dominant étant parfois accompagné de quelques signes des déficiences visuelles (voir également Sprenger-Charolles et coll.,

sous presse ; Ziegler et Goswami, 2005

).
Compétences déficitaires hors lecture chez les dyslexiques
Les difficultés sévères et spécifiques rencontrées par les dyslexiques en lecture de mots nouveaux sont généralement expliquées par la faiblesse de leurs habilités phonologiques en dehors de la lecture, entre autres, en analyse phonémique et en mémoire à court terme phonologique. Des déficits dans ces domaines peuvent en effet entraver la mise en place de la procédure phonologique de lecture vu que, pour utiliser cette procédure, il faut d'abord mettre en correspondance les unités sublexicales de l'écrit, les graphèmes, avec les unités correspondantes de l'oral, les phonèmes. Il faut ensuite assembler les unités résultant du décodage pour accéder aux mots. La première opération nécessite des habiletés d'analyse phonémique, la seconde implique la mémoire phonologique à court terme. Un enfant incapable d'extraire les phonèmes et souffrant en plus d'un déficit mnésique va difficilement pouvoir utiliser cette procédure (Liberman et coll., 1982

; Mann et Liberman, 1984

; McDougall et coll., 1994 ; Scarborough, 1998a

et b

).
Plus récemment, il a été mis en relief des déficits de précision, et surtout de rapidité, dans l'accès au lexique chez les dyslexiques (Wolf et Bowers, 1999

; Wolf et coll., 2000

; Wolf et coll., 2002

). Partant de ce constat, certains auteurs assument qu'il y aurait deux sources indépendantes expliquant les déficits en lecture des dyslexiques, l'une reliée aux compétences d'analyse et de mémoire phonologique, l'autre reliée à l'accès lexical, généralement évaluée par le temps de réponse dans des tâches de dénomination rapide (
Rapid Automatic Naming, ou RAN) impliquant des items très fréquents : images d'objet (une table, un ballon...), ou de couleur (rouge, bleu...), suites de nombres ou de lettres. Deux principales preuves ont été apportées à l'appui de cette hypothèse. D'une part, la réussite aux tâches de dénomination rapide permet d'expliquer une part unique de la variance en lecture, en plus de celle expliquée par les tâches d'analyse et de mémoire phonologique. D'autre part, les capacités d'analyse phonologique et de dénomination rapide ne sont pas reliées aux mêmes compétences de lecture, la première expliquant la précision de la réponse, la seconde le temps de traitement. Cette interprétation a été fortement critiquée (Wagner et coll., 1997

; Vellutino et coll., 2004

) dans la mesure où ces résultats peuvent s'expliquer aussi bien par le type de mesure utilisé (précision pour les tâches phonologiques, rapidité pour les autres), que par le type de tâche. En plus, la tâche de dénomination le plus souvent utilisée implique des lettres, et donc des capacités directement liées à la lecture. En fait, quand le niveau de pré-lecture est contrôlé, le pouvoir prédictif des habiletés de dénomination rapide diminue, pas celui des capacités d'analyse phonémique (Wagner et coll., 1997

).
Dans la section suivante sont examinées les études de groupes indifférenciés de dyslexiques, ainsi que celles portant sur des dyslexiques présentant des profils dissociés de dyslexie, qui ont mis en relief des déficits des dyslexiques dans ces différents domaines de compétence. Une attention particulière est portée aux études dans lesquelles les capacités phonologiques hors lecture de dyslexiques ont été comparées à leurs capacités dans des domaines n'impliquant pas la phonologie. La dernière partie porte sur les prédicteurs de la dyslexie.
Études de groupes indifférenciés de dyslexiques
Dans deux des études déjà citées (Lindgren et coll., 1985

; Paulesu et coll., 2001

), il a été noté que ce sont principalement les capacités verbales qui différencient les dyslexiques des normolecteurs de même âge. Ainsi, dans l'étude de Lindgren et coll. (1985

), les capacités d'analyse phonémique, de répétition de phrases et de dénomination permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs dans chaque groupe linguistique (anglais et italiens), mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. De même, et toujours quel que soit leur groupe linguistique (anglais, français, italiens), les dyslexiques adultes examinés par Paulesu et coll. (2001

) diffèrent des témoins de même âge dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (analyse phonémique, mémoire phonologique à court terme et dénomination rapide), mais pas, par exemple, dans des épreuves de compréhension. Partant de ce constat, Paulesu et coll. (2001

) soulignent qu'un déficit dans les traitements phonologiques est un problème « universel » dans la dyslexie.
Dans les deux études précédentes, les comparaisons ont porté sur des sujets de même âge chronologique. Étant donné que le niveau de lecture a une incidence sur les capacités phonologiques en dehors de la lecture, ces résultats pourraient n'être que la conséquence du faible niveau de lecture des dyslexiques. Cela ne semble pas être le cas. En effet, les mêmes tendances ont été observées dans des comparaisons avec des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture que les dyslexiques, les déficits les plus robustes concernant toutefois les compétences d'analyse phonémique. C'est ce qui ressort de l'étude de Pennington et coll. (2001

) qui a porté sur 70 enfants (de 7 à 12 ans) et adolescents (de 12 à 18 ans) dyslexiques. Quel que soit le groupe de dyslexiques, leurs scores sont plus faibles que ceux des normolecteurs de même niveau de lecture dans les tâches impliquant la manipulation de phonèmes. En revanche, seuls les dyslexiques adolescents les plus atteints ont des scores inférieurs aux témoins de même niveau de lecture pour les tâches de mémoire. Ce n'est le cas pour aucun des deux groupes de dyslexiques pour les tâches de dénomination. Les analyses de régression indiquent en plus que les compétences en analyse phonémique rendent compte de la majeure partie de la variance en lecture, y compris après avoir contrôlé les effets de l'âge et du QI verbal, les compétences en dénomination rapide n'expliquant dans ce contexte qu'une modeste part additionnelle de variance.
Des résultats similaires ont été rapportés par Chiappe et coll. (2002

) dans une étude intensive (5 heures d'observation par sujet) qui a porté sur 40 adultes dyslexiques et autant de normolecteurs de même niveau de lecture. Les scores des dyslexiques ne sont inférieurs à ceux des témoins que dans les tâches qui requièrent des compétences en analyse phonémique. Comme dans l'étude précédente, la majeure partie de la variance en lecture (plus de 50 %) est expliquée par les capacités d'analyse phonémique et, dans une moindre mesure, par celles de dénomination rapide. Comme le soulignent les auteurs, ces résultats signalent que les déficits des compétences d'analyse phonémique sont au cœur de la dyslexie, ces déficits étant persistants.
Des déficits d'analyse phonémique ont été rapportés dans d'autres études impliquant des dyslexiques et des témoins de même niveau de lecture en anglais (entre autres, Swan et Goswami, 1997a

; Joanisse et coll., 2000

), ainsi que dans d'autres langues (en allemand, Landerl et coll., 1997

). Toutefois, certaines études suggèrent que quand l'orthographe est transparente, les déficits d'analyse phonémique se retrouvent uniquement dans les étapes précoces de l'apprentissage de la lecture (Landerl et Wimmer, 2000

).
Enfin, certaines études indiquent que les dyslexiques réussissent moins bien les tâches d'analyse phonémique qui impliquent des pseudo-mots que celles qui utilisent des mots (Bruck et Treiman, 1990

; Bruck, 1992

) ce qui signale que leurs déficits dans ce domaine sont plus importants quand ils ne peuvent pas s'aider sur leurs compétences lexicales (voir aussi Swan et Goswami, 1997a

). Les mêmes tendances ont été relevées dans des épreuves impliquant la mémoire phonologique à court terme (Snowling et coll., 1986

b) ou les capacités de dénomination (Swan et Goswami, 1997b

).
Ainsi, dans l'étude de Swan et Goswami (1997b

), le niveau de vocabulaire a été évalué par des tâches de dénomination d'images de mots courts et longs qui étaient fréquents ou rares. Les mêmes items ont été présentés dans une tâche de désignation d'images (4 images : une qui représente le mot correct, plus un intrus visuel, un intrus phonologique et un intrus sémantique). Les enfants ont également passé un test classique de vocabulaire (en désignation d'images). Dans l'épreuve de dénomination, les scores des dyslexiques sont plus faibles que ceux des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture pour les mots rares, pas pour les mots fréquents. Surtout, les dyslexiques sont les seuls à être négativement affectés par la longueur des items, quelle que soit leur fréquence. En plus, ils produisent de nombreuses erreurs phonologiques, ce qui témoigne de l'imprécision de leurs représentations phonologiques. En revanche, dans les deux tâches de désignation d'images, les scores des dyslexiques ne diffèrent pas de ceux des témoins, y compris ceux de même âge chronologique. Selon les auteurs, ces résultats indiquent que les dyslexiques ont des difficultés de récupération des codes phonologiques des mots.
Les études de groupes indifférenciés de dyslexiques ont également mis en relief l'existence de déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques avant l'apprentissage de la lecture chez de futurs dyslexiques comparativement à de futurs normolecteurs. C'est le cas, par exemple, pour la répétition de pseudo-mots, la détection de rimes et la dénomination rapide dans l'étude de Hawelka et Wimmer (2005

; voir aussi Wimmer, 1996

).
Études de groupes de dyslexiques présentant un profil contrasté de dyslexie
Les résultats des études dans lesquelles ont été comparés des groupes de dyslexiques présentant un profil différent de dyslexie sont contradictoires. En effet, dans certaines études, seuls les dyslexiques phonologiques ont des déficits de nature phonologique (Manis et coll., 1996

; Stanovich et coll., 1997

; Bosse et Valdois, 2003

; Bailey et coll., 2004

), et pas dans d'autres (Sprenger-Charolles et coll., 2000

; Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana, 2002

; Zabell et Everatt, 2002

).
Ainsi, dans l'étude de Manis et coll. (1996

), les capacités d'analyse phonémique de dyslexiques phonologiques et de surface ont été évaluées. Par rapport à des normolecteurs de même niveau de lecture, seuls les dyslexiques phonologiques ont des scores inférieurs. Les mêmes résultats ont été retrouvés dans l'étude de Bailey et coll. (2004

) et dans celle de Stanovich et coll. (1997

) dans des tâches impliquant, entre autres, la manipulation de phonèmes. De plus, dans l'étude de Stanovich et coll. (1997

), les dyslexiques ayant un profil mixte se comportent comme les dyslexiques phonologiques. En particulier, leurs scores dans des tâches de manipulation de syllabes ou de phonèmes sont équivalents, et inférieurs à ceux de normolecteurs de même niveau de lecture. Une des rares études dans lesquelles les performances de dyslexiques ayant un profil mixte, et donc un double déficit, ont été examinées, indique donc que les capacités phonologiques de ces deux groupes de dyslexiques sont également détériorées. Comme les profils de type surface sont très peu fréquents, ces résultats suggèrent que la plupart des dyslexiques ont des troubles phonologiques en dehors de la lecture.
En revanche, dans d'autres études, aucune différence n'a été relevée entre des dyslexiques de surface et des dyslexiques phonologiques dans les compétences phonologiques en dehors de la lecture. Ainsi, dans l'étude de Zabell et Everatt (2002

), les performances des dyslexiques de surface ne se différenciaient pas de celles des dyslexiques phonologiques dans quatre tâches phonologiques (par exemple, en dehors de la lecture de pseudo-mots, dans des tâches de fluence phonologique et de dénomination rapide d'images ou de chiffres), quelle que soit la mesure utilisée : précision ou rapidité. De même, dans l'étude par Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana (2002

), aucune différence n'a été observée entre dyslexiques de surface et dyslexiques phonologiques dans des épreuves d'analyse phonologique.
Des résultats similaires ont été relevés en français dans une étude (Sprenger-Charolles et coll., 2000

) qui a permis de mettre en relief, à partir du temps de latence des réponses vocales en lecture de pseudo-mots et de mots irréguliers fréquents, un groupe de dyslexiques phonologiques et un groupe de dyslexiques de surface. Les examens ont porté sur la mémoire phonologique et visuelle à court terme, un déficit en mémoire phonologique étant attendu chez les dyslexiques phonologiques et un déficit de la mémoire visuelle, qui ne leur permettrait pas de fixer l'image orthographique des mots, chez les dyslexiques de surface. Dans le test visuel utilisé (le Corsi), les enfants devaient reproduire une trajectoire entre plusieurs points (de 2 à 7). Le test phonologique était similaire (rappel de pseudo-mots de 3 à 6 syllabes). Les résultats sont présentés dans le tableau 9.V

.
Aucune différence entre les deux groupes de dyslexiques n'est relevée, pas plus en mémoire phonologique qu'en mémoire visuelle. Toutefois, dans l'épreuve de mémoire phonologique, les deux groupes de dyslexiques ont des scores inférieurs à ceux d'enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture.
Tableau 9.V Mémoire à court-terme phonologique et visuelle (d'après Sprenger-Charolles et coll., 2000 )
)
|
Empan de mémoire à court terme (MCT)
|
|
|
Dyslexiques de surface (2) (n = 10) |
Dyslexiques phonologiques (2) (n = 16) |
|
Moyenne et écart-type (ET) pour des dyslexiques et des normolecteurs de même âge (NLAC) et de même niveau de lecture (NLAL).
1Les deux groupes témoins comportent les mêmes enfants, testés à 10 ans (NLAC) et à 8 ans (NLAL) ; 2 Dyslexiques âgés de 10 ans
|
|
MCT phonologique (/6)
|
4,95 (ET = 0,97)
|
4,84 (ET = 0,83)
|
3,40 (ET = 1,17)
|
3,75 (ET = 0,77)
|
|
MCT visuelle (/7)
|
5,16 (ET = 0,76)
| |
4,90 (ET = 0,88)
|
4,88 (ET = 0,96)
|
Les enfants de cette étude ont également passé avant et après l'apprentissage de la lecture (à 5 ans et 7 ans) une épreuve d'analyse phonémique. Ils devaient supprimer le premier phonème de 20 pseudo-mots, 10 « consonne-voyelle » (nan, zon, ja...) et 10 « consonne-voyelle-consonne » (vour, buf, nol, bap...). Une épreuve d'analyse musicale leur a aussi été proposée aux mêmes époques. Ils devaient juger si deux mélodies de trois notes étaient ou non identiques. Parmi les 18 paires présentées, 6 se différenciaient par le contour, 6 par le registre et 2 par les deux. Les résultats sont présentés dans la figure 9.4

. Avant l'apprentissage de la lecture, les scores des futurs dyslexiques phonologiques ne différaient pas de ceux des futurs dyslexiques de surface et étaient inférieurs à ceux des futurs normolecteurs dans l'épreuve d'analyse phonémique, mais pas dans celle d'analyse musicale.
De plus, dans l'épreuve d'analyse phonémique, les performances de la plupart des futurs dyslexiques étaient égales à zéro avant l'apprentissage de la lecture (0/20 pour 23 des 33 futurs dyslexiques, soit 70 %), et cela quel que soit leur futur profil de dyslexie. Seuls 3 des futurs normolecteurs étaient, à la même époque, incapables de réaliser cette tâche. Toutefois, les scores de 3 d'entre eux étaient très faibles (1 ou 2 sur 20). Si les enfants qui ont des scores entre 0 et 3 pour l'apprentissage de la lecture sont dits être « à risque », c'est le cas pour 73 % des futurs dyslexiques contre 32 % des futurs normolecteurs. Ces données indiquent, qu'avec une épreuve du type de celle utilisée, il est possible de repérer dès cette époque de façon relativement fiable les enfants à risque pour l'apprentissage de la lecture.
Les compétences déficitaires chez les dyslexiques sont donc principalement les compétences d'analyse phonémique, celles de mémoire phonologique à court terme, de dénomination rapide et le niveau de connaissance des lettres. Ce sont également ces compétences qui, comme l'indiquaient les études présentées dans le chapitre sur l'apprentissage de la lecture, sont les prédicteurs les plus fiables du futur niveau de lecture des enfants. En comparaison, le poids des habiletés non verbales, tout comme celui des facteurs socioculturels, est moindre.
Dans la section suivante, sont examinés les prédicteurs des difficultés de lecture chez des enfants dits « à risque » pour cet apprentissage, à savoir ceux qui sont issus de milieux défavorisés et de familles de dyslexiques. Les enfants dysphasiques, qui souffrent de troubles spécifiques du langage oral, sont également inclus dans cette catégorie.
Prédicteurs des difficultés de lecture dans les populations « à risque »
Comme le notent Elbro et Scarborough (2003

) dans leur synthèse de la littérature, les résultats de plusieurs études montrent que les indicateurs qui prédisent le devenir en lecture sont identiques, quelle que soit la population : par exemple, chez des enfants « tout-venant »
versus ceux qui sont supposés « à risque » pour l'apprentissage de la lecture, que ce risque soit d'origine linguistique ou sociologique (voir par exemple, Snow et coll., 1991

). Dans la suite, nous examinerons les études qui ont porté sur des familles de dyslexiques ainsi que celles incluant des enfants dysphasiques (voir le chapitre 2 pour les études portant sur des enfants tout-venant).
Enfants de familles de dyslexiques
Le risque de devenir dyslexique pour un enfant issu d'une famille dans laquelle l'un des parents proches est dyslexique est multiplié par 4, voire plus (Gilger et coll., 1991

). Ainsi, selon Scarborough (1998a

), environ 40 % des enfants de telles familles deviennent dyslexiques alors que des difficultés spécifiques de lecture sont relevées dans moins de 10 % des cas dans des familles sans dyslexiques. Scarborough (1989

, 1990

et 1991

) a suivi entre 2 ans et demi et 8 ans des enfants issus ou non de familles de dyslexiques. Les groupes étaient appariés en fonction du milieu socioculturel et du niveau d'intelligence des enfants. Une partie de ces enfants a été revue à l'âge de 14 ans (66 sur 78 ; Scarborough, 1998b

). À la fin de la 2
e année du primaire, 22 des 34 enfants de famille à risque avaient un an ou plus de retard en lecture. Le même résultat n'est relevé que pour 2 des 44 autres enfants des familles de témoin. Les différences de niveau de lecture en fonction du « risque » familial ont également été retrouvées en 8
e année.
Scarborough a examiné de façon rétrospective les données recueillies avant l'entrée à l'école. Dès 2 ans et demi, alors que les enfants des deux groupes ont des compétences non-verbales similaires, ils diffèrent pour la compréhension, et surtout pour la production du langage. Plus précisément, bien qu'à 2 ans et demi les futurs dyslexiques utilisent dans la conversation un vocabulaire aussi étendu que celui des futurs normolecteurs, ils font plus d'erreurs de prononciation et produisent des phrases moins longues et moins complexes. À partir de 3 ans et demi, les futurs lecteurs dyslexiques ont des performances significativement inférieures à celles du groupe témoin pour le vocabulaire et la dénomination d'images. À 5 ans, ils ont davantage de difficultés dans des tâches d'analyse phonologique ainsi que dans des épreuves de connaissance des lettres, tout comme dans celles impliquant la manipulation des correspondances grapho-phonologiques.
Des résultats identiques sont rapportés par Gallagher et coll. (2000

) dans une étude qui a porté sur 59 familles avec au moins un parent dyslexique. Comme dans l'étude précédente, les critères exclusionnaires classiques ont été pris en compte (en particulier, problèmes visuels, émotionnels et médicaux). Les enfants ont été suivis de 4 ans à 6 ans. À 4 ans, les évaluations ont porté sur les compétences non verbales (test de dessin du bonhomme), le niveau de vocabulaire (en désignation et en dénomination), la qualité de la syntaxe (longueur des phrases produites) et de la compréhension du langage (rappel d'une histoire). La maîtrise des aspects phonologiques du langage a été évaluée par la qualité de l'articulation, les compétences en répétition de pseudo-mots et par la sensibilité aux rimes. Dans ce dernier cas, les enfants devaient, d'une part, réciter des «
nursery rhymes » et, d'autre part, corriger les erreurs produites par l'expérimentateur quand il récitait ces petites poésies en les modifiant. Les évaluations à 6 ans ont porté sur les capacités de lecture et d'écriture, incluant la compréhension.
Sur les 63 enfants du groupe à risque, 36 (soit 57 %) ont effectivement des difficultés de lecture à 6 ans : leurs scores sont à plus de 1 écart-type de ceux des témoins. C'est le cas pour 4 enfants (sur 34, soit 12 %) du groupe témoin. Les analyses ont comparé le groupe témoin et les deux groupes d'enfants qui étaient « à risque », ceux qui ont effectivement rencontré des difficultés de lecture et les autres. Aucune différence entre les 3 groupes n'est relevée pour le milieu socioculturel, le sexe et les habiletés non verbales. En revanche, les performances des enfants en difficultés de lecture diffèrent de celles des enfants du groupe témoin dans pratiquement toutes les mesures impliquant le langage. Sauf dans les évaluations de la qualité de l'articulation, les enfants en difficultés de lecture se différencient également de leurs pairs à risque qui ont normalement appris à lire sur presque toutes les mesures impliquant le traitement du langage. Enfin, les analyses de régression indiquent que les prédicteurs du niveau de lecture sont, par ordre décroissant : le niveau de connaissance des lettres ; la maîtrise des aspects phonologiques du langage (évaluée par la précision de l'articulation et la répétition de pseudo-mots) ; et les autres capacités langagières (évaluées par le niveau de vocabulaire, les capacités syntaxiques et le rappel d'histoire).
Les résultats de ces deux études ont été reproduits dans d'autres études impliquant des enfants anglais (par exemple Pennington et coll., 1999

; Pennington et Lefly, 2001

), mais également des enfants danois (Petersen et Elbro, 1999

) et finlandais (Lyytinen et coll., 1994

). Dans toutes ces études, alors que les groupes ne diffèrent pas pour les habiletés non verbales, les enfants issus de familles de dyslexiques souffrent de troubles spécifiques et précoces du langage oral. Dans l'étude finlandaise, un dysfonctionnement dans l'activité neurale suscitée par l'écoute de sons de la parole a même été observé très précocement chez eux, à 6 mois (Leppänen et coll., 1999

; Leppänen et coll., 2002

).
Enfants dysphasiques
La dysphasie est un trouble spécifique du langage oral qui se manifeste en l'absence de troubles sensori-moteurs avérés. Une partie de ces enfants ont également des difficultés de lecture (Baker et Cantwell, 1987

; Aram et Hall, 1989

; Bishop et Adams, 1990

; Catts, 1993

; Billard et coll., 1994

; Stothard et coll., 1998

; Snowling et coll., 2000

).
Tous les dysphasiques ne deviennent cependant pas dyslexiques. Ainsi, dans une étude longitudinale qui a concerné un groupe de 68 enfants dysphasiques suivis depuis l'âge de 4 ans, Bishop et Adams (1990

) n'ont relevé que 4 dyslexiques à 8 ans et demi (6 %), 2 ayant également des difficultés de compréhension en lecture, plus 2 autres enfants qui n'étaient déficitaires que dans ce dernier domaine.
Sept ans plus tard toutefois, le niveau de lecture des dysphasiques s'est considérablement détérioré (Snowling et coll., 2000

). Les résultats sont présentés dans le tableau 9.VI

. La proportion des dyslexiques passe de 6 % à 43 %, 25 % d'entre eux souffrant uniquement de troubles spécifiques de lecture. De même, celle des enfants ayant des problèmes de compréhension écrite augmente de 6 à 23 %, parmi lesquels 5,4 % ne sont en difficultés que dans ce domaine. D'après ces données, approximativement la moitié des dysphasiques ont donc également des difficultés sévères de lecture.
Tableau 9.VI Catégorisation en fonction des performances en lecture pour des enfants dysphasiques et des témoins de 15 ans (d'après Snowling et coll., 2000 )
)
|
Catégorisation à 15 ans
|
Résultats tenant compte du QI performance
|
| |
Dysphasiques (%)
|
groupe témoin (%)
|
|
Déficit spécifique en lecture
|
25,0
|
5,7
|
|
Déficit de compréhension en lecture
|
5,4
|
3,8
|
|
Double déficit (capacités spécifiques à la lecture
et compréhension en lecture)
|
17,8
|
0
|
|
Lecteurs en retard (problèmes additionnels d'intelligence)
|
0
|
5,7
|
|
Normolecteurs
|
51,7
|
84,6
|
Comme le signalent Elbro et Scarborough (2003

), les prédicteurs des futures difficultés de lecture sont les mêmes dans cette population que dans les autres. Il s'agit principalement des capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que des compétences en dénomination rapide. Toutefois, le niveau cognitif des enfants dysphasiques a une forte incidence sur leur futur niveau de lecture, probablement parce que ceux qui ont une intelligence supérieure à la normale sont plus aptes que les autres à mettre en œuvre des stratégies compensatoires (Snowling et coll., 2000

).
Discussion sur les compétences déficitaires en dehors de la lecture chez les dyslexiques
Les dyslexiques ont des compétences particulièrement déficitaires dans des tâches qui impliquent des traitements phonologiques en dehors de la lecture : en analyse phonémique, en mémoire à court terme phonologique ainsi que dans des épreuves qui permettent d'évaluer la précision et la rapidité de l'accès au lexique. Comme pour la lecture, ces déficits sont observés y compris par rapport à des sujets plus jeunes mais de même niveau de lecture, ce qui signale une nouvelle fois que la dyslexie correspond à une déviance développementale. De plus, ces déficits sont prévalents : ils se retrouvent en effet chez la plupart des dyslexiques, y compris avant l'apprentissage de la lecture. Enfin, les compétences dans ces différents domaines sont les prédicteurs les plus fiables du futur niveau de lecture des enfants. En comparaison, le poids des habiletés non verbales, tout comme celui des facteurs socioculturels, est moindre. Ces résultats ont été relevés aussi bien dans des populations « tout-venant » que chez des enfants « à risque » pour l'apprentissage de la lecture, que ce risque se justifie par leur milieu socioéconomique, la présence de difficultés de lecture chez leurs parents, ou le fait qu'ils souffrent de troubles développementaux du langage oral (enfants dysphasiques).
Comment rendre compte des résultats ?
Différents types d'études, effectuées dans diverses langues, ont été examinés afin d'évaluer la fiabilité et la prédominance des déficits relevés en lecture, ainsi que dans les compétences reliées à la lecture, chez les dyslexiques ainsi que les profils de dyslexie. Cette partie examine le poids des déficiences phonologiques et non phonologiques dans la dyslexie, ainsi que le rôle que peuvent avoir les stratégies compensatoires.
Déficits phonologiques dans la dyslexie du développement
Les difficultés sévères rencontrées par les dyslexiques en lecture de mots nouveaux proviennent en général de la faiblesse de leurs habilités phonologiques en dehors de la lecture, en particulier, en analyse phonémique, en mémoire à court terme phonologique et en dénomination. Des déficits dans ces domaines peuvent entraver la mise en place de la procédure sublexicale de lecture. En effet, pour utiliser cette procédure, il faut d'abord mettre en correspondance les unités sublexicales de l'écrit, les graphèmes, avec les unités correspondantes de l'oral, les phonèmes. Il faut ensuite assembler les unités résultant du transcodage pour accéder aux mots. La première opération nécessite des habiletés d'analyse phonémique, la seconde implique la mémoire phonologique à court terme ainsi que la précision et la rapidité de l'accès au lexique oral. Un enfant incapable d'extraire les phonèmes et souffrant en plus d'un déficit mnésique et/ou d'une déficience dans l'accès à son lexique, va difficilement pouvoir utiliser cette procédure d'identification des mots écrits. Ce type de dyslexie proviendrait donc d'un déficit cognitif spécifique, de nature phonologique. Le fait que la plupart des dyslexiques ont aussi des images orthographiques peu spécifiées (et donc un double déficit) s'explique parfaitement si on accepte que la mise en place du lexique orthographique dépend de l'efficience de la procédure phonologique de lecture. En conséquence, pratiquement tous les dyslexiques ont un double déficit en lecture, leur déficit phonologique étant toutefois le plus sévère puisqu'il est relevé y compris par rapport à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture.
Profils de type surface et déficits visuels dans la dyslexie du développement
Des déficits dans des domaines n'impliquant pas les traitements phonologiques ont été relevés dans des cas de dyslexie de surface. Ce type de déficit a principalement été étudié dans deux domaines. D'une part, partant du constat qu'un déficit de mémoire phonologique à court terme est fréquemment associé à la dyslexique phonologique, des chercheurs ont fait l'hypothèse qu'un déficit mnésique de même nature affectant la modalité visuelle pourrait être lié à la dyslexie de surface. Les difficultés orthographiques de ces dyslexiques s'expliqueraient donc par des difficultés de mémorisation de la forme visuelle des mots. Si cette explication est séduisante, comme le souligne Snowling (2000

), elle n'a pas reçu, au moins jusqu'à présent, de larges confirmations. En effet, en dehors de l'étude de Goulandris et Snowling (1991

), des déficits mnésiques visuels n'ont pas été relevés chez des dyslexiques de surface.
Une autre hypothèse pouvant expliquer les déficits spécifiques de certains dyslexiques est une déficience des traitements séquentiels visuels. Une telle déficience a été rapportée dans certaines études de cas unique, par exemple, chez Allan (Hanley et coll., 1992

), tout comme dans des études de séries des cas, par exemple, chez RO, MF et AR (Seymour, 1986

). Toutefois, comme dans les études de groupes (Hutzler et Wimmer, 2004

), les résultats des études publiées ne permettent pas de soutenir l'hypothèse que ce déficit est à l'origine de la dyslexie, ou d'une forme particulière de dyslexie, pour trois raisons. D'une part, les déficits visuels relevés chez les dyslexiques peuvent simplement être la conséquence de leurs difficultés de lecture, vu que pratiquement toutes les études dans ce domaine ont comparé des dyslexiques à des normolecteurs de même âge chronologique, à la différence des études qui ont mis en relief les déficits phonologiques (excepté celles de Paulesu et coll., 2001

et de Lindgren et coll., 1985

). D'autre part, ce type de déficit est toujours plus marqué sur les pseudo-mots que sur des mots ou des suites de lettres non prononçables (Seymour, 1986

; Hanley et coll., 1992

). Enfin, dans la plupart des études signalant des déficits visuels spécifiques, les habiletés visuelles des dyslexiques, mais pas leurs habiletés phonologiques, ont été évaluées en tenant compte de la vitesse de traitement et/ou avec des tâches comportant des contraintes temporelles (par exemple, durée très brève d'exposition des stimuli). Il est donc difficile d'affirmer que les habiletés phonologiques de ces dyslexiques étaient préservées. Dans quelques rares études, les habiletés phonologiques et visuelles ont été examinées en utilisant des méthodologies comparables (par exemple, Seymour, 1986

). Or, sur les 21 cas de dyslexie examinés par ce chercheur, un déficit supposé spécifique aux traitements visuels n'a été relevé que chez 3 sujets (RO, MF et AR). Ils avaient cependant tous des performances plus fortement affectées par les effets de longueur en lecture de pseudo-mots qu'en lecture de mots ou dans des tâches purement visuelles de comparaison de chaînes de lettres. En plus, ces trois dyslexiques avaient tous une histoire de troubles phonologiques.
Une autre hypothèse est que les dyslexiques de surface seraient en fait des dyslexiques phonologiques qui ont un sévère déficit de leur procédure lexicale de lecture s'expliquant par des facteurs environnementaux défavorables (Stanovich et coll., 1997

). Ainsi, des enfants issus de milieux moins favorisés peuvent avoir été moins souvent confrontés à l'écrit et moins aidés pour dépasser leur handicap que des dyslexiques qui évoluent dans un environnement susceptible de les motiver à apprendre à lire en dépit de la difficulté de cet apprentissage. Cette explication peut rendre compte du fait que le déficit phonologique des dyslexiques de surface est moins marqué que leur déficit orthographique, l'acquisition des représentations orthographiques nécessitant une bonne confrontation avec l'écrit. Elle est confortée par des données suggérant que les déficits orthographiques s'expliqueraient par des facteurs environnementaux, alors que l'origine des déficits phonologiques pourrait être génétique (Castles et coll., 1999

; Olson et coll., 1999

).
Rôle des stratégies compensatoires
Chez le lecteur habile, l'identification des mots écrits est un acte quasi réflexe, qui n'est pas influencé par les informations contextuelles. En fait, les effets du contexte sur cette identification baissent en fonction de l'augmentation de l'âge et du niveau de lecture (West et Stanovich, 1978

; Perfetti et coll., 1979

; Raduege et Swantes, 1987

), les lecteurs les moins habiles, et particulièrement les dyslexiques, utilisant plus le contexte que les bons lecteurs (Bruck, 1990

).
C'est probablement grâce à de telles stratégies compensatoires que les dyslexiques arriveraient à surmonter leur déficit phonologique. Des données à l'appui de cette interprétation ont été relevées dans les études longitudinales. Par exemple, comme le soulignent les auteurs (Hulme et Snowling, 1992

), le cas JM développe progressivement des stratégies compensatoires. C'est ce qu'indiquent les effets facilitateurs d'un amorçage sémantique en lecture de pseudo-mots (le pseudo-mot «
sawce » présenté après le mot «
tomato ») observés chez lui quand il avait 13 ans, mais pas auparavant.
Le très fort effet de la lexicalité relevé chez les dyslexiques n'est probablement que le résultat de stratégies compensatoires, les dyslexiques utilisant plus que les normolecteurs l'information lexicale contenue dans les mots, probablement pour suppléer la déficience de leurs habiletés phonologiques. C'est ce que signale le fait que, dans l'étude de Seymour (1986

), les performances de la plupart des dyslexiques ayant un déficit phonologique sévère sont meilleures quand les pseudo-mots se prononcent comme des mots de la langue. C'est également ce que suggère le fait qu'ils réussissent mieux les tâches phonologiques hors lecture quand elles impliquent des mots simples et fréquents (Snowling et coll., 1986

a

; Bruck et Treiman, 1990

; Bruck, 1992

; Swan et Goswami, 1997a

et b

).
D'autres évidences indirectes de la mise en place progressive de stratégies compensatoires proviennent des données longitudinales publiées par Seymour (1986

), les trois adolescents ne présentant pas de déficit phonologique majeur lors des observations effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans ayant tous présenté antérieurement un trouble phonologique, soit un retard de développement du langage oral (RO and MF), soit un déficit phonologique en lecture (AR, Seymour et Porpodas, 1980

).
En conclusion,
les études passées en revue indiquent que la présence de déficits sévères et spécifiques de la procédure phonologique de lecture, accompagnée de déficits phonologiques hors lecture également sévères et spécifiques, est la caractéristique majeure de la dyslexie développementale, de tels déficits ayant systématiquement été relevés dans les études de groupes, et ayant systématiquement été observés chez la plupart des dyslexiques examinés dans les études de séries de cas. Le fait que ces déficits émergent y compris par rapport à des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture est le signe d'une déviance développementale. En outre, l'opacité de l'orthographe est un facteur environnemental aggravant. Enfin, un fort consensus se dégage des différentes études sur le fait que les prédicteurs les plus fiables de l'apprentissage de la lecture sont des compétences de nature phonologique (capacités d'analyse phonémique, de mémoire phonologique à court terme et de dénomination rapide). En comparaison, le poids des habiletés non verbales, tout comme celui des facteurs socioculturels, est moindre.
Comme le signalent Ziegler et Goswami (2005

; voir également Sprenger-Charolles et coll.,

sous presse), le fait que les mêmes déficits aient été relevés chez les dyslexiques dans différents contextes linguistiques (en anglais, en allemand, en hollandais, en français, en italien, en espagnol...) dans des tâches impliquant des traitements phonémiques en lecture (faible maîtrise des correspondances graphème-phonème attestées par des scores particulièrement déficitaires en lecture de pseudo-mots, quand il n'est pas possible de s'appuyer sur des compétences lexicales pour lire) et hors lecture (en particulier, en analyse phonémique) est difficile à concilier avec l'idée qu'il puisse y avoir des sous-types de dyslexie fortement contrastés. Ce constat s'applique aux études de groupes et les résultats d'études de série de cas de dyslexiques vont dans le même sens. Ainsi, comme le soulignait Seymour (1986

), qui est un des rares chercheurs a avoir examiné finement les déficits phonologiques et visuo-attentionnels avec des méthodologies comparables, tous les dyslexiques de sa cohorte présentaient des troubles phonologiques qui se manifestaient en lecture de pseudomots par la faible précision et/ou la lenteur de leurs réponses ainsi que par les effets de longueur, ce pattern dominant étant parfois accompagné de quelques signes des déficiences visuelles. En l'état de la recherche, les preuves à l'appui d'un déficit visuel à l'origine de la dyslexie (ou de certaines formes de dyslexie) sont fragiles.
Bibliographie
[1] ans b,
carbonnel s,
valdois s. A connectionist multiple-trace memory model for polysyllabic word reading.
Psychol Rev. 1998;
105:678
-723

[2] aram dm,
hall ne. Longitudinal follow-up of children with preschool communication disorders: treatment implications.
School Psychology Review. 1989;
18:487
-501

[3] backman j,
bruck m,
hebert m,
seidenberg ms. Acquisition and use of spelling sound correspondances in reading.
Journal of Experimental Child Psychology. 1984;
38:114
-133

[4] baddeley ad,
ellis nc,
miles tr,
lewis vj. Developmental and acquired dyslexia: A comparison.
Cognition. 1982;
11:185
-196

[5] bailey ce,
manis fr,
pedersen wc,
seidenberg ms. Variation among developmental dyslexics: evidence from a printed-word-learning task.
J Exp Child Psychol. 2004;
87:125
-154

[6] baker l,
cantwell dp. A prospective psychiatric follow-up of children with speech/language disorders.
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1987;
26:546
-553

[7] beauvois mf,
derouesné j. Phonologica alexia: Three dissociations.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1979;
42:1115
-1124

[8] beech jr,
harding lm. Phonemic processing and the poor reader from a developmental lag viewpoint.
Reading Research Quarterly. 1984;
19:357
-366

[9] billard c,
toutain a,
loisel ml,
gillet p,
barthez ma,
maheut j. Genetic basis of developmental dysphasia. Report of eleven familial cases in six families.
Genet Couns. 1994;
5:23
-33

[10] bishop dv,
adams c. A prospective study of the relationship between specific language impairment, phonological disorders and reading retardation.
J Child Psychol Psychiatry. 1990;
31:1027
-1050

[11] boder e. Developmental dyslexia: a diagnostic approach based on three atypical reading-spelling patterns.
Developmental Medicine and Child Neurology. 1973;
15:663
-687

[12] bosse ml,
valdois s. Patterns of developmental dyslexia according to a multi-trace memory model of reading.
Current Psychology Letters. Special Issue on Language Disorders and Reading Acquisition 2003, 10 (1);
:
http://cpl.revues.org/document92.html.

[13] bruck m. The word recognition and spelling of dyslexic children.
Reading Research Quarterly. 1988;
23:51
-69

[14] bruck m. Word-recognition skills of adults with childhood diagnoses of dyslexia.
Developmental Psychology. 1990;
26:439
-454

[15] bruck m. Persistence of Dyslexics’ Phonological Awareness Deficits.
Developmental Psychology. 1992;
28:874
-886

[16] bruck m,
treiman r. Phonological awareness and spelling in normal children and dyslexics: the case of initial consonant clusters.
J Exp Child Psychol. 1990;
50:156
-178

[17] bryant pe,
impey l. The similarities between normal readers and developmental and acquired dyslexic children.
Cognition. 1986;
24:121
-137

[18] casalis s. Lecture et dyslexies de l’enfant.
Paris:Septentrion;
1995.

[20] castles a,
coltheart m. Varieties of developmental dyslexia.
Cognition. 1993;
47:149
-180

[21] castles a,
datta h,
gayan j,
olson rk. Varieties of reading disorder: genetic and environmental influences.
Journal of Experimental Child Psychology. 1999;
72:73
-94

[22] catts hw. The relationship between speech-language impairments and reading disabilities.
Journal of Speech and Hearing Research. 1993;
36:948
-958

[23] chiappe p,
stringer n,
siegel ls,
stanovich k. Why the timing deficit hypothesis does not explain reading disability in adults.
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 2002;
15:73
-107

[24] cohen j. Statistical power analysis for the behavioural sciences.
In: , editors.
.
Hillsdale, New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc;
1988.
p.
-

[25] coltheart m. Lexical access in simple reading tasks.
In: underwood g, editors.
Strategies of information processing.
London:Academic Press;
1978.
p. 151
-216

[26] coltheart m. Are there lexicons?.
Q J Exp Psychol A. 2004;
57:1153
-1171

[27] coltheart m,
masterson j,
byng s,
prior m,
riddoch j. Surface dyslexia.
Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1983;
35:469
-595

[28] coltheart m,
curtis b,
atkins p,
haller m. Models of reading aloud: Dual route and parallel processing approaches.
Psychological Review. 1993;
100:589
-608

[29] coltheart m,
rastle k,
perry c,
langdon r,
ziegler j. DRC: A dual route cascaded model of visual word recognition and reading aloud.
Psychological Review. 2001;
108:204
-256

[30] cossu g,
shankweiler d,
liberman iy,
gugliotta m. Visual and phonological determinants of misreadings in a transparent orthography.
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 1995;
7:235
-256

[31] critchley m. The dyslexic child.
London:Heinemann Medical Book;
1970.

[32] de luca m,
borrelli m,
judica a,
spinelli d,
zoccolotti p. Reading words and pseudowords: An eye movement study of developmental dyslexia.
Brain and Language. 2002;
80:617
-626

[33] de luca m,
di pace e,
judica a,
spinelli d,
zoccolotti p. Eye movement patterns in linguistic and non linguistic tasks in developmental surface dyslexia.
Neuropsychologia. 1999;
37:1407
-1420

[34] elbro c,
scarborough hs. Early identification.
In: bryant p, nunes t, editors.
Handbook of Children’s reading.
Dordrecht:Kluwer Academic Press;
2003.
p. 361
-381

[35] fischer fw,
liberman iy,
shankweiler d. Reading reversals and developmental dyslexia: a further study.
Cortex. 1978;
14:496
-510

[36] frith u,
snowling mj. Reading for meaning and reading for sound in autistic and dyslexic children.
British Journal of Developmental Psychology. 1983;
1:329
-342

[37] frith u. A developmental framework for developmental dyslexia.
Annals of Dyslexia. 1986;
:69
-81

[38] frith u. Beneath the surface of developmental dyslexia.
In: patterson ke, marshall jc, coltheart m, editors.
Surface dyslexia: Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading.
London:Erlbaum;
1985.
p. 301
-330

[39] gallagher a,
frith u,
snowling mj. Precursors of literacy delay among children at genetic risk of dyslexia.
J Child Psychol Psychiatry. 2000;
41:203
-213

[40] génard n,
mousty p,
content a,
alegria j,
leybaert j,
morais j. Methods to establish subtypes of developmental dyslexia.
In: reitsma p, verhoeven l, editors.
Problems and interventions in literacy development.
The Netherlands, Kluwer:Dordrecht;
1998.
p. 163
-176

[41] gilger jw,
bruce f,
pennington bf,
defries jc. Risk for reading disability as a function of parental history in three family studies.
Reading and Writing. 1991;
3:205
-217

[42] goulandris n,
snowling mj. Visual memory deficits: A plausible cause of developmental dyslexia? Evidence from a single case study.
Cognitive Neuropsychology. 1991;
8:127
-154

[43] grainger j,
bouttevin s,
truc c,
bastien m,
ziegler j. Word superiority, pseudoword superiority, and learning to read: A comparison of dyslexic and normal readers.
Brain and Language. 2003;
87:432
-440

[44] hanley jr,
hastie k,
kay j. Developmental surface dyslexia and dysgraphia: an orthographic processing impairment.
Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1992;
44A:285
-320

[45] harris m,
coltheart m. Language processing in children and adults: An introduction.
London:Routledge and Kegan;
1986.

[46] hawelka s,
wimmer h. Impaired visual processing of multi-element arrays is associated with increased number of eye movements in dyslexic reading.
Vision Res. 2005;
45:855
-863

[47] hulme c,
snowling m. Phonological deficits in dyslexia: a reappraisal of the verbal deficit hypothesis.
In: singh n, beale i, editors.
Current perspectives in learning disabilities.
New York:Springer-Verlag;
1992.
p. 270
-331

[48] hutzler f,
wimmer h. Eye movements of dyslexic children when reading in a regular orthography.
Brain and Language. 2004;
89:235
-242

[49] inizan a. Analyse de la compétence en lecture (ANALEC).
Issy-les-Moulineaux:EAP;
1995.

[50]international dyslexia association. Frequently Asked Questions (FAQ): What is dyslexia ?.
2005;
http://www.interdys.org/.

[51] jared d. Spelling-sound consistency affects the naming of high-frequency words.
Journal of Memory and Language. 1997;
36:687
-715

[52] jastak s,
wilkinson gs. The wide range achievement test-Revised.
Wilmington, DE:Jastak Associates;
1984.

[53] jimenez-gonzalez je,
valle ih. Word identification and reading disorders in the Spanish language.
Journal of Learning Disabilities. 2000;
33:44
-60

[54] jimenez-gonzalez je,
ramirez-santana g. Identifying subtypes of reading disability in a transparent orthography.
The Spanish Journal of Psychology. 2002;
5:3
-19

[55] joanisse mf,
manis fr,
keating p,
seidenberg ms. Language deficits in dyslexic children: speech perception, phonology, and morphology.
J Exp Child Psychol. 2000;
77:30
-60

[56] judica a,
de luca m,
spinelli d,
zoccolotti p. Training of developmental surface dyslexia improves reading performance and shortens eye fixation during reading.
Neuropsychological Rehabilitation. 2002;
12:177
-197

[57] landerl k,
wimmer h. Deficits in phoneme segmentation are not the core problem of dyslexia: evidence from german and anglish children.
Applied psycholinguistics. 2000;
21:243
-262

[58] landerl k,
wimmer h,
frith u. The impact of orthography consistency on dyslexia: A German-English comparison.
Cognition. 1997;
63:315
-334

[59] leppänen pht,
pihko e,
eklund km,
lyytinen h. Cortical responses of infants with and without a genetic risk for dyslexia: II. Group effects.
NeuroReport. 1999;
10:901
-905

[60] leppänen pht,
richardson u,
pihko e,
eklund km,
guttorm tk. Brain responses to changes in speech sound durations differ between infants with and without familial risk for dyslexia.
Developmental Neuropsychology. 2002;
22:407
-422

[61] liberman iy,
mann va,
werfelman m. Children’s memory for recurring linguistic and non-linguistic material in relation to reading ability.
Cortex. 1982;
18:367
-375

[62] liberman iy,
shankweiler d,
orlando c,
harris ks,
berti fb. Letter confusions and reversals of sequence in the beginning reader: Implications for Orton’s theory of developmental dyslexia.
Cortex. 1971;
7:127
-142

[63] lindgren sd,
de renzi e,
richman lc. Cross-national comparisons of developmental dyslexia in Italy and the United States.
Child Development. 1985;
56:1404
-1417

[64] lyytinen h,
ahonen t,
räsänen p. Dyslexia and dyscalculia in childrenRisks, early precursors, bottlenecks and cognitive mechanisms.
Acta Paedopsychiatrica (special issue). 1994;
56:179
-192

[65] manis fr,
seidenberg ms,
doi lm,
mcbride-chang c,
peterson a. On the basis of two subtypes of developmental dyslexia.
Cognition. 1996;
58:157
-195

[66] manis fr,
szeszulsli pa,
holt lk,
graves k. Variation in component word recognition and spelling skills among dyslexic children and normal readers.
In: carr th, levy ba, editors.
Reading and its development: Component skills approaches.
New York:Academic Press;
1990.
p. 207
-259

[67] mann va,
liberman iy. L’apprenti lecteur : Recherches empiriques et implications pédagogiques.
In: rieben l, perfetti ch, editors.
Textes de base en psychologie.
Lausanne:Delâchaux et Niestlé;
1984.
p. 222
-

[68] marsh g,
friedman m,
welch v,
desberg p. A Cognitive developmental theory of reading acquisition.
In: mackinnon ge, waller tg, editors.
Reading research: Advances in theory and practice.
Vol. 3.
Hillsdale:Erlbaum;
1981.
p. 199
-221

[69] mcdougall p,
borowsky r,
mackinnon ge,
hymel s. Process dissociation of sight vocabulary and phonetic decoding in reading: A new perspective on surface and phonological dyslexias.
Brain and Language. 2004;
92:185
-203

[70] metsala jl,
stanovich ke,
brown gda. Regularity effects and the phonological deficit model of reading disabilities: A meta-analytic review.
Journal of Educational Psychology. 1998;
90:279
-293

[71] milne rd,
nicholson t,
corballis mc. Lexical access and phonological decoding in adult dyslexic subtypes.
Neuropsychology. 2003;
17:362
-368

[72] morton j. An information-processing account of reading acquisition.
In: galaburda am, editors.
From reading to neurons.
Cambridge, MA:M.I.T. Press;
1989.
p. 43
-66

[73] mousty p,
leybaert j. Évaluation des habiletés de lecture et d’orthographe au moyen de la BELEC : données longitudinales auprès d’enfants francophones testés en 2
e et 4
e années.
Revue Européenne de Psychologie Appliquée. 1999;
49:325
-342

[74] murphy l,
pollatsek a. Developmental dyslexia: heterogeneity without discrete subgroups.
Annals of dyslexia. 1994;
44:120
-146

[75] olson rk,
datta h,
gayan j,
defries jc. A behavioural-genetic analysis of reading disabilities and component processes.
In: klein r, mcmullen p, editors.
Converging methods for understanding reading and dyslexia.
Cambridge, MA:MIT Press;
1999.
p. 33
-152

[76] olson rk,
forsberg h,
wise b,
rack j. Measurement of word recognition, orthographic and phonological skills.
In: lyon gr, editors.
Frames of reference for the assessment of learning disabilities: New views on measurement issues.
Baltimore/London/Toronto/Sydney:Paul H. Brookes;
1994.
p. 243
-275

[77] olson rk,
kliegl r,
davidson b,
foltz g. Individual and developmental differences in reading disability.
In: mackinnon ge, waller tg, editors.
Reading research: Advances in theory and practice.
vol.4.
:Academic Press Inc, CA;
1985.
p. 1
-64

[78] orton md,
samuel t. Reading, writing and speech problems in children. W. W.
New-York:Norton&Co;
1937.

[79] paulesu e,
démonet jf,
fazio f,
mccrory e,
chanoine v. Dyslexia, Cultural diversity and Biological unity.
Science. 2001;
291:2165
-2167

[80] pennington bf,
lefly dl. Early reading development in children at family risk for dyslexia.
Child Development. 2001;
72:816
-833

[81] pennington bf,
lefly d,
boada r. Phonological development and reading outcomes in children at family risk for dyslexia.
In: pennington bf, editors.
Longitudinal studies of children at family risk for dyslexia: Results from four countries.
Albuquerque, NM:Symposium conducted at the meeting of the Society for Research in Child Development;
1999.
p.
-

[82] perfetti ca,
goldman sr,
hogaboam tw. Reading skill and the identification of words in discourse context.
Memory and Cognition. 1979;
4:273
-282

[83] perfetti ca. Reading ability.
New-York:Oxford University Press;
1985.

[84] petersen dk,
elbro c. Pre-school prediction and prevention of dyslexia: A longitudinal study with children of dyslexic parents.
In: nunes t, editors.
Learning to read: An integrated view from research and practice.
Kluwer:Dordrecht;
1999.
p. 133
-154

[85] plaut dc,
mcclelland jl,
seidenberg ms,
patterson ke. Understanding normal and impaired word reading: Computational principles in quasi-regular domain.
Psychological Review. 1996;
103:56
-115

[86] rack jp,
snowling mj,
olson rk. The nonword reading deficit in developmental dyslexia: A review.
Reading Research Quarterly. 1992;
27:29
-53

[87] raduege ta,
schwantes fm. Effects of rapid word recognition training on sentence context effects in children.
Journal of Reading Behavior. 1987;
4:395
-414

[88] rayner k. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research.
Psychological Bulletin. 1998;
3:372
-422

[89] savigny m. Bat-Elem.
Issy-les-Moulineaux:Editions de Psychologie Appliquée;
1974.

[90] scarborough hs. Prediction of reading disability from familial and individual differences.
Journal of Educational Psychology. 1989;
81:101
-108

[91] scarborough hs. Antecedents to reading disability: Preschool language development and literacy experiences of children from dyslexic families.
Reading and Writing. 1991;
3:219
-233

[92] scarborough hs. Predicting the future achievement of second graders with reading disabilities: Contributions of phonemic awareness, verbal memory, rapid serial naming, and IQ.
Annals of Dyslexia. 1998a;
48:115
-136

[93] scarborough hs. Early identification of children at risk for reading disabilities: Phonological awareness and some other promising predictors.
In: shapiro bk, accardo pj, capute aj, editors.
Specific reading disability: A view of the spectrum.
:MD, York Press, Timonium ;
1998b.
p. 75
-119

[94] scarborough hs. Very early language deficits in dyslexic children.
Child Development. 1990;
61:1728
-1743

[95] seymour phk. A cognitive analysis of dyslexia.
London:Routledge and Kegan Paul;
1986.

[96] seymour phk,
porpodas cd. Lexical and non-lexical processing of spelling in dyslexia.
In: frith u, editors.
Cognitive processes in spelling.
London:Academic Press;
1980.
p. 443
-473

[97] shaywitz se,
shaywitz ba. Dyslexia (Specific Reading Disability).
Biological Psychiatry. 2005;
57:1301
-1309

[98] siegel ls,
ryan eb. Development of grammatical sensitivity, phonological, and short-term memory skills in normally achieving and learning disabled children.
Developmental Psychology. 1988;
24:28
-37

[99] snow ce,
barnes ws,
chandler j,
goodman jr,
hemphill l. Unfulfilled expectations: Home and school influences on literacy.
Cambridge, MA:Harvard University Press;
1991.

[100] snowling mj. Phonemics deficits in developmental dyslexia.
Psychological Research. 1981;
43:219
-234

[101] snowling mj. Dyslexia.
Oxford:Blackwell;
2000.

[102] snowling mj,
stackouse j,
rack j. Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis.
Cognitive Neuropsychology. 1986a;
3:309
-339

[103] snowling m,
goulandris n,
bowlby m,
howell p. Segmentation and speech perception in relation to reading skill: a developmental analysis.
J Exp Child Psychol. 1986b;
41:489
-507

[104] snowling mj,
goulandris n,
defty n. A longitudinal study of reading development in dyslexic children.
Journal of Educational Psychology. 1996a;
88:653
-669

[105] snowling mj,
bryant p,
hulme c. Theoretical and methodological pitfalls in making comparisons between developmental and acquired dyslexia: Some comments on A. Castles and M. Coltheart (1993).
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 1996b;
8:443
-451

[106] snowling m,
bishop dv,
stothard se. Is preschool language impairment a risk factor for dyslexia in adolescence?.
J Child Psychol Psychiatry. 2000;
41:587
-600

[107] sprenger-charolles l,
siegel ls. A longitudinal study of the effects of syllabic structure on the development of reading and spelling skills in French.
Applied psycholinguistics. 1997;
18:485
-505

[108] sprenger-charolles l,
cole p,
lacert p,
serniclaes w. On Subtypes of Developmental Dyslexia: Evidence from Processing Time and Accuracy Scores.
Canadian Journal of Experimental Psycholog. 2000;
54:88
-104

[109] sprenger-charolles l,
siegel ls,
bechennec d,
serniclaes w. Development of phonological and orthographic processing in reading aloud, in silent reading, and in spelling: A four-year longitudinal study.
J Experimental Child Psychology. 2003;
84:194
-217

[110] sprenger-charolles l,
colé p,
béchennec d,
kipffer-piquard a. French normative data on reading and related skills: from EVALEC, a new computarized battery of tests.
European Review of Applied Psychology. 2005;
55:157
-186

[111] sprenger-charolles l,
colé p,
serniclaes w. Reading Acquisition and developmental dyslexia.
London:Psychology Press;
2006.

[112] stanovich ke,
nathan rg,
zolman je. The developmental lag hypothesis in reading: Longitudinal and matched reading-level comparisons.
Child Development. 1988;
59:71
-86

[113] stanovich ke,
siegel ls,
gottardo a. Converging evidence for phonological and surface subtypes of reading disability.
Journal of Educational Psychology. 1997;
89:114
-127

[114] stothard se,
snowling mj,
bishop dv,
chipchase bb,
kaplan ca. Language-impaired preschoolers: a follow-up into adolescence.
J Speech Lang Hear Res. 1998;
41:407
-418

[115] stuebing kk,
fletcher jm,
ledoux jm,
lyon gr,
shaywitz se,
shaywitz ba. Validity of IQ-discrepancy classifications of reading disabilities: A meta-analysis.
American Educational Research Journal. 2002;
2:469
-518

[116] swan d,
goswami u. Picture naming deficits in developmental dyslexia: the phonological representations hypothesis.
Brain Lang. 1997a;
56:334
-353

[117] swan d,
goswami u. Phonological awareness deficits in developmental dyslexia and the phonological representations hypothesis.
Journal of Experimental Child Psychology. 1997b;
66:8
-41

[118] szeszulski pa,
manis fr. A comparison of word recognition processes in dyslexic and normal readers at two reading-age levels.
Journal of Experimental Child Psychology. 1987;
3:364
-76

[119] tallal p. Auditory temporal perception, phonics and reading disabilities in children.
Brain and Language. 1980;
9:182
-198

[120] temple cm,
marshall jc. A case study of developmental phonological dyslexia.
British Journal of Psychology. 1983;
74:517
-533

[121] thorndike rl. Reading comprehension education in fifteen countries: An empirical study.
New York:Halsted;
1973.

[122] treiman r,
hirsh-pasek k. Are there qualitative differences in reading behaviour between dyslexics and normal readers?.
Memory and Cognition. 1985;
13:357
-364

[123] van ijzendoorn mh,
bus ag. Meta-analytic confirmation of the non-word reading deficit in developmental dyslexia.
Reading Research Quarterly. 1994;
29:266
-275

[124] vellutino fr. Dyslexia: Theory and research.
Cambridge:Mass, MIT Press;
1979.

[125] vellutino fr,
fletcher jm,
snowling mj,
scanlon dm. Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?.
J Child Psychol Psychiatry. 2004;
45:2
-40

[126] vellutino fr,
scanlon dm,
lyon gr. Differentiating between difficult-to-remediate and readily remediated poor readers: More evidence against the IQ-achievement discrepancy definition of reading disability.
Journal of Learning Disabilities. 2000;
33:223
-238

[127] wagner rk,
torgesen jk,
rashotte ca,
hecht sa,
barker ta. Changing relations between phonological processing abilities and word-level reading as children develop from beginning to skilled readers: A five year longitudinal study.
Developmental Psychology. 1997;
33:468
-479

[128] waters gs,
seidenberg ms,
bruck m. Children’s and adults’ use of spelling sound information in three reading task.
Memory and Cognition. 1984;
12:293
-305

[129] west rf,
stanovich ke. Automatic contextual facilitation in readers of three ages.
Child Development. 1978;
49:717
-727

[130] wimmer h. Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system.
Applied Psycholinguistics. 1993;
14:1
-33

[131] wimmer h. The nonword deficit in developmental dyslexia: Evidence from German children.
Journal of Experimental Child Psychology. 1995;
61:80
-90

[132] wimmer h. The early manifestation of developmental dyslexia: Evidence from German children.
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 1996;
8:171
-188

[133] wimmer h,
mayringer h. Dysfluent reading in the absence of spelling difficulties: A specific disability in regular orthographies.
Journal of Educational Psychology. 2002;
94:272
-277

[134] wolf m,
bowers p. The question of naming speed deficits in developmental reading disabilities: An introduction to the double-deficit hypothesis.
Journal of Educational Psychology. 1999;
19:1
-24

[135] wolf m,
bowers pg,
biddle k. Naming-speed processes, timing, and reading: A conceptual review.
Journal of Learning Disabilities. 2000;
33:387
-407

[136] wolf m,
goldberg o’rourke a,
gidney c,
lovett m,
cirino p,
morris r. The second deficit: An investigation of the independence of phonological and naming-speed deficits in developmental dyslexia.
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 2002;
15:43
-72

[137] woodcock rw. Woodcock Reading Mastery Tests-Revised.
Circle Pines, MN:American Guidance Service;
1987.

[138]world health organization. The international classification of diseases. Classification of mental and behavioural disorders (Vol. 10).
Switzerland:World Health Organization Publications;
1993.

[139] zabell c,
everatt j. Surface and phonological subtypes of adult developmental dyslexia.
Dyslexia. 2002;
8:160
-177

[140] zieger j,
goswami u,
ziegler j,
goswami u. Reading acquisition, developmental dyslexia and skilled reading accross languages: A psycholinguistic grain size theory.
Psychological Bulletin. 2005;
13:3
-29

[141] ziegler jc,
perry c,
ma-wyatt a,
ladner d,
schule-körne d. Developmental dyslexia in different languages: Language-specific or Universal?.
Journal of Experimental Child Psychology. 2003;
86:169
-193

[142] zoccolotti p,
de luca m,
di pace e,
judica a,
orlandi m,
spinelli d. Marker of developmental surface dyslexia in a language (Italian) with high grapheme-phoneme correspondence.
Applied Psycholinguistics. 1999;
20:191
-216

→ Aller vers SYNTHESE
 ; World Health Organization, 1993
; World Health Organization, 1993 ).
).  ).
). ; Woodcock, 1987
; Woodcock, 1987 ). Ces tests, utilisés aussi bien par les cliniciens que par les chercheurs, comportent des épreuves de lecture de mots et de pseudo-mots, qui ne prennent toutefois en compte que la précision de la réponse (pas le temps de réponse), ce qui a pu conduire à sous-estimer les déficits des dyslexiques les plus âgés (Shaywitz et Shaywitz, 2005
). Ces tests, utilisés aussi bien par les cliniciens que par les chercheurs, comportent des épreuves de lecture de mots et de pseudo-mots, qui ne prennent toutefois en compte que la précision de la réponse (pas le temps de réponse), ce qui a pu conduire à sous-estimer les déficits des dyslexiques les plus âgés (Shaywitz et Shaywitz, 2005 ). De telles batteries existent en France, la Belec (Mousty et Leybaert, 1999
). De telles batteries existent en France, la Belec (Mousty et Leybaert, 1999 ), l'Odedys et l'Evalec (Sprenger-Charolles et coll., 2005
), l'Odedys et l'Evalec (Sprenger-Charolles et coll., 2005 ). Seule la dernière présente des données normatives pour le niveau CP qui tiennent compte à la fois de la précision et du temps de latence des réponses correctes.
). Seule la dernière présente des données normatives pour le niveau CP qui tiennent compte à la fois de la précision et du temps de latence des réponses correctes.  ; Coltheart et coll., 2001
; Coltheart et coll., 2001 ), pour identifier les mots, le lecteur peut utiliser une procédure lexicale (ou visuo-orthographique) ou une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), ce qui renvoie, dans la terminologie utilisée dans le domaine de l'enseignement, à la lecture globale de mot, par opposition à son décodage. Dans ce contexte, la question est de savoir s'il y a des troubles des procédures d'identification des mots écrits qui prévalent chez les dyslexiques (c'est-à-dire qui se retrouvent de façon convergente à travers les études et qui caractérisent la majorité des cas) ou si, au contraire, il y a différents types de dyslexie. Cette question a des implications pour la prise en charge des enfants, qui doit s'adapter à la nature du trouble. Dans les parties suivantes, après avoir présenté la première étude dans laquelle la question de l'homogénéité des profils de dyslexie a été évaluée, sont explicités quelques problèmes méthodologiques à la source d'incohérences dans la littérature sur la dyslexie.
), pour identifier les mots, le lecteur peut utiliser une procédure lexicale (ou visuo-orthographique) ou une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), ce qui renvoie, dans la terminologie utilisée dans le domaine de l'enseignement, à la lecture globale de mot, par opposition à son décodage. Dans ce contexte, la question est de savoir s'il y a des troubles des procédures d'identification des mots écrits qui prévalent chez les dyslexiques (c'est-à-dire qui se retrouvent de façon convergente à travers les études et qui caractérisent la majorité des cas) ou si, au contraire, il y a différents types de dyslexie. Cette question a des implications pour la prise en charge des enfants, qui doit s'adapter à la nature du trouble. Dans les parties suivantes, après avoir présenté la première étude dans laquelle la question de l'homogénéité des profils de dyslexie a été évaluée, sont explicités quelques problèmes méthodologiques à la source d'incohérences dans la littérature sur la dyslexie. ) qui a porté sur une centaine d'enfants de 8 à 16 ans. Dans un premier temps, des mots étaient présentés durant une seconde. Ceux qui n'ont alors pas été reconnus ont été représentés pendant 10 secondes. Les items reconnus dans la première condition sont supposés faire partie du vocabulaire « visuel » des enfants et ceux lus dans la seconde, supposés avoir été décodés. La dernière étape de l'étude comportait une épreuve d'écriture portant sur les mots reconnus visuellement et sur ceux décodés. La typologie a été établie sur la base des résultats de cette épreuve. La plupart des dyslexiques (60 %) ont des troubles phonologiques sélectifs. Ces dyslexiques, dits dysphonétiques, n'écrivent correctement que les mots qu'ils connaissent par cœur. Les 10 % de dyslexiques dits dyseidétiques ont des problèmes spécifiques de mémorisation de la forme visuelle des mots : ils écrivent les mots comme ils les prononcent. Un troisième groupe inclut les enfants les plus sévèrement handicapés, qui souffrent à la fois de troubles visuels et phonologiques. D'après cette étude, les troubles phonologiques se retrouvent donc dans la majorité des cas de dyslexie. Cette étude a eu une large influence dans la pratique clinique. Elle est toutefois biaisée par le fait que la classification des dyslexiques était basée sur leurs habiletés d'écriture. Cette approche a été remplacée dès la fin des années 1970 par les travaux issus de la neuropsychologie.
) qui a porté sur une centaine d'enfants de 8 à 16 ans. Dans un premier temps, des mots étaient présentés durant une seconde. Ceux qui n'ont alors pas été reconnus ont été représentés pendant 10 secondes. Les items reconnus dans la première condition sont supposés faire partie du vocabulaire « visuel » des enfants et ceux lus dans la seconde, supposés avoir été décodés. La dernière étape de l'étude comportait une épreuve d'écriture portant sur les mots reconnus visuellement et sur ceux décodés. La typologie a été établie sur la base des résultats de cette épreuve. La plupart des dyslexiques (60 %) ont des troubles phonologiques sélectifs. Ces dyslexiques, dits dysphonétiques, n'écrivent correctement que les mots qu'ils connaissent par cœur. Les 10 % de dyslexiques dits dyseidétiques ont des problèmes spécifiques de mémorisation de la forme visuelle des mots : ils écrivent les mots comme ils les prononcent. Un troisième groupe inclut les enfants les plus sévèrement handicapés, qui souffrent à la fois de troubles visuels et phonologiques. D'après cette étude, les troubles phonologiques se retrouvent donc dans la majorité des cas de dyslexie. Cette étude a eu une large influence dans la pratique clinique. Elle est toutefois biaisée par le fait que la classification des dyslexiques était basée sur leurs habiletés d'écriture. Cette approche a été remplacée dès la fin des années 1970 par les travaux issus de la neuropsychologie.  ) et ceux du second type une dyslexie phonologique (Beauvois et Derouesné, 1979
) et ceux du second type une dyslexie phonologique (Beauvois et Derouesné, 1979 ). Ces doubles dissociations, à la base du modèle à double voie de lecture (Coltheart, 1978
). Ces doubles dissociations, à la base du modèle à double voie de lecture (Coltheart, 1978 ; Coltheart et coll., 1993
; Coltheart et coll., 1993 et 2001
et 2001 ), indiquent qu'il existerait deux procédures fonctionnellement distinctes : une procédure lexicale, s'appuyant sur la forme « globale » des mots et une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), s'appuyant sur les correspondances grapho-phonémiques.
), indiquent qu'il existerait deux procédures fonctionnellement distinctes : une procédure lexicale, s'appuyant sur la forme « globale » des mots et une procédure sublexicale (ou par médiation phonologique), s'appuyant sur les correspondances grapho-phonémiques.  ; Frith, 1985
; Frith, 1985 et 1986
et 1986 ; Harris et Coltheart, 1986
; Harris et Coltheart, 1986 ; Morton, 1989
; Morton, 1989 ). Si on admet que, d'une part, les procédures de lecture se mettent en place progressivement, en suivant une trajectoire développementale spécifique, la maîtrise de la procédure sublexicale (par médiation phonologique) conditionnant la mise en place de la procédure lexicale (voir le chapitre 2) et que, d'autre part, les dyslexiques présentent des déficiences dans les traitements impliquant la phonologie (Ramus, 2003), la procédure sublexicale ne devrait pas se mettre correctement en place chez eux, ni par voie de conséquence, la procédure lexicale. On ne devrait donc pas rencontrer de profils dissociés de type dyslexie phonologique (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure phonologique de lecture) ou dyslexie de surface (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure lexicale de lecture) dans la dyslexie du développement.
). Si on admet que, d'une part, les procédures de lecture se mettent en place progressivement, en suivant une trajectoire développementale spécifique, la maîtrise de la procédure sublexicale (par médiation phonologique) conditionnant la mise en place de la procédure lexicale (voir le chapitre 2) et que, d'autre part, les dyslexiques présentent des déficiences dans les traitements impliquant la phonologie (Ramus, 2003), la procédure sublexicale ne devrait pas se mettre correctement en place chez eux, ni par voie de conséquence, la procédure lexicale. On ne devrait donc pas rencontrer de profils dissociés de type dyslexie phonologique (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure phonologique de lecture) ou dyslexie de surface (caractérisée par un déficit spécifique de la procédure lexicale de lecture) dans la dyslexie du développement.  ), alors que les études de groupes visent à déterminer ce qui caractérise le comportement moyen des dyslexiques, à partir de l'examen d'une large population supposée représentative de ce qu'est la dyslexie.
), alors que les études de groupes visent à déterminer ce qui caractérise le comportement moyen des dyslexiques, à partir de l'examen d'une large population supposée représentative de ce qu'est la dyslexie. ). Dans ce cas, il est illégitime de dire que le déficit observé est prévalent.
). Dans ce cas, il est illégitime de dire que le déficit observé est prévalent.  ) ont été les premiers à avoir mis en relief le caractère crucial d'une comparaison entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture. Ce type de comparaison, à la différence de celles avec des normolecteurs de même âge chronologique, permet en effet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard d'apprentissage. Pour donner une image, on peut se figurer une balance avec deux plateaux et des poids sur chacun d'eux, les poids sur le plateau de gauche et sur celui de droite indiquant respectivement l'efficience des procédures sublexicale et lexicale de lecture. Le poids global de ces deux procédures est identique chez les dyslexiques et les normolecteurs. Si les plateaux s'équilibrent de la même façon chez les dyslexiques et les normolecteurs plus jeunes, les dyslexiques ont un simple retard d'apprentissage. Les plateaux peuvent toutefois ne pas se positionner de façon identique dans les deux populations. Dans ce cas, comme le soulignent Bryant et Impey (1986
) ont été les premiers à avoir mis en relief le caractère crucial d'une comparaison entre dyslexiques et normolecteurs de même niveau de lecture. Ce type de comparaison, à la différence de celles avec des normolecteurs de même âge chronologique, permet en effet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard d'apprentissage. Pour donner une image, on peut se figurer une balance avec deux plateaux et des poids sur chacun d'eux, les poids sur le plateau de gauche et sur celui de droite indiquant respectivement l'efficience des procédures sublexicale et lexicale de lecture. Le poids global de ces deux procédures est identique chez les dyslexiques et les normolecteurs. Si les plateaux s'équilibrent de la même façon chez les dyslexiques et les normolecteurs plus jeunes, les dyslexiques ont un simple retard d'apprentissage. Les plateaux peuvent toutefois ne pas se positionner de façon identique dans les deux populations. Dans ce cas, comme le soulignent Bryant et Impey (1986 ), les dyslexiques présentent un profil atypique, non observé chez des enfants qui ont le même niveau global de lecture qu'eux : leur trajectoire développementale est donc déviante.
), les dyslexiques présentent un profil atypique, non observé chez des enfants qui ont le même niveau global de lecture qu'eux : leur trajectoire développementale est donc déviante. ). Cela permet de comprendre pourquoi, dans les études effectuées avec des dyslexiques anglophones, il n'a le plus souvent été tenu compte que de la précision. En effet, le nombre moyen de réponses correctes est souvent très bas, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues, comme en espagnol ou en allemand, dans lesquelles les bilans de dyslexie se basent sur le temps de traitement. Ce n'est également pas le cas en français bien que le temps de réponse ne soit que rarement pris en compte, ce qui a pu conduire à des erreurs de diagnostic. En effet, il n'est pas possible de dire que les capacités de lecture d'un sujet dyslexique sont préservées quand ce sujet est aussi précis que des normolecteurs mais plus lent.
). Cela permet de comprendre pourquoi, dans les études effectuées avec des dyslexiques anglophones, il n'a le plus souvent été tenu compte que de la précision. En effet, le nombre moyen de réponses correctes est souvent très bas, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues, comme en espagnol ou en allemand, dans lesquelles les bilans de dyslexie se basent sur le temps de traitement. Ce n'est également pas le cas en français bien que le temps de réponse ne soit que rarement pris en compte, ce qui a pu conduire à des erreurs de diagnostic. En effet, il n'est pas possible de dire que les capacités de lecture d'un sujet dyslexique sont préservées quand ce sujet est aussi précis que des normolecteurs mais plus lent. ). Cette hypothèse encore très populaire a été rejetée.
). Cette hypothèse encore très populaire a été rejetée.  ; Vellutino, 1979
; Vellutino, 1979 ), comme les lecteurs débutants (Liberman et coll., 1971
), comme les lecteurs débutants (Liberman et coll., 1971 ; Cossu et coll., 1995
; Cossu et coll., 1995 ; Sprenger-Charolles et Siegel, 1997
; Sprenger-Charolles et Siegel, 1997 ), font autant de confusion entre p et b qu'entre t et d, ce qui suggère, comme le soulignent les auteurs, que les erreurs entre p et b sont plutôt phonologiques que visuelles.
), font autant de confusion entre p et b qu'entre t et d, ce qui suggère, comme le soulignent les auteurs, que les erreurs entre p et b sont plutôt phonologiques que visuelles.  ; Coltheart et coll., 1993
; Coltheart et coll., 1993 et 2001
et 2001 ) et/ou sur les modèles développementaux (Frith, 1985
) et/ou sur les modèles développementaux (Frith, 1985 ; Harris et Coltheart, 1986
; Harris et Coltheart, 1986 ; Seymour, 1986
; Seymour, 1986 ; Morton, 1989
; Morton, 1989 ), l'objectif étant de vérifier si le déficit des dyslexiques concerne plutôt la procédure sublexicale que la procédure lexicale de lecture.
), l'objectif étant de vérifier si le déficit des dyslexiques concerne plutôt la procédure sublexicale que la procédure lexicale de lecture.  ; Waters et coll., 1984
; Waters et coll., 1984 ; Sprenger-Charolles et coll., 1998 et 2003
; Sprenger-Charolles et coll., 1998 et 2003 ).
).  ) et dans la méta-analyse de Van Ijzendoorn et Bus (1994
) et dans la méta-analyse de Van Ijzendoorn et Bus (1994 ).
).  ) ont séparé les études en deux ensembles : celles où les dyslexiques se sont avérés plus faibles que les NLAL et les autres. Le premier ensemble comporte dix études impliquant 428 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Snowling, 1981
) ont séparé les études en deux ensembles : celles où les dyslexiques se sont avérés plus faibles que les NLAL et les autres. Le premier ensemble comporte dix études impliquant 428 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Snowling, 1981 ; Baddeley et coll., 1982
; Baddeley et coll., 1982 ; Siegel et Ryan, 1988
; Siegel et Ryan, 1988 ). Les dyslexiques ont de 5 à 1,3 ans de plus que les NLAL (médiane : 2,5 ans). Les différences pour l'exactitude de la réponse en lecture de pseudo-mots varie de 43 % (Snowling, 1981
). Les dyslexiques ont de 5 à 1,3 ans de plus que les NLAL (médiane : 2,5 ans). Les différences pour l'exactitude de la réponse en lecture de pseudo-mots varie de 43 % (Snowling, 1981 ) à 9 % (Baddeley et coll., 1982
) à 9 % (Baddeley et coll., 1982 ) avec une médiane de 19 %. L'autre ensemble inclut six études impliquant 276 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Beech et Harding, 1984
) avec une médiane de 19 %. L'autre ensemble inclut six études impliquant 276 dyslexiques et un nombre équivalent de NLAL (Beech et Harding, 1984 ; Treiman et Hirsh-Pasek, 1985
; Treiman et Hirsh-Pasek, 1985 ; Szeszulski et Manis, 1987
; Szeszulski et Manis, 1987 ). Les différences d'âge entre groupes varient entre 4 et 1 ans (médiane : 3) et celles pour les scores en lecture de pseudo-mots entre 15 et 0 % (médiane : 4 %), les deux scores extrêmes ayant été relevés chez les enfants qui avaient le niveau de lecture le plus bas et le plus élevé dans l'étude de Szeszulski et Manis (1987
). Les différences d'âge entre groupes varient entre 4 et 1 ans (médiane : 3) et celles pour les scores en lecture de pseudo-mots entre 15 et 0 % (médiane : 4 %), les deux scores extrêmes ayant été relevés chez les enfants qui avaient le niveau de lecture le plus bas et le plus élevé dans l'étude de Szeszulski et Manis (1987 ). Le résultat nul observé dans le dernier cas peut donc provenir d'effets plafonds pour la précision de la réponse. Rack et coll. (1992
). Le résultat nul observé dans le dernier cas peut donc provenir d'effets plafonds pour la précision de la réponse. Rack et coll. (1992 ) postulent que les différences entre ces deux ensembles peuvent être dues soit aux tests employés pour apparier les groupes, soit au type de pseudo-mots utilisé. En effet, les différences non significatives émergent, d'une part, dans les études dans lesquelles les dyslexiques ont été appariés aux NLAL sur la base d'un test impliquant la lecture de mots en contexte, ou celle de mots simples. D'autre part, elles se retrouvent surtout dans les études qui ont utilisé des pseudo-mots simples (courts ou peu complexes).
) postulent que les différences entre ces deux ensembles peuvent être dues soit aux tests employés pour apparier les groupes, soit au type de pseudo-mots utilisé. En effet, les différences non significatives émergent, d'une part, dans les études dans lesquelles les dyslexiques ont été appariés aux NLAL sur la base d'un test impliquant la lecture de mots en contexte, ou celle de mots simples. D'autre part, elles se retrouvent surtout dans les études qui ont utilisé des pseudo-mots simples (courts ou peu complexes). ) dans une méta-analyse des études prises en compte par Rack et coll. (1992
) dans une méta-analyse des études prises en compte par Rack et coll. (1992 ). La population entière comporte 1 183 sujets, la moitié étant dyslexiques. Van Ijzendoorn et Bus ont calculé la taille de la différence entre les scores des dyslexiques et ceux des NLAL en nombre d'écarts-type. Pour estimer la force d'un effet, les valeurs proposées par Cohen (1988
). La population entière comporte 1 183 sujets, la moitié étant dyslexiques. Van Ijzendoorn et Bus ont calculé la taille de la différence entre les scores des dyslexiques et ceux des NLAL en nombre d'écarts-type. Pour estimer la force d'un effet, les valeurs proposées par Cohen (1988 ) ont été utilisées : un effet de 0,20 est considéré faible, à partir de 0,50, il est dit modéré, et à partir de 0,80, fort. Pour la totalité des études passées en revue par Van Ijzendoorn et Bus, la taille de l'effet varie de 0 à 1,03 (moyenne : 0,48). La taille de l'effet est de 0,66 pour les études dans lesquelles la différence entre dyslexiques et NLAL était significative. Toutefois, la combinaison des scores des études qui, individuellement, n'avaient pas permis de mettre en relief un déficit des dyslexiques en lecture de pseudo-mots montre que ce déficit est présent : bien qu'étant plus faible que pour les autres études (0,27), la différence entre dyslexiques et NLAL est significative (p < 0,005).
) ont été utilisées : un effet de 0,20 est considéré faible, à partir de 0,50, il est dit modéré, et à partir de 0,80, fort. Pour la totalité des études passées en revue par Van Ijzendoorn et Bus, la taille de l'effet varie de 0 à 1,03 (moyenne : 0,48). La taille de l'effet est de 0,66 pour les études dans lesquelles la différence entre dyslexiques et NLAL était significative. Toutefois, la combinaison des scores des études qui, individuellement, n'avaient pas permis de mettre en relief un déficit des dyslexiques en lecture de pseudo-mots montre que ce déficit est présent : bien qu'étant plus faible que pour les autres études (0,27), la différence entre dyslexiques et NLAL est significative (p < 0,005).  ), ont pu biaiser les résultats. En fait, le type de pseudo-mots (longueur ou degré de similitude par rapport à des mots) n'a pas d'incidence sur la taille d'effet. En revanche, la nature du test utilisé pour apparier les groupes influe sur la taille de l'effet, qui est plus faible dans les études qui ont utilisé un test de lecture de mots en contexte ou facile à lire (0,23) que dans celles fondées sur la lecture de mots complexes (0,62).
), ont pu biaiser les résultats. En fait, le type de pseudo-mots (longueur ou degré de similitude par rapport à des mots) n'a pas d'incidence sur la taille d'effet. En revanche, la nature du test utilisé pour apparier les groupes influe sur la taille de l'effet, qui est plus faible dans les études qui ont utilisé un test de lecture de mots en contexte ou facile à lire (0,23) que dans celles fondées sur la lecture de mots complexes (0,62).  ), à savoir que le déficit systématiquement relevé en lecture de pseudo-mots chez les dyslexiques comparativement à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture, est un argument fort à l'appui de l'hypothèse qu'un déficit phonologique est au cœur de la dyslexie, ce déficit traduisant un développement déviant de leurs compétences phonologiques de lecture. Elle signale aussi les biais introduits par un appariement fait sur la base d'un test non adéquat.
), à savoir que le déficit systématiquement relevé en lecture de pseudo-mots chez les dyslexiques comparativement à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture, est un argument fort à l'appui de l'hypothèse qu'un déficit phonologique est au cœur de la dyslexie, ce déficit traduisant un développement déviant de leurs compétences phonologiques de lecture. Elle signale aussi les biais introduits par un appariement fait sur la base d'un test non adéquat. ). En dépit de la validité apparente de cette prédiction, un effet de régularité de même amplitude a été relevé entre dyslexiques et normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture (NLAL) dans les études anglophones (Olson et coll., 1985
). En dépit de la validité apparente de cette prédiction, un effet de régularité de même amplitude a été relevé entre dyslexiques et normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture (NLAL) dans les études anglophones (Olson et coll., 1985 ; Bruck, 1988
; Bruck, 1988 ; Stanovich et coll., 1988
; Stanovich et coll., 1988 ; Snowling et coll., 1996a
; Snowling et coll., 1996a ). Metsala et coll. (1998
). Metsala et coll. (1998 ) ont effectué une méta-analyse de 17 études (en tout, plus de 1 000 participants : 536 dyslexiques et 580 NLAL).
) ont effectué une méta-analyse de 17 études (en tout, plus de 1 000 participants : 536 dyslexiques et 580 NLAL).  ), la taille de l'effet de la régularité a été évaluée en fonction de l'écart-type entre les groupes, pondéré cette fois par l'effectif. La taille de cet effet est globalement de 0,63 (non pondéré : 0,74), et, contrairement aux prédictions, elle est de même amplitude pour les dyslexiques (0,58 ; non pondéré : 0,64) et les NLAL (0,68 ; non pondéré : 0,85). Y compris dans les huit études qui avaient montré une infériorité de cet effet chez les dyslexiques (Frith et Snowling, 1983
), la taille de l'effet de la régularité a été évaluée en fonction de l'écart-type entre les groupes, pondéré cette fois par l'effectif. La taille de cet effet est globalement de 0,63 (non pondéré : 0,74), et, contrairement aux prédictions, elle est de même amplitude pour les dyslexiques (0,58 ; non pondéré : 0,64) et les NLAL (0,68 ; non pondéré : 0,85). Y compris dans les huit études qui avaient montré une infériorité de cet effet chez les dyslexiques (Frith et Snowling, 1983 ; Szeszulski et Manis, 1987
; Szeszulski et Manis, 1987 ; Murphy et Pollatsek, 1994
; Murphy et Pollatsek, 1994 ), la taille de l'effet n'est pas pour eux différente de celle observée pour les NLAL. En outre, la fréquence des mots a un impact sur l'importance de l'effet, son amplitude diminuant en fonction de la fréquence des mots. Cependant, y compris dans les études qui ont employé des mots de haute fréquence, la taille moyenne de l'effet est au-dessus de zéro, en conformité avec les résultats rapportés par Jared (1997
), la taille de l'effet n'est pas pour eux différente de celle observée pour les NLAL. En outre, la fréquence des mots a un impact sur l'importance de l'effet, son amplitude diminuant en fonction de la fréquence des mots. Cependant, y compris dans les études qui ont employé des mots de haute fréquence, la taille moyenne de l'effet est au-dessus de zéro, en conformité avec les résultats rapportés par Jared (1997 ) montrant que la régularité affecte même la lecture de mots de haute fréquence.
) montrant que la régularité affecte même la lecture de mots de haute fréquence. ). Au début de l'étude, les scores des dyslexiques en lecture ne différaient pas de ceux des NLAL. Toutefois, ils deviennent inférieurs à ceux des NLAL au temps 2 (soit deux ans après la première évaluation), particulièrement pour la lecture de pseudo-mots (15 % d'amélioration contre 42 % pour les NLAL, soit une différence de 27 %). La différence de progression entre sessions pour ces deux groupes est moins marquée pour les mots réguliers (16 %) et les mots irréguliers (12 %). Ainsi, même lorsqu'un déficit en lecture de pseudo-mots n'a pas été observé chez des dyslexiques comparativement à des NLAL, les différences de progression dans le temps montrent que les dyslexiques ont des difficultés majeures quand ils doivent utiliser les correspondances grapho-phonémiques sans pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances lexicales. En revanche, l'effet de la régularité, significatif pour les deux groupes et pour les deux sessions de test, ne permettait pas de différencier les dyslexiques des NLAL, ce qui est conforme aux résultats rapportés par Metsala et coll. (1998
). Au début de l'étude, les scores des dyslexiques en lecture ne différaient pas de ceux des NLAL. Toutefois, ils deviennent inférieurs à ceux des NLAL au temps 2 (soit deux ans après la première évaluation), particulièrement pour la lecture de pseudo-mots (15 % d'amélioration contre 42 % pour les NLAL, soit une différence de 27 %). La différence de progression entre sessions pour ces deux groupes est moins marquée pour les mots réguliers (16 %) et les mots irréguliers (12 %). Ainsi, même lorsqu'un déficit en lecture de pseudo-mots n'a pas été observé chez des dyslexiques comparativement à des NLAL, les différences de progression dans le temps montrent que les dyslexiques ont des difficultés majeures quand ils doivent utiliser les correspondances grapho-phonémiques sans pouvoir s'appuyer sur leurs connaissances lexicales. En revanche, l'effet de la régularité, significatif pour les deux groupes et pour les deux sessions de test, ne permettait pas de différencier les dyslexiques des NLAL, ce qui est conforme aux résultats rapportés par Metsala et coll. (1998 ).
).  ) qui a impliqué des dyslexiques dont le niveau de lecture était inférieur de deux ans à leur âge chronologique. Ces enfants dyslexiques (QI normal, absence de déficit linguistique ou sensori-moteur) ont été appariés à des NLAL. Les deux groupes ont eu à lire des pseudo-mots ainsi que des mots réguliers et irréguliers. L'exactitude et la latence de la réponse vocale ont été mesurées. Comme relevé dans les études anglophones (Metsala et coll., 1998
) qui a impliqué des dyslexiques dont le niveau de lecture était inférieur de deux ans à leur âge chronologique. Ces enfants dyslexiques (QI normal, absence de déficit linguistique ou sensori-moteur) ont été appariés à des NLAL. Les deux groupes ont eu à lire des pseudo-mots ainsi que des mots réguliers et irréguliers. L'exactitude et la latence de la réponse vocale ont été mesurées. Comme relevé dans les études anglophones (Metsala et coll., 1998 ), l'effet de la régularité est significatif et également fort dans les deux groupes. En revanche, et toujours comme en anglais (Rack et coll., 1992
), l'effet de la régularité est significatif et également fort dans les deux groupes. En revanche, et toujours comme en anglais (Rack et coll., 1992 ; Van Ijzendoorn et Bus, 1994
; Van Ijzendoorn et Bus, 1994 ), l'effet de la lexicalité est plus fort chez les dyslexiques que chez les NLAL.
), l'effet de la lexicalité est plus fort chez les dyslexiques que chez les NLAL.  ; Grainger et coll., 2003
; Grainger et coll., 2003 ). Dans l'étude de Bosse et Valdois (2003
). Dans l'étude de Bosse et Valdois (2003 ), bien que les performances en lecture de deux groupes de 10 dyslexiques (âge entre 9 et plus de 15 ans), l'un présentant un déficit visuo-attentionnel, l'autre un déficit phonologique, soient similaires à celles de normolecteurs de même niveau de lecture, quel que soit le test (lecture de mots réguliers ou irréguliers et lecture de pseudo-mots) et la mesure (précision ou rapidité), l'examen des données montre que les dyslexiques ont systématiquement des scores inférieurs à ceux des normolecteurs de même niveau de lecture, en lecture de pseudo-mots. Ainsi, le groupe des dyslexiques phonologiques est moins précis que le groupe témoin plus jeunes (28,4 réponses correctes contre 30,2 ; écarts-types : 6,4 et 3,9) et plus lent (2,3 secondes contre 1,7 ; écarts-types : 0,8 et 0,6). Les mêmes tendances ont été relevées chez les 10 dyslexiques souffrant d'un déficit visuo-attentionnel, chez lesquels les différences sont surtout marquées pour le temps de traitement (plus d'une seconde de différence avec les normolecteurs de même niveau de lecture : 3,3 secondes contre 2,2 ; écarts-types : 1,7 et 0,4), pas pour la précision de la réponse (28,8 réponses correctes contre 29,1 ; écarts-types : 5,9 et 3,8).
), bien que les performances en lecture de deux groupes de 10 dyslexiques (âge entre 9 et plus de 15 ans), l'un présentant un déficit visuo-attentionnel, l'autre un déficit phonologique, soient similaires à celles de normolecteurs de même niveau de lecture, quel que soit le test (lecture de mots réguliers ou irréguliers et lecture de pseudo-mots) et la mesure (précision ou rapidité), l'examen des données montre que les dyslexiques ont systématiquement des scores inférieurs à ceux des normolecteurs de même niveau de lecture, en lecture de pseudo-mots. Ainsi, le groupe des dyslexiques phonologiques est moins précis que le groupe témoin plus jeunes (28,4 réponses correctes contre 30,2 ; écarts-types : 6,4 et 3,9) et plus lent (2,3 secondes contre 1,7 ; écarts-types : 0,8 et 0,6). Les mêmes tendances ont été relevées chez les 10 dyslexiques souffrant d'un déficit visuo-attentionnel, chez lesquels les différences sont surtout marquées pour le temps de traitement (plus d'une seconde de différence avec les normolecteurs de même niveau de lecture : 3,3 secondes contre 2,2 ; écarts-types : 1,7 et 0,4), pas pour la précision de la réponse (28,8 réponses correctes contre 29,1 ; écarts-types : 5,9 et 3,8). ). Elle a inclus plus de 1 500 enfants de 11 ans, environ 1 000 anglophones et 500 italophones. Le niveau de lecture a été évalué à l'aide des tests de compréhension : 50 questions à choix multiple portant sur 8 textes (International Evaluation of Educational Achievement, Thorndike, 1973
). Elle a inclus plus de 1 500 enfants de 11 ans, environ 1 000 anglophones et 500 italophones. Le niveau de lecture a été évalué à l'aide des tests de compréhension : 50 questions à choix multiple portant sur 8 textes (International Evaluation of Educational Achievement, Thorndike, 1973 ). Les enfants ayant un QI supérieur ou égal à 85 et un score de compréhension en lecture avec un écart-type en dessous de leur QI ont été dits dyslexiques. Sur cette base, la dyslexie paraît sensiblement plus prévalente aux États-Unis (7,3 %) qu'en Italie (3,6 %). Les capacités de décodage ont été également évaluées. En raison des différences entre les tests anglais et italiens, il n'a pas été possible de comparer les résultats des deux groupes nationaux. Les scores de 59 % des dyslexiques anglophones sont à au moins un écart-type en dessous des normes nationales en lecture de pseudo-mots, contre seulement ceux de 25 % des dyslexiques italophones. Les déficits des dyslexiques en lecture de pseudo-mots ont toutefois pu être sous-estimés, seule l'exactitude de la réponse ayant été prise en compte. De plus, comme le soulignent les auteurs, les différences entre dyslexiques et normolecteurs se retrouvent principalement dans des tests impliquant le traitement du langage. En particulier, les capacités verbales (entre autres, capacités de dénomination, de répétition de phrases et d'analyse phonémique) permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs, mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. Ainsi, bien que les déficits des dyslexiques anglophones semblent plus graves que ceux des dyslexiques italophones, les similitudes entre les deux groupes sont plus fortes que les différences. Toutefois, comme le soulignent encore les auteurs, l'irrégularité de l'orthographe de l'anglais pourrait conduire les anglophones à s'appuyer plus que les italophones sur des procédures « visuelles » (ou lexicales) de lecture.
). Les enfants ayant un QI supérieur ou égal à 85 et un score de compréhension en lecture avec un écart-type en dessous de leur QI ont été dits dyslexiques. Sur cette base, la dyslexie paraît sensiblement plus prévalente aux États-Unis (7,3 %) qu'en Italie (3,6 %). Les capacités de décodage ont été également évaluées. En raison des différences entre les tests anglais et italiens, il n'a pas été possible de comparer les résultats des deux groupes nationaux. Les scores de 59 % des dyslexiques anglophones sont à au moins un écart-type en dessous des normes nationales en lecture de pseudo-mots, contre seulement ceux de 25 % des dyslexiques italophones. Les déficits des dyslexiques en lecture de pseudo-mots ont toutefois pu être sous-estimés, seule l'exactitude de la réponse ayant été prise en compte. De plus, comme le soulignent les auteurs, les différences entre dyslexiques et normolecteurs se retrouvent principalement dans des tests impliquant le traitement du langage. En particulier, les capacités verbales (entre autres, capacités de dénomination, de répétition de phrases et d'analyse phonémique) permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs, mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. Ainsi, bien que les déficits des dyslexiques anglophones semblent plus graves que ceux des dyslexiques italophones, les similitudes entre les deux groupes sont plus fortes que les différences. Toutefois, comme le soulignent encore les auteurs, l'irrégularité de l'orthographe de l'anglais pourrait conduire les anglophones à s'appuyer plus que les italophones sur des procédures « visuelles » (ou lexicales) de lecture.  ) qui ont examiné les capacités de lecture de dyslexiques anglophones et germanophones de 11-12 ans qui avaient un retard en lecture d'environ 3-4 ans. Chaque groupe a été comparé à un groupe de normolecteurs plus jeunes (8 ans) mais de même âge lexique (NLAL). Des mots proches ont été utilisés dans les deux langues (« boat-boot »). Des pseudo-mots ont été créés en changeant les débuts des mots (« brind » pour « blind »). La longueur des items variait de 1 à 3 syllabes. Les scores des dyslexiques germanophones sont meilleurs que ceux des anglophones, même quand on compare la lecture des items les plus difficiles (pseudo-mots de 3 syllabes) à celle des items les plus faciles (mots de 1 syllabe). L'augmentation des erreurs en fonction de la longueur des items est plus importante pour les dyslexiques anglophones que pour les germanophones, surtout pour les pseudo-mots : 70 % d'erreurs sur les pseudo-mots de 3 syllabes pour les anglais contre 20 % pour les allemands. De plus, les différences entre les deux groupes de dyslexiques concernent surtout la lecture des voyelles (324 prononciations incorrectes de la première voyelle d'un mot chez les dyslexiques anglophones contre 20 chez les germanophones), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'en anglais – mais pas en allemand – les correspondances graphème-phonème pour les voyelles sont très inconsistantes. Enfin, comparativement à leurs pairs NLAL, les dyslexiques, quelle que soit leur langue, font plus d'erreurs sur les pseudo-mots. Ces résultats reflètent l'impact de la consistance de l'orthographe sur les performances en lecture des dyslexiques. Ils indiquent également que, quel que soit le degré d'opacité de l'orthographe, les déficits des dyslexiques sont principalement relevés en lecture de pseudo-mots, y compris par rapport à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture.
) qui ont examiné les capacités de lecture de dyslexiques anglophones et germanophones de 11-12 ans qui avaient un retard en lecture d'environ 3-4 ans. Chaque groupe a été comparé à un groupe de normolecteurs plus jeunes (8 ans) mais de même âge lexique (NLAL). Des mots proches ont été utilisés dans les deux langues (« boat-boot »). Des pseudo-mots ont été créés en changeant les débuts des mots (« brind » pour « blind »). La longueur des items variait de 1 à 3 syllabes. Les scores des dyslexiques germanophones sont meilleurs que ceux des anglophones, même quand on compare la lecture des items les plus difficiles (pseudo-mots de 3 syllabes) à celle des items les plus faciles (mots de 1 syllabe). L'augmentation des erreurs en fonction de la longueur des items est plus importante pour les dyslexiques anglophones que pour les germanophones, surtout pour les pseudo-mots : 70 % d'erreurs sur les pseudo-mots de 3 syllabes pour les anglais contre 20 % pour les allemands. De plus, les différences entre les deux groupes de dyslexiques concernent surtout la lecture des voyelles (324 prononciations incorrectes de la première voyelle d'un mot chez les dyslexiques anglophones contre 20 chez les germanophones), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'en anglais – mais pas en allemand – les correspondances graphème-phonème pour les voyelles sont très inconsistantes. Enfin, comparativement à leurs pairs NLAL, les dyslexiques, quelle que soit leur langue, font plus d'erreurs sur les pseudo-mots. Ces résultats reflètent l'impact de la consistance de l'orthographe sur les performances en lecture des dyslexiques. Ils indiquent également que, quel que soit le degré d'opacité de l'orthographe, les déficits des dyslexiques sont principalement relevés en lecture de pseudo-mots, y compris par rapport à des enfants plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture.  ) moins sévèrement atteints (la différence avec les NLAL est d'un peu plus de 2 ans contre 34 ans dans l'étude de Landerl et coll., 1997
) moins sévèrement atteints (la différence avec les NLAL est d'un peu plus de 2 ans contre 34 ans dans l'étude de Landerl et coll., 1997 ). Ces enfants ont eu à lire des items simples (mots et pseudo-mots d'une syllabe). La précision de la réponse et le temps de latence ont été pris en compte. Une nouvelle fois, un déficit des dyslexiques par rapport aux NLAL est relevé en lecture de pseudo-mots, mais seulement sur le temps de réponse, ce déficit étant de même amplitude dans les deux langues. Ces résultats suggèrent que, tout au moins quand les pseudo-mots ne sont pas trop difficiles et quand le retard en lecture des dyslexiques n'est pas trop sévère, même les dyslexiques anglais peuvent utiliser les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit se manifestant seulement sur le temps qu'il leur faut pour réaliser la tâche.
). Ces enfants ont eu à lire des items simples (mots et pseudo-mots d'une syllabe). La précision de la réponse et le temps de latence ont été pris en compte. Une nouvelle fois, un déficit des dyslexiques par rapport aux NLAL est relevé en lecture de pseudo-mots, mais seulement sur le temps de réponse, ce déficit étant de même amplitude dans les deux langues. Ces résultats suggèrent que, tout au moins quand les pseudo-mots ne sont pas trop difficiles et quand le retard en lecture des dyslexiques n'est pas trop sévère, même les dyslexiques anglais peuvent utiliser les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit se manifestant seulement sur le temps qu'il leur faut pour réaliser la tâche.  ). Le temps de latence de la réponse vocale a été évalué pour des mots et des pseudo-mots. Afin de permettre une comparaison avec l'italien, uniquement des mots réguliers ont été utilisés en français et en anglais. Ces items étaient en plus très fréquents. Des pseudo-mots ont été créés à partir des mots, en changeant les consonnes internes. Quand les tailles relatives des effets (z-scores) ont été comparées, le déficit en lecture des dyslexiques anglais n'est pas plus marqué que celui des dyslexiques français ou italiens, en dépit de la plus grande inconsistance de l'orthographe de l'anglais. Ce n'est pas le même tableau qui ressort des scores bruts, comme le montre la figure 9.1
). Le temps de latence de la réponse vocale a été évalué pour des mots et des pseudo-mots. Afin de permettre une comparaison avec l'italien, uniquement des mots réguliers ont été utilisés en français et en anglais. Ces items étaient en plus très fréquents. Des pseudo-mots ont été créés à partir des mots, en changeant les consonnes internes. Quand les tailles relatives des effets (z-scores) ont été comparées, le déficit en lecture des dyslexiques anglais n'est pas plus marqué que celui des dyslexiques français ou italiens, en dépit de la plus grande inconsistance de l'orthographe de l'anglais. Ce n'est pas le même tableau qui ressort des scores bruts, comme le montre la figure 9.1 : plus l'orthographe est opaque, plus sévère est le déficit des dyslexiques. Le plus surprenant est que les performances des dyslexiques italiens se situent entre celles des normolecteurs anglais et français. On peut en conclure que la dyslexie est simplement la manifestation d'une difficulté linguistique spécifique, s'expliquant par l'opacité des relations grapho-phonémiques. Toutefois, un examen approfondi de cette figure permet de relever que, dans chaque groupe linguistique, l'écart entre les performances des dyslexiques et celles des normolecteurs est important. Surtout, et quel que soit le degré d'opacité des relations grapho-phonémiques, le déficit le plus notable se retrouve en lecture de pseudo-mots. En plus des investigations comportementales, des données de neuro-imagerie ont permis de relever un dysfonctionnement commun dans les trois groupes de dyslexiques comparativement aux normolecteurs, ce qui signale que le déficit de lecture des dyslexiques, qui concerne principalement la procédure phonologique de lecture, aurait une origine neurale commune.
: plus l'orthographe est opaque, plus sévère est le déficit des dyslexiques. Le plus surprenant est que les performances des dyslexiques italiens se situent entre celles des normolecteurs anglais et français. On peut en conclure que la dyslexie est simplement la manifestation d'une difficulté linguistique spécifique, s'expliquant par l'opacité des relations grapho-phonémiques. Toutefois, un examen approfondi de cette figure permet de relever que, dans chaque groupe linguistique, l'écart entre les performances des dyslexiques et celles des normolecteurs est important. Surtout, et quel que soit le degré d'opacité des relations grapho-phonémiques, le déficit le plus notable se retrouve en lecture de pseudo-mots. En plus des investigations comportementales, des données de neuro-imagerie ont permis de relever un dysfonctionnement commun dans les trois groupes de dyslexiques comparativement aux normolecteurs, ce qui signale que le déficit de lecture des dyslexiques, qui concerne principalement la procédure phonologique de lecture, aurait une origine neurale commune.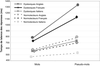
 )
) ; en allemand : Wimmer, 1993
; en allemand : Wimmer, 1993 ; Wimmer, 1995
; Wimmer, 1995 ; en français : Casalis, 1995
; en français : Casalis, 1995 et 2003
et 2003 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ; Grainger et coll., 2003
; Grainger et coll., 2003 ).
).  ; Hutzler et Wimmer, 2004
; Hutzler et Wimmer, 2004 ) et en italien (Zoccolotti et coll., 1999
) et en italien (Zoccolotti et coll., 1999 ; Judica et coll., 2002
; Judica et coll., 2002 ).
).  ) a pris en compte deux groupes de germanophones souffrant de dissociations entre leurs capacités de lecture et d'écriture. La logique qui sous-tend cette étude est que l'allemand se caractérise par une plus forte consistance des relations grapho-phonémiques (utilisées pour lire) que des relations phono-graphémiques (utilisées pour écrire). Il faut donc avoir des représentations orthographiques bien spécifiées pour écrire correctement les mots, alors qu'il suffit d'avoir une bonne maîtrise des relations grapho-phonémiques pour bien les lire. Le niveau de lecture a été évalué par la lecture d'une histoire courte et de deux listes de mots. Un score composite de fluence, exprimé en nombre de syllabes lues par minute, a été calculé sur la base des résultats aux trois tests de lecture. Les mots choisis pour le test d'écriture ne pouvaient pas être correctement orthographiés en utilisant les correspondances phonème-graphème. Les enfants ont eu aussi à lire des pseudo-mots, la précision et la rapidité de la réponse ont été prises en compte. Trois ans auparavant (1re année de primaire), leurs capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que la rapidité de dénomination de mots fréquents, avaient été évaluées.
) a pris en compte deux groupes de germanophones souffrant de dissociations entre leurs capacités de lecture et d'écriture. La logique qui sous-tend cette étude est que l'allemand se caractérise par une plus forte consistance des relations grapho-phonémiques (utilisées pour lire) que des relations phono-graphémiques (utilisées pour écrire). Il faut donc avoir des représentations orthographiques bien spécifiées pour écrire correctement les mots, alors qu'il suffit d'avoir une bonne maîtrise des relations grapho-phonémiques pour bien les lire. Le niveau de lecture a été évalué par la lecture d'une histoire courte et de deux listes de mots. Un score composite de fluence, exprimé en nombre de syllabes lues par minute, a été calculé sur la base des résultats aux trois tests de lecture. Les mots choisis pour le test d'écriture ne pouvaient pas être correctement orthographiés en utilisant les correspondances phonème-graphème. Les enfants ont eu aussi à lire des pseudo-mots, la précision et la rapidité de la réponse ont été prises en compte. Trois ans auparavant (1re année de primaire), leurs capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que la rapidité de dénomination de mots fréquents, avaient été évaluées.  ; De Luca et coll., 2002
; De Luca et coll., 2002 ; Judica et coll., 2002
; Judica et coll., 2002 ; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004
; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004 ; Hawelka et Wimmer, 2005
; Hawelka et Wimmer, 2005 ). Comme Rayner l'expliquait (1998
). Comme Rayner l'expliquait (1998 ), il n'est pas possible d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans toutes les études ci-dessus citées, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique, à la différence de celles qui ont évalué les déficits phonologiques en lecture (excepté Lindgren et coll., 1985
), il n'est pas possible d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans toutes les études ci-dessus citées, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique, à la différence de celles qui ont évalué les déficits phonologiques en lecture (excepté Lindgren et coll., 1985 ; Paulesu et coll., 2001
; Paulesu et coll., 2001 ). De plus, certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. Ainsi, comme le soulignent Hutzler et Wimmer (2004
). De plus, certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. Ainsi, comme le soulignent Hutzler et Wimmer (2004 ), l'opacité de l'orthographe semble avoir une incidence sur la durée moyenne de fixation, qui est plus courte chez les dyslexiques italiens que chez les germanophones. Par exemple, lors de la lecture d'un passage, cette durée est de 290 ms chez des dyslexiques italiens de 12 ans (56 ms de plus que chez les normolecteurs ; De Luca et coll., 1999
), l'opacité de l'orthographe semble avoir une incidence sur la durée moyenne de fixation, qui est plus courte chez les dyslexiques italiens que chez les germanophones. Par exemple, lors de la lecture d'un passage, cette durée est de 290 ms chez des dyslexiques italiens de 12 ans (56 ms de plus que chez les normolecteurs ; De Luca et coll., 1999 ). Dans une tâche identique, la durée moyenne des fixations est de 360 ms pour des dyslexiques allemands plus âgés (soit plus de 175 ms que chez les normolecteurs ; Hutzler et Wimmer, 2004
). Dans une tâche identique, la durée moyenne des fixations est de 360 ms pour des dyslexiques allemands plus âgés (soit plus de 175 ms que chez les normolecteurs ; Hutzler et Wimmer, 2004 ). Enfin, les différences les plus notables entre dyslexiques italiens et allemands sont encore trouvées en lecture de pseudo-mots.
). Enfin, les différences les plus notables entre dyslexiques italiens et allemands sont encore trouvées en lecture de pseudo-mots. ), les résultats de ces études ne permettent pas de corroborer l'hypothèse que les dyslexiques non-anglophones auraient un profil de type surface, ce d'autant plus que le patron atypique des mouvements oculaires relevé chez eux comparativement aux normolecteurs (nombre plus élevé de fixations et durée prolongée de ces fixations) a été non seulement trouvé en lecture de mots, comme attendu chez les dyslexiques de surface, mais aussi, et de façon encore plus marquée, en lecture de pseudo-mots, comme attendu chez les dyslexiques phonologiques. De plus, des déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (en particulier : répétition de pseudo-mots, détection de rimes et dénomination rapide) ont été relevés avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs de l'étude Hawelka et Wimmer (2005
), les résultats de ces études ne permettent pas de corroborer l'hypothèse que les dyslexiques non-anglophones auraient un profil de type surface, ce d'autant plus que le patron atypique des mouvements oculaires relevé chez eux comparativement aux normolecteurs (nombre plus élevé de fixations et durée prolongée de ces fixations) a été non seulement trouvé en lecture de mots, comme attendu chez les dyslexiques de surface, mais aussi, et de façon encore plus marquée, en lecture de pseudo-mots, comme attendu chez les dyslexiques phonologiques. De plus, des déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (en particulier : répétition de pseudo-mots, détection de rimes et dénomination rapide) ont été relevés avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs de l'étude Hawelka et Wimmer (2005 ).
). ), Van Ijzendoorn et Bus (1994
), Van Ijzendoorn et Bus (1994 ), et Metsala et coll. (1998
), et Metsala et coll. (1998 ), et que, dans les autres études examinées (Casalis, 1995
), et que, dans les autres études examinées (Casalis, 1995 ; Snowling et coll., 1996a
; Snowling et coll., 1996a ), les effets de lexicalité et de régularité ont été évalués avec les mêmes enfants, ces résultats ne peuvent pas être attribués à des différences de population. Comme le soulignent Metsala et coll. (1998
), les effets de lexicalité et de régularité ont été évalués avec les mêmes enfants, ces résultats ne peuvent pas être attribués à des différences de population. Comme le soulignent Metsala et coll. (1998 ) les résultats des simulations effectuées avec le réseau connexionniste de Seidenberg et McClelland (1989) peuvent expliquer pourquoi les dyslexiques ont des difficultés spécifiques en lecture de pseudo-mots. En effet, ces simulations, qui ont permis de reproduire l'effet classique de la régularité, amplifient celui de la lexicalité : les performances du réseau en lecture de pseudo-mots étant plus faibles que celles de lecteurs experts (Besner et coll., 1990). L'échec de ce réseau pour la lecture de pseudomots a été attribué à la nature des codes utilisés pour mettre en correspondance les unités sublexicales écrites avec les unités sublexicales orales, à savoir des triplets de lettres. Comme suggéré par des recherches ultérieures, il est possible d'améliorer les performances de ce réseau en utilisant un codage plus approprié entre les unités d'entrée et de sortie, en l'occurrence, les correspondances graphème-phonème (Plaut et coll., 1996
) les résultats des simulations effectuées avec le réseau connexionniste de Seidenberg et McClelland (1989) peuvent expliquer pourquoi les dyslexiques ont des difficultés spécifiques en lecture de pseudo-mots. En effet, ces simulations, qui ont permis de reproduire l'effet classique de la régularité, amplifient celui de la lexicalité : les performances du réseau en lecture de pseudo-mots étant plus faibles que celles de lecteurs experts (Besner et coll., 1990). L'échec de ce réseau pour la lecture de pseudomots a été attribué à la nature des codes utilisés pour mettre en correspondance les unités sublexicales écrites avec les unités sublexicales orales, à savoir des triplets de lettres. Comme suggéré par des recherches ultérieures, il est possible d'améliorer les performances de ce réseau en utilisant un codage plus approprié entre les unités d'entrée et de sortie, en l'occurrence, les correspondances graphème-phonème (Plaut et coll., 1996 ). Le fait que, pour la lecture de pseudomots, les performances des dyslexiques soient similaires à celles relevées dans les premières simulations de Seidenberg et McClelland (1989) pourrait donc provenir de l'inadéquation de leurs représentations phonologiques.
). Le fait que, pour la lecture de pseudomots, les performances des dyslexiques soient similaires à celles relevées dans les premières simulations de Seidenberg et McClelland (1989) pourrait donc provenir de l'inadéquation de leurs représentations phonologiques.  ). Ces études ont été choisies parce qu'elles ont pris en compte la précision et la rapidité dans différentes évaluations des capacités phonologiques de lecture des dyslexiques et de leurs capacités visuelles. Cinq autres études sont également décrites parce qu'elles ont utilisé une méthodologie identique et qu'elles comportent des comparaisons avec des normolecteurs de même âge chronologique et de même niveau de lecture. Environ 300 dyslexiques ont été examinés dans ces études : 196 anglophones et 108 francophones. L'analyse de ces données devrait permettre de cerner de façon relativement fiable la prévalence des profils de dyslexie2
.
). Ces études ont été choisies parce qu'elles ont pris en compte la précision et la rapidité dans différentes évaluations des capacités phonologiques de lecture des dyslexiques et de leurs capacités visuelles. Cinq autres études sont également décrites parce qu'elles ont utilisé une méthodologie identique et qu'elles comportent des comparaisons avec des normolecteurs de même âge chronologique et de même niveau de lecture. Environ 300 dyslexiques ont été examinés dans ces études : 196 anglophones et 108 francophones. L'analyse de ces données devrait permettre de cerner de façon relativement fiable la prévalence des profils de dyslexie2
.  et 9.II
et 9.II . Ces tableaux présentent également les scores de chacun des 21 dyslexiques. Les cellules grisées indiquent un fonctionnement efficient. Sont qualifiées d'efficientes les compétences qui sont à moins de 1 écart-type (pour les tâches de lecture, tableau 9.I
. Ces tableaux présentent également les scores de chacun des 21 dyslexiques. Les cellules grisées indiquent un fonctionnement efficient. Sont qualifiées d'efficientes les compétences qui sont à moins de 1 écart-type (pour les tâches de lecture, tableau 9.I ) ou entre les deux limites extrêmes (pour les tâches visuelles, tableau 9.II
) ou entre les deux limites extrêmes (pour les tâches visuelles, tableau 9.II ) de celles des normolecteurs.
) de celles des normolecteurs. . Les dyslexiques chez qui l'effet de la lexicalité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de pseudo-mots et celle de mots) est plus fort que chez les témoins, mais pas celui de la régularité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de mots réguliers et irréguliers), sont dits souffrir d'un trouble phonologique en lecture.
. Les dyslexiques chez qui l'effet de la lexicalité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de pseudo-mots et celle de mots) est plus fort que chez les témoins, mais pas celui de la régularité (c'est-à-dire la différence entre la lecture de mots réguliers et irréguliers), sont dits souffrir d'un trouble phonologique en lecture.  . Comparativement à la proportion de dyslexiques ayant des troubles phonologiques en lecture (18/21), ceux ayant des troubles visuels sont très peu nombreux. En effet, seulement 9 des 21 dyslexiques ont des troubles dans les tâches visuelles d'après le temps de traitement et seulement 3 d'après la précision de la réponse.
. Comparativement à la proportion de dyslexiques ayant des troubles phonologiques en lecture (18/21), ceux ayant des troubles visuels sont très peu nombreux. En effet, seulement 9 des 21 dyslexiques ont des troubles dans les tâches visuelles d'après le temps de traitement et seulement 3 d'après la précision de la réponse.  )
)
 )
)
 ) souffrent ou ont souffert d'un déficit phonologique, certains l'ayant surmonté dans le temps probablement grâce à l'aide de stratégies compensatoires. À l'appui de cette hypothèse, on peut noter que, parmi les trois cas n'ayant pas de déficit phonologique d'après les évaluations de leurs compétences de lecture effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans, deux ont eu des troubles du développement précoce de leur langage oral (RO et MF), l'autre présentait à 10 ans un profil de dyslexie mixte, et donc un déficit phonologique (Seymour et Porpodas, 1980
) souffrent ou ont souffert d'un déficit phonologique, certains l'ayant surmonté dans le temps probablement grâce à l'aide de stratégies compensatoires. À l'appui de cette hypothèse, on peut noter que, parmi les trois cas n'ayant pas de déficit phonologique d'après les évaluations de leurs compétences de lecture effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans, deux ont eu des troubles du développement précoce de leur langage oral (RO et MF), l'autre présentait à 10 ans un profil de dyslexie mixte, et donc un déficit phonologique (Seymour et Porpodas, 1980 ).
). ; Stuebing et coll., 2002
; Stuebing et coll., 2002 ).
). ; Manis et coll., 1996
; Manis et coll., 1996 ; Stanovich et coll., 1997
; Stanovich et coll., 1997 ) et deux francophones (Génard et coll., 1998
) et deux francophones (Génard et coll., 1998 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ), 283 dyslexiques (175 anglophones, 108 francophones) ont été comparés à 401 normolecteurs de même âge chronologique (NLAC : 151 anglophones, 250 francophones) et à 342 de même âge lexique (NLAL : 67 anglophones, 275 francophones). Ces études ont utilisé, entre autres, la méthode classique pour typologiser les dyslexiques. Dans cette méthode, on tient compte d'un déficit absolu de l'une des procédures de lecture, l'autre étant préservée. On définit comme dyslexique phonologique l'enfant qui a des performances normales en lecture de mots irréguliers mais dont les performances en lecture de pseudo-mots sont en dessous de la norme, et vice versa pour la dyslexie de surface. La typologie a été effectuée en tenant compte de la précision de la réponse en lecture à haute voix de mots irréguliers et de pseudo-mots. Dans l'étude de Sprenger-Charolles et coll. (2000
), 283 dyslexiques (175 anglophones, 108 francophones) ont été comparés à 401 normolecteurs de même âge chronologique (NLAC : 151 anglophones, 250 francophones) et à 342 de même âge lexique (NLAL : 67 anglophones, 275 francophones). Ces études ont utilisé, entre autres, la méthode classique pour typologiser les dyslexiques. Dans cette méthode, on tient compte d'un déficit absolu de l'une des procédures de lecture, l'autre étant préservée. On définit comme dyslexique phonologique l'enfant qui a des performances normales en lecture de mots irréguliers mais dont les performances en lecture de pseudo-mots sont en dessous de la norme, et vice versa pour la dyslexie de surface. La typologie a été effectuée en tenant compte de la précision de la réponse en lecture à haute voix de mots irréguliers et de pseudo-mots. Dans l'étude de Sprenger-Charolles et coll. (2000 ), le temps de latence des réponses correctes a également été examiné. Le tableau 9.III
), le temps de latence des réponses correctes a également été examiné. Le tableau 9.III présente les données descriptives de ces études.
présente les données descriptives de ces études. ). De plus, si on trouve à peu près autant de dyslexiques phonologiques que de dyslexiques de surface dans les trois études anglaises qui s'appuient toutes sur la précision de la réponse, cela n'est vrai en français que quand on se fonde sur le temps de latence (Sprenger-Charolles et coll., 2000
). De plus, si on trouve à peu près autant de dyslexiques phonologiques que de dyslexiques de surface dans les trois études anglaises qui s'appuient toutes sur la précision de la réponse, cela n'est vrai en français que quand on se fonde sur le temps de latence (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ). En revanche, quand en français on utilise la précision de la réponse, le nombre de dyslexiques phonologiques est plus faible que celui des dyslexiques de surface (Génard et coll., 1998
). En revanche, quand en français on utilise la précision de la réponse, le nombre de dyslexiques phonologiques est plus faible que celui des dyslexiques de surface (Génard et coll., 1998 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ). Ces résultats ne prennent en compte qu'un seul indicateur, soit la précision, soit le temps. Quand on tient compte de ces deux mesures (Sprenger-Charolles et coll., 2000
). Ces résultats ne prennent en compte qu'un seul indicateur, soit la précision, soit le temps. Quand on tient compte de ces deux mesures (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ), pratiquement tous les sujets ont un double déficit. Enfin, une faible proportion d'entre eux n'a aucun déficit, tout au moins d'après la précision de la réponse (16 sur les 283 dyslexiques), ce qui confirme que la plupart souffrent d'une déficience des procédures d'identification des mots écrits. C'est le cas pour tous quand la classification est effectuée sur la base de la précision et de la rapidité (Sprenger-Charolles et coll., 2000
), pratiquement tous les sujets ont un double déficit. Enfin, une faible proportion d'entre eux n'a aucun déficit, tout au moins d'après la précision de la réponse (16 sur les 283 dyslexiques), ce qui confirme que la plupart souffrent d'une déficience des procédures d'identification des mots écrits. C'est le cas pour tous quand la classification est effectuée sur la base de la précision et de la rapidité (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ).
).
 ; Manis et coll., 1996
; Manis et coll., 1996 ; Stanovich et coll., 1997
; Stanovich et coll., 1997 ; Génard et coll., 1998
; Génard et coll., 1998 ). Cette comparaison permet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard développemental. Les résultats sont présentés dans le tableau 9.IV
). Cette comparaison permet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard développemental. Les résultats sont présentés dans le tableau 9.IV .
. ). La majeure partie des dyslexiques (177 cas, soit 75,5 %) se comporte donc comme les normolecteurs plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture. La trajectoire développementale de la plupart des dyslexiques apparaît donc comme n'étant pas déviante, au moins quand il n'est tenu compte que de la précision de la réponse.
). La majeure partie des dyslexiques (177 cas, soit 75,5 %) se comporte donc comme les normolecteurs plus jeunes qu'eux mais de même niveau de lecture. La trajectoire développementale de la plupart des dyslexiques apparaît donc comme n'étant pas déviante, au moins quand il n'est tenu compte que de la précision de la réponse. ), la précision et le temps de traitement ont été évalués. Il est à signaler que tous les enfants de 21 classes de grande section de maternelle qui répondaient aux critères exclusionnaires classiques ont été intégrés dans cette étude. L'accord parental a été obtenu pour environ 400 enfants, 373 ont pu être suivis jusqu'à 8 ans. Les dyslexiques sont issus d'un groupe de 52 enfants qui avaient à 8 ans des scores de lecture à plus de 1 écart-type de la norme (d'après la Batelem ; Savigny, 1974
), la précision et le temps de traitement ont été évalués. Il est à signaler que tous les enfants de 21 classes de grande section de maternelle qui répondaient aux critères exclusionnaires classiques ont été intégrés dans cette étude. L'accord parental a été obtenu pour environ 400 enfants, 373 ont pu être suivis jusqu'à 8 ans. Les dyslexiques sont issus d'un groupe de 52 enfants qui avaient à 8 ans des scores de lecture à plus de 1 écart-type de la norme (d'après la Batelem ; Savigny, 1974 ). La plupart de ces enfants en difficulté de lecture (45) ont pu être revus à 10 ans. Les 33 enfants de 10 ans dits dyslexiques sont ceux qui présentaient alors un déficit sévère en lecture (plus de 2 écarts-types de la norme d'après l'Analec A2 ; Inizan, 1995
). La plupart de ces enfants en difficulté de lecture (45) ont pu être revus à 10 ans. Les 33 enfants de 10 ans dits dyslexiques sont ceux qui présentaient alors un déficit sévère en lecture (plus de 2 écarts-types de la norme d'après l'Analec A2 ; Inizan, 1995 ). Cette population peut donc être supposée représentative de ce qu'est un dyslexique français « tout-venant ».
). Cette population peut donc être supposée représentative de ce qu'est un dyslexique français « tout-venant ». ). Les performances sont dites déficitaires quand elles se situent à moins de 1 écart-type (pour la précision) ou à plus de 1 écart-type (pour la rapidité de la latence de la réponse vocale) de celles des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture.
). Les performances sont dites déficitaires quand elles se situent à moins de 1 écart-type (pour la précision) ou à plus de 1 écart-type (pour la rapidité de la latence de la réponse vocale) de celles des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture. ; Van Ijzendoorn et Bus, 1994
; Van Ijzendoorn et Bus, 1994 ; Snowling et coll., 1996a
; Snowling et coll., 1996a ; en français : Casalis, 1995
; en français : Casalis, 1995 ; Grainger et coll., 2003
; Grainger et coll., 2003 ; en allemand : Wimmer, 1993
; en allemand : Wimmer, 1993 et 1995
et 1995 ; Landerl et coll., 1997
; Landerl et coll., 1997 ; Ziegler et coll., 2003
; Ziegler et coll., 2003 ; en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000
; en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000 ). En outre, ce déficit est plus notable quand les dyslexiques sont confrontés à une écriture peu transparente, comme c'est le cas en anglais (Lindgren et coll., 1985
). En outre, ce déficit est plus notable quand les dyslexiques sont confrontés à une écriture peu transparente, comme c'est le cas en anglais (Lindgren et coll., 1985 ; Landerl et coll., 1997
; Landerl et coll., 1997 ; Paulesu et coll., 2001
; Paulesu et coll., 2001 ) comparativement au français (Paulesu et coll., 2001
) comparativement au français (Paulesu et coll., 2001 ), à l'allemand (Landerl et coll., 1997
), à l'allemand (Landerl et coll., 1997 ), ou à l'italien (Lindgren et coll., 1985
), ou à l'italien (Lindgren et coll., 1985 ; Paulesu et coll., 2001
; Paulesu et coll., 2001 ). Toutefois, quand l'orthographe est transparente, le déficit de la procédure sublexicale des dyslexiques se note principalement par leur lenteur en lecture de pseudomots (en allemand : Wimmer, 1993
). Toutefois, quand l'orthographe est transparente, le déficit de la procédure sublexicale des dyslexiques se note principalement par leur lenteur en lecture de pseudomots (en allemand : Wimmer, 1993 et 1995
et 1995 ; Ziegler et coll., 2003
; Ziegler et coll., 2003 ; en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000
; en espagnol : Jimenez-Gonzalez et Valle, 2000 ; en français : Sprenger-Charolles et coll., 2000
; en français : Sprenger-Charolles et coll., 2000 ).
). ; Hutzler et Wimmer 2004
; Hutzler et Wimmer 2004 ; pour l'italien, De Luca et coll., 1999
; pour l'italien, De Luca et coll., 1999 et 2002
et 2002 ; Zoccolotti et coll., 1999
; Zoccolotti et coll., 1999 ; Judica et coll., 2002
; Judica et coll., 2002 ). En d'autres termes, les dyslexiques non-anglophones souffriraient d'une dyslexie de surface et les anglophones d'une dyslexie phonologique. Il est toutefois difficile d'imaginer que le phénotype de la dyslexie puisse fortement différer en fonction de la transparence de l'orthographe et de la mesure utilisée. Les évidences à l'appui de l'hypothèse d'une spécificité des déficits des dyslexiques non anglophones viennent principalement de l'examen des mouvements oculaires au cours de tâche de lecture (en italien : De Luca et coll., 1999
). En d'autres termes, les dyslexiques non-anglophones souffriraient d'une dyslexie de surface et les anglophones d'une dyslexie phonologique. Il est toutefois difficile d'imaginer que le phénotype de la dyslexie puisse fortement différer en fonction de la transparence de l'orthographe et de la mesure utilisée. Les évidences à l'appui de l'hypothèse d'une spécificité des déficits des dyslexiques non anglophones viennent principalement de l'examen des mouvements oculaires au cours de tâche de lecture (en italien : De Luca et coll., 1999 et 2002
et 2002 ; Judica et coll., 2002
; Judica et coll., 2002 ; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004
; en allemand : Hutzler et Wimmer, 2004 ; Hawelka et Wimmer, 2005
; Hawelka et Wimmer, 2005 ). Comme Rayner l'expliquait dans une revue de la littérature (1998
). Comme Rayner l'expliquait dans une revue de la littérature (1998 ), il est difficile d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans ces études, à la différence de celles qui ont mis en relief les déficits phonologiques, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique. En plus, comme Hutzler et Wimmer le signalent (2004
), il est difficile d'affirmer que le patron atypique des mouvements oculaires le plus souvent observé chez les dyslexiques soit la cause plutôt que la conséquence de leurs difficultés de lecture. Le poids de cette remarque est d'autant plus fort que, dans ces études, à la différence de celles qui ont mis en relief les déficits phonologiques, les performances des dyslexiques ont été comparées à celles de normolecteurs de même âge chronologique. En plus, comme Hutzler et Wimmer le signalent (2004 ), certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. C'est le cas, par exemple, pour l'impact négatif de l'opacité de l'orthographe, tout comme pour celui de la lexicalité, sur la durée des fixations oculaires (les différences les plus notables entre dyslexiques et normolecteurs concernent la lecture de pseudomots). C'est également ce que suggère la présence, avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs, de déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (répétition de pseudomots, détection de rimes et dénomination rapide, cf. Hawelka et Wimmer, 2005
), certains résultats relevés dans ces études sont compatibles avec l'hypothèse phonologique. C'est le cas, par exemple, pour l'impact négatif de l'opacité de l'orthographe, tout comme pour celui de la lexicalité, sur la durée des fixations oculaires (les différences les plus notables entre dyslexiques et normolecteurs concernent la lecture de pseudomots). C'est également ce que suggère la présence, avant l'apprentissage de la lecture chez les futurs dyslexiques comparativement aux futurs normolecteurs, de déficits dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (répétition de pseudomots, détection de rimes et dénomination rapide, cf. Hawelka et Wimmer, 2005 ).
). ; Manis et coll., 1996
; Manis et coll., 1996 ; Stanovich et coll., 1997
; Stanovich et coll., 1997 ) et deux avec des francophones (Génard et coll., 1998
) et deux avec des francophones (Génard et coll., 1998 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ) par rapport aux témoins de même âge, la méthode classique a mis en relief surtout des profils mixtes, avec un double déficit, concernant à la fois la procédure phonologique de lecture et la procédure lexicale. C'est quasi-systématiquement le cas quand il est tenu compte de la précision et du temps de latence des réponses correctes (Sprenger-Charolles et coll., 2000
) par rapport aux témoins de même âge, la méthode classique a mis en relief surtout des profils mixtes, avec un double déficit, concernant à la fois la procédure phonologique de lecture et la procédure lexicale. C'est quasi-systématiquement le cas quand il est tenu compte de la précision et du temps de latence des réponses correctes (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ).
). ; Sprenger-Charolles et coll., 2000
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ). Par contre, quand la classification des dyslexiques français est élaborée sur la base de la rapidité (Sprenger-Charolles et coll., 2000
). Par contre, quand la classification des dyslexiques français est élaborée sur la base de la rapidité (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ), on observe autant de dyslexiques phonologiques que dans les études anglaises s'appuyant sur la précision (Castles et Coltheart, 1993
), on observe autant de dyslexiques phonologiques que dans les études anglaises s'appuyant sur la précision (Castles et Coltheart, 1993 ; Manis et coll., 1996
; Manis et coll., 1996 ; Stanovich et coll., 1997
; Stanovich et coll., 1997 ). Les différences entre les études francophones et anglophones sont probablement dues à des facteurs linguistiques. Les correspondances grapho-phonémiques étant plus régulières en français, les dyslexiques francophones peuvent plus facilement que les anglophones surmonter les difficultés de mise en œuvre de la procédure sublexicale. Ces données, comme celles relevées dans les études de groupes, suggèrent que les dyslexiques francophones pourraient utiliser à peu près correctement les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit phonologique se manifestant surtout par la lenteur de cette opération.
). Les différences entre les études francophones et anglophones sont probablement dues à des facteurs linguistiques. Les correspondances grapho-phonémiques étant plus régulières en français, les dyslexiques francophones peuvent plus facilement que les anglophones surmonter les difficultés de mise en œuvre de la procédure sublexicale. Ces données, comme celles relevées dans les études de groupes, suggèrent que les dyslexiques francophones pourraient utiliser à peu près correctement les correspondances grapho-phonémiques, leur déficit phonologique se manifestant surtout par la lenteur de cette opération. ), suggère en plus que presque tous les dyslexiques ont un déficit phonologique sévère, qui se manifeste systématiquement quand ils doivent lire des mots nouveaux sur l'une ou l'autre, voire sur les deux mesures. Partant de ce constat, on peut supposer que, dans les études qui n'ont pas examiné le temps de traitement, la proportion des dyslexiques présentant des troubles phonologiques sévères est sous-estimée (Zabell et Everatt, 2002
), suggère en plus que presque tous les dyslexiques ont un déficit phonologique sévère, qui se manifeste systématiquement quand ils doivent lire des mots nouveaux sur l'une ou l'autre, voire sur les deux mesures. Partant de ce constat, on peut supposer que, dans les études qui n'ont pas examiné le temps de traitement, la proportion des dyslexiques présentant des troubles phonologiques sévères est sous-estimée (Zabell et Everatt, 2002 ).
). ; Castles et Coltheart, 1993
; Castles et Coltheart, 1993 ; Manis et coll., 1996
; Manis et coll., 1996 ; Stanovich et coll., 1997
; Stanovich et coll., 1997 ; Zabell et Everatt, 2002
; Zabell et Everatt, 2002 ), francophones (Génard et coll., 1998
), francophones (Génard et coll., 1998 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000
; Sprenger-Charolles et coll., 2000 ; voir également pour des résultats en espagnol Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana, 2002
; voir également pour des résultats en espagnol Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana, 2002 ) indiquent que le déficit de la procédure phonologique de lecture est prévalent dans la dyslexie. Ce déficit est aussi sévère puisqu'il se retrouve chez la plupart des dyslexiques dans la comparaison avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture, tout au moins quand il est tenu compte de la précision et de la rapidité. Comme le soulignait Seymour lui-même (1986
) indiquent que le déficit de la procédure phonologique de lecture est prévalent dans la dyslexie. Ce déficit est aussi sévère puisqu'il se retrouve chez la plupart des dyslexiques dans la comparaison avec des enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture, tout au moins quand il est tenu compte de la précision et de la rapidité. Comme le soulignait Seymour lui-même (1986 ), les 21 dyslexiques de sa cohorte présentaient tous des troubles phonologiques qui se manifestaient en lecture de pseudo-mots par la faible précision et/ou la lenteur de leurs réponses ainsi que par les effets de longueur, ce pattern dominant étant parfois accompagné de quelques signes des déficiences visuelles (voir également Sprenger-Charolles et coll.,
), les 21 dyslexiques de sa cohorte présentaient tous des troubles phonologiques qui se manifestaient en lecture de pseudo-mots par la faible précision et/ou la lenteur de leurs réponses ainsi que par les effets de longueur, ce pattern dominant étant parfois accompagné de quelques signes des déficiences visuelles (voir également Sprenger-Charolles et coll.,  sous presse ; Ziegler et Goswami, 2005
sous presse ; Ziegler et Goswami, 2005 ).
). ; Mann et Liberman, 1984
; Mann et Liberman, 1984 ; McDougall et coll., 1994 ; Scarborough, 1998a
; McDougall et coll., 1994 ; Scarborough, 1998a et b
et b ).
). ; Wolf et coll., 2000
; Wolf et coll., 2000 ; Wolf et coll., 2002
; Wolf et coll., 2002 ). Partant de ce constat, certains auteurs assument qu'il y aurait deux sources indépendantes expliquant les déficits en lecture des dyslexiques, l'une reliée aux compétences d'analyse et de mémoire phonologique, l'autre reliée à l'accès lexical, généralement évaluée par le temps de réponse dans des tâches de dénomination rapide (Rapid Automatic Naming, ou RAN) impliquant des items très fréquents : images d'objet (une table, un ballon...), ou de couleur (rouge, bleu...), suites de nombres ou de lettres. Deux principales preuves ont été apportées à l'appui de cette hypothèse. D'une part, la réussite aux tâches de dénomination rapide permet d'expliquer une part unique de la variance en lecture, en plus de celle expliquée par les tâches d'analyse et de mémoire phonologique. D'autre part, les capacités d'analyse phonologique et de dénomination rapide ne sont pas reliées aux mêmes compétences de lecture, la première expliquant la précision de la réponse, la seconde le temps de traitement. Cette interprétation a été fortement critiquée (Wagner et coll., 1997
). Partant de ce constat, certains auteurs assument qu'il y aurait deux sources indépendantes expliquant les déficits en lecture des dyslexiques, l'une reliée aux compétences d'analyse et de mémoire phonologique, l'autre reliée à l'accès lexical, généralement évaluée par le temps de réponse dans des tâches de dénomination rapide (Rapid Automatic Naming, ou RAN) impliquant des items très fréquents : images d'objet (une table, un ballon...), ou de couleur (rouge, bleu...), suites de nombres ou de lettres. Deux principales preuves ont été apportées à l'appui de cette hypothèse. D'une part, la réussite aux tâches de dénomination rapide permet d'expliquer une part unique de la variance en lecture, en plus de celle expliquée par les tâches d'analyse et de mémoire phonologique. D'autre part, les capacités d'analyse phonologique et de dénomination rapide ne sont pas reliées aux mêmes compétences de lecture, la première expliquant la précision de la réponse, la seconde le temps de traitement. Cette interprétation a été fortement critiquée (Wagner et coll., 1997 ; Vellutino et coll., 2004
; Vellutino et coll., 2004 ) dans la mesure où ces résultats peuvent s'expliquer aussi bien par le type de mesure utilisé (précision pour les tâches phonologiques, rapidité pour les autres), que par le type de tâche. En plus, la tâche de dénomination le plus souvent utilisée implique des lettres, et donc des capacités directement liées à la lecture. En fait, quand le niveau de pré-lecture est contrôlé, le pouvoir prédictif des habiletés de dénomination rapide diminue, pas celui des capacités d'analyse phonémique (Wagner et coll., 1997
) dans la mesure où ces résultats peuvent s'expliquer aussi bien par le type de mesure utilisé (précision pour les tâches phonologiques, rapidité pour les autres), que par le type de tâche. En plus, la tâche de dénomination le plus souvent utilisée implique des lettres, et donc des capacités directement liées à la lecture. En fait, quand le niveau de pré-lecture est contrôlé, le pouvoir prédictif des habiletés de dénomination rapide diminue, pas celui des capacités d'analyse phonémique (Wagner et coll., 1997 ).
). ; Paulesu et coll., 2001
; Paulesu et coll., 2001 ), il a été noté que ce sont principalement les capacités verbales qui différencient les dyslexiques des normolecteurs de même âge. Ainsi, dans l'étude de Lindgren et coll. (1985
), il a été noté que ce sont principalement les capacités verbales qui différencient les dyslexiques des normolecteurs de même âge. Ainsi, dans l'étude de Lindgren et coll. (1985 ), les capacités d'analyse phonémique, de répétition de phrases et de dénomination permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs dans chaque groupe linguistique (anglais et italiens), mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. De même, et toujours quel que soit leur groupe linguistique (anglais, français, italiens), les dyslexiques adultes examinés par Paulesu et coll. (2001
), les capacités d'analyse phonémique, de répétition de phrases et de dénomination permettent de rendre compte de la plupart des différences entre dyslexiques et normolecteurs dans chaque groupe linguistique (anglais et italiens), mais pas les capacités visuelles (perception visuo-spatiale et capacités visuo-motrices), au moins dans ce dernier cas pour les dyslexiques italiens. De même, et toujours quel que soit leur groupe linguistique (anglais, français, italiens), les dyslexiques adultes examinés par Paulesu et coll. (2001 ) diffèrent des témoins de même âge dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (analyse phonémique, mémoire phonologique à court terme et dénomination rapide), mais pas, par exemple, dans des épreuves de compréhension. Partant de ce constat, Paulesu et coll. (2001
) diffèrent des témoins de même âge dans des tâches impliquant des traitements phonologiques (analyse phonémique, mémoire phonologique à court terme et dénomination rapide), mais pas, par exemple, dans des épreuves de compréhension. Partant de ce constat, Paulesu et coll. (2001 ) soulignent qu'un déficit dans les traitements phonologiques est un problème « universel » dans la dyslexie.
) soulignent qu'un déficit dans les traitements phonologiques est un problème « universel » dans la dyslexie. ) qui a porté sur 70 enfants (de 7 à 12 ans) et adolescents (de 12 à 18 ans) dyslexiques. Quel que soit le groupe de dyslexiques, leurs scores sont plus faibles que ceux des normolecteurs de même niveau de lecture dans les tâches impliquant la manipulation de phonèmes. En revanche, seuls les dyslexiques adolescents les plus atteints ont des scores inférieurs aux témoins de même niveau de lecture pour les tâches de mémoire. Ce n'est le cas pour aucun des deux groupes de dyslexiques pour les tâches de dénomination. Les analyses de régression indiquent en plus que les compétences en analyse phonémique rendent compte de la majeure partie de la variance en lecture, y compris après avoir contrôlé les effets de l'âge et du QI verbal, les compétences en dénomination rapide n'expliquant dans ce contexte qu'une modeste part additionnelle de variance.
) qui a porté sur 70 enfants (de 7 à 12 ans) et adolescents (de 12 à 18 ans) dyslexiques. Quel que soit le groupe de dyslexiques, leurs scores sont plus faibles que ceux des normolecteurs de même niveau de lecture dans les tâches impliquant la manipulation de phonèmes. En revanche, seuls les dyslexiques adolescents les plus atteints ont des scores inférieurs aux témoins de même niveau de lecture pour les tâches de mémoire. Ce n'est le cas pour aucun des deux groupes de dyslexiques pour les tâches de dénomination. Les analyses de régression indiquent en plus que les compétences en analyse phonémique rendent compte de la majeure partie de la variance en lecture, y compris après avoir contrôlé les effets de l'âge et du QI verbal, les compétences en dénomination rapide n'expliquant dans ce contexte qu'une modeste part additionnelle de variance. ) dans une étude intensive (5 heures d'observation par sujet) qui a porté sur 40 adultes dyslexiques et autant de normolecteurs de même niveau de lecture. Les scores des dyslexiques ne sont inférieurs à ceux des témoins que dans les tâches qui requièrent des compétences en analyse phonémique. Comme dans l'étude précédente, la majeure partie de la variance en lecture (plus de 50 %) est expliquée par les capacités d'analyse phonémique et, dans une moindre mesure, par celles de dénomination rapide. Comme le soulignent les auteurs, ces résultats signalent que les déficits des compétences d'analyse phonémique sont au cœur de la dyslexie, ces déficits étant persistants.
) dans une étude intensive (5 heures d'observation par sujet) qui a porté sur 40 adultes dyslexiques et autant de normolecteurs de même niveau de lecture. Les scores des dyslexiques ne sont inférieurs à ceux des témoins que dans les tâches qui requièrent des compétences en analyse phonémique. Comme dans l'étude précédente, la majeure partie de la variance en lecture (plus de 50 %) est expliquée par les capacités d'analyse phonémique et, dans une moindre mesure, par celles de dénomination rapide. Comme le soulignent les auteurs, ces résultats signalent que les déficits des compétences d'analyse phonémique sont au cœur de la dyslexie, ces déficits étant persistants. ; Joanisse et coll., 2000
; Joanisse et coll., 2000 ), ainsi que dans d'autres langues (en allemand, Landerl et coll., 1997
), ainsi que dans d'autres langues (en allemand, Landerl et coll., 1997 ). Toutefois, certaines études suggèrent que quand l'orthographe est transparente, les déficits d'analyse phonémique se retrouvent uniquement dans les étapes précoces de l'apprentissage de la lecture (Landerl et Wimmer, 2000
). Toutefois, certaines études suggèrent que quand l'orthographe est transparente, les déficits d'analyse phonémique se retrouvent uniquement dans les étapes précoces de l'apprentissage de la lecture (Landerl et Wimmer, 2000 ).
). ; Bruck, 1992
; Bruck, 1992 ) ce qui signale que leurs déficits dans ce domaine sont plus importants quand ils ne peuvent pas s'aider sur leurs compétences lexicales (voir aussi Swan et Goswami, 1997a
) ce qui signale que leurs déficits dans ce domaine sont plus importants quand ils ne peuvent pas s'aider sur leurs compétences lexicales (voir aussi Swan et Goswami, 1997a ). Les mêmes tendances ont été relevées dans des épreuves impliquant la mémoire phonologique à court terme (Snowling et coll., 1986
). Les mêmes tendances ont été relevées dans des épreuves impliquant la mémoire phonologique à court terme (Snowling et coll., 1986 b) ou les capacités de dénomination (Swan et Goswami, 1997b
b) ou les capacités de dénomination (Swan et Goswami, 1997b ).
). ), le niveau de vocabulaire a été évalué par des tâches de dénomination d'images de mots courts et longs qui étaient fréquents ou rares. Les mêmes items ont été présentés dans une tâche de désignation d'images (4 images : une qui représente le mot correct, plus un intrus visuel, un intrus phonologique et un intrus sémantique). Les enfants ont également passé un test classique de vocabulaire (en désignation d'images). Dans l'épreuve de dénomination, les scores des dyslexiques sont plus faibles que ceux des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture pour les mots rares, pas pour les mots fréquents. Surtout, les dyslexiques sont les seuls à être négativement affectés par la longueur des items, quelle que soit leur fréquence. En plus, ils produisent de nombreuses erreurs phonologiques, ce qui témoigne de l'imprécision de leurs représentations phonologiques. En revanche, dans les deux tâches de désignation d'images, les scores des dyslexiques ne diffèrent pas de ceux des témoins, y compris ceux de même âge chronologique. Selon les auteurs, ces résultats indiquent que les dyslexiques ont des difficultés de récupération des codes phonologiques des mots.
), le niveau de vocabulaire a été évalué par des tâches de dénomination d'images de mots courts et longs qui étaient fréquents ou rares. Les mêmes items ont été présentés dans une tâche de désignation d'images (4 images : une qui représente le mot correct, plus un intrus visuel, un intrus phonologique et un intrus sémantique). Les enfants ont également passé un test classique de vocabulaire (en désignation d'images). Dans l'épreuve de dénomination, les scores des dyslexiques sont plus faibles que ceux des normolecteurs plus jeunes mais de même niveau de lecture pour les mots rares, pas pour les mots fréquents. Surtout, les dyslexiques sont les seuls à être négativement affectés par la longueur des items, quelle que soit leur fréquence. En plus, ils produisent de nombreuses erreurs phonologiques, ce qui témoigne de l'imprécision de leurs représentations phonologiques. En revanche, dans les deux tâches de désignation d'images, les scores des dyslexiques ne diffèrent pas de ceux des témoins, y compris ceux de même âge chronologique. Selon les auteurs, ces résultats indiquent que les dyslexiques ont des difficultés de récupération des codes phonologiques des mots. ; voir aussi Wimmer, 1996
; voir aussi Wimmer, 1996 ).
). ; Stanovich et coll., 1997
; Stanovich et coll., 1997 ; Bosse et Valdois, 2003
; Bosse et Valdois, 2003 ; Bailey et coll., 2004
; Bailey et coll., 2004 ), et pas dans d'autres (Sprenger-Charolles et coll., 2000
), et pas dans d'autres (Sprenger-Charolles et coll., 2000 ; Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana, 2002
; Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana, 2002 ; Zabell et Everatt, 2002
; Zabell et Everatt, 2002 ).
). ), les capacités d'analyse phonémique de dyslexiques phonologiques et de surface ont été évaluées. Par rapport à des normolecteurs de même niveau de lecture, seuls les dyslexiques phonologiques ont des scores inférieurs. Les mêmes résultats ont été retrouvés dans l'étude de Bailey et coll. (2004
), les capacités d'analyse phonémique de dyslexiques phonologiques et de surface ont été évaluées. Par rapport à des normolecteurs de même niveau de lecture, seuls les dyslexiques phonologiques ont des scores inférieurs. Les mêmes résultats ont été retrouvés dans l'étude de Bailey et coll. (2004 ) et dans celle de Stanovich et coll. (1997
) et dans celle de Stanovich et coll. (1997 ) dans des tâches impliquant, entre autres, la manipulation de phonèmes. De plus, dans l'étude de Stanovich et coll. (1997
) dans des tâches impliquant, entre autres, la manipulation de phonèmes. De plus, dans l'étude de Stanovich et coll. (1997 ), les dyslexiques ayant un profil mixte se comportent comme les dyslexiques phonologiques. En particulier, leurs scores dans des tâches de manipulation de syllabes ou de phonèmes sont équivalents, et inférieurs à ceux de normolecteurs de même niveau de lecture. Une des rares études dans lesquelles les performances de dyslexiques ayant un profil mixte, et donc un double déficit, ont été examinées, indique donc que les capacités phonologiques de ces deux groupes de dyslexiques sont également détériorées. Comme les profils de type surface sont très peu fréquents, ces résultats suggèrent que la plupart des dyslexiques ont des troubles phonologiques en dehors de la lecture.
), les dyslexiques ayant un profil mixte se comportent comme les dyslexiques phonologiques. En particulier, leurs scores dans des tâches de manipulation de syllabes ou de phonèmes sont équivalents, et inférieurs à ceux de normolecteurs de même niveau de lecture. Une des rares études dans lesquelles les performances de dyslexiques ayant un profil mixte, et donc un double déficit, ont été examinées, indique donc que les capacités phonologiques de ces deux groupes de dyslexiques sont également détériorées. Comme les profils de type surface sont très peu fréquents, ces résultats suggèrent que la plupart des dyslexiques ont des troubles phonologiques en dehors de la lecture. ), les performances des dyslexiques de surface ne se différenciaient pas de celles des dyslexiques phonologiques dans quatre tâches phonologiques (par exemple, en dehors de la lecture de pseudo-mots, dans des tâches de fluence phonologique et de dénomination rapide d'images ou de chiffres), quelle que soit la mesure utilisée : précision ou rapidité. De même, dans l'étude par Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana (2002
), les performances des dyslexiques de surface ne se différenciaient pas de celles des dyslexiques phonologiques dans quatre tâches phonologiques (par exemple, en dehors de la lecture de pseudo-mots, dans des tâches de fluence phonologique et de dénomination rapide d'images ou de chiffres), quelle que soit la mesure utilisée : précision ou rapidité. De même, dans l'étude par Jimenez-Gonzalez et Ramirez-Santana (2002 ), aucune différence n'a été observée entre dyslexiques de surface et dyslexiques phonologiques dans des épreuves d'analyse phonologique.
), aucune différence n'a été observée entre dyslexiques de surface et dyslexiques phonologiques dans des épreuves d'analyse phonologique. ) qui a permis de mettre en relief, à partir du temps de latence des réponses vocales en lecture de pseudo-mots et de mots irréguliers fréquents, un groupe de dyslexiques phonologiques et un groupe de dyslexiques de surface. Les examens ont porté sur la mémoire phonologique et visuelle à court terme, un déficit en mémoire phonologique étant attendu chez les dyslexiques phonologiques et un déficit de la mémoire visuelle, qui ne leur permettrait pas de fixer l'image orthographique des mots, chez les dyslexiques de surface. Dans le test visuel utilisé (le Corsi), les enfants devaient reproduire une trajectoire entre plusieurs points (de 2 à 7). Le test phonologique était similaire (rappel de pseudo-mots de 3 à 6 syllabes). Les résultats sont présentés dans le tableau 9.V
) qui a permis de mettre en relief, à partir du temps de latence des réponses vocales en lecture de pseudo-mots et de mots irréguliers fréquents, un groupe de dyslexiques phonologiques et un groupe de dyslexiques de surface. Les examens ont porté sur la mémoire phonologique et visuelle à court terme, un déficit en mémoire phonologique étant attendu chez les dyslexiques phonologiques et un déficit de la mémoire visuelle, qui ne leur permettrait pas de fixer l'image orthographique des mots, chez les dyslexiques de surface. Dans le test visuel utilisé (le Corsi), les enfants devaient reproduire une trajectoire entre plusieurs points (de 2 à 7). Le test phonologique était similaire (rappel de pseudo-mots de 3 à 6 syllabes). Les résultats sont présentés dans le tableau 9.V .
. )
)
 . Avant l'apprentissage de la lecture, les scores des futurs dyslexiques phonologiques ne différaient pas de ceux des futurs dyslexiques de surface et étaient inférieurs à ceux des futurs normolecteurs dans l'épreuve d'analyse phonémique, mais pas dans celle d'analyse musicale.
. Avant l'apprentissage de la lecture, les scores des futurs dyslexiques phonologiques ne différaient pas de ceux des futurs dyslexiques de surface et étaient inférieurs à ceux des futurs normolecteurs dans l'épreuve d'analyse phonémique, mais pas dans celle d'analyse musicale.
 )
) ) dans leur synthèse de la littérature, les résultats de plusieurs études montrent que les indicateurs qui prédisent le devenir en lecture sont identiques, quelle que soit la population : par exemple, chez des enfants « tout-venant » versus ceux qui sont supposés « à risque » pour l'apprentissage de la lecture, que ce risque soit d'origine linguistique ou sociologique (voir par exemple, Snow et coll., 1991
) dans leur synthèse de la littérature, les résultats de plusieurs études montrent que les indicateurs qui prédisent le devenir en lecture sont identiques, quelle que soit la population : par exemple, chez des enfants « tout-venant » versus ceux qui sont supposés « à risque » pour l'apprentissage de la lecture, que ce risque soit d'origine linguistique ou sociologique (voir par exemple, Snow et coll., 1991 ). Dans la suite, nous examinerons les études qui ont porté sur des familles de dyslexiques ainsi que celles incluant des enfants dysphasiques (voir le chapitre 2 pour les études portant sur des enfants tout-venant).
). Dans la suite, nous examinerons les études qui ont porté sur des familles de dyslexiques ainsi que celles incluant des enfants dysphasiques (voir le chapitre 2 pour les études portant sur des enfants tout-venant). ). Ainsi, selon Scarborough (1998a
). Ainsi, selon Scarborough (1998a ), environ 40 % des enfants de telles familles deviennent dyslexiques alors que des difficultés spécifiques de lecture sont relevées dans moins de 10 % des cas dans des familles sans dyslexiques. Scarborough (1989
), environ 40 % des enfants de telles familles deviennent dyslexiques alors que des difficultés spécifiques de lecture sont relevées dans moins de 10 % des cas dans des familles sans dyslexiques. Scarborough (1989 , 1990
, 1990 et 1991
et 1991 ) a suivi entre 2 ans et demi et 8 ans des enfants issus ou non de familles de dyslexiques. Les groupes étaient appariés en fonction du milieu socioculturel et du niveau d'intelligence des enfants. Une partie de ces enfants a été revue à l'âge de 14 ans (66 sur 78 ; Scarborough, 1998b
) a suivi entre 2 ans et demi et 8 ans des enfants issus ou non de familles de dyslexiques. Les groupes étaient appariés en fonction du milieu socioculturel et du niveau d'intelligence des enfants. Une partie de ces enfants a été revue à l'âge de 14 ans (66 sur 78 ; Scarborough, 1998b ). À la fin de la 2e année du primaire, 22 des 34 enfants de famille à risque avaient un an ou plus de retard en lecture. Le même résultat n'est relevé que pour 2 des 44 autres enfants des familles de témoin. Les différences de niveau de lecture en fonction du « risque » familial ont également été retrouvées en 8e année.
). À la fin de la 2e année du primaire, 22 des 34 enfants de famille à risque avaient un an ou plus de retard en lecture. Le même résultat n'est relevé que pour 2 des 44 autres enfants des familles de témoin. Les différences de niveau de lecture en fonction du « risque » familial ont également été retrouvées en 8e année. ) dans une étude qui a porté sur 59 familles avec au moins un parent dyslexique. Comme dans l'étude précédente, les critères exclusionnaires classiques ont été pris en compte (en particulier, problèmes visuels, émotionnels et médicaux). Les enfants ont été suivis de 4 ans à 6 ans. À 4 ans, les évaluations ont porté sur les compétences non verbales (test de dessin du bonhomme), le niveau de vocabulaire (en désignation et en dénomination), la qualité de la syntaxe (longueur des phrases produites) et de la compréhension du langage (rappel d'une histoire). La maîtrise des aspects phonologiques du langage a été évaluée par la qualité de l'articulation, les compétences en répétition de pseudo-mots et par la sensibilité aux rimes. Dans ce dernier cas, les enfants devaient, d'une part, réciter des « nursery rhymes » et, d'autre part, corriger les erreurs produites par l'expérimentateur quand il récitait ces petites poésies en les modifiant. Les évaluations à 6 ans ont porté sur les capacités de lecture et d'écriture, incluant la compréhension.
) dans une étude qui a porté sur 59 familles avec au moins un parent dyslexique. Comme dans l'étude précédente, les critères exclusionnaires classiques ont été pris en compte (en particulier, problèmes visuels, émotionnels et médicaux). Les enfants ont été suivis de 4 ans à 6 ans. À 4 ans, les évaluations ont porté sur les compétences non verbales (test de dessin du bonhomme), le niveau de vocabulaire (en désignation et en dénomination), la qualité de la syntaxe (longueur des phrases produites) et de la compréhension du langage (rappel d'une histoire). La maîtrise des aspects phonologiques du langage a été évaluée par la qualité de l'articulation, les compétences en répétition de pseudo-mots et par la sensibilité aux rimes. Dans ce dernier cas, les enfants devaient, d'une part, réciter des « nursery rhymes » et, d'autre part, corriger les erreurs produites par l'expérimentateur quand il récitait ces petites poésies en les modifiant. Les évaluations à 6 ans ont porté sur les capacités de lecture et d'écriture, incluant la compréhension. ; Pennington et Lefly, 2001
; Pennington et Lefly, 2001 ), mais également des enfants danois (Petersen et Elbro, 1999
), mais également des enfants danois (Petersen et Elbro, 1999 ) et finlandais (Lyytinen et coll., 1994
) et finlandais (Lyytinen et coll., 1994 ). Dans toutes ces études, alors que les groupes ne diffèrent pas pour les habiletés non verbales, les enfants issus de familles de dyslexiques souffrent de troubles spécifiques et précoces du langage oral. Dans l'étude finlandaise, un dysfonctionnement dans l'activité neurale suscitée par l'écoute de sons de la parole a même été observé très précocement chez eux, à 6 mois (Leppänen et coll., 1999
). Dans toutes ces études, alors que les groupes ne diffèrent pas pour les habiletés non verbales, les enfants issus de familles de dyslexiques souffrent de troubles spécifiques et précoces du langage oral. Dans l'étude finlandaise, un dysfonctionnement dans l'activité neurale suscitée par l'écoute de sons de la parole a même été observé très précocement chez eux, à 6 mois (Leppänen et coll., 1999 ; Leppänen et coll., 2002
; Leppänen et coll., 2002 ).
). ; Aram et Hall, 1989
; Aram et Hall, 1989 ; Bishop et Adams, 1990
; Bishop et Adams, 1990 ; Catts, 1993
; Catts, 1993 ; Billard et coll., 1994
; Billard et coll., 1994 ; Stothard et coll., 1998
; Stothard et coll., 1998 ; Snowling et coll., 2000
; Snowling et coll., 2000 ).
). ) n'ont relevé que 4 dyslexiques à 8 ans et demi (6 %), 2 ayant également des difficultés de compréhension en lecture, plus 2 autres enfants qui n'étaient déficitaires que dans ce dernier domaine.
) n'ont relevé que 4 dyslexiques à 8 ans et demi (6 %), 2 ayant également des difficultés de compréhension en lecture, plus 2 autres enfants qui n'étaient déficitaires que dans ce dernier domaine. ). Les résultats sont présentés dans le tableau 9.VI
). Les résultats sont présentés dans le tableau 9.VI . La proportion des dyslexiques passe de 6 % à 43 %, 25 % d'entre eux souffrant uniquement de troubles spécifiques de lecture. De même, celle des enfants ayant des problèmes de compréhension écrite augmente de 6 à 23 %, parmi lesquels 5,4 % ne sont en difficultés que dans ce domaine. D'après ces données, approximativement la moitié des dysphasiques ont donc également des difficultés sévères de lecture.
. La proportion des dyslexiques passe de 6 % à 43 %, 25 % d'entre eux souffrant uniquement de troubles spécifiques de lecture. De même, celle des enfants ayant des problèmes de compréhension écrite augmente de 6 à 23 %, parmi lesquels 5,4 % ne sont en difficultés que dans ce domaine. D'après ces données, approximativement la moitié des dysphasiques ont donc également des difficultés sévères de lecture.  )
)
 ), les prédicteurs des futures difficultés de lecture sont les mêmes dans cette population que dans les autres. Il s'agit principalement des capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que des compétences en dénomination rapide. Toutefois, le niveau cognitif des enfants dysphasiques a une forte incidence sur leur futur niveau de lecture, probablement parce que ceux qui ont une intelligence supérieure à la normale sont plus aptes que les autres à mettre en œuvre des stratégies compensatoires (Snowling et coll., 2000
), les prédicteurs des futures difficultés de lecture sont les mêmes dans cette population que dans les autres. Il s'agit principalement des capacités d'analyse et de mémoire phonologique, ainsi que des compétences en dénomination rapide. Toutefois, le niveau cognitif des enfants dysphasiques a une forte incidence sur leur futur niveau de lecture, probablement parce que ceux qui ont une intelligence supérieure à la normale sont plus aptes que les autres à mettre en œuvre des stratégies compensatoires (Snowling et coll., 2000 ).
). ), elle n'a pas reçu, au moins jusqu'à présent, de larges confirmations. En effet, en dehors de l'étude de Goulandris et Snowling (1991
), elle n'a pas reçu, au moins jusqu'à présent, de larges confirmations. En effet, en dehors de l'étude de Goulandris et Snowling (1991 ), des déficits mnésiques visuels n'ont pas été relevés chez des dyslexiques de surface.
), des déficits mnésiques visuels n'ont pas été relevés chez des dyslexiques de surface. ), tout comme dans des études de séries des cas, par exemple, chez RO, MF et AR (Seymour, 1986
), tout comme dans des études de séries des cas, par exemple, chez RO, MF et AR (Seymour, 1986 ). Toutefois, comme dans les études de groupes (Hutzler et Wimmer, 2004
). Toutefois, comme dans les études de groupes (Hutzler et Wimmer, 2004 ), les résultats des études publiées ne permettent pas de soutenir l'hypothèse que ce déficit est à l'origine de la dyslexie, ou d'une forme particulière de dyslexie, pour trois raisons. D'une part, les déficits visuels relevés chez les dyslexiques peuvent simplement être la conséquence de leurs difficultés de lecture, vu que pratiquement toutes les études dans ce domaine ont comparé des dyslexiques à des normolecteurs de même âge chronologique, à la différence des études qui ont mis en relief les déficits phonologiques (excepté celles de Paulesu et coll., 2001
), les résultats des études publiées ne permettent pas de soutenir l'hypothèse que ce déficit est à l'origine de la dyslexie, ou d'une forme particulière de dyslexie, pour trois raisons. D'une part, les déficits visuels relevés chez les dyslexiques peuvent simplement être la conséquence de leurs difficultés de lecture, vu que pratiquement toutes les études dans ce domaine ont comparé des dyslexiques à des normolecteurs de même âge chronologique, à la différence des études qui ont mis en relief les déficits phonologiques (excepté celles de Paulesu et coll., 2001 et de Lindgren et coll., 1985
et de Lindgren et coll., 1985 ). D'autre part, ce type de déficit est toujours plus marqué sur les pseudo-mots que sur des mots ou des suites de lettres non prononçables (Seymour, 1986
). D'autre part, ce type de déficit est toujours plus marqué sur les pseudo-mots que sur des mots ou des suites de lettres non prononçables (Seymour, 1986 ; Hanley et coll., 1992
; Hanley et coll., 1992 ). Enfin, dans la plupart des études signalant des déficits visuels spécifiques, les habiletés visuelles des dyslexiques, mais pas leurs habiletés phonologiques, ont été évaluées en tenant compte de la vitesse de traitement et/ou avec des tâches comportant des contraintes temporelles (par exemple, durée très brève d'exposition des stimuli). Il est donc difficile d'affirmer que les habiletés phonologiques de ces dyslexiques étaient préservées. Dans quelques rares études, les habiletés phonologiques et visuelles ont été examinées en utilisant des méthodologies comparables (par exemple, Seymour, 1986
). Enfin, dans la plupart des études signalant des déficits visuels spécifiques, les habiletés visuelles des dyslexiques, mais pas leurs habiletés phonologiques, ont été évaluées en tenant compte de la vitesse de traitement et/ou avec des tâches comportant des contraintes temporelles (par exemple, durée très brève d'exposition des stimuli). Il est donc difficile d'affirmer que les habiletés phonologiques de ces dyslexiques étaient préservées. Dans quelques rares études, les habiletés phonologiques et visuelles ont été examinées en utilisant des méthodologies comparables (par exemple, Seymour, 1986 ). Or, sur les 21 cas de dyslexie examinés par ce chercheur, un déficit supposé spécifique aux traitements visuels n'a été relevé que chez 3 sujets (RO, MF et AR). Ils avaient cependant tous des performances plus fortement affectées par les effets de longueur en lecture de pseudo-mots qu'en lecture de mots ou dans des tâches purement visuelles de comparaison de chaînes de lettres. En plus, ces trois dyslexiques avaient tous une histoire de troubles phonologiques.
). Or, sur les 21 cas de dyslexie examinés par ce chercheur, un déficit supposé spécifique aux traitements visuels n'a été relevé que chez 3 sujets (RO, MF et AR). Ils avaient cependant tous des performances plus fortement affectées par les effets de longueur en lecture de pseudo-mots qu'en lecture de mots ou dans des tâches purement visuelles de comparaison de chaînes de lettres. En plus, ces trois dyslexiques avaient tous une histoire de troubles phonologiques. ). Ainsi, des enfants issus de milieux moins favorisés peuvent avoir été moins souvent confrontés à l'écrit et moins aidés pour dépasser leur handicap que des dyslexiques qui évoluent dans un environnement susceptible de les motiver à apprendre à lire en dépit de la difficulté de cet apprentissage. Cette explication peut rendre compte du fait que le déficit phonologique des dyslexiques de surface est moins marqué que leur déficit orthographique, l'acquisition des représentations orthographiques nécessitant une bonne confrontation avec l'écrit. Elle est confortée par des données suggérant que les déficits orthographiques s'expliqueraient par des facteurs environnementaux, alors que l'origine des déficits phonologiques pourrait être génétique (Castles et coll., 1999
). Ainsi, des enfants issus de milieux moins favorisés peuvent avoir été moins souvent confrontés à l'écrit et moins aidés pour dépasser leur handicap que des dyslexiques qui évoluent dans un environnement susceptible de les motiver à apprendre à lire en dépit de la difficulté de cet apprentissage. Cette explication peut rendre compte du fait que le déficit phonologique des dyslexiques de surface est moins marqué que leur déficit orthographique, l'acquisition des représentations orthographiques nécessitant une bonne confrontation avec l'écrit. Elle est confortée par des données suggérant que les déficits orthographiques s'expliqueraient par des facteurs environnementaux, alors que l'origine des déficits phonologiques pourrait être génétique (Castles et coll., 1999 ; Olson et coll., 1999
; Olson et coll., 1999 ).
). ; Perfetti et coll., 1979
; Perfetti et coll., 1979 ; Raduege et Swantes, 1987
; Raduege et Swantes, 1987 ), les lecteurs les moins habiles, et particulièrement les dyslexiques, utilisant plus le contexte que les bons lecteurs (Bruck, 1990
), les lecteurs les moins habiles, et particulièrement les dyslexiques, utilisant plus le contexte que les bons lecteurs (Bruck, 1990 ).
). ), le cas JM développe progressivement des stratégies compensatoires. C'est ce qu'indiquent les effets facilitateurs d'un amorçage sémantique en lecture de pseudo-mots (le pseudo-mot « sawce » présenté après le mot « tomato ») observés chez lui quand il avait 13 ans, mais pas auparavant.
), le cas JM développe progressivement des stratégies compensatoires. C'est ce qu'indiquent les effets facilitateurs d'un amorçage sémantique en lecture de pseudo-mots (le pseudo-mot « sawce » présenté après le mot « tomato ») observés chez lui quand il avait 13 ans, mais pas auparavant. ), les performances de la plupart des dyslexiques ayant un déficit phonologique sévère sont meilleures quand les pseudo-mots se prononcent comme des mots de la langue. C'est également ce que suggère le fait qu'ils réussissent mieux les tâches phonologiques hors lecture quand elles impliquent des mots simples et fréquents (Snowling et coll., 1986
), les performances de la plupart des dyslexiques ayant un déficit phonologique sévère sont meilleures quand les pseudo-mots se prononcent comme des mots de la langue. C'est également ce que suggère le fait qu'ils réussissent mieux les tâches phonologiques hors lecture quand elles impliquent des mots simples et fréquents (Snowling et coll., 1986 a
a ; Bruck et Treiman, 1990
; Bruck et Treiman, 1990 ; Bruck, 1992
; Bruck, 1992 ; Swan et Goswami, 1997a
; Swan et Goswami, 1997a et b
et b ).
). ), les trois adolescents ne présentant pas de déficit phonologique majeur lors des observations effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans ayant tous présenté antérieurement un trouble phonologique, soit un retard de développement du langage oral (RO and MF), soit un déficit phonologique en lecture (AR, Seymour et Porpodas, 1980
), les trois adolescents ne présentant pas de déficit phonologique majeur lors des observations effectuées alors qu'ils avaient entre 14 et 17 ans ayant tous présenté antérieurement un trouble phonologique, soit un retard de développement du langage oral (RO and MF), soit un déficit phonologique en lecture (AR, Seymour et Porpodas, 1980 ).
). ; voir également Sprenger-Charolles et coll.,
; voir également Sprenger-Charolles et coll.,  sous presse), le fait que les mêmes déficits aient été relevés chez les dyslexiques dans différents contextes linguistiques (en anglais, en allemand, en hollandais, en français, en italien, en espagnol...) dans des tâches impliquant des traitements phonémiques en lecture (faible maîtrise des correspondances graphème-phonème attestées par des scores particulièrement déficitaires en lecture de pseudo-mots, quand il n'est pas possible de s'appuyer sur des compétences lexicales pour lire) et hors lecture (en particulier, en analyse phonémique) est difficile à concilier avec l'idée qu'il puisse y avoir des sous-types de dyslexie fortement contrastés. Ce constat s'applique aux études de groupes et les résultats d'études de série de cas de dyslexiques vont dans le même sens. Ainsi, comme le soulignait Seymour (1986
sous presse), le fait que les mêmes déficits aient été relevés chez les dyslexiques dans différents contextes linguistiques (en anglais, en allemand, en hollandais, en français, en italien, en espagnol...) dans des tâches impliquant des traitements phonémiques en lecture (faible maîtrise des correspondances graphème-phonème attestées par des scores particulièrement déficitaires en lecture de pseudo-mots, quand il n'est pas possible de s'appuyer sur des compétences lexicales pour lire) et hors lecture (en particulier, en analyse phonémique) est difficile à concilier avec l'idée qu'il puisse y avoir des sous-types de dyslexie fortement contrastés. Ce constat s'applique aux études de groupes et les résultats d'études de série de cas de dyslexiques vont dans le même sens. Ainsi, comme le soulignait Seymour (1986 ), qui est un des rares chercheurs a avoir examiné finement les déficits phonologiques et visuo-attentionnels avec des méthodologies comparables, tous les dyslexiques de sa cohorte présentaient des troubles phonologiques qui se manifestaient en lecture de pseudomots par la faible précision et/ou la lenteur de leurs réponses ainsi que par les effets de longueur, ce pattern dominant étant parfois accompagné de quelques signes des déficiences visuelles. En l'état de la recherche, les preuves à l'appui d'un déficit visuel à l'origine de la dyslexie (ou de certaines formes de dyslexie) sont fragiles.
), qui est un des rares chercheurs a avoir examiné finement les déficits phonologiques et visuo-attentionnels avec des méthodologies comparables, tous les dyslexiques de sa cohorte présentaient des troubles phonologiques qui se manifestaient en lecture de pseudomots par la faible précision et/ou la lenteur de leurs réponses ainsi que par les effets de longueur, ce pattern dominant étant parfois accompagné de quelques signes des déficiences visuelles. En l'état de la recherche, les preuves à l'appui d'un déficit visuel à l'origine de la dyslexie (ou de certaines formes de dyslexie) sont fragiles.