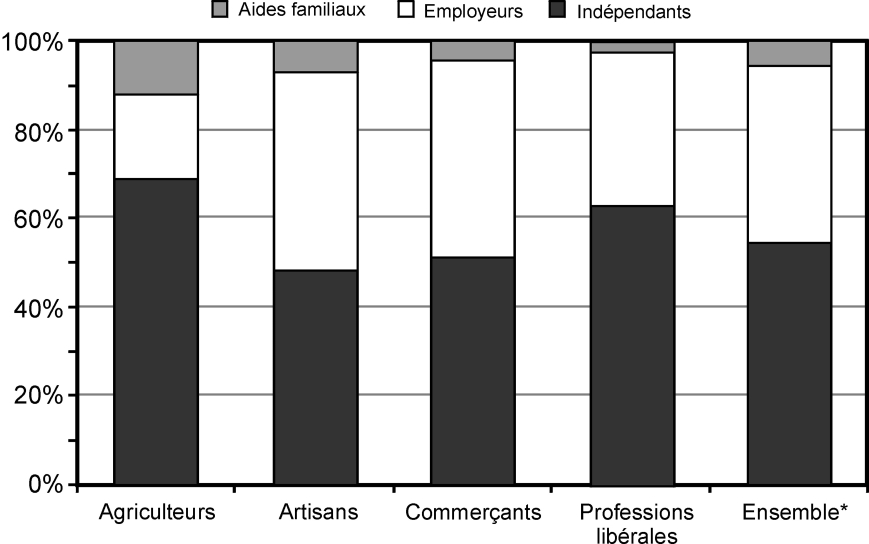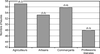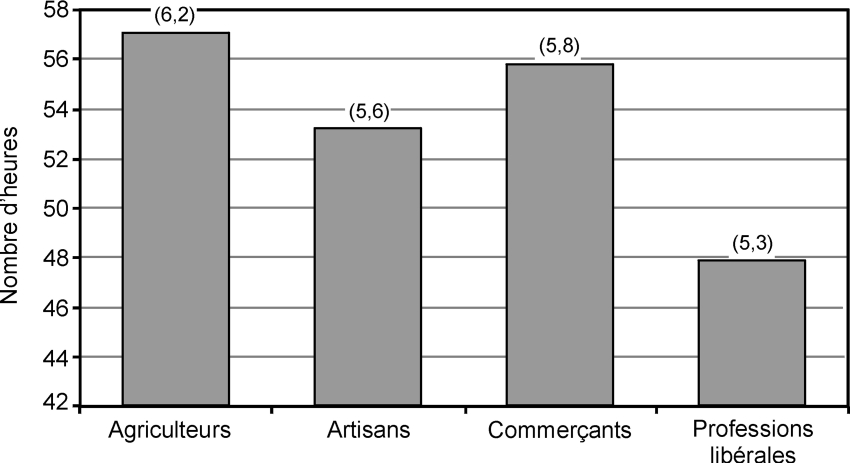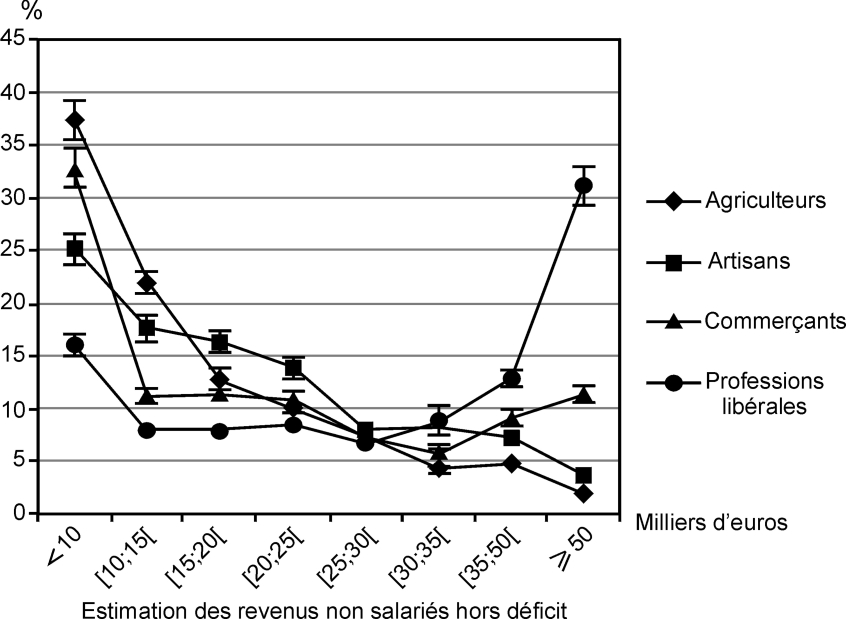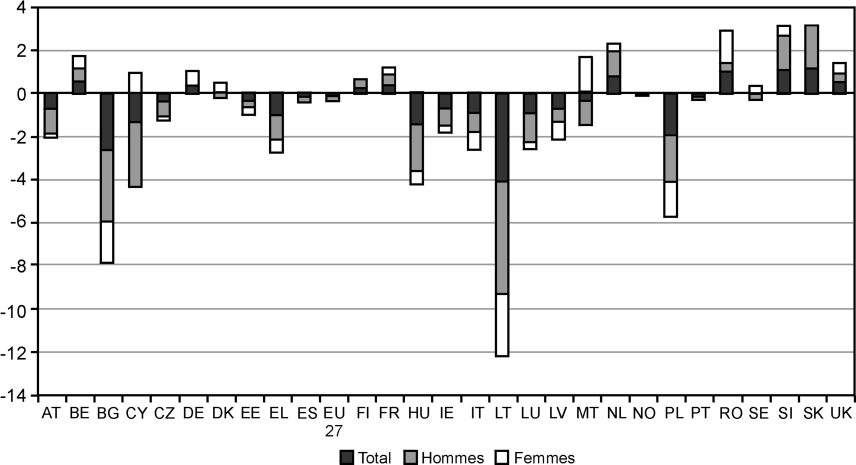2011
→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE
Travailleurs indépendants : des normes aux faits
Qui sont les travailleurs indépendants ? Pour anodine qu’elle puisse paraître, cette question n’appelle pas de réponse évidente. Généralement, les indépendants sont assimilés à ceux qui dirigent une entreprise, qui sont entrepreneurs, qui travaillent à leur compte ou en freelance. Ces typologies simplificatrices masquent toutefois l’hétérogénéité considérable caractérisant les travailleurs indépendants. Il n’est donc pas surprenant d’observer de nombreuses nomenclatures concurrentes. L’analyse qui en est proposée invite à élaborer une typologie cohérente susceptible de préserver un certain degré d’homogénéité comportementale au sein de la population visée. Un portrait sociodémographique général complète cette approche. La fragilité des conditions permettant la pleine réalisation de l’indépendance est ensuite abordée.
Cette contribution vise à préciser quelques caractéristiques fondamentales du domaine de recherche consacré aux indépendants. La nécessité d’élaborer un cadre normatif cohérent préalablement à toute investigation est ainsi soulignée. Les principaux traits sociodémographiques propres aux indépendants sont ensuite rappelés. Un éclairage portant sur les conditions effectives de la réalisation d’une activité indépendante et leurs limites est finalement apporté.
De l’indépendance aux travailleurs indépendants
L’indépendance est avant tout un attribut défini légalement. Sur cette base fondamentale, une première typologie officielle met en exergue les différents statuts pouvant supporter cet attribut au regard de la structure entrepreneuriale encadrant l’activité du travailleur. Toutefois, l’observation des typologies retenues à l’occasion d’études empiriques fait émerger une absence patente de consensus ontologique.
À la source de l’indépendance : le Code du travail
Tout l’esprit de l’indépendance est synthétisé par un simple article du Code du travail
1
stipulant qu’est « présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Permettant enfin l’inscription explicite de l’appellation « travailleur indépendant » au sein du Code, cet article vulgarise de surcroît les termes juridiques préexistants de l’indépendance
2
.
Ainsi, l’autonomie décisionnelle dont est supposé être doté l’indépendant constitue l’assise de sa position sur le marché du travail. Elle se traduit dans les faits par une organisation du travail gouvernée par trois attributs indissociables :
• la réalisation des tâches effectuées par le travailleur ne répond à aucune directive hiérarchique ;
• la supervision de l’activité incombe au travailleur ;
• les manquements du travailleur dans son activité ne font pas l’objet de sanctions disciplinaires.
Au regard des conditions de réalisation de l’activité, le législateur s’est donc attaché à définir l’indépendance en forgeant un antonyme juridique du salariat. En effet, le travailleur salarié est juridiquement subordonné à son employeur, ce qui le place dans une position strictement inverse vis-à-vis des trois points énoncés. Sous cet éclairage, il n’est pas surprenant que l’indépendant soit qualifié de travailleur « non-subordonné » par le juriste ou de « non-salarié » par les instances fiscales et administratives.
Toutefois, si le principe de non-subordination assure une forme de souveraineté absolue du travailleur sur son activité, sa mise en pratique est soumise à certaines limites d’origine conventionnelle. Le contrat d’entreprise
3
conclu par l’indépendant avec un donneur d’ordre peut prévoir des clauses atténuant plus ou moins la portée des attributs fondamentaux de l’indépendance. Le contrat de sous-traitance, intégrant un cahier des charges très contraignant tant sur les processus de production que sur les délais de livraison, en est la meilleure illustration. La perte d’autonomie concédée par l’indépendant résulte cependant de la négociation des termes du contrat. C’est d’ailleurs pour parer à tout risque d’instauration d’une relation de subordination effective entre le donneur d’ordre et le prestataire que la qualité d’indépendant n’est pas irréfragable. Le cas échéant, le contrat d’entreprise peut être juridiquement requalifié en contrat de travail avec des conséquences notables en termes de paiement de charges pour le donneur d’ordre
4
.
D’autre part, le choix de l’indépendance pour un travailleur induit un coût notable mesuré en termes de risques pris dans les domaines juridiques, sociaux et économiques. À l’inverse du salariat où la plus grande part de ces risques sont reportés sur l’employeur – la relation de subordination justifie cette configuration – l’indépendant les assume directement. Ainsi, le défaut de paiement de la part d’un client, l’incapacité temporaire de travailler ou la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale en cas de contentieux juridique sont autant d’écueils mettant en péril son activité et, à terme, son emploi. Ces aléas sont démultipliés lorsqu’il exerce sous l’égide d’une entreprise individuelle
5
. Dans ce cas, il est indéfiniment responsable des dettes sociales de l’entreprise et, dans la mesure où la personnalité morale de l’entreprise est confondue avec celle du travailleur, les dettes professionnelles sont garanties par ses biens propres. Le passage à une forme sociale de type EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou SARL (Société anonyme à responsabilité limitée) permet d’atténuer ces risques financiers par la distinction du patrimoine social et personnel, mais n’assure en rien la pérennité de l’emploi.
Sous cet éclairage, la typologie juridique de l’indépendant fondée sur la présomption de non-subordination du travailleur véhicule une représentation sociologique exempte de neutralité. Celle-ci plonge ses racines dans la littérature économique classique dédiée à l’entrepreneur qui, depuis la publication de l’« Essai sur la nature du commerce en général » en 1755 de Richard Cantillon, s’attache à décrire un individu « risquophile » animé par un esprit d’initiative et d’indépendance prégnant. Toutefois, ces seules considérations forment une vision trop parcellaire des travailleurs indépendants. De fait, l’indépendance n’a de cohérence qu’au regard de l’activité professionnelle qu’elle encadre au sein d’une structure entrepreneuriale.
Professionnels indépendants
Une des finalités de la délimitation des frontières du non-salariat s’inscrit dans une logique de structuration de la Sécurité sociale. Dès sa constitution, les indépendants ont systématiquement rejeté les principes d’un système universaliste s’étendant à l’ensemble des travailleurs sans distinction de statut. Les spécificités professionnelles et patrimoniales caractérisant les non-salariés sont alors mises en avant pour justifier d’un calcul de cotisations spécifique à leur situation
6
. Le législateur accède à ces revendications en créant des régimes propres à chacune des familles de professionnels indépendants : les artisans, les commerçants et industriels, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux. Actuellement, un mouvement d’homogénéisation des régimes est observable consécutivement à la création du Régime social des indépendants (RSI) qui gère tout ou partie des risques sociaux des non-salariés non-agricoles
7
. La protection sociale des exploitants agricoles reste du ressort de la Mutualité sociale agricole (MSA).
Si la qualité d’indépendant rend obligatoire l’inscription et les cotisations à l’un de ces régimes, il s’avère que le non-salariat recouvre des statuts professionnels variés. Au regard de la Sécurité sociale, est ainsi réputé non-salarié :
• l’entrepreneur individuel, dont la personnalité juridique est indissociable de celle de l’entreprise ;
• l’associé d’une société civile professionnelle, le membre d’une société en participation, le membre d’une société de fait. Dans ces structures juridiques, pouvant être assimilées à des regroupements de professionnels non-salariés cherchant à améliorer les conditions d’exercice de leur activité, les membres conservent leur statut juridique originel ;
• le commandité d’une société en commandite simple ou par action ;
• l’associé unique d’une EURL ;
• le gérant majoritaire d’une SARL, l’associé exerçant une activité non-salariée au sein d’une SARL, le gérant d’un collège de gérance majoritaire ;
• l’associé d’une société en nom collectif ;
• le conjoint associé ;
• le conjoint collaborateur et l’aide familial.
Cette typologie offre un premier filtre d’observation des indépendants fondé sur le seul critère juridique. Sa composition appelle quelques commentaires que le chercheur doit garder à l’esprit lors de ses investigations. En premier lieu, le non-salariat est avant tout un attribut ayant un sens au regard de la protection sociale. Ainsi, le gérant majoritaire de SARL ou l’associé unique d’une EURL relèvent bien du régime social des non-salariés, mais peuvent relever du régime fiscal des salariés en fonction du mode d’imposition choisi pour la société. Dans le cadre d’une enquête, il peut donc exister un biais d’interprétation de la réponse au regard du statut fiscal du répondant. D’autre part, au sein d’une société, le rôle effectif des associés bénéficiant du statut de non-salarié réclame une certaine attention. Il n’est pas certain que les ressorts comportementaux animant l’indépendant impliqué physiquement dans le processus de production soient identiques à ceux prévalant pour un simple apporteur de capitaux (Storey, 1991

). Un questionnement de même nature doit être envisagé lorsque sont considérés le conjoint collaborateur ou l’aide familial qui participent activement à l’activité de l’entreprise sans recevoir de rémunération pécuniaire (Laferrère, 2000

).
Une alternative à l’ontologie strictement juridique est envisageable par le recours à la nomenclature des positions dans l’emploi pour les actifs retenue par l’Insee. Celle-ci intègre trois classes dédiées aux non-salariés :
• les indépendants, classe qui recouvre les non-salariés pilotant leur activité sans recourir à de la main d’œuvre salariée ;
• les employeurs qui regroupent tous les non-salariés faisant appel à de la main d’œuvre salariée ;
• les aides familiaux.
La dichotomie opérée entre les indépendants et les employeurs participe d’une recherche d’homogénéité comportementale fondée sur la taille de l’entreprise. Toutefois, la sémantique retenue porte fréquemment à confusion. La qualité d’indépendant est entendue dans un sens restrictif relativement à la définition privilégiée par le Législateur. Cette modulation définitionnelle dévoile le principal écueil que rencontre le chercheur au cours de ses investigations : bien qu’une norme juridique soit établie, aucun consensus ontologique émerge des approches empiriques de l’indépendance.
Choix nécessaire d’un empirisme normatif
Parallèlement au traitement typologique de l’associé et de l’aide familial, le polymorphisme définitionnel de l’indépendant est prégnant au sein des contributions empiriques tant internationales que nationales. Il est principalement lié à la prise en compte de la structure de l’entreprise dirigée par le non-salarié
8
. Sous cet éclairage, quatre typologies alternatives émergent :
• les entreprises individuelles unipersonnelles (Carroll et Holtz-Eakin, 1996

) ;
• l’ensemble des entreprises individuelles qu’elles soient ou non dotées de masse salariale (Henley, 2005

; Lurton et Toutlemonde, 2007

) ;
• l’ensemble des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles (Parker et Robson, 2004

; Burke et coll., 2008

) ;
• l’ensemble des entreprises individuelles et des sociétés avec ou sans masse salariale (Ajayi-Obe et Parker, 2005

; Constant et Zimmermann, 2006

).
Ces variations typologiques participent de l’acceptation plus ou moins implicite de postulats comportementaux opposant, d’une part, l’entrepreneur individuel au gérant de société et les non-employeurs aux employeurs d’autre part. La première opposition semble fondée au regard des risques économiques supportés par le non-salarié, ceux-ci étant plus limités – au moins en termes de capital personnel – dans le cadre d’une société. La seconde opposition relève du comportement entrepreneurial. L’employeur est ainsi directement assimilé à un chef d’entreprise alors que le non-employeur s’apparente à un travailleur faisant le choix d’exercer son emploi sous l’égide d’une autonomie presque parfaite. Néanmoins, rien ne garantit la robustesse de ces antagonismes. Ainsi, le gérant majoritaire d’une petite SARL partage sans conteste beaucoup plus de points communs avec un consultant indépendant qu’avec le dirigeant d’une société de plus de cinquante salariés.
À la lumière de ces éléments, une alternative typologique peut être envisagée. Il est largement admis que le fonctionnement d’une très petite entreprise – quelle que soit sa structure juridique – repose presque intégralement sur l’activité, la personnalité et la rationalité de son dirigeant (Charpentier et Lepley, 2003

; Torres, 2003

). Parallèlement, les approches sociologiques soulignent l’importance du métier dans la construction de l’identité sociale des non-salariés (Gresle, 1981

; Zarca, 1988

). Des travaux sociométriques viennent confirmer ces analyses (Beugelsdijk et Noorderhaven, 2005

; Garner et coll., 2006

). Dès lors, il convient certainement d’intégrer un critère fondé sur la pratique effective du métier, quels que soient le statut du non-salarié et la structure de son entreprise. Bien que délicate, cette approche laisse espérer une assez grande homogénéité comportementale par l’intégration de l’objet premier du travail indépendant : l’exercice de la profession.
Ce dernier critère n’est pas sans relation avec la détermination d’une taille d’entreprise critique au-delà de laquelle l’entrepreneur n’est plus réellement un homme de métier mais un dirigeant d’entreprise. Un tel seuil constitue d’ailleurs l’un des attributs réglementaires permettant de définir une entreprise artisanale qui ne doit pas excéder dix salariés
9
. Dès la création des Chambres de métiers en 1925, il a été imposé par les organisations professionnelles de l’artisanat, ces dernières ayant exigé que la qualité d’artisan soit accordée aux seuls entrepreneurs qui exercent effectivement le métier afin de l’interdire aux simples employeurs de main d’œuvre artisanale. La taille de l’entreprise peut donc constituer un critère cohérent même si le choix du seuil optimal appelle une certaine circonspection. L’objectif de la présente contribution n’étant pas d’arrêter une typologie, l’approche socioéconomique subséquente est dédiée aux travailleurs non-salariés dans leur ensemble.
Tableau socioéconomique des indépendants
Parallèlement à la prise en compte des nomenclatures statutaires et empiriques, l’observation des caractéristiques socioéconomiques d’ordre général peut aider à la détermination du champ d’observation. Dans cette optique, les principales caractéristiques des entreprises pilotées par les non-salariés sont abordées. Ce panorama est complété par une approche comparative mettant en exergue les spécificités sociodémographiques des non-salariés par rapport aux salariés, mais aussi des différents types de non-salariés – les indépendants, les employeurs et les aides familiaux – qui s’avère riche d’enseignements.
Non-salariés et leurs entreprises
Globalement, force est de constater que les non-salariés jouent un rôle primordial dans le tissu économique. Au niveau national, ils dirigent 89 % des entreprises tous secteurs confondus. Pourtant, leur place dans la population active occupée reste modeste. Selon les données de l’enquête emploi en continu (Insee, 2008

), 10,8 % des actifs occupés – soit 2,8 millions d’individus – sont non-salariés. Bien que cette proportion soit la plus faible observée depuis 2003, elle reste dans une tendance laissant entrevoir un accroissement de la population des non-salariés dans les décennies à venir (Rapelli et Lespagnol, 2007

). Comme le montre la figure 1

, près de 54 % des non-salariés sont des indépendants au sens de l’Insee (non-employeurs). La part des aides familiaux est très faible – moins de 6 % – et tend à décroître régulièrement. Cette évolution participe d’un double phénomène : la diminution continue des effectifs non-salariés du secteur agricole et la recherche d’un statut garantissant une meilleure couverture sociale. Toutefois, le détail des familles professionnelles met en valeur quelques contrastes notables.
Avec un effectif de 750 000 individus, les commerçants représentent 27 % des actifs non-salariés. Il est à noter que la définition du commerçant est relativement souple puisqu’elle est fondée sur l’acte commercial. Ainsi, sont considérés comme commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et dont ils font leur profession habituelle. Plus de la moitié d’entre eux n’emploient pas de main d’œuvre salariée. De fait, les entreprises du secteur sont de taille plutôt modeste : 85 % d’entre elles comptent moins de cinq salariés. Toutefois, cette faiblesse des effectifs ne doit pas masquer une réelle importance économique dans la mesure où les très petites entreprises (de un à neuf salariés) génèrent plus d’un quart de l’emploi salarié total du secteur. Bien que les structures entrepreneuriales soient de taille réduite, il est à noter que les commerçants exercent majoritairement dans le cadre d’une société de type SARL ou EURL. Cette caractéristique participe d’une stratégie de protection du patrimoine personnel au regard des risques économiques liés à la gestion des stocks de marchandises. En outre, si la place des aides familiaux s’est considérablement réduite au cours des dernières décennies, la dimension familiale de l’entreprise reste encore perceptible puisque trois salariés sur dix sont membres de la famille – le plus fréquemment conjointe ou conjoint – du non-salarié.
En revanche, le caractère familial de l’activité reste très présent chez les artisans. Certes, les nouvelles générations ont délaissé le statut d’aide familial qui est adopté par 7 % seulement des 717 000 non-salariés de l’artisanat. En revanche, près de trois fois sur cinq, le capital des sociétés est détenu par le cercle familial du non-salarié et deux artisans employeurs sur cinq ont recruté au moins un membre de leur famille. Les entreprises artisanales sont néanmoins un véritable moteur d’emploi : plus de la moitié d’entre elles possède au moins un salarié. D’autre part, l’esprit entrepreneurial semble particulièrement enraciné chez les artisans. Ils sont 55 % à exercer sous l’égide d’une entreprise individuelle, alors même que la charge financière du capital productif est souvent importante et que les risques de l’activité, tant physiques qu’économiques, sont prégnants. Bien que la proportion ait été réduite de sept points en une décennie, cette préférence statutaire est certainement la marque d’un attachement profond des artisans à leur métier et à leur entreprise. Cet attribut est d’ailleurs souvent mis en exergue (Zarca, 1986

et 1988

).
Pour des raisons fondamentalement différentes, l’entreprise individuelle est la structure entrepreneuriale qui prévaut dans l’exercice d’une profession libérale. En effet, elle est adoptée par 77 % des 650 000 professionnels libéraux et assimilés. Parallèlement, seul un tiers d’entre eux est employeur et le recours aux aides familiaux est très rare. Cette configuration est en prise directe avec les spécificités des activités exercées qui consistent (selon les définitions en vigueur) à apporter des services non-commerciaux sous des formes juridiquement, économiquement et politiquement indépendantes. Elles sont essentiellement de nature intellectuelle et requièrent donc un faible investissement en capital physique relativement aux autres professions indépendantes. En outre, des dispositions légales autorisent les ressortissants des professions réglementées
10
à exercer au sein d’une société civile professionnelle sans perdre leur personnalité juridique individuelle. À la lumière de ces éléments, la structuration entrepreneuriale des professions libérales semble donc cohérente avec le rôle central conféré au praticien dans l’accomplissement courant de l’activité, quels que soient les techniques, les connaissances ou l’art qu’il maîtrise.
Le secteur des activités agricoles est lui aussi marqué par un faible nombre d’employeurs qui représentent moins de 20 % des 539 000 exploitants agricoles. Une productivité du travail importante due à une mécanisation importante, la faible valorisation pécuniaire des productions, mais surtout le rôle prédominant des membres de la famille dans l’activité des exploitations contribuent à la compression des effectifs salariés. De fait, trois quarts des entreprises n’emploient aucun salarié, mais 12 % des non-salariés agricoles sont recensés sous le statut d’aide familial. L’entreprise agricole est d’ailleurs avant tout une entreprise familiale. En effet, 47 % des exploitants exercent dans le cadre d’une société et les parts sociales sont détenues par des membres de la famille près de trois fois sur cinq.
Caractéristiques sociodémographiques
La première spécificité de la population des non-salariés émerge de la pyramide des âges. Ils sont en moyenne plus âgés que les salariés : 45,5 ans contre 39,5 ans respectivement. Si les non-salariés liquident plus tardivement leurs droits à la retraite, cette configuration est aussi à rapprocher de l’âge moyen de la mise à son compte qui s’établit à 38,5 ans. La constitution d’un capital entrepreneurial, l’accumulation d’une expérience préalable favorisant le développement de réseaux professionnels sont des paramètres qui peuvent, en partie, expliquer cette particularité. De fait, l’entrée dans l’indépendance par le biais de la reprise d’une entreprise familiale s’effectue à un âge beaucoup moins avancé (26 ans). L’approche sectorielle montre que les non-salariés sont en moyenne plus âgés dans les secteurs du commerce et de l’agriculture. Dans le premier cas, la configuration est inhérente à la forte attraction qu’exerce le secteur sur les créateurs d’entreprise âgés de 50 ans et plus. En revanche, l’agriculture est clairement marquée par une carence dans le renouvellement des générations.
La population des non-salariés se distingue aussi par une répartition sexuelle très inégalitaire. Si la parité est presque de mise pour les salariés, les femmes non-salariées sont en revanche 2,17 fois moins nombreuses que leurs homologues masculins. Elles sont moins d’un tiers à faire appel à de la main d’œuvre salariée, alors que plus de 44 % des hommes sont des employeurs. Par ailleurs, elles représentent 71,7 % des aides familiaux. Il convient de souligner que dans ce rôle, elles sont en charge d’activités essentielles à la conduite de l’entreprise telles que la gestion courante, la comptabilité ou la relation avec la clientèle (Zarca, 1986

). D’autre part, l’asymétrie observée s’inverse lorsqu’est considéré le détail des métiers. Ainsi, plus de huit psychothérapeutes ou infirmiers libéraux sur dix sont des femmes. Elles représentent plus de 70 % des artisans coiffeurs, des manucures, des esthéticiens et des traducteurs-interprètes. Elles sont aussi majoritaires dans certains segments du commerce (détaillants en alimentation et en habillement, fleuristes, exploitants de café, hôteliers-restaurateurs) et des professions libérales (avocats, notaires, spécialistes de la rééducation, moniteurs d’auto-école). En revanche, elles restent très minoritaires dans les métiers de l’artisanat du bâtiment.
Au regard du niveau d’enseignement, les non-salariés semblent détenir un niveau de formation plus important que celui des salariés : la part des titulaires d’un diplôme postérieur au baccalauréat est respectivement de 32 % et 29,9 %. Parallèlement, les diplômés d’une formation professionnelle – BTS, DUT, baccalauréat professionnel, CAP, BEP et équivalents – sont sensiblement plus fréquents chez les non-salariés (50,3 %) que chez les salariés (49,2 %). Cette caractéristique est d’ailleurs un peu plus marquée pour les diplômes techniques de type CAP et BEP. La formation scolaire des non-salariés est donc caractérisée par une double orientation pouvant paraître antinomique : un haut niveau de qualification et une formation fondamentalement professionnelle. La présence de différentes familles de métiers couvertes par le non-salariat explique cette configuration.
Ainsi, bien que plus de neuf professionnels libéraux sur dix possèdent au minimum le baccalauréat, la proportion est deux fois moindre pour les commerçants et quatre fois plus réduite pour les artisans. Toutefois, il convient de se garder d’un jugement qualitatif. Ces différences sont l’expression d’un mode d’apprentissage adapté aux professions. Pour les professionnels libéraux, la formation vise la maîtrise d’une science, d’une technique ou d’un art réclamant le plus souvent un apprentissage théorique long sanctionné par une reconnaissance académique formelle. Les commerçants et les artisans s’orientent traditionnellement vers des formations professionnalisantes généralement complétées de manière informelle par une transmission intergénérationnelle de savoir-faire (Rapelli et Piatecki, 2008

). En outre, il faut noter que, dans l’ensemble, les employeurs sont en moyenne plus diplômés que les non-employeurs et que trois quarts des aides familiaux ont un niveau de diplôme inférieur ou égal au CAP. Ces caractéristiques sont sans doute à mettre en relation avec la fonction effective du non-salarié au sein de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur tend à s’apparenter à un gestionnaire d’entreprise au fur et à mesure que l’effectif salarié s’accroît alors que, par définition, l’indépendant reste un homme de métier.
La dichotomie entre les salariés et les non-salariés est encore plus éclatante lorsqu’est considéré le temps de travail. Les premiers déclarent travailler hebdomadairement 37,9 heures en moyenne contre 53,5 heures pour les seconds. Les employeurs sont les non-salariés déclarant le volume horaire le plus important. Ils travaillent 56,7 heures, alors que les indépendants déclarent 52 heures. La différence est en partie imputable à la gestion courante de la main d’œuvre, tant administrative que physique, et à la réalisation de démarches commerciales. Le temps de travail des aides familiaux est estimé à 43,1 heures, mais il reste difficile à évaluer en raison d’une porosité prégnante entre les activités familiales et professionnelles. La décomposition selon les familles de métiers montre que ce sont les agriculteurs et les commerçants qui déclarent le temps de travail le plus important (figure 2

) : 57,1 et 55,7 heures respectivement. Viennent ensuite les artisans (53,2 heures) puis les professionnels libéraux avec 47,8 heures. Il convient toutefois de souligner deux éléments. D’une part, l’intensité du travail
11
est sensiblement la même pour tous les non-salariés. Ils travaillent en moyenne près de 10 heures par jour, même si des variations saisonnières sont à prendre en compte notamment pour les professions agricoles ou l’artisanat du bâtiment dont l’activité reste fortement corrélée au rythme des saisons. D’autre part, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux déclarent à plus de 65 % travailler le soir et à leur domicile. Cette particularité est le signe d’un impact certain de l’exercice du métier sur la vie extra-professionnelle, mais aussi d’un enchevêtrement du capital professionnel et personnel.
Le volume horaire important dont font état les non-salariés n’implique pas nécessairement des revenus très élevés
12
(figure 3

). Ces derniers sont fortement corrélés au secteur d’activité, à l’âge de l’individu, à son ancienneté dans la profession, à la taille de l’entreprise et au sexe (Favre, 2009

). Ainsi, en 2006, les exploitants agricoles tirent un revenu moyen annuel compris entre 6 600 € et 41 800 € qui est, en outre, très dépendant des aides directes. Dans l’artisanat, un entrepreneur individuel sans salarié spécialisé dans les biens de consommation déclare en moyenne 15 000 €, ce montant atteignant 40 200 € pour le gérant d’une SARL de construction. Des revenus similaires sont observés dans le commerce. Les professions libérales sont caractérisées par une très forte amplitude de revenus – de 9 000 € à 198 500 € – qui n’est pas sans rappeler la très forte hétérogénéité des métiers concernés. En effet dans ce groupe, les activités libérales non-réglementées, comme l’enseignement ou certaines prestations de service aux particuliers, côtoient les activités réglementées du droit et de la santé. Or, c’est au sein des professions non-réglementées que se développe un emploi parfois précaire, souvent partiel ou d’appoint.
Il est largement admis qu’en contrepartie de revenus modestes et un temps de travail conséquent, les non-salariés tirent une grande satisfaction de leur emploi (Benz et Frey, 2008

). Outre l’intérêt du travail ou la réalisation de projets entrepreneuriaux, cette satisfaction repose avant tout sur l’autonomie dont jouit le non-salarié. Pourtant, la pratique effective d’une activité indépendante se heurte de plus en plus fréquemment à des restrictions de l’indépendance.
Entraves à l’indépendance
Si, pour un indépendant, le risque « fait partie du jeu » et constitue sans aucun doute une source de satisfaction, il peut dans certaines circonstances dégrader les conditions d’exercice de la profession. Cette limite émerge dès lors que le non-salarié perd tout ou partie de la maîtrise de son activité. Ainsi, une dépendance technique peut émerger dans le cadre de la location-gérance. Cette convention permet au non-salarié d’exploiter librement un fonds de commerce ou un établissement artisanal en contrepartie d’une redevance versée à son propriétaire. Le non-salarié bénéficie donc d’un outil entrepreneurial complet sans devoir supporter des investissements importants. En revanche, si le renouvellement du capital productif échoit au bailleur, l’exploitant perd le contrôle de son outil de travail. Cette configuration se traduit par un risque économique non-maîtrisable dès lors que l’adaptation du capital physique est rendue nécessaire par sa vétusté ou l’évolution de l’environnement économique.
Le risque de dépendance technique est particulièrement sensible lorsque le non-salarié exerce sous l’égide d’un contrat de franchise
13
. Le franchisé acquiert le droit d’exploiter l’enseigne, le savoir-faire et l’exclusivité de la vente des produits et services d’une entreprise partenaire. Il peut, de plus, bénéficier d’une assistance commerciale et/ou technique. Il s’agit d’un engagement de long terme porteur de nombreux attraits pour le franchisé et fondé sur un contrat commercial entre deux entreprises distinctes. Néanmoins, dans les faits ce dernier est dépossédé d’une partie de son indépendance. Il conserve la maîtrise partielle du domaine commercial, mais il est contractuellement contraint d’appliquer strictement les prescriptions du franchiseur attenantes à l’exploitation de l’objet visé par la franchise. Celles-ci portent naturellement sur des obligations de fournitures exclusives, mais concernent parallèlement des domaines aussi divers que les prix de vente, la présentation des locaux et du personnel ou les objectifs commerciaux. En outre, le franchiseur peut exercer un contrôle coercitif du respect des règles d’exploitation. Dès lors, le non-salarié subit de nombreuses contraintes ordinairement appliquées au salarié tout en assumant l’intégralité du risque commercial. En d’autres termes, il se trouve en situation de subordination. La requalification du contrat de franchise en contrat de travail alimente d’ailleurs régulièrement la jurisprudence.
Parallèlement à ces configurations bien identifiées, les situations de subordination techniques et économiques sont devenues relativement fréquentes au cours des vingt dernières années avec le développement de l’externalisation. Cette pratique productive consiste pour une entreprise à confier à un prestataire externe la totalité d’une fonction ou d’un service qu’elle assurait auparavant en interne au moyen de ressources propres (Edouard, 2005

). Parmi toutes les méthodes d’externalisation, l’essaimage retient l’attention. Cette appellation désigne les appuis et accompagnements apportés par une entreprise à un ou plusieurs de ses salariés qui souhaitent créer ou reprendre une activité avec l’objectif de contribuer à leur réussite (Sabot, 2007

). L’accompagnement prend des formes variées comme l’information, l’appui technique, l’apport d’expertise, l’aide financière, le parrainage ou le transfert de brevet. Si l’essaimage constitue une aide effective au passage à l’indépendance, les risques de subordination technique et économique restent prégnants. La nature même des aides apportées ainsi que les relations privilégiées pré-existantes à l’installation entre le prestataire essaimé et l’entreprise externalisante devenant son client en sont la cause. Une relation de pouvoir asymétrique est alors susceptible d’émerger favorisant la mise en place d’un monopsone
14
.
En cas de rupture ou de non-renouvellement de la relation commerciale, cette relation fait courir un risque démesuré sur les revenus d’activité du prestataire. En outre, elle influe directement sur les conditions d’exercice de l’activité. Comme l’enseigne la théorie microéconomique, le monopsone génère un contrôle des prix par l’acheteur. Par un effet d’enchaînement, ce contrôle s’exerce aussi sur les coûts – formels ou non – et les délais de production supportés par le non-salarié. Sous cet éclairage, les biais de subordination sont donc considérables et peuvent plonger le prestataire dans des conditions de travail exécrables. Ces biais sont transposables aux relations de sous-traitance en raison du très haut degré de spécialisation de l’outil productif des sous-traitants qui est le vecteur principal de leur compétitivité. Cette caractéristique rend peu aisée la reconversion de l’entreprise en cas de rejet des conditions édictées par le donneur d’ordre ou de défaillance de ce dernier.
Une autre limite de l’indépendance est inhérente aux conditions dans lesquelles le travailleur choisit le non-salariat. La littérature économique classique repère deux stimuli alternatifs lors du choix de l’indépendance : l’espérance d’un revenu croissant rendu possible par la réalisation d’un projet entrepreneurial dans un contexte économique favorable ou la recherche d’une option professionnelle face au chômage. Si les données d’enquête (Insee, 2009b

) montrent que l’appel de l’indépendance reste un des principaux déterminants de l’entrée dans le non-salariat, l’absence d’emploi est une motivation pour près d’un quart des répondants. En outre, pour 65 % des nouveaux non-salariés, la mise à son compte vise essentiellement à générer leur propre emploi. En 2002, ils n’étaient que 54 % à retenir cet objectif. Enfin, la part des créateurs qui se trouvaient initialement au chômage croît au cours des années, passant de 34 % en 2002 à 40 % en 2006.
Ces quelques éléments laissent à penser que le choix de l’indépendance participe d’une stratégie de refuge face au chômage pour une part croissante des nouveaux non-salariés
15
. Les politiques d’aide à la création d’entreprise renforcent, sans conteste, ce mouvement (Rapelli, 2008

). Un tel phénomène conduit à s’interroger sur une possible précarisation des professions indépendantes et la pérennité des emplois non-salariés créés. Plus encore, le statut d’indépendant et ses caractéristiques socioéconomiques forment un ensemble cohérent aussi longtemps que le travailleur s’expose aux risques qu’il a choisi d’assumer par son mode d’activité et qu’il peut maîtriser. À n’en pas douter, les déterminants de ce choix constituent un moteur comportemental capital.
En conclusion, l’étude comportementale des travailleurs non-salariés ne peut se départir d’un resserrement du champ d’observation. La diversité des conditions de travail et des statuts dans l’emploi appelle une définition cohérente de l’« indépendant » dans un souci d’homogénéité. À cette fin, il paraît nécessaire d’imposer un critère fondé sur l’exercice effectif du métier par l’individu non-salarié. Alternativement, un critère de taille maximale de l’entreprise peut être envisagé avec la limite de dix salariés, retenue dans la définition d’une entreprise artisanale, qui semble pertinente. En outre, l’approche sociodémographique montre une certaine disparité des caractéristiques en fonction du secteur d’activité du non-salarié. Elle laisse présager l’existence de variations comportementales selon les groupes socioprofessionnels. Enfin, il convient de porter une attention soutenue au contexte dans lequel s’inscrit l’activité. Les entraves à la réalisation de l’indépendance sont à même de générer des conditions de travail dégradées pour le non-salarié.
Stéphane RapelliRapelli Études Socioéconomiques, Orléans
Bibliographie
[1] AJAYI-OBE O, PARKER SC. The changing nature of work among the self-employed in the 1990s: evidence from Britain.
Journal of Labor Research. 2005;
26 :501
-517

[2] BENZ M, FREY BS. The value of doing what you like: evidence from the self-employed in 23 countries.
Journal of Economic Behavior and Organization. 2008;
68 :445
-455

[3] BEUGELSDIJK S, NOORDERHAVEN N. Personality characteristics of self-employed; an empirical study.
Small Business Economics. 2005;
24 :159
-167

[4] BLANCHFLOWER DG. Self-employement in OECD countries.
Labour Economics. 2000;
7 :471
-505

[5] BURKE AE, FITZROY FR, NOLAN MA. What makes a die-hard entrepreneur? Beyond the ‘employee or entrepreneur’ dichotomy.
Small Business Economics. 2008;
31 :93
-115

[6] CARROLL R, HOLTZ-EAKIN D. Income taxes and entrepreneurs’use of labor. Document de travail 373, Industrial Relations Section, Université de Princeton.
1996;
33 p

[7] CHARPENTIER P, LEPLEY B. Les TPE face aux 35 heures.
Document d’études de la DARES. 2003;
65 : 55p

[8] CONSTANT A, ZIMMERMANN KF. The making of entrepreneurs in Germany: are native men and immigrants alike?.
Small Business Economics. 2006;
26 :279
-300

[9] ÉDOUARD F. Conséquences sur l’emploi et le travail des stratégies d’externalisation d’activités. Avis et Rapports du CES 2005-4, Conseil Économique et Social.
Paris:2005;
170p

[10] FAVRE F. Hommes-femmes, des différences de revenu sensibles pour les non-salariés.
In : Les revenus d’activité des indépendants.
Insee (éd);
Insee Références. pages 31-45 Insee. 2009;
153p

[11] GARNER H, MEDA D, SENIK C. La place du travail dans les identités.
Économie et Statistique. 2006;
393-394 :21
-40

[12] GRESLE F. L’indépendance professionnelle: actualité et portée du concept dans le cas français.
Revue Française de Sociologie. 1981;
22 :483
-501

[13] HENLEY A. Job creation by the self-employed: the roles of entrepreneurial and financial capital.
Small Business Economics. 2005;
25 :175
-196

[14]INSEE. Fichiers détail : Enquête emploi en continu 2007.
Base de données.
2008;
http://www.insee.fr.

[15]INSEE. Fichiers détail : Dénombrement des entreprises et des établissements 2008 – champ total.
Base de données.
2009a;
http://www.insee.fr.

[16]INSEE. Créations et créateurs d’entreprises – Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans après.
Base de données.
2009b;
http://www.insee.fr.

[17] LAFERRÈRE A. Self-employment and intergenerational transfers: liquidity constraints and family environment.
Miméo, CREST;
Paris:2000;
22p

[18] LATTES G. La protection sociale : entre partage des risques et partage des revenus.
Économie et Statistique. 1996;
291-292 :13
-31

[19] LURTON G, TOUTLEMONDE F. Les déterminants de l’emploi non-salarié en France depuis 1970.
Document d’études de la DARES. 2007;
129 : 51p

[20] MEAGER N. Does unemployment lead to self-employement.
Small Business Economics. 1992;
4 :87
-103

[21] PARKER SC, ROBSON MT. Explaining international variations in self-employment: evidence from a panel of OECD countries.
Southern Economic Journal. 2004;
71 :287
-301

[22] RAPELLI S. Attraits et limites de l’indépendance.
La Lettre de l’Observatoire Alptis. 2006;
21 :2
-7

[23] RAPELLI S. Le renouveau de l’indépendance en question.
La Lettre de l’Observatoire Alptis. 2008;
24 :7
-10

[24] RAPELLI S, LESPAGNOL C. La population des travailleurs non-salariés à l’horizon 2030.
Communication au Colloque Prospective et Entreprise.
6 décembre;
Université Paris-Dauphine. Paris:2007;
15p

[25] RAPELLI S, PIATECKI C. Les travailleurs indépendants de l’industrie, du bâtiment et des services : portraits et perspectives.
Pharmathèmes Éditions;
Paris:2008;
144p

[26] SABOT D. Favoriser la création et la reprise d’entreprises par les salariés.
Guide Opérationnel d’Essaimage 2.
APCE;
Paris:2007;
155p

[27] STOREY DJ. The birth of new firms – Does unemployment matter? A review of evidence.
Small Business Economics. 1991;
3 :167
-168

[28] TORRES O. Petitesse des entreprises et grossissement des effets de proximité.
Revue Française de Gestion. 2003;
2003/3(144) :119
-138

[29] ZARCA B. L’artisanat français : du métier traditionnel au groupe social.
Economica;
Paris:1986;
290p

[30] ZARCA B. Identité de métier et identité artisanale.
Revue Française de Sociologie. 1988;
29 :247
-273

Des mutations du travail aux travailleurs indépendants
Un vaste dispositif d’enquêtes et de très nombreuses monographies permettent de dresser un tableau des mutations du travail dans les dernières décennies. Épidémiologistes, médecins, ergonomes, économistes ou sociologues aboutissent, avec des méthodologies très diverses, à un même constat : le mouvement global d’amélioration progressive des conditions de travail qui avait caractérisé le XXe siècle s’est inversé au tournant des années 1990. Ce dernier mouvement touche aussi bien le monde du salariat que celui des indépendants d’autant plus que la frontière entre ces deux catégories devient floue.
De nouvelles pratiques de travail déjà anciennes
Commençons par les évolutions récentes du travail. Premièrement, les métiers traditionnellement pénibles n’ont pas tous disparu. Le bâtiment et les travaux publics demeurent un monde dur cumulant exposition à des produits toxiques, risques d’accidents, températures extrêmes ou pression sonore élevée. Le travail à la chaîne ou sous contrainte automatique ne régresse pas : il concerne encore aujourd’hui 10 % des travailleurs. En outre, de nouveaux métiers particulièrement pénibles apparaissent dans des activités peu visibles mais croissantes. Par exemple, le tri sélectif et recyclage implique que des travailleurs traquent et corrigent manuellement nos erreurs de tri sur un flot continu de déchets ménagers.
Deuxièmement, l’exposition des salariés à la plupart des risques et la pénibilité du travail ont eu tendance à augmenter dans la dernière décennie. L’enquête Sumer qui porte sur des salariés et réalisée par les médecins du travail fournit une batterie d’indicateurs précis
1
.
La proportion de salariés du privé exposée à des produits chimiques a augmenté de 34 à 37 % de 1994 à 2003. Désormais, les deux tiers des ouvriers sont concernés ; en 2003, au moins 2,4 millions de travailleurs étaient en contact avec des produits cancérigènes. Les contraintes physiques comme la manutention de charge ou le piétinement pendant 20 heures par semaine déclinent en moyenne, mais augmentent pour les ouvriers. Les contraintes organisationnelles notamment de rythmes et de délais, se généralisent. L’« incertitude au travail », comme le fait de devoir effectuer des tâches non prévues, augmente pour toutes les catégories de salariés, accroissant la charge mentale. Le contrôle par la hiérarchie décline au profit d’un quasi doublement du contrôle informatique, concernant désormais plus du quart des salariés.
Même si la réduction du temps de travail a limité la fréquence des semaines longues, les temps sont de plus en plus éclatés. Le travail de nuit (surtout des femmes) se développe. Les horaires atypiques ou imprévisibles deviennent la norme, induisant des difficultés pour conjuguer vie privée (dont l’éducation des enfants) et vie professionnelle.
Ces évolutions tiennent en partie à la diffusion dans les secteurs des services, des méthodes d’optimisation des phases de travail issues du monde industriel. Dans l’ensemble, les inégalités se creusent, risques et pénibilité augmentant davantage pour les ouvriers et les employés que pour les autres catégories.
Le tâcheron – travailleur indépendant – d’une usine de désossage de viande qui doit en permanence se concentrer pour préparer des pièces de viande naturellement toutes différentes, doit mobiliser l’ensemble de ses capacités cognitives et physiques. De même, la caissière d’hypermarché doit non seulement déplacer quotidiennement 2 tonnes de marchandises, mais aussi trouver l’emplacement de milliers de codes barres, les scanner, répondre aux sollicitations, anticiper les modes de paiement ou encore éviter la « démarque inconnue ».
De fait, contrairement aux représentations les plus répandues, les formes de pénibilité traditionnelles et nouvelles ne se substituent pas : elles se cumulent. Et ce cumul peut se traduire par des pathologies d’hyper-sollicitation, en particulier les troubles musculosquelettiques (TMS). D’après l’étude pilote menée dans les Pays de la Loire en 2003
2
, 11 % des hommes et 15 % des femmes souffrent de troubles musculosquelettiques. Les données de la Caisse nationale de l’Assurance maladie montrent une montée ininterrompue des fréquences des TMS déclarés chez les salariés. Elles suggèrent une mécanique d’usure progressive des travailleurs – salariés comme indépendants – face à des organisations qui se stabilisent à un haut niveau de contraintes (tableau I

).
3
Tableau I Des contraintes qui se stabilisent à un haut niveau en France (d’après Enquêtes conditions de travail. Salariés et travailleurs indépendants, Dares)
|
En % des travailleurs concernés
|
1984
|
1991
|
1998
|
2005
|
|
Rester longtemps dans une posture pénible
|
16,2
|
29,0
|
37,3
|
34,2
|
|
Devoir porter ou déplacer des charges lourdes
|
21,5
|
31,4
|
37,6
|
39,0
|
|
Rythme imposé par des normes ou délais de une heure au plus
|
5,2
|
16,2
|
23,2
|
25,0
|
|
Tensions avec le public
|
Nd
|
20,9
|
29,7
|
28,6
|
|
Changer de poste en fonction des besoins de l’entreprise
|
Nd
|
22,8
|
23,2
|
18,7
|
|
Devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre plus urgente
|
Nd
|
48,1
|
55,7
|
59,5
|
Une mécanique macro-économique
Ces difficultés au travail résultent principalement des choix organisationnels et technologiques des entreprises : elles sont fondamentalement collectives. L’entreprise connaît en effet une profonde remise en cause de l’organisation du travail, liée au fait que la capacité à être la première à arriver sur un marché et à réagir aussi rapidement que possible aux évolutions de la demande est progressivement devenue la clef de la compétitivité.
Un productivisme réactif s’impose, basé sur des pratiques d’organisation flexibles et innovantes comme les équipes autonomes, la rotation de postes, le « juste à temps », pratiques associées à une sous-traitance accrue, à la réduction des lignes hiérarchiques, à la montée en puissance des normes de qualité (notamment ISO). Ces pratiques se diffusent rapidement dans le secteur privé mais aussi dans le secteur public. En 2005, un tiers des établissements français de plus de 20 salariés sont sous normalisation ISO. Parallèlement, bien que leur efficacité ne soit pas démontrée, les progiciels de gestion intégrés ou ERP
4
, peu présents il y a encore 10 ans, sont utilisés là aussi dans un tiers des établissements.
Ces changements organisationnels sont inséparables des technologies de l’information et de la communication : le développement de celles-ci permet la mise en place de nouvelles configurations, et inversement. C’est de la conjonction des deux que les entreprises attendent des gains de performance. Ce mouvement est global et s’auto-entretient en modifiant en permanence les conditions de concurrence entre entreprises et en stimulant l’innovation. Le travail est au centre de cette dynamique. Le mouvement de transformation du travail et de l’organisation des activités économiques étant globaux, les travailleurs indépendants sont aussi concernés par capillarité que les salariés. Les indépendants n’échappent pas à la logique des donneurs d’ordre, à l’exigence de mobilité.
Néanmoins, les indépendants se distinguent a priori (nous reviendrons sur l’a priori) par leur autonomie dans le travail. De nombreux travaux internationaux (voir la communication de Stéphane Rapelli dans cet ouvrage) permettent de dresser un portrait particulier des indépendants. Les indépendants sont souvent plus satisfaits de leur travail surtout s’ils n’ont pas de salariés ; et, on n’observe pas de déclin de la satisfaction des indépendants dans les Eurobarometer Surveys. Et pourtant, ils ont des horaires plus longs mais non extrêmes (hormis les agriculteurs). Leurs rémunérations sont généralement plus basses, surtout plus incertaines. Ils déclarent un métier plus « stressant », mais ne sont pas nécessairement plus exposés au stress. Être indépendant est aussi un échappatoire à l’environnement de travail du monde salarié.
Des organisations moins délétères ?
Les transformations de l’économie et leurs conséquences ne sont naturellement pas un monopole français. D’ailleurs, la montée des TMS ou l’intensification du travail ont été observées dans la plupart des pays développés à partir du milieu ou de la fin des années 1980.
Cette évolution n’est cependant pas inéluctable. En témoigne le fait que les difficultés au travail sont inégalement distribuées. Deux entreprises aussi réactives et compétitives l’une que l’autre peuvent traiter de manière très différente leurs salariés. Les entreprises les plus délétères sont celles qui associent à l’innovation dans l’organisation de la production des formes de désorganisation du travail comme le fait de recevoir des ordres contradictoires ou de supprimer les phases d’échanges collectifs nécessaires à l’équilibre des équipes de travail ou à la passation des consignes. Une meilleure formation des salariés ou des démarches de qualité de vie au travail permettent au contraire aux organisations de devenir matures.
Dans la plupart des pays européens comme en Amérique du Nord, de nombreuses entreprises se sont efforcées de réduire l’usure au travail et d’améliorer les organisations. Dès le début des années 1990, leurs agences sanitaires ont soulevé la question des TMS. Les élites managériales formées aux questions de santé et de sécurité au travail et à leur gestion ont été alertées par le coût croissant de l’absentéisme et des maladies professionnelles, sous la pression, notamment dans les pays anglo-saxons, des assureurs santé. Dans les pays nordiques, le nécessaire allongement de la vie au travail a en outre induit chez les partenaires sociaux et l’État une attention particulière aux conditions de travail des seniors, mais aussi à celles des travailleurs plus jeunes pour leur éviter une usure prématurée. Ces réflexions sont entrées en résonance avec la mode de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
5
.
Concomitamment, on assiste à une stabilisation, voire à un reflux, des effets délétères des nouvelles organisations, la plupart des indicateurs de « bien-être » au travail s’améliorant. Les enquêtes européennes, en particulier les enquêtes sur les conditions de travail de la Fondation de Dublin, suggèrent une pause dans la montée des contraintes organisationnelles depuis le milieu des années 1990 alors que les fréquences d’accidents du travail décroissent significativement. Les États-Unis ou la Grande-Bretagne voient une réduction progressive de l’ordre de 4 % par an des fréquences de TMS depuis maintenant une décennie, sans avoir pour autant renoncer au productivisme réactif. En Allemagne, cela fait également une décennie, que le nombre de cas de TMS s’est stabilisé, voire décline, et que, dans le même temps, l’absentéisme a reculé d’un tiers, alors même que la coalition rouge-verte avait réintroduit en 1999 une indemnisation à 100 % dès le premier jour d’arrêt maladie ; de fait, face à des perspectives démographiques particulièrement défavorables, les entreprises allemandes anticipent le maintien en emploi de leurs salariés, dont les compétences deviendront rares. La crise actuelle n’a pas remis en cause cette dynamique.
La France semble à la marge de cette tendance favorable. L’écart de fréquence d’accidents entre la France et la moyenne européenne se creuse. Le mouvement d’intensification n’y a pas décéléré significativement. Le nombre de cas de TMS déclarés à la Sécurité Sociale progresse toujours annuellement de 20 %. Depuis 2000, elle est même le seul grand pays à voir progresser nettement les accidents du travail impliquant un handicap permanent (même si la fréquence des accidents mortels continue de régresser) : plus 15 % contre, par exemple, une baisse de 10 % en Allemagne. L’absentéisme a crû dans la même proportion. Même en retirant de la facture les conséquences de 30 ans de retard dans des dossiers comme celui de l’amiante, le coût des atteintes à la santé dues au travail s’envole et participe au creusement du déficit du régime général qui assume la plupart des maladies d’origine professionnelle, et aux déséquilibres de la branche travail.
De fait, la prise de conscience de l’impact délétère de nouvelles organisations non matures sur la santé des travailleurs est tardive et encore balbutiante dans la plupart des entreprises françaises ; c’est seulement depuis 2005 que l’État a reconnu les TMS comme un véritable problème de santé publique avec le Plan Santé Travail.
Les indépendants en France
Ainsi, les difficultés françaises sont moins liées à la mondialisation des modes de production ou au développement d’un capitalisme cynique, qu’aux défaillances d’un compromis collectif caractérisé par l’inadaptation de ses régulations et l’impréparation de ses élites.
La régulation touche non seulement le travail, mais aussi le statut même des travailleurs, dont celui des indépendants. Les conditions de travail des indépendants dépendent également fondamentalement de la frontière entre indépendants et salariés, c’est-à-dire qui sont les indépendants.
Sur 50 ans, le nombre d’indépendants (même hors agriculture) est en très fort déclin dans l’OCDE. On assiste cependant à un rebond dans les années 1980 suite à des réformes fiscales notamment en Grande-Bretagne. Inversement, des faux salariés émergent avec le portage salarial par exemple en France. Les années 1990-2000 ont également vu la montée des indépendants « économiquement dépendants ». Ces derniers cumulent la plupart des contraintes des salariés et indépendants, en gardant potentiellement une certaine autonomie.
Les changements de régulations nationales peuvent ainsi modifier profondément la catégorie d’indépendant. Dans le secteur de la construction, 90 % des travailleurs sont indépendants aux Pays-Bas... contre 25 % en Belgique ! La croissance et la décroissance souvent massives de la part des indépendants dans l’emploi total sur la période pourtant très courte de 2004 à 2007 d’un pays européen à un autre illustrent ces différences de régulations (figure 1

).
La France n’échappe pas à la redéfinition des frontières avec la création de l’auto-entreprenariat qui génère à la fois plus d’indépendants de tous types, y compris des cumulants salariés-indépendants. Cette évolution va à rebours de celle de l’Italie depuis 2006-2007 avec l’arrivée du statut légal protecteur pour les indépendants dépendants
6
, la syndicalisation des indépendants dépendants aux États-Unis ou l’introduction de la place des indépendants dans des accords de branche en Allemagne. Mais cette évolution française, désormais installée, ouvre de nouveaux enjeux : nouveaux indépendants, nouveaux concurrents pour les indépendants classiques... qui peuvent profondément influer sur l’« état de stress » des indépendants en France par effet de composition comme d’environnement concurrentiel et de contenu de travail.
En conclusion, étudier le stress des indépendants impose deux pré-requis. Le premier enjeu essentiel est de déterminer le champ exact des indépendants et surtout d’anticiper les évolutions de la frontière entre salariat et indépendants pour pouvoir construire un suivi longitudinal au sein d’une catégorie mouvante et ainsi ne pas « oublier » des populations nouvelles qui concentreraient les expositions aux « stresseurs ». Le deuxième enjeu est de bâtir des indicateurs capables tout à la fois d’être adaptés aux spécificités des métiers d’indépendants – les outils type Karasek étant par nature adaptés à la relation salariale –, et de capturer les évolution du contenu du travail.
Philippe Askenazy
Directeur de recherche au CNRS, École d’économie de Paris
Autonomie et dépendance des indépendants
Au sein du monde du travail, les indépendants occupent une place singulière. Représentant environ 10 % de la population active, ils y forment un groupe anachronique résistant à un mode d’emploi quasi hégémonique, celui du salariat. Malgré une disparition maintes fois annoncée, le pourcentage des travailleurs indépendants dans la population active reste, en moyenne, stable depuis plusieurs décennies, cette stabilité masquant cependant des transformations incessantes qui affectent les différentes catégories régies par ce statut. Le groupe tend à se dilater lorsque croît le chômage associé à une récession économique, il se contracte lorsque l’environnement lui devient plus hostile et que le salariat semble assurer un avenir moins incertain à ses membres les plus proches des catégories ouvrières ou employées. Hormis les agriculteurs, les indépendants sont spécialisés dans la transformation des matières premières (les artisans inscrits au répertoire des métiers avec 205 entrées possibles), l’achat et la revente de biens (les commerçants inscrits au registre du commerce) et l’exploitation d’un savoir (les professions libérales regroupant un ensemble très hétéroclite de professions : 32 sont réglementées, plus de 170 ne le sont pas). Rien ne confère une unité apparente à ce groupe où se retrouvent les professions les plus prestigieuses et « la boutique », l’artisanat d’art et le maréchal ferrant consacrant désormais son activité aux chevaux de loisir, rien si ce n’est un statut et les représentations qui lui sont associées – ce qui est beaucoup – ces deux dimensions structurant en effet la distinction de ses membres au sein de la population active et un socle partagé d’éléments constitutifs de leur identité.
Après avoir très brièvement rappelé, dans ce court exposé, les grands traits du statut des indépendants et les représentations qui y sont associées, on s’attachera à mettre en évidence ce qui le distingue des autres « formes » de travail aujourd’hui existantes. On s’interrogera dans un deuxième temps sur les critiques formulées par les sociologues à l’égard des privilèges dont bénéficient certains segments de ce groupe et quelques unes des transformations qui l’affectent.
« Forme » du travail indépendant
Statut
Le point nodal du statut a trait à l’absence de subordination juridique (article L. 120-3 du Code du travail) du travailleur indépendant qui exécute un travail pour autrui sans lui être subordonné, ce qui le distingue radicalement des salariés. Le travailleur indépendant (quand bien même il se fait aider dans sa tâche par des compagnons ou des aides familiaux) est censé détenir les connaissances et l’expertise nécessaires à la réalisation de son activité. Mais cette absence de liens de subordination n’implique évidemment pas l’absence de règles dans l’exercice de l’activité. Depuis la loi d’Allarde (2-17 mars 1791) supprimant les corporations mais instaurant une patente, la loi le Chapelier (14-18 juin 1791) prohibant les coalitions ouvrières (les organisations de compagnons) (Sewel, 1983

; Poitrineau, 1992

; Kaplan, 2001

; Kaplan et Minard, 2004

) en passant par l’invention de « l’artisan fiscal » sous la Troisième République (Zdadtny, 1999

), la charte du travail corporatiste de Vichy (Le Crom, 1995

; Margairaz et Tartakowsky, 2008

, voir en particulier la première partie de l’ouvrage consacrée aux « Patrons et artisans, corporatisme, syndicalisme »), jusqu’aux toutes dernières lois concernant la création d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), le statut d’auto-entrepreneur, les règles qui encadrent l’activité des travailleurs indépendants font florès. Elles concernent aussi bien la taille des entreprises, la fiscalité, le statut des conjoints et des aides familiaux, le pré-requis éventuel de titres ou de diplômes pour l’exercice de certains métiers ou professions... La capacité d’auto-organisation des travailleurs indépendants varie par ailleurs fortement d’un métier à l’autre selon une multiplicité de critères (monopole ou non de l’exercice d’une pratique, maîtrise reconnue d’un métier, caractéristiques du marché...). Un certain nombre de professions réglementées, remplissant, pour certaines, une mission de service public, sont dotées d’instances spécifiques (les ordres professionnels : des médecins, avocats, architectes...) qui exercent une véritable juridiction sur leurs membres. Pour les artisans, comme le souligne Bernard Zarca (1986

, 1987

, 1998

), l’identité collective se construit autour du métier conduisant à un morcellement de leur représentation au sein des chambres de métiers. Mais un même constat peut être fait pour les métiers du commerce fourmillant d’organisations chargées de la défense de leurs intérêts (à titre d’exemple, la chambre de commerce de Lyon accueille à elle seule 222 organisations) (Offerlé, 1998

et 2009

; Rapelli et Piatecki, 2008

). Ces diverses organisations sont regroupées au sein de fédérations ou confédérations plus ou moins puissantes, certaines intégrées au sein du Medef, d’autres non (comme l’Union nationale des professions libérales, UNAPL créée en 1977), toutes visant les mêmes objectifs : l’obtention d’une législation, notamment fiscale, qui leur soit la plus favorable possible, des formes de couverture sociale adaptée à leur situation et, le cas échéant, la régulation des relations avec leurs salariés (conventions collectives sur les salaires et la durée du travail, conditions d’accès à la profession...).
Représentations collectives
Malgré la grande rupture révolutionnaire, les travailleurs indépendants sont aussi les héritiers d’une longue tradition qui remonte au XII
e siècle, riche d’une histoire dense qui alimente encore, même s’il s’agit le plus souvent d’une forme fantasmée de cette histoire, l’imaginaire collectif (Lequin, 1992

). Ils restent encore aujourd’hui les dépositaires du vieux rêve proudhonien d’une disparition possible du salariat que le maître appelait de ses vœux. Derrière le mot d’indépendant se love pour les artisans la possibilité d’une pratique autonome du métier entendu comme « un corps constitué de techniques, de savoir faire en vue de la production d’une gamme relativement restreinte de biens et services qui ne s’acquièrent que dans le temps long et positif de l’expérience professionnelle » permettant l’émergence « des composantes d’une culture telles que le langage, la gestuelle ou la transmission intergénérationnelle des techniques et des coutumes » (Zarca, 1998

). La maîtrise complète du processus, le bel ouvrage réalisé selon les règles de l’art sont leur fierté. Ce qui est vrai pour l’artisan et sans doute également pour les membres des professions libérales
1
prend, comme le montre bien François Gresle, un autre sens pour le commerçant pour qui l’indépendance « n’existe que par l’acte commercial, les relations avec « ses pratiques », la présence publique de la boutique... L’indépendance reste le but ultime du détaillant ; elle est seulement pour l’artisan le moyen d’atteindre son idéal professionnel » (Gresle, 1980

, 1981a

et b

).
Ce long apprentissage du métier, qu’il soit intellectuel ou manuel, « l’évasion dans la boutique » pour reprendre l’expression de Michèle Perrot, contribuent à façonner la morphologie des indépendants. Ils sont en moyenne plus âgés que ne l’est la population active – il faut du temps pour pouvoir se former et quelques moyens pour s’installer – mais ils ont un niveau de formation supérieur à la moyenne des actifs, ce qui s’explique à la fois par la très longue durée de formation des professions libérales et par l’exigence de diplômes dans de nombreux secteurs de l’artisanat. Plusieurs enquêtes confirment leur goût pour l’indépendance et pour la possibilité d’un travail accompli de manière autonome. Les travaux de l’Insee sur les créateurs d’entreprise soulignent le goût d’entreprendre autant pour développer une innovation que par souci d’une insertion sociale personnalisée par le biais de la création de son propre emploi (Daniel et Kergosse, 2008

). On trouve proportionnellement un peu plus d’immigrés parmi eux qu’au sein de la population active, « la mise à son compte » étant sans doute aussi un moyen pour ces derniers d’échapper à l’ostracisme de l’emploi salarié les concernant. Enfin, ces indépendants ont une durée hebdomadaire du travail et une longévité dans l’activité sans commune mesure avec celles de leurs homologues salariés, ceci étant particulièrement notoire pour les commerçants et les artisans
2
.
De ce survol très rapide d’un groupe à la fois très hétérogène, en partie instable, dont les diverses composantes sont plus ou moins bien étudiées (que sait-on vraiment du travail, de la carrière et des conditions de vie des petits commerçants de quartier, des patrons de döner kébabs ou des coiffeuses à domicile pour ne prendre que quelques exemples ?), on peut retenir la donnée la plus solide qui a trait à l’autonomie qui leur est reconnue par le droit. Il reste à comprendre ce qui en est dans les faits.
Une comparaison de « formes »
Pour mieux saisir une spécificité, il est souvent utile de procéder par comparaison. On emprunte ici à Alain Supiot (2000)

, en l’adaptant, le raisonnement retenu pour comparer la relation au travail des agents des secteurs public et privé lorsqu’il écrit : « Tandis que le contrat permet de faire du travail un objet de négoce, le statut (il s’agit de celui des fonctionnaires) isole au contraire le travail de la sphère marchande. Par le contrat, le salarié vend son travail au plus offrant sur le marché (du travail) ; la relation est dissymétrique (l’un des contractants se place sous les ordres de l’autre) ; synallagmatique (le salaire est la contrepartie du travail fourni) et sa durée est aléatoire. Aucun de ces traits ne se retrouve dans le statut, qui implique un autre rapport au temps, au pouvoir et à l’argent ». Si le contrat de travail est bien un contrat de subordination à un employeur (subordination bornée par le code du travail mais bien réelle) dans le cadre de la fonction publique, « l’agent n’est pas assujetti à un homme déterminé, mais à une organisation et aux valeurs qu’elle incarne ». Le fonctionnaire est certes soumis aux ordres de son supérieur hiérarchique, l’un et l’autre cependant le sont au service d’une même cause : le service de l’intérêt général. Le salaire est la contrepartie de la valeur estimée du travail accompli dans un système concurrentiel et conventionnel, le traitement du fonctionnaire est la contrepartie de son engagement sans lien avec une quelconque valeur marchande. Le lien qui unit un salarié à son employeur est précaire, le fonctionnaire a une garantie d’emploi à vie correspondant au principe de continuité du service public.
Si l’on intègre dans ce raisonnement les travailleurs indépendants, leur seule dépendance se manifeste à l’égard du marché et de la réception par ce dernier des biens et services qu’ils peuvent offrir, mais aussi de l’État régulateur. Le besoin de défendre ses intérêts (et notamment fiscaux) et le particularisme des situations expliquent sans doute en partie la prolifération déjà évoquée des instances de représentation corporatives dans le sens précis et hérité de ce terme. On sait la capacité protestataire et le poids politique (bien supérieur à leur nombre) de certaines catégories de travailleurs indépendants (Offerlé, 1998

et 2009

; Zdadtny, 1999

). La pérennité de l’exercice de leur activité dépend fortement de l’environnement économique au sein duquel ils opèrent, et ils ne reçoivent ni un salaire, ni un traitement mais un revenu fruit de la vente de leurs prestations. Ce revenu est de l’ordre de 23 000 € en moyenne par an (Favre, 2008

) soulignant par là même que c’est bien l’indépendance et l’autonomie dans l’exercice de l’activité plus que l’appât du gain qui motivent les indépendants (quand bien même certains d’entre eux ont des revenus qui dépassent largement cette moyenne). Si enfin on étend la comparaison à la qualification, c’est l’emploi occupé qui définit la qualification du salarié alors que c’est le concours passé et son niveau qui classe le fonctionnaire dans une catégorie ; le métier et la profession exercés définissent la qualification du travailleur indépendant et sont un élément essentiel de son patrimoine. Le tableau I

résume les éléments de comparaison qui viennent d’être évoqués.
Tableau I Formes d’autonomie et de dépendance : esquisse d’une typologie
| |
Salariés
|
Fonctionnaires
|
Indépendants
|
|
Types de relations à :
| | | |
|
La collectivité de travail
|
Le contrat
|
Le statut
|
Le marché
|
|
Le temps de l’engagement
|
Indéterminé
|
Une vie
|
Une vie et indéterminé
|
|
Le pouvoir
|
Subordination
|
L’intérêt général
|
Le marché et l’État régulateur
|
|
L’argent
|
Le salaire
|
Le traitement
|
Le revenu
|
|
La qualification
|
Le poste
|
Fonction/grade (le concours)
|
Le métier, la profession
|
Nd : non déterminé
Bien entendu, ces trois formes sont des idéaux-types, des faits stylisés comme disent les économistes, ayant essentiellement une valeur heuristique qui rend mal compte de la diversité et de la complexité de la réalité. Ils peuvent permettre de réfléchir aux altérations que subissent chacune d’entre elles pour des raisons propres et par réciprocité d’effets.
Quelques éléments de réflexion sur les transformations du travail indépendant
Indépendance et autonomie, quelle légitimité ?
Si, comme convenu, le travail agricole est exclu de la réflexion, force est de constater la faiblesse en nombre des travaux sociologiques français concernant le travail des indépendants comparés à ceux traitant du travail salarié. Les beaux travaux de Bernard Zarca sur l’artisanat et de François Gresles sur les commerçants qui ont maintenant plus d’une vingtaine d’années restent des références encore incontournables, mais n’ont pas vraiment fait école
3
. Économistes, historiens et sociologues s’intéressent cependant de plus en plus aux petites entreprises et à leurs dirigeants (par exemple : Bruno et Zalc, 2006

; dans le domaine des relations sociales : Verrier, 2009

). La sociologie politique contribue pour sa part à une meilleure connaissance des comportements politiques et des modes de défense de leurs intérêts par les indépendants (Offerlé, 1998

et 2009

; Bosc, 2009

). Les professions libérales, au moins les plus prestigieuses d’entre elles, ont en revanche fait l’objet de nombreux travaux tant en France qu’à l’étranger (pour la France on peut citer sans prétendre à l’exhaustivité : Karpik, 1995

; Hassenteufel, 1997

; Quemin, 1997

; Champy, 1998

; Mathieu-Fritz, 2005

). Bien des raisons expliquent cette attention particulière portée aux professions libérales qui reproduisent encore le mieux les traits des anciennes corporations. Le débat qu’elles ont suscité et suscitent encore au sein de ce qui est devenu une branche particulière de la discipline – la sociologie des professions – est intéressant dans la mesure où il porte précisément sur la légitimité de l’indépendance et de l’autonomie qu’elles revendiquent comme étant essentielles à l’exercice de leurs pratiques (Dubar et Tripier, 1998

; deux ouvrages défendant encore des thèses opposées viennent d’être très récemment publiés : Champy, 2009

; Demazière et coll., 2009

). Au sein de ce champ de la discipline, la controverse s’est nouée essentiellement autour des médecins, ces derniers étant érigés en représentants archétypiques de la notion de profession.
Jusqu’à la fin des années 1960, le courant de la sociologie fonctionnaliste dominant dans la discipline s’est attaché à démontrer la légitimité des privilèges reconnus aux professions libérales et en particulier aux médecins en analysant les fonctions qui sont les leurs et les services qu’ils rendent à la société. Pour les chercheurs de ce courant, ces professions ont un certain nombre de caractéristiques spécifiques : elles se réfèrent à des connaissances scientifiques mobilisées dans des pratiques permettant de résoudre des problèmes qui se posent aux individus ou à la société. Les membres de ces professions partagent des valeurs communes produites à la fois par un contrôle de la socialisation de leurs membres (contrôle de l’accès au marché du travail et contrôle de la socialisation dans le cadre de la formation) et par un contrôle de leur activité (un code de déontologie appliqué par la profession elle-même). L’indépendance et l’autonomie de la profession sont justifiées par l’importance de la fonction exercée pour l’équilibre de la société. La complexité de la tâche accomplie et les connaissances scientifiques exigées pour l’accomplir expliquent la nécessité du contrôle par les pairs de l’accès à la profession et de la socialisation de leurs membres. Démuni de cette expertise, aucun profane ne peut prétendre s’immiscer dans « les affaires » de la profession.
Des sociologues du courant interactionniste qui a succédé à l’école fonctionnaliste mais également des sociologues marxistes vont radicalement contester cette légitimation des privilèges des professions libérales et, en particulier ceux des professions médicales. Ce courant critique va reprocher aux fonctionnalistes de s’être laissés séduire par la rhétorique auto justificatrice des professionnels qu’ils se seraient contentés de retranscrire dans leurs analyses. Les problèmes que les professionnels prétendent être seuls à même de résoudre ne sont pas « donnés » mais construits par eux-mêmes qui nomment et définissent les maladies. L’altruisme et le désintéressement censés caractériser leur ethos sont des plus douteux et, dans tous les cas, loin d’être partagés par tous les membres de la profession. Malgré une formation et une socialisation contrôlées par les membres, on observe, de fait, une forte hétérogénéité des pratiques. Les bénéfices tirés de l’exercice de la profession, le prestige qui en est issu permettent en réalité à la profession d’être dans un rapport de force favorable à la construction d’un monopole d’exercice (en déléguant éventuellement « le sale boulot » à des professions subalternes) et d’auto-contrôle de la profession. L’indépendance et l’autonomie dont bénéficient ces professionnels ne sont que le résultat d’une lutte victorieuse pour l’acquisition d’une place privilégiée au sein du marché du travail. Ils n’ont rien à voir avec l’activité elle-même. Toutes les activités de travail doivent être jugées à la même aune, d’où l’intérêt porté par les interactionnistes à tous les métiers et en particulier les plus modestes d’entre eux. La sociologie des professions apparue en France il y a une vingtaine d’années maintenant, se situe résolument dans ce courant critique, au point même de ne plus évoquer le terme de « profession » pour lui préférer celui de « groupes professionnels » (Dubar et Tripier, 1998

; Demazière, et coll., 2009

). Dans cette perspective, les statuts (salariés, fonctionnaires, indépendants) sont supposés n’avoir aucune inférence sur le travail.
Remise en cause de l’autonomie et de l’indépendance
Cette attaque en règle contre les professions ne permet pas au courant de la sociologie critique de les défendre sans qu’ait été prise la mesure de l’importance de l’autonomie et de l’indépendance sur la qualité de l’acte professionnel lui-même, au moment où autonomie et indépendance sont remises en cause.
Dans un article récent, Anne-Chantal Hardy-Dubernet (2002)

met particulièrement bien en évidence les nouvelles formes de dépendance et la perte d’autonomie des médecins libéraux à partir de l’atteinte portée à trois éléments essentiels de la profession :
• la perte de contrôle de la régulation numérique de la profession par le biais du numerus clausus imposé par l’État tant à l’entrée dans la profession que lors des orientations de spécialisation ;
• l’intégration du code de déontologie dans le Code de la santé publique et les suggestions apportées en matière de prescription affectant de fait, le geste technique, point essentiel de l’autonomie ;
• la redéfinition du système de soin : modalité de remboursement, mise en place de réseau de soin et rôle du médecin référent restreignant très fortement l’indépendance du praticien.
Florent Champy, à partir de ses recherches sur les architectes, s’alarme de la même manière sur les atteintes portées à l’indépendance et à l’autonomie des professions à pratiques prudentielles, le conduisant à proposer un renouvellement des problématiques de recherche évitant les excès du fonctionnalisme et de la sociologie critique. Il ne s’agit plus de mettre le pouvoir au cœur de la réflexion (et donc l’indépendance) comme c’est le cas dans la sociologie critique, mais l’autonomie, l’approche proposée consistant « à se situer sur un plan cognitif : alors que le pouvoir se juge dans l’action, l’autonomie de la réflexion est plus importante que l’autonomie de décision » (Champy, 1998

). Cette affirmation est sans doute fondée dans le cas des architectes fortement soumis aux choix de leur client mais qui devraient rester maître du projet architectural, est-elle aussi pertinente dans le cas des médecins ? Le point essentiel de l’approche suggérée que l’on souhaite souligner ici est l’importance nouvelle accordée au lien entre autonomie et qualité de l’activité. Si la qualité de l’acte professionnel dépend de l’autonomie de celui qui l’accomplit, alors il est effectivement essentiel de défendre l’autonomie, ce que les sociologues critiques ont ignoré. Mais l’autonomie dans l’accomplissement du travail peut-elle être garantie sans l’indépendance qui la protège ?
Florent Champy, Pierre-Michel Menger (2003) et bien d’autres s’accordent sur d’autres menaces qui pèsent sur les indépendants. On a évoqué la prolifération des normes pesant sur l’activité de certaines professions étroitement contrôlées : normes de résultats qui ne peuvent manquer d’influer sur les procédures de travail auxquelles s’ajoutent désormais des dérégulations supranationales (par exemple, la directive européenne concernant les services) permettant l’installation sur le territoire de professionnels européens, mettant en cause la capacité de régulation des marchés du travail spécifiques à chaque profession (on se souvient de l’affaire du plombier polonais !). Les numerus clausus ou les difficultés d’accès à certaines professions (les vétérinaires, les masseurs-kinésithérapeutes...) conduisent ceux qui y aspirent à franchir les frontières, mettant à mal le contrôle de la socialisation professionnelle par les professions elles-mêmes (ce qui ne veut pas dire que les formations reçues ailleurs soient moins bonnes que les nôtres !). Pour les petits entrepreneurs, la dépendance à l’égard du système financier n’est plus à démontrer, la période de crise que nous vivons exacerbant les difficultés financières pour les petites entreprises. Plus généralement, l’indépendance des petits entrepreneurs est particulièrement contrainte par l’environnement économique et par un dispositif législatif et réglementaire qui encadre leur activité, expliquant la multiplicité des instances de défense des intérêts spécifiques des différentes catégories d’indépendants ayant pour cible essentielle l’État et son action pour obtenir des protections supplémentaires ou des avantages spécifiques (la baisse de la TVA dans l’hôtellerie-restauration en constitue un exemple récent). La dépendance des petites entreprises dans le cadre de la sous-traitance ou des mécanismes de franchise questionne de plus en plus la réalité de leur autonomie.
Des frontières brouillées entre mondes professionnels
Les idéaux-types présentés dans la première partie de cet exposé ne sont que des modèles théoriques permettant de mettre en exergue les grands traits de ces mondes séparés que sont les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Dans la réalité, on assiste à un brouillage identitaire de ces différents mondes dont les frontières sont de plus en plus poreuses autant sur des plans symboliques que pratiques. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible de repérer certains indices illustrant ce propos.
Le métier, apanage du travail indépendant, est désormais au cœur des dispositifs de gestion des grandes entreprises qui se réorganisent autour de familles de métiers, qui ne parlent plus d’ouvriers mais de compagnons et qui accordent, de fait, une plus grande autonomie à leurs salariés et une prescription moins précise du travail. Les enquêtes de la Dares sur les conditions de travail (Algava et Vinck, 2009

) font état de cette progression de l’autonomie n’excluant évidemment pas le contrôle, ce dernier se situant désormais
a posteriori sur les objectifs atteints et non plus, comme dans le modèle taylorien, sur le
modus operandi. La qualification, longtemps définie par celle du poste occupé, se « personnalise » dans le cadre de la mise en œuvre de ce que le Medef nomme « la logique compétence ». Le travail en équipes, en groupes de projets, change les relations sociales et favorise un apprentissage de type compagnonnique. La modernisation de la fonction publique, sans remettre en cause radicalement le statut, modifie profondément les conditions de travail des fonctionnaires par le biais de l’importation des pratiques de gestion du secteur privé (la RGPP, Réforme générale des politiques publiques ; la LOLF, Loi organique relative aux lois de finances). La volonté d’individualiser les salaires (attribution de primes de performance ou d’excellence !) fait dériver le traitement vers un salaire. Par ailleurs, un nombre croissant d’agents contractuels dans certaines administrations et grandes entreprises publiques conduisent à la cohabitation au sein de mêmes entités d’agents aux statuts hétérogènes. La transformation de l’usager en client affecte l’ethos même de l’engagement du fonctionnaire (Warin, 2002

; Cartier, 2003

; Weller, 2003

), la prise en compte des situations individuelles se substituant progressivement à l’égalité de traitement de l’usager. Paradoxalement, c’est encore dans certains grands corps de l’État que l’on retrouve le mieux préservé l’idéal des professions libérales : indépendance et autonomie dans l’exercice de la fonction (Latour, 2002

).
Du côté du travail indépendant, on a évoqué, dans le point précédent, l’altération de ce statut dans le cadre des relations liant grandes entreprises à sous-traitants, relations susceptibles dans certains cas de réduire l’indépendance à une pure fiction
4
. Le développement des « franchises » dans la coiffure, la restauration, la mode, permet à l’entrepreneur indépendant de conserver sa clientèle, mais le prive de toute autonomie dans le choix des produits, leur mode de présentation
5
...
Dans une période de crise durable de l’emploi, tout est bon pour le soutenir. La loi sur les Entreprises Uninominales à Responsabilité Limitée et celle annoncée sur les Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée réduisent la nature du risque pris par les entrepreneurs. C’est sans doute une bonne chose. Il reste à s’interroger sur ce que la « responsabilité limitée » va avoir comme effet sur le goût du risque supposé être une des qualités saillantes des entrepreneurs indépendants. Enfin, le statut récent d’auto-entrepreneur (320 000 sur les 580 000 entreprises créées en 2009) contribue encore à brouiller les frontières dans la mesure où il est adopté aussi bien par de vrais indépendants que par des retraités, des salariés (29 % d’entre eux), des fonctionnaires ou des bénéficiaires de minima sociaux. Ce statut, très favorable quand il permet un appoint financier lorsque les heures supplémentaires sont introuvables ou qu’il évite le travail au noir, peut aussi permettre aux entreprises de contourner les contraintes du Code du travail en confiant des missions à d’anciens salariés incités à se mettre « à leur compte » et sans droit aux Assedic, la mission terminée.
En conclusion, le groupe des travailleurs indépendants se caractérise par une recomposition ou une déformation quasi permanente des catégories qui le composent. Aux franges du salariat, il en est à la fois la nostalgie et « la nouvelle frontière ». Des nouveaux métiers naissent en son sein liés aux technologies de l’information et de la communication alors que d’autres déclinent ou disparaissent. Les petites boutiques de mode ou de produits exotiques connaissent un
turn-over considérable alors que les boutiques de luxe « ne connaissent pas la crise ». L’avocat au statut souvent sécurisé par celui d’enseignant y côtoie l’architecte qui peine à gagner sa vie et l’immigré qui crée son petit restaurant ou sa boutique de produits alimentaires. Les conditions de travail des indépendants se caractérisent par une durée du travail beaucoup plus élevée que celles des autres catégories de salariés et l’emprise du travail sur la vie privée peut être considérable (Algava et Vinck, 2009

). Ils sont cependant beaucoup moins soumis que les salariés du secteur privé à un rythme de travail contraint, plus autonomes, et vivent, le cas échéant, des relations de travail moins conflictuelles. Ils sont relativement optimistes sur leur avenir et envisagent sans inquiétude la possibilité d’exercer jusqu’à leur retraite le métier qu’ils ont choisi. On comprend mieux pourquoi, malgré ses difficultés, ses défauts, ses ambiguïtés, le statut de travailleur indépendant reste attractif pour tous ceux qui rêvent « d’un travail à soi ».
Françoise PiotetProfesseur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Laboratoire Georges Friedmann (UMR 85 93)
Bibliographie
[1] ALGAVA E, VINCK L. Les conditions de travail des non-salariés en 2005.
DARES;
Première Synthèse.
décembre 2009;
50-1

[2] BOSC M. Sociologie des classes moyennes.
La Découverte, Collection Repères;
Paris:2009;

[3] BRUNO AS, ZALC C. Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en France (XIX-XX
e siècle).
Publibook Université;
Paris:2006;

[4] CARTIER M. Les facteurs et leurs tournées, un service public au quotidien.
La Découverte;
Paris:2003;

[5] CHAMPY F. Les architectes et la commande publique.
PUF;
Paris:1998;

[6] CHAMPY F. La sociologie des professions.
PUF;
Paris:2009;

[7] DANIEL C, KERGOSSE R. Création et créateurs d’entreprises. L’emploi, nouveaux enjeux.
Insee, Références;
2008;

[8] DEMAZIÈRE D, GADEA C, BECKER H. Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis.
La Découverte, Collection Recherches;
Paris:2009;

[9] DUBAR C, TRIPIER P. La sociologie des professions.
A. Colin;
Paris:1998;

[10] FAVRE F. Les revenus des entrepreneurs individuels en 2005.
Insee, Première;
février 2008;
1175

[11] GRESLE F. Indépendants et petits patrons : pérennité et transformation d’une classe sociale.
Éd. Honoré Champion;
Paris:1980;

[12] GRESLE F. Indépendance professionnelle : Actualité et portée du concept dans le cas français.
Revue française de sociologie. 1981a;
22 :483
-501

[13] GRESLE F. Les petits patrons du Nord (1920-1975).
PUL;
Lille:1981b;

[14] HARDY-DUBERNET AC. Des métiers traditionnels aux vrais métiers.
In : La révolution des métiers.
In: PIOTET F (ed), editors.
PUF, Collection Le lien social;
Paris:2002;

[15] HASSENTEUFEL P. Les médecins face à l’État.
Presses de la FNSP;
Paris:1997;

[16] KAPLAN SL. La fin des corporations.
Fayard;
Paris:2001;

[17] KAPLAN SL, MINARD P. La France malade du corporatisme ? XVIII
e-XX
e siècles.
Belin;
Paris:2004;

[18] KARPIK L. Les avocats. Entre l’État, le public et les marchés, XIII-XX siècle.
Gallimard;
Paris:1995;

[19] LATOUR B. La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État.
La Découverte;
Paris:2002;

[20] LE CROM JP. Syndicats, nous voilà ! Vichy et le corporatisme.
Éditions de L’Atelier, Collection Patrimoine;
Paris:1995;

[21] LEQUIN Y. Le métier.
In : Les lieux de mémoire. Tome III, Les France. vol. 2.
In: NORA P (ed), editors.
Gallimard;
Paris:1992;

[22] MARGAIRAZ M, TARTAKOWSKY D. Le syndicalisme dans la France occupée.
Rennes:PUR;
2008;

[23] MATHIEU-FRITZ A. Les huissiers de justice.
PUF;
Paris:2005;

[24] MENGER PM. Les professions et leurs sociologies. Modèles théoriques, catégorisations, évolutions.
Éditions de la MSH;
Paris:2003;

[25] OFFERLÉ M. Sociologie des groupes d’intérêts.
Montchrestien;
Paris:(1994);
2
e édition 1998.

[26] OFFERLÉ M. Sociologie des organisations patronales.
La Découverte, Collection Repères;
Paris:2009;

[27] PIOTET F. La révolution des métiers.
PUF, Collection Le lien social;
Paris:2002;

[28] POITRINEAU A. Ils travaillaient la France. Métiers et mentalités du XVI
e au XIX
e siècle.
A. Colin;
Paris, :1992;

[29] QUEMIN A. Les commissaires priseurs. La mutation d’une profession.
Anthropos-Economica;
Paris:1997;

[30] RAPELLI S, PIATECKI C. Les travailleurs indépendants de l’industrie, du bâtiment et des services.
Portraits et perspectives.
Alptis, Pharmathèmes;
Paris:2008;

[31] SCHWINT D. Artisans du bois. Travail et passion du tourneur et du tabletier jurassiens.
Cêtre;
Besançon:1997;

[32] SEWELL WH. Gens de métier et révolution. Le langage du travail de l’ancien régime à 1848.
Aubier;
Paris:1983;
(1
ère éd. 1948).

[33] SUPIOT A. Introduction.
In : Servir l’intérêt général.
In: BODIGUEL J, GARBAR CA, SUPIOT A (eds), editors.
Paris:PUF;
2000;

[34] VERRIER B. Les relations sociales dans « les mondes » des très petites entreprises. La note de veille, N° 154/155.
2009;
In: Centre d’analyse stratégique, editors.
http://www.strategie.gouv.fr.

[35] WARIN P. Les dépanneurs de justice.
LGDJ, tome 33;
Paris:2002;

[36] WELLER JM. Le travail administratif, le droit et le principe de proximité.
L’Année sociologique. 2003;
53 :431
-458

[37] ZARCA B. L’artisanat français du métier traditionnel au groupe social.
Economica;
Paris:1986;

[38] ZARCA B. Les artisans, gens de métier, gens de paroles.
L’Harmattan;
Paris:1987;

[39] ZARCA B. Identité de métier et identité artisanale.
Revue française de sociologie. 1998;
XXIX :247
-273

[40] ZDADTNY SM. Les artisans en France au XX
e siècle. Préface de Michèle Perrot.
Belin;
Paris:1999;

Place des travailleurs indépendants dans l’organisation du travail et ses conséquences sur leur santé
Les changements majeurs intervenus au cours des trente dernières années ont profondément bouleversé les organisations du travail et modifié les relations contractuelles de travail, qu’il s’agisse du travail salarié ou non-salarié. Un dossier de la revue « Problèmes politiques et sociaux »
1
a rassemblé les travaux de chercheurs qui, depuis des années, alertent sur ces transformations mettant en péril la vie et la santé physique et mentale des travailleurs. Les auteurs ne traitent pas spécifiquement des travailleurs indépendants, mais examinent les conditions de production des risques psychosociaux ainsi que leurs conséquences, dont la plus dramatique – le suicide – par sa radicalité a conduit à briser le silence qui entoure habituellement les atteintes à la santé liées au travail. Il s’agissait de travailleurs salariés. En quoi cela concerne-t-il les travailleurs indépendants ?
Par comparaison avec celle des travailleurs salariés, la santé des travailleurs indépendants ne peut se comprendre qu’en identifiant la ou les places qu’ils occupent dans l’organisation et la division sociales du travail et des risques. Ceci permet de dégager les invariants et spécificités de leur situation, au regard des risques psychosociaux et d’en examiner les conséquences, même si celles-ci demeurent pour l’essentiel invisibles.
Place des travailleurs indépendants dans la division sociale du travail
La définition que donnent les institutions européennes des travailleurs indépendants est la suivante : « Un travailleur indépendant est un individu qui rend des services réels et authentiques à un autre individu en échange de percevoir une rémunération. Le service peut être effectué sans rapport de subordination et de façon périodique, continue ou régulière. »
2
. Au niveau de l’Union Européenne, un travailleur sur six est « indépendant ». Il s’agit d’une population très hétérogène comme le montre l’exemple de la France.
Selon l’Insee, en 2007, la France comptait 2,3 millions de travailleurs indépendants. Parmi les travailleurs indépendants, la population des agriculteurs indépendants n’a cessé de décroître au cours des dernières décennies. En revanche, la population des travailleurs indépendants du commerce, de l’industrie, du BTP et des services, a augmenté de 2 % par an environ entre 2002 et 2007 pour atteindre 1,5 million en 2007. Leur revenu d’activité moyen est de 28 400 euros par an, mais pour 13 % d’entre eux, il est nul ou négatif
3
.
Il faut distinguer deux types de travailleurs indépendants. Le premier type correspond aux professions libérales exerçant leur activité indépendante en raison de l’organisation d’une profession (médecins, pharmaciens, avocats, notaires), ou dans certains services spécialisés comme l’immobilier, les activités comptables, le conseil, les activités juridiques.
Le second type correspond à ce que des inspecteurs du travail ont pu désigner comme du vrai « faux travail indépendant ». Il s’agit le plus souvent de travailleurs subordonnés à un donneur d’ordre par le biais de relations de sous-traitance qui transforment les rapports de travail en une relation marchande client-fournisseur. Cette situation concerne certains travailleurs indépendants relevant des secteurs du commerce, de l’industrie, du BTP
4
et des services, notamment les services à la personne
5
et plus particulièrement les femmes. Il s’agit d’activités considérées comme peu qualifiées et professionnellement plutôt dévalorisantes. On observe une grande similitude par rapport aux autres formes d’emploi précaire : l’individualisation de l’emploi, la non-reconnaissance de l’expérience et des compétences, l’insécurité économique et l’absence de droits, l’invisibilité des travailleurs eux-mêmes du fait des postes de travail occupés. Dans des activités industrielles comme le BTP, la maintenance ou le nettoyage, ces travailleurs indépendants occupent des postes en bout de cascades de sous-traitance (sous-traitance de sous-traitance à plusieurs niveaux). Les relations qui s’instaurent sont alors marquées par des formes très contraignantes de sujétion temporelle, technique, organisationnelle. La recherche menée sur la sous-traitance de la maintenance des centrales nucléaires en est un exemple emblématique
6
. Dans les services à la personne, la relation individualisée fortement inégalitaire entre « client » et travailleuse indépendante met celle-ci en position dominée sans marges de manœuvre.
Conditions de production des risques psychosociaux et transposition aux travailleurs indépendants
Les risques psychosociaux s’inscrivent dans l’articulation entre l’organisation du travail et la santé au travail. Pour identifier comment ils concernent spécifiquement les travailleurs indépendants, il faut comprendre les dimensions structurelles de la « désorganisation du travail », observée dans les trois dernières décennies, et leur impact sur la santé au travail.
Désorganisation du travail et santé au travail
Une revue de littérature internationale, réalisée par Quinlan et Mayhew
7
, spécialistes de l’impact de la précarisation du travail sur la santé au travail, montre comment la généralisation du recours à la sous-traitance, en particulier lorsqu’elle s’accompagne d’une augmentation du travail indépendant et de l’intérim, peut être qualifiée de « désorganisation du travail » très préjudiciable à la santé des travailleurs. Les auteurs mettent en évidence quatre dimensions majeures des conséquences qui en résultent du point de vue de la santé au travail.
La première est le creusement des inégalités dans la répartition des risques et des conditions de travail entre travailleurs permanents des entreprises dominantes et les autres travailleurs impliqués dans la sous-traitance. Se situant le plus souvent en bout de cascade de sous-traitance, les travailleurs indépendants du second type – faux indépendants – subissent un cumul de risques et de contraintes correspondant à ce qu’exige la réalisation de tâches déléguées d’un niveau de sous-traitance à l’autre, sans possibilité de négocier les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées. C’est souvent à leur niveau que pèse le plus l’obligation de résultats qu’implique la relation client-fournisseur.
La deuxième dimension est l’inadéquation entre les conditions d’exposition aux risques et les dispositifs de prévention prévus par la réglementation du travail. Le Code du travail est construit en référence au contrat de travail. Or, les travailleurs indépendants sont dans une relation commerciale par rapport à ceux qui leur prescrivent le travail. Il s’agit non pas d’une prescription de travail, dans le cadre du contrat qui détermine les droits et obligations de chacun dans le cadre de la relation salariale, mais d’une prestation de services et sa traduction financière. Les droits et obligations de chacun sont régis par le droit commercial et le droit commun (civil ou pénal). Ainsi le droit du travail est-il inopérant, en tant que tel, pour les travailleurs indépendants. En matière de risques professionnels, quels que soient ces risques, le donneur d’ordre n’est pas soumis à l’obligation de sécurité du chef d’entreprise.
La troisième dimension est l’invisibilité croissante des atteintes liées au travail surtout dans le cas des risques à effet différé ou n’ayant pas d’impact physique spécifique. En matière d’accident du travail et des maladies professionnelles, il existe une assurance volontaire pour les travailleurs indépendants qui, bien souvent, n’est pas souscrite. Quelle qu’en soit l’origine, les atteintes à la santé liées au travail des travailleurs indépendants ne sont pas identifiées comme telles.
Enfin, la quatrième dimension est « l’érosion des droits » des travailleurs précaires, salariés et non-salariés. Cette érosion, voire même une absence de droits, se conjugue à différents niveaux :
• en matière de représentation dans les instances de protection de la santé sur les lieux de travail (CHSCT) ;
• en matière d’accès à des droits (droit de retrait en cas d’infraction aux mesures de protection, droit d’expression sur les conditions de travail, obtention des attestations d’exposition) ;
• en matière de reconnaissance en maladie professionnelle pour ceux qui sont atteints.
Face à l’inégalité des pouvoirs entre le « client » et le travailleur indépendant qui réalise une prestation pour ce dernier, il n’existe le plus souvent pas de marges de négociation, individuelles ou collectives, des conditions et contraintes du travail.
Stress et risques psychosociaux dans le travail
La mise en évidence de conditions et contraintes du travail ayant un impact sur la santé mentale des travailleurs s’est faite en référence à deux modèles sur lesquels s’appuient les différentes enquêtes concernant les risques psychosociaux. Le modèle de Karasek prend en considération trois dimensions de l’activité : les exigences du travail, les marges de manœuvre et d’autonomie et le soutien social. Le modèle de Siegrist insiste, pour sa part, sur l’importance de la rétribution, en particulier l’estime (y compris l’estime de soi), le statut, les gratifications monétaires. L’enquête Sumer menée par la Dares en 2003 a permis de mettre en évidence comment le recours à ces modèles permet d’identifier des situations de risque pour la santé psychologique des travailleurs salariés du secteur privé du fait des contraintes organisationnelles vécues dans l’activité de travail
8
. Les résultats montrent une situation à fort risque pour les femmes, les ouvriers non qualifiés, le BTP. Ces situations sont caractérisées par la violence au travail. Celle-ci est constituée de certaines contraintes organisationnelles, temporelles et hiérarchiques, qui caractérisent aussi les relations client-fournisseur vécues par les travailleurs indépendants, sachant que même « indépendants » ces travailleurs sont souvent contraints par les hiérarchies présentes sur les sites ou chantiers dans lesquels ils interviennent. Ces contraintes sont aggravées par le renforcement de contraintes physiques et des menaces de sanction en cas d’erreur. L’enquête Sumer montre qu’il existe, chez les salariés, une perception du lien entre ces situations de « stress » et la mauvaise santé, un soutien social insatisfaisant renforçant l’appréciation négative des salariés sur leur santé.
Il n’existe pas d’étude concernant spécifiquement les risques psychosociaux chez les travailleurs indépendants. Cependant, leur inscription du côté du travail fortement contraint, sans soutien social et sans reconnaissance, mise en évidence dans l’enquête Sumer, fait penser qu’ils sont particulièrement concernés par le stress et les risques psychosociaux au travail, sachant qu’ils connaissent une insécurité économique permanente, avec la hantise de ne plus trouver de travail sur le marché des indépendants.
Invisibilité/visibilité des conséquences : le cas du suicide
« Il s’agit, partout et toujours, de contradictions graves entre les exigences de la vie sociale et le destin individuel »
9
. La définition du suicide donnée par Christian Baudelot et Roger Establet met en question ces « exigences de la vie sociale » que comporte la vie professionnelle sur ce versant du travail sous-traité et des services. Le suicide au travail, comme tout acte de violence contre soi-même, est une énigme difficile à déchiffrer.
Tout d’abord, rappelons qu’il ne s’agit pas d’un phénomène inédit. Pour la seule année 1995, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) de la centrale nucléaire de Chinon avait dénombré huit cas de suicide chez des salariés d’entreprises extérieures intervenant dans la maintenance de la centrale... sans attirer l’attention des médias ! L’organisation du « travail irradié », nécessaire à cette maintenance, n’est pas étrangère à cette série de suicides. La direction du parc nucléaire obtient le respect des limites individuelles d’exposition à la radioactivité fixées par la loi, en faisant se succéder, sur les postes concernés, un nombre important de travailleurs recrutés par le biais de la sous-traitance et de l’intérim. C’est ce qu’on appelle la « gestion de l’emploi par la dose ». Cette pratique, discriminatoire, fait perdre leur emploi aux travailleurs temporaires qui, ayant atteint la dose-limite, se voient interdits d’entrée en centrale, exclus de leurs lieux de travail. Pour ces intermittents du nucléaire, la contradiction entre emploi et santé se révèle insurmontable, car ils sont seuls à l’assumer. C’est ce que l’un d’entre eux, suivi dans le cadre de l’enquête citée plus haut, a signifié peu avant son suicide. Il faut souligner que les quelque vingt-cinq mille à trente-cinq mille travailleurs extérieurs intervenant en « zone contrôlée » (c’est-à-dire comportant un risque d’irradiation) pour la maintenance des installations nucléaires (soit environ 50 % du personnel surveillé) reçoivent 80 % de la dose collective d’irradiation subie dans l’industrie nucléaire française.
Quand, à quelques mois d’intervalle, en 2005-2006, quatre cadres et techniciens hautement qualifiés du Technocentre de Renault à Guyancourt mettent fin à leurs jours, sur le lieu de travail ou en imputant explicitement leur suicide au travail, une réelle inquiétude s’exprime au-delà des murs de ce fleuron de l’industrie automobile française. Selon les éléments d’enquête et d’expertise menées au Technocentre, la transformation pour les salariés de l’obligation normale de travail en une obligation de résultats (le « Contrat 2009 ») a fait naître des contradictions impossibles à résoudre. Ce contrat vise l’augmentation du dividende par action de 250 %. Cet enjeu financier converti en objectifs productifs supposait une croissance des ventes de huit cent mille véhicules entre 2005 et 2009 et le lancement de vingt-six nouveaux modèles en trois ans. Chaque salarié s’est retrouvé alors personnellement engagé sur ce « Contrat 2009 », avec des objectifs à atteindre. L’évaluation continue et individualisée de l’activité exerce une pression constante sur chaque salarié sans possibilité de discuter les contradictions techniques et temporelles, individuelles et collectives, d’un tel défi.
Ces deux exemples permettent d’aller plus loin que la question d’une « exposition aux risques psychosociaux », comme le fait Yves Clot
10
. Ce dernier met en lumière les limites d’une compréhension « hygiéniste » de ces risques, vus comme menace externe supportée passivement par des travailleurs « exposés ». Il situe le danger au cœur d’une impossibilité d’accomplissement du travail par ceux-là mêmes qui ont à cœur de l’accomplir. Telle est la contradiction majeure mais aussi l’enjeu des rapports sociaux de travail, qui, selon lui, constitue l’urgence « pour en finir avec les risques psychosociaux ».
Les conditions de possibilité de suicides chez des travailleurs indépendants puisent aux mêmes sources que celles du suicide chez les salariés. Elles invitent, non pas à chercher des spécificités pouvant infléchir telle ou telle dimension de l’analyse, mais au contraire renforcent l’urgence à agir sur l’organisation du travail en tenant compte en tout premier lieu de la critique qu’en font les premiers intéressés.
En conclusion, la croissance du travail non-salarié, dans sa version de « vrai faux travail indépendant », met en question les règles du Code du travail dont le sens premier était de contrôler la violence née de l’inégalité structurelle des rapports de travail dans le cadre de la relation salariale. Les conséquences sur la santé se lisent d’elles-mêmes, même si du fait de l’invisibilité de ces travailleurs elles demeurent également invisibles.
La lutte contre les formes de violence vécues aujourd’hui par les travailleurs indépendants suppose la mise en application des principes généraux de prévention contenus dans la directive cadre européenne sur la santé au travail de 1989 qui voit dans la participation des travailleurs à l’évaluation des risques et à la mise en place des stratégies de prévention le socle d’une véritable politique de santé au travail. Alors que la connaissance des risques par les salariés eux-mêmes est reconnue comme la garantie d’une dynamique de prévention dans l’activité de travail, les relations de sous-traitance entre donneurs d’ordre et sous-traitants ont instauré une incommunicabilité entre celui qui prescrit le travail - le donneur d’ordre - et ceux qui l’exécutent dans les activités sous-traitées. Les travailleurs indépendants sont particulièrement concernés. C’est la légitimité même de ces travailleurs comme acteurs premiers de la prévention qui doit être établie, avec des formes de représentation à inventer, pour permettre une compréhension des atteintes psychologiques et des moyens de transformer le travail pour les éliminer.
Annie Thébaud-Mony
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), Inserm U 723
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
Données de décès par suicide
Le lien entre stress au travail et suicide a été jusqu’à aujourd’hui peu étudié en France. Une étude détaillée de cette problématique pourrait tirer profit de la base de données de mortalité par cause de décès du CépiDc-Inserm. En effet, ces données de mortalité constituent un premier indicateur épidémiologique facilement utilisable, car, pour chaque décès survenu en France, un certificat médical rapportant les causes du décès doit être établi par un médecin.
Ce chapitre décrit dans un premier temps la base de données de mortalité du CépiDc-Inserm, en présentant les principes de la certification médicale et du codage des causes, de la description du certificat jusqu’à la sélection de la cause initiale de décès. Dans un second temps est rapporté le niveau de la mortalité par suicide en France métropolitaine, selon les caractéristiques démographiques habituellement utilisées en épidémiologie descriptive (sexe, âge, état matrimonial). Dans une troisième partie, la mortalité par suicide est étudiée selon les catégories socioprofessionnelles à partir des données disponibles dans la base du CépiDc, en insistant sur les limites d’un tel exercice.
Base de données de mortalité par cause médicale de décès
La statistique nationale des causes médicales de décès est élaborée annuellement par le Centre d’Épidémiologie sur les Causes Médicales de Décès (CépiDc-Inserm) à partir des informations fournies par les certificats médicaux de décès.
De la certification médicale à la codification de la cause initiale de décès
Certification des décès
Selon la loi nº 2004-806 du 9 août 2004, article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales : « L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité... ».
Ce court texte fixe les caractéristiques principales de la certification médicale des décès en France : la certification est obligatoire, le certificat doit être établi par un médecin et les causes du décès sont confidentielles.
Certificat médical de décès
L’enregistrement des causes médicales de décès est principalement motivé par la prévention : identifier et quantifier les causes de décès sur lesquelles il est possible d’agir. La certification des décès par les médecins est encadrée par le format du certificat de décès et par le concept de cause initiale du décès. La codification des causes de décès par des codeurs-nosologistes s’appuie sur la Classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS (1993). Ce cadre vise à maximiser la qualité et la comparabilité internationale des données de mortalité. Malgré cette standardisation, il existe des différences entre pays dans la certification et la codification qui peuvent influencer les données, comme par exemple le niveau de confidentialité des causes de décès ou le système de codification manuel ou automatique.
Le certificat de décès comporte deux parties qui doivent être remplies par un médecin. Une partie supérieure comportant l’identification de la commune de décès et l’identification du décédé. Cette partie nominative permet également au médecin de spécifier la date du décès et la présence ou non d’un obstacle médico-légal. Elle est signée par le médecin qui doit également apposer son cachet. Une partie inférieure permettant de spécifier les causes médicales du décès. Cette partie comporte certains renseignements individuels (lieu de décès, sexe, date de naissance et de décès), les causes du décès et des informations complémentaires sur le décès. Cette partie doit également comporter la signature et le cachet du médecin. De plus, elle doit être close afin de préserver la confidentialité des causes de décès. La partie médicale du certificat de décès comprend elle-même deux parties :
• la partie 1 comporte 4 lignes qui permettent au médecin de décrire l’enchaînement causal ayant directement conduit à la mort, de la cause immédiate rapportée sur la première ligne à la cause initiale mentionnée sur la dernière ligne remplie ;
• la partie 2 permet de notifier les autres états morbides qui ont pu contribuer au décès.
La cause initiale de décès est définie par l’OMS comme « a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l’évolution morbide conduisant directement au décès, ou b) les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel ». La cause initiale est donc la cause sur laquelle il faut agir pour prévenir le décès. C’est cette cause qui sera principalement utilisée pour présenter les statistiques des causes médicales de décès.
Circuit administratif du certificat
Le médecin remplit les 2 parties du certificat et le transmet à la mairie. La mairie rédige alors 2 documents : l’avis 7 bis et le bulletin 7. L’avis 7 bis comporte le nom de la personne décédée et les informations d’état civil, il est transmis à l’Insee. Le bulletin 7 comprend les mêmes informations individuelles sur la personne décédée mais sans le nom. La mairie envoie l’avis 7 bis à l’Insee et le bulletin 7, accompagné de la partie inférieure du certificat toujours close, à la Ddass du département. La partie inférieure du certificat est ensuite envoyée à l’Inserm toujours accompagné du bulletin 7. Ce circuit relativement complexe a pour objectif de garantir la confidentialité des causes de décès : l’Insee sait qui est mort mais ne connaît pas les causes médicales du décès, alors que l’Inserm connaît les causes du décès mais ne sait pas qui est la personne décédée.
En parallèle à cette procédure, en cas de mort suspecte, une investigation judiciaire est engagée. Le corps est alors examiné dans un institut médico-légal (IML) par un médecin légiste qui rédige le certificat médical de décès définitif. Le retour d’information sur les causes de décès par les instituts médico-légaux suite à une mort suspecte, pose parfois problème. En effet, certains IML ne transmettent pas leurs informations médicales au CépiDc-Inserm. Ce manque d’information entraîne entre autre une sous-estimation des décès par suicide.
Codification médicale des décès
La codification médicale des décès comporte deux tâches distinctes et successives :
• attribuer un code à chaque maladie, traumatisme ou cause externe de décès mentionné sur le certificat ;
• sélectionner et coder la cause initiale de décès.
La Classification internationale des maladies (CIM) définit les codes, les règles et les directives permettant de mener ces tâches à bien.
Classification internationale des maladies (CIM)
La CIM existe depuis plus d’un siècle. Elle est révisée périodiquement et la version actuelle est la dixième révision (CIM 10) (1993). Différentes règles permettent au codeur de sélectionner la cause initiale du décès, en respectant le plus possible les informations rapportées par le médecin certificateur. La cause initiale mentionnée par le médecin sur le certificat peut être ambiguë, erronée ou ne pas répondre aux besoins statistiques. Par exemple, le médecin peut mentionner une cause initiale acceptable, comme une dépression entraînant un suicide, mais la présentation des statistiques de mortalité selon la seule cause initiale privilégie la sélection de la cause externe (suicide) par rapport à la maladie (dépression).
Codes utilisés dans la CIM 10 dans le cas du suicide
Les codes de la Classification internationale des maladies utilisés pour le suicide se situent au sous chapitre « Lésions auto-infligées » (codes X60-X84) du chapitre XX de la dixième révision (CIM 10) intitulé « Causes externes de morbidité et de mortalité ». De plus, le code « Y87.0 » correspondant aux « Séquelles d’une lésion auto-infligée » a été retenu pour homogénéiser les données analysées.
Niveau de la mortalité par suicide en France métropolitaine
Mortalité selon le genre
En 2007, la statistique officielle recense en France 10 093 décès par suicide (tableau I

). Le poids de ces décès est de 2 % dans la mortalité toutes causes (530 820 décès). Les hommes sont plus touchés que les femmes : 7 décès sur 10 sont masculins, représentant plus d’un tiers des morts violentes chez les hommes. Avec 2 698 décès, la part des suicides chez les femmes est trois fois moins élevée (1 % de la mortalité générale féminine) correspondant à un décès féminin sur cinq par mort violente.
Tableau I Effectif et taux bruts de décès selon la classe d’âge (France métropolitaine, année 2007)
| |
Deux sexes
|
Masculin
|
Féminin
| |
| |
Effectif
|
%
|
Tauxa
|
Effectif
|
%
|
Tauxa
|
Effectif
|
%
|
Tauxa
|
Ratio H/F
|
|
<15 ans
|
21
|
0,2
|
0,2
|
15
|
0,2
|
0,3
|
6
|
0,2
|
0,1
|
2,4
|
|
15-24 ans
|
506
|
5,0
|
6,4
|
393
|
5,3
|
9,8
|
113
|
4,2
|
2,9
|
3,4
|
|
25-34 ans
|
1 039
|
10,3
|
13,1
|
838
|
11,3
|
21,2
|
201
|
7,4
|
5,1
|
4,2
|
|
35-44 ans
|
1 897
|
18,8
|
21,7
|
1 419
|
19,2
|
32,8
|
478
|
17,7
|
10,8
|
3,0
|
|
45-54 ans
|
2 254
|
22,3
|
26,8
|
1 644
|
22,2
|
39,9
|
610
|
22,6
|
14,2
|
2,8
|
|
55-64 ans
|
1 531
|
15,2
|
21,2
|
1 017
|
13,8
|
28,8
|
514
|
19,1
|
13,9
|
2,1
|
|
65-74 ans
|
1 070
|
10,6
|
21,5
|
755
|
10,2
|
33,3
|
315
|
11,7
|
11,6
|
2,9
|
|
75-84 ans
|
1 230
|
12,2
|
31,3
|
909
|
12,3
|
59,5
|
321
|
11,9
|
13,4
|
4,4
|
|
85 ans et +
|
545
|
5,4
|
41,7
|
405
|
5,5
|
107,6
|
140
|
5,2
|
15,1
|
7,1
|
|
Total
|
10 093
|
100,0
|
16,3b
|
7 395
|
100,0
|
27,7b
|
2 698
|
100,0
|
8,5b
|
2,9
|
a Taux bruts/100 000 ; b Taux standardisés/100 000 (Population de référence : France métropolitaine au RP1990)
Le taux de décès standardisé par âge s’élève à 16,3 décès pour 100 000 habitants. Le taux masculin atteint 27,7. Le taux féminin, de 8,5, est nettement inférieur. Le ratio de surmortalité masculine correspondant est de 2,9.
Mortalité selon l’âge
Les deux tiers des décès par suicide surviennent entre 25 et 64 ans (6 721 décès). Les taux de décès progressent très fortement avec l’âge, mais cette augmentation n’est pas régulière (tableau I

). Pour l’ensemble de la population, on distingue très nettement trois phases : une forte augmentation jusqu’à 45-54 ans, suivi d’un fléchissement entre 55 et 64 ans. À partir de 65 ans, le taux de décès par suicide croît à nouveau considérablement. Ces tendances sont particulièrement marquées chez les hommes.
Mortalité selon le statut marital
Dans la population des plus de 25 ans, c’est chez les divorcés que les taux de décès standardisés sont les plus élevés (33,2/100 000). Ils sont suivis par les décès des célibataires (taux de 31,0/100 000). Les personnes mariées se suicident deux fois moins (tableau II

).
Chez les femmes, les divorcées demeurent largement touchées (18,9/100 000). Les taux de décès des veuves et des célibataires sont très proches (de l’ordre de 14/100 000). Pour les hommes en revanche, ce sont les veufs qui se suicident le plus fréquemment (taux de 78,1/100 000), suivis par les divorcés (55,5/100 000) et les célibataires (48,0/100 000). Autant chez les hommes que chez les femmes et, quel que soit l’âge, les taux de décès des mariés restent les plus faibles. La surmortalité masculine est particulièrement marquée chez les veufs (5,6/100 000) et se situe à environ 3/100 000 pour les autres statuts.
Tableau II Taux standardisés de décès selon le sexe et le statut matrimonial (plus de 25 ans, année 2007, France métropolitaine)
| |
Deux sexes
|
Masculin
|
Féminin
| |
| |
Effectif
|
Tauxa
|
Effectif
|
Tauxa
|
Effectif
|
Tauxa
|
Ratio H/F
|
|
Célibataires
|
2 867
|
31,0
|
2 248
|
48,0
|
619
|
14,3
|
3,4
|
|
Mariés (es)
|
4 152
|
15,9
|
3 180
|
24,2
|
972
|
7,2
|
3,3
|
|
Veufs (ves)
|
1 198
|
26,8
|
662
|
78,1
|
536
|
13,9
|
5,6
|
|
Divorcés (es)
|
1 377
|
33,2
|
916
|
55,5
|
461
|
18,9
|
2,9
|
|
Total
|
9 594
|
22,5
|
7 006
|
34,7
|
2 588
|
10,9
|
3,2
|
a Taux standardisés/100 000 (Population de référence : France métropolitaine au RP1990)
Mode de suicide selon le genre
Trois modes de suicide sont majoritairement utilisés (trois quarts des suicides) (tableau III

). En premier lieu, la pendaison avec près d’un décès sur deux. Ce mode est suivi à part égale (15 %), par l’ingestion d’une substance liquide ou solide (principalement des médicaments) et l’utilisation d’une arme à feu. Le saut d’un lieu élevé et la noyade représentent conjointement 12 % des décès par suicide. Le gaz domestique ou l’arme blanche sont nettement moins usités.
La fréquence du mode de suicide diffère selon le sexe. La pendaison reste le moyen le plus employé quel que soit le sexe, mais elle est beaucoup plus répandue chez les hommes (un décès sur deux). Le deuxième procédé masculin est l’emploi d’une arme à feu dans un cas sur cinq, précédant l’ingestion de médicaments. L’absorption de médicaments avec trois décès sur dix, est trois fois plus utilisée par les femmes que par les hommes. La chute d’un lieu élevé et la noyade sont nettement plus fréquentes chez les femmes avec un poids avoisinant chacun 11 %.
Tableau III Part de décès selon le mode de suicide (année 2007, France métropolitaine)
| |
Deux sexes
|
Hommes
|
Femmes
|
|
Pendaison
|
48,0
|
53,9
|
31,9
|
|
Ingestion de produits
|
15,8
|
10,1
|
31,2
|
|
Arme à feu
|
13,9
|
18,0
|
2,6
|
|
Saut d’un lieu élevé
|
6,5
|
4,7
|
11,3
|
|
Noyade
|
5,3
|
3,3
|
10,6
|
|
Autres - non précisés
|
10,6
|
9,9
|
12,5
|
|
Total
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Mortalité par suicide par profession et catégories socioprofessionnelles
La profession et la catégorie socioprofessionnelle (CSP) sont déclarées à la mairie au moment du décès. La déclaration peut aussi bien être faite par le médecin, que les proches ou l’administration funéraire. Cette information n’est traitée et codée par l’Insee que pour les sujets actifs, excluant ainsi l’information des sujets retraités, formant la très grande majorité des décès.
Le nombre de valeurs manquantes étant particulièrement important pour les femmes, y compris pour les sujets d’âges actifs (66 % de valeurs manquantes), seuls les résultats pour les hommes sont présentés ici.
Par ailleurs, les indépendants ne peuvent pas être spécifiquement distingués dans ces calculs.
Pour la tranche d’âge des 25-59 ans, le taux de mortalité standardisé par suicide est 4 fois plus élevé pour les agriculteurs exploitants et ouvriers comparé aux cadres et professions intellectuelles supérieures (tableau IV

). Le taux de mortalité standardisé des professions libérales et indépendantes se situe à un niveau intermédiaire.
Tableau IV Taux de mortalité par profession et catégories socioprofessionnelles (CSP) chez les hommes de 25 à 59 ans (année 2006, France métropolitaine)
| |
Tranche d’âges (année)
|
|
Catégorie socioprofessionnelle
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50-54
|
55-59
|
25-59a
|
|
Agriculteurs exploitants
|
34,1
|
25,1
|
30,0
|
31,0
|
38,1
|
40,3
|
27,0
|
31,8
|
|
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
|
18,9
|
14,4
|
13,5
|
20,9
|
21,4
|
22,0
|
17,3
|
18,0
|
|
Cadres, professions intellectuelles supérieures
|
6,8
|
5,0
|
6,1
|
8,6
|
8,2
|
12,6
|
10,2
|
7,9
|
|
Professions intermédiaires
|
6,0
|
9,3
|
14,2
|
16,5
|
17,8
|
16,8
|
19,0
|
13,7
|
|
Employés
|
13,6
|
13,2
|
22,7
|
25,6
|
47,6
|
32,7
|
30,9
|
25,0
|
|
Ouvriers
|
16,4
|
23,0
|
30,3
|
32,7
|
36,2
|
31,6
|
33,7
|
28,4
|
|
Ensemble
|
12,0
|
14,3
|
19,7
|
22,5
|
26,4
|
23,7
|
21,7
|
19,5
|
a Taux standardisés/100 000 (Population de référence : France métropolitaine au RP1990)
Qualité des données de mortalité
Les données de mortalité par suicide sont théoriquement exhaustives. Cependant, certains suicides peuvent être « masqués » par une autre cause de décès au niveau de la certification médicale
1
. Les biais induits par ce phénomène peuvent être mesurés indirectement en analysant les causes de décès « concurrentes » définies comme des causes de décès pouvant « masquer » un suicide dans les statistiques. Ce peut être le cas des morts violentes indéterminées quant à l’intention et des causes inconnues de décès. Les résultats d’une enquête réalisée en 2003 sur un échantillon de cas auprès des médecins certificateurs, indiquaient que l’on pouvait estimer à 35 % la part des causes indéterminées étant en fait des suicides (Chappert et coll., 2003

). Depuis 2006, le CépiDc-Inserm met en place la certification électronique des causes médicales de décès en France (Pavillon et coll., 2007

). Ce projet a pour objectif de raccourcir le délai de mise à disposition des causes médicales de décès et d’accroître la qualité des données. Dans le cas des causes indéterminées quant à l’intention, cette procédure permettra au CépiDc d’obtenir très rapidement des informations complémentaires auprès du médecin certificateur. L’autre source de biais considérée, les causes inconnues, s’explique souvent par une absence de retour d’informations suite à une enquête médico-légale, ce qui est en particulier le cas pour Paris. Deux enquêtes effectuées avec les instituts médico-légaux de Paris et de Lyon ont permis d’estimer qu’environ 25 % de ces cas étaient des suicides (Tilhet-Coartet et coll., 2000

; Jougla et coll., 2002

). Ces études ont conclu que les taux de suicides déterminés à partir des données officielles étaient sous-évalués d’environ 20 %. Une enquête réalisée plus récemment par le CépiDc a cependant réévalué cette sous-estimation à 10 % (résultats non publiés). L’amélioration des statistiques de décès en France impose un retour exhaustif des informations issues des instituts médico-légaux.
En conclusion, le suicide, inacceptable en ce qu’il tue en majorité des sujets jeunes, et parce qu’il est le résultat d’une détresse non perçue par l’entourage, doit faire l’objet d’actions ciblées à partir d’indicateurs pertinents. La base de données du CépiDc-Inserm permet de décrire de façon fiable un grand nombre de caractéristiques de la mortalité par suicide. À ce jour, elle est la seule base de données nationale et à visée d’exhaustivité sur cette problématique. Cependant, ces données ne permettent pas à elles seules de réaliser une étude de l’impact des facteurs professionnels et sociaux sur la mortalité par suicide. En effet, l’information socioprofessionnelle sur la personne décédée est souvent trop partielle, peu fiable et peu précise. Elle nécessiterait une évolution du recueil de données au niveau de l’état-civil. Le CépiDc propose à cet égard l’inclusion de questions supplémentaires simples permettant de renseigner la dernière catégorie socioprofessionnelle pour les personnes retraitées ou anciennement actives. Des appariements entre la base de données du CépiDc et des informations socioprofessionnelles disponibles à un niveau individuel dans d’autres bases, l’Echantillon démographique permanent (EDP) et l’échantillon des données DADS (Déclaration automatisées des données sociales), ont été effectués par le passé (Cohidon et coll., 2010a

et b

). Outre les apports complémentaires de ces méthodes à la connaissance épidémiologique du suicide, ces analyses permettent de constater le faible écart entre les résultats basés sur les certificats de décès et ceux utilisant d’autres sources.
Cependant, les données les plus récentes issues de ces appariements datent de 2002. Une mise à jour régulière de ces appariements ainsi qu’une évaluation directe de la catégorie socioprofessionnelle déclarée sur le certificat de décès à partir de ces données permettraient une production en routine de ces résultats.
Il est enfin important de rappeler que les différentes observations présentées ici confirment l’aspect multifactoriel des facteurs de risque de suicide, incluant des dimensions d’âge, de sexe, de statut marital et de profession. L’étude d’un facteur de risque spécifique ne peut être faite sans la prise en compte de chacun de ces facteurs majeurs.
Grégoire ReyInserm, CépiDc, Le Vésinet, France
Bibliographie
[1] CHAPPERT JL, PEQUIGNOT F, PAVILLON G, JOUGLA E. Évaluation de la qualité des données de mortalité par suicide - Biais et impact sur les données nationales en France, à partir de l’analyse des causes indéterminées quant à l’intention.
DREES, Série Etudes;
30 avril 2003;
45p

[2] COHIDON C, GEOFFROY-PEREZ B, FOUQUET A, LE NAOUR C, GOLDBERG M, IMBERNON E. Suicide et activité professionnelle en France: premières exploitations de données disponibles.
Institut de veille sanitaire. 2010a;

[3] COHIDON C, SANTIN G, GEOFFROY-PEREZ B, IMBERNON E. Suicide et activité professionnelle en France.
Rev Epidemiol Santé Publique. 2010b;
58 :139
-150

[4] JOUGLA E, PEQUIGNOT F, CHAPPERT JL, ROSSOLLIN F, LE TOULLEC A, PAVILLON G. La qualité des données de mortalité sur le suicide.
Rev Epidemiol Santé Publique. 2002;
50 :49
-62

[5]OMS (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ). Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision. Organisation Mondiale de la Santé.
1993;
3 volumes:

[6] PAVILLON G, COILLAND P, JOUGLA E. Mise en place de la certification électronique des causes médicales de décès en France : premier bilan et perspectives.
BEH;
2007;
35-36 :306308

[7] TILHET-COARTET S, HATTON F, LOPEZ C, PEQUIGNOT F, MIRAS A, et coll. Importance des données médico-légales pour la statistique nationale des causes de décès.
La Presse Médicale. 2000;
29 :181
-185

La référence au « travailler » dans le rapport entre santé mentale et travail
Le titre de cette communication peut paraître étrange en raison du terme « travailler » ici utilisé comme verbe substantivé. Si en clinique et en psychodynamique du travail on a introduit ce terme, c’est pour souligner que ce qui compte du point de vue psychologique, ce n’est pas tant le statut (salarié, bénévole, travailleur indépendant) que l’engagement du corps et de l’intelligence dans des gestes, des postures, des habiletés, orientés vers une tâche à accomplir.
La tâche, concept ergonomique, désigne l’objectif à atteindre et le mode opératoire prescrit pour atteindre cet objectif. On sait depuis une quarantaine d’années que les opérateurs ou les travailleurs ne respectent jamais exactement les prescriptions (Daniellou et coll., 1983

). Pour s’approcher au plus près de la tâche, il faut réajuster le mode opératoire, parce que le travail ne se présente jamais exactement comme prévu (pannes, incidents, bugs, accidents, dysfonctionnements, défection du client, retard administratif...).
De fait, les réajustements nécessaires conduisent à un travail effectif différent du travail prescrit : c’est ce qu’en ergonomie on désigne sous le nom « d’activité ». Le « travailler » c’est donc ce qu’il revient à chaque travailleur d’inventer avec son corps et son intelligence pour faire face à ce qui n’a pas été prévu ni prescrit. Or, c’est précisément l’engagement de la personnalité et de l’intelligence pour combler cet écart qui est au centre de l’analyse du rapport subjectif (ou psychique) au travail. Et c’est à ce niveau qu’il convient de faire porter l’investigation si l’on veut comprendre les enjeux psychiques du travail.
C’est dire que dans l’intitulé « stress au travail et santé chez les indépendants », le terme « indépendant » constitue une catégorie analytique inadéquate, car il ne dit rien du « travailler » de chaque individu. D’autre part, ce terme de stress est peu opératoire lui aussi, car il y a des situations où, stressés, les travailleurs se portent bien (par exemple : trader, sportif professionnel...) et des situations où l’ennui, sans stress, génère des symptômes psychopathologiques (pathologie du « placard », Lhuilier, 2002

).
Dans les activités de service, où la part qui revient à la relation avec le client ou l’usager peut générer des conflits psychiques (conflit avec le client et parfois conflit avec soi-même lorsqu’il faut déroger à la déontologie par exemple), il faut recourir à une psychologie qui théorise le conflit intrapsychique, ce qui est impossible avec les « théories » du stress. Enfin, les théories conventionnelles traitent de façon erronée la question de la vulnérabilité individuelle. En effet, avant que survienne la crise ou la décompensation, le même individu a parfois été longtemps compétent et apprécié, en dépit de la vulnérabilité psychologique qui était pourtant déjà là. On peut montrer que ce qui est en cause dans la vulnérabilité psychologique de l’individu est souvent à la source de ses meilleurs talents. C’est le cas lorsque le métier a pu être librement choisi. Dans ce choix, la vulnérabilité joue un rôle important, car la vocation ou l’enthousiasme résultent d’un investissement passionné du métier précisément pour cette raison qu’il donne à l’individu en cause, l’occasion d’une confrontation avec les énigmes héritées de son enfance, par le truchement d’une transposition de ces énigmes sur le théâtre du travail (sublimation). La mobilisation de l’intelligence et le succès apportent alors du plaisir qui profite à la construction et au renforcement de la santé mentale (compensation de la vulnérabilité psychologique).
L’évaluation du travailler est possible. Mais elle ne peut pas être quantitative. Le travailler ne se mesure pas. Au mieux peut-on mesurer le résultat du travail, mais il n’y a aucune proportionnalité entre résultats du travail et travail. L’évaluation doit alors être entendue au sens noble de jugement porté sur la valeur d’une chose. Elle passe par des jugements qui, d’ordinaire, s’articulent dans la psychodynamique de la reconnaissance
1
.
Souffrance au travail
La souffrance au travail n’est pas pathologique, elle est banale. La souffrance au travail résulte de la confrontation au réel. Le réel de la tâche, c’est ce qui se fait connaître à un travailleur (adroit et expérimenté) par sa résistance à la maîtrise (dysfonctionnement, incident, panne, anomalie...) :
• travailler c’est d’abord échouer ;
• c’est ensuite endurer l’échec avec obstination, le temps qu’il faut pour inventer la solution, ou trouver le chemin qui permettra de surmonter le réel ;
• enfin en cas de réussite, le plaisir au travail vient d’abord du pouvoir de vaincre l’échec, et ensuite de la reconnaissance par les autres de la qualité de la contribution apportée à la situation. La reconnaissance passe par deux types de jugement : le jugement d’utilité, proféré par la ligne hiérarchique – subordonnés et supérieurs – qui porte sur l’utilité économique, sociale ou technique du travail ; et le jugement de beauté, proféré par les pairs, qui porte sur la conformité aux règles de travail et de métier ainsi que sur l’originalité des solutions élaborées. Même pour l’indépendant, il y a des lieux de confrontation qui permettent les jugements de reconnaissance : séminaires, formation continue, syndicats professionnels, analyse de pratique... ; il en existe pratiquement dans toutes les professions. Chez les médecins, par exemple, cet exercice est institutionnalisé dans l’évaluation des pratiques professionnelles avec groupes de pairs (EPP).
Le « travailler », lorsqu’il n’est pas reconnu, génère des sentiments d’injustice et de la souffrance. Lorsqu’il bénéficie de la reconnaissance, le travail transforme la souffrance en plaisir et éventuellement en accomplissement de soi. La reconnaissance est une rétribution symbolique dont l’impact est majeur sur l’accroissement de l’identité et par voie de conséquence pour la santé mentale. Car l’identité est l’armature de la santé mentale. Le processus qui, du « travailler » va de la souffrance à la reconnaissance fait du travail un médiateur central dans la santé mentale des adultes.
Être privé de travail, c’est ne plus pouvoir apporter de contribution à l’organisation du travail, à l’entreprise, ni à la société, et c’est par voie de conséquence être privé des bénéfices psychologiques de la reconnaissance. C’est pourquoi la perte d’emploi, la menace de perte d’emploi et le chômage sont délétères pour la santé mentale.
Le travail peut donc générer le meilleur ou le pire en fonction des rapports entre reconnaissance et organisation du travail. Au centre du processus, il y a toujours la référence à la qualité du travail, c’est-à-dire au respect d’un certain nombre de règles qui caractérisent et définissent un métier.
Travail et genre
Le travail engage la subjectivité et l’intelligence, c’est-à-dire la personnalité tout entière. Ce qui signifie que le rapport au travail a toujours des implications en dehors du travail, non seulement sur la personnalité mais sur les relations hors travail, jusque et y compris dans la sphère privée.
De surcroît, les contraintes du travail dans la sphère domestique sont en concurrence avec les contraintes du travail dans la sphère de la production. Ce conflit ne se présente pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes.
De longs développements seraient nécessaires pour montrer que la situation n’est pas égale pour les hommes et pour les femmes, de sorte qu’en clinique du travail le rapport entre le « travailler » et la santé mentale ne se joue pas du tout de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Les théories récentes sur le «
care »
2
permettent aujourd’hui de rendre compte de ces différences avec précision (Gilligan, 1982

; Tronto, 1993

; Molinier, 2003

).
En résumé, si l’on veut étudier les relations entre travail et santé mentale, il faut passer par des investigations de terrain, visant spécifiquement l’analyse, dans chaque situation, du décalage entre travail prescrit et travail effectif, et le coût psychique de sa gestion au quotidien par chaque individu.
Travail collectif
Le travail n’est pas un rapport seulement individuel à la matière, l’outil ou l’objet technique. Le travail implique aussi des relations : on travaille pour un chef, pour ses subordonnés, pour les collègues d’une équipe, et on travaille aussi pour des clients. La psychodynamique de la reconnaissance rend compte, en partie, des enjeux de ces relations structurées par le travail. Mais d’une partie seulement.
De même qu’on avait rappelé le décalage entre tâche et activité au niveau individuel, il convient d’établir une distinction entre l’organisation du travail prescrite (la coordination qui relève des ordres et prescriptions) et l’organisation du travail effective (la coopération qui relève des remaniements ou de « l’interprétation » des ordres par le collectif ou l’équipe de travail). L’écart entre coordination et coopération est géré et régulé par la construction d’accords et de normes inventés par les membres d’un collectif, sur ce qui est acceptable et ne l’est pas, sur ce qui est juste et injuste, efficace et inefficace... L’activité de production des règles (règles de travail, règles de métier, règles de l’art et plus généralement tous les accords normatifs sur le faire ou le « travailler ») sur lesquelles repose la coopération est décrite sous le nom d’activité déontique. Elle ne peut pas être développée ici (Dejours, 2009

). On peut toutefois souligner deux choses :
• les règles de travail construites dans l’activité déontique traitent d’abord le problème de l’efficacité de la coopération à l’égard de la production et de la rentabilité. Mais elles traitent toujours, en même temps, la question des relations entre les membres d’un collectif : respect, entraide, prévenance, solidarité, savoir-vivre...
• l’activité déontique est le ressort fondamental de la maintenance et du renouvellement de la convivialité et du vivre ensemble. On peut montrer que c’est sur la qualité des relations qui se tissent pour la coopération que repose l’essentiel de l’activité préventive en matière de santé mentale au travail (par le truchement de l’entraide et de la solidarité).
Coopération, travail indépendant et santé mentale
Chez les travailleurs indépendants, le problème de la coopération est essentiel au regard de la santé mentale en dépit de l’orientation tendancielle vers l’isolement et la solitude qui caractérise un grand nombre de ces emplois.
Dimensions de la coopération
On distingue actuellement trois dimensions dans la coopération (du Tertre, 2008

) :
• la coopération horizontale entre pairs, entre collègues, entre membres d’un collectif ou d’une équipe ;
• la coopération verticale, avec les chefs et avec les subordonnés ;
• la coopération transverse avec le client, qui devient très importante dans les activités de service.
Car en fin de compte la qualité du service dépend pour une bonne part de la coopération avec le client. Par exemple, pour le diabétologue, la qualité de sa prise en charge du patient dépend de la façon dont il parvient à obtenir la coopération du diabétique et dont il lui permet d’accroître ses compétences dans la conduite et l’auto-surveillance de son propre traitement. Il en va de même avec la question de la coopération des adolescents au travail de transmission de connaissances et de formation proposé par les enseignants dans les lycées et collèges, ou encore de la coopération que le banquier doit être capable d’établir avec l’entrepreneur auquel il va prêter des fonds.
Déontique, qualité et quantité
Pour les travailleurs indépendants, il existe souvent un conflit de rationalité entre contrainte économique (chiffre d’affaire, marge, rentabilité...) et contrainte de qualité (règles de métier, déontologie...). À chaque fois que la contrainte économique s’accroît, il y a un risque pour la qualité du travail. La quantité de travail à fournir nuit tendanciellement au respect des règles de métier.
Or, les compromis avec les règles de travail peuvent menacer le respect de l’éthique professionnelle, et engager dans certains cas le rapport à l’éthique personnelle (consentir à des pratiques que moralement on réprouve). Il en résulte alors l’apparition de ce qu’on désigne en clinique et psychodynamique du travail sous le nom de « souffrance éthique ». La souffrance éthique résultant des compromis voire des compromissions par rapport à l’éthique professionnelle est à l’origine de la perte du sens du travail et fait le lit de nombreuses décompensations psychopathologiques (atteinte du socle éthique de l’identité et déstabilisation de la santé mentale).
Dans le travail indépendant, la multiplicité des tâches à accomplir n’engendre pas seulement un problème de compétences ou de polyvalence. Si l’on classe les tâches en quatre groupes principaux :
• tâches commerciales (réseau, contacts, suivi, marketing, démarchage...) ;
• tâches administratives et comptables, voire juridiques et fiscales ;
• tâches de production ;
• tâche de formation-information.
On constate qu’entre ces tâches naissent aussi des contradictions de rationalité qui se situent au-delà des questions soulevées par l’acquisition des compétences spécialisées.
La difficulté principale est d’abord d’éviter la surcharge et les pathologies de surcharge. La difficulté seconde consiste à maintenir, actualiser et accroître les connaissances et les compétences. La troisième difficulté, c’est de faire l’arbitrage entre les différentes tâches, à hiérarchiser les priorités, à fixer les compromis entre les exigences propres à chacune des tâches. Cette difficulté s’est considérablement accrue lorsque le travailleur indépendant ne peut pas confronter sa pratique à celle des autres, c’est-à-dire lorsqu’il se fait prendre dans la spirale de l’isolement vis-à-vis de la communauté de métier, ou de la communauté de pairs ou d’appartenance.
En conclusion, la difficulté dans l’analyse du rapport entre santé mentale et travail chez les indépendants résulte :
• de la multiplicité des tâches à assumer conjointement ;
• des conflits de rationalité entre les différentes tâches ;
• de la difficulté à arbitrer et à établir un compromis entre ces rationalités ;
• de la tendance à l’isolement avec ses conséquences sur les risques de perte de sens du métier, de souffrance éthique, de pathologie de surcharge (sans parler des craintes portant sur la compétitivité, l’endettement et de dépôt de bilan).
Cette grande diversité et variabilité impliquent en retour des contraintes spécifiques d’investigation scientifique. Il est nécessaire de multiplier les enquêtes de terrain analysant la situation jusque dans le détail du « travailler », avec les méthodologies cliniques ad hoc. Cet effort en faveur de l’investigation de terrain devrait être capitalisé sous la forme de nouvelles compétences à l’analyse du travail qu’il faudrait ensuite mettre à la disposition des travailleurs indépendants dans des centres de ressources soutenus par les politiques publiques.
Christophe DejoursLaboratoire Psychologie du travail et de l’action Conservatoire national des arts et métiers, Paris
Bibliographie
[1] DANIELLOU F, LAVILLE A, TEIGER C. Fiction et réalité du travail ouvrier. Documentation Française.
Les Cahiers Français. 1983;
209 :39
-45

[2] DEJOURS C. Travail vivant. Tome II : Travail et émancipation.
Payot;
Paris:2009;

[3] DU TERTRE C. Services immatériels et relationnels : intensité du travail et santé.
Activités. 2008;
23 :37
-49

[4] GILLIGAN C. Une voix différente : pour une éthique du « care ».
Flammarion;
Paris:1982, traduction française, 2008;

[5] LHUILIER D. Placardisés : des exclus dans l’entreprise.
Seuil;
Paris:2002;
232p

[6] MOLINIER P. L’enjeu de la femme active.
Petite Bibliothèque Payot;
Paris:2003;

[7] TRONTO J. Un monde vulnérable. Pour une éthique du « care ».
La Découverte;
Paris:1993, traduction française, 2009;

Réseau Anact et prise en compte du travail dans la prévention des risques psychosociaux
L’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, 80 personnes) est un établissement public administratif caractérisé par sa gestion tripartite : État (tutelle assurée par le ministère du Travail, Direction générale du travail), organisations patronales (Medef, UPA, CGPME) et les 5 confédérations syndicales (CGT, CFDT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC). L’Anact « fonctionne » en réseau avec 26 Aract (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail, 220 salariés) qui sont des associations loi 1901, donc de droit privé, gérées par des conseils d’administration paritaires.
Le projet du Réseau Anact (Anact et Aract) est d’améliorer les conditions de travail des salariés des entreprises françaises, en particulier par la production de connaissances issues de ses expériences et destinées aux acteurs de l’entreprise ou branches professionnelles.
Le champ des conditions de travail sur lequel le réseau intervient a été défini dans le cadre du dernier contrat de progrès (CP4) qui lie le réseau à l’État, il s’agit :
• de la promotion de la santé au travail ;
• du développement des compétences des personnes ;
• de l’organisation du travail ;
• du pilotage des conditions de travail ;
• d’une meilleure connaissance des populations au travail ;
• du lien entre performance économique et amélioration des conditions de travail.
Concrètement, le réseau travaille sur des questions telles que les risques psychosociaux, les troubles musculosquelettiques, l’approche globale de la prévention des risques, les approches par la simulation du travail, le développement de diagnostics territoriaux autour des impacts du travail, l’usure professionnelle, l’approche des conditions de travail par le genre, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le management du travail...
Les modalités d’action du réseau sont extrêmement variées : interventions, colloques, publications, formations, manifestations... Elles visent un but ultime de transfert auprès de cibles identifiées : les acteurs relais (exemples : médecins du travail, direction des ressources humaines, préventeurs, conseillers formation...), des partenaires sociaux (confédéraux, branches, entreprises) et les TPE, PME. L’Anact intervient plus précisément auprès des grandes entreprises.
Approche de l’Anact sur la question des risques psychosociaux
Difficulté à faire émerger le sujet
L’Anact est en veille sur le sujet des risques psychosociaux depuis 1995 en rassemblant et analysant les différentes formes de production en France et à l’étranger. Les mouvements organisationnels repérés dans les entreprises (financiarisation, organisation
Lean1
, délocalisation...) sont autant de thèmes qui génèrent des impacts sur les conditions de travail et le ressenti des salariés, et l’Anact est attentive aux conséquences sur la santé des travailleurs. À cette époque, l’Anact travaillait aussi intensément sur les troubles musculosquelettiques de plus en plus nombreux et dont on pouvait percevoir les conséquences sur les personnes.
Néanmoins, le sujet est parvenu à percer et c’est en 2005 que la décision a été prise de publier en interne un ouvrage sur le stress et les risques psychosociaux (Sahler et coll., 2007
2
), à une période (octobre 2004) où l’accord cadre européen sur le stress au travail venait d’être signé. Dans cet ouvrage, nous tirions les enseignements des années de réflexion et d’interventions en entreprise sur le sujet. Il nous a permis d’en dégager une démarche qu’aujourd’hui nous utilisons dans nos interventions et qui nous apporte ainsi qu’aux nombreux consultants qui l’utilisent, une solidité pour aborder la problématique et envisager des transformations dans l’entreprise.
Fondements de la démarche : déplacement d’une approche technique au profit d’une construction sociale
Cette démarche s’inscrit en tout point dans le cadre des démarches portées habituellement par le réseau : elle est centrée sur le travail. Elle cherche à en comprendre en situation tous les rouages, mécanismes et déterminants humains, organisationnels, techniques, économiques et financiers.
Elle pose comme principe que dans la réalisation de leur travail, les personnes sont soumises à des tensions auxquelles elles doivent faire face. Ces tensions trouvent leur source dans des facteurs variés, de natures différentes, issus de l’organisation. Ces facteurs se confrontent aux ressources dont disposent les personnes. Le terme de ressource, dans ce cas de figure, est à prendre dans un sens large : organisationnelle, physique, mentale, sociale... Les tensions peuvent elles-mêmes être modifiées dans des contextes de changements et varier selon la configuration du soutien en place (collègues, hiérarchie).
L’autre volet que nous développons porte sur l’identification des facteurs de régulation, leurs forces et faiblesses. Analyse des tensions et identification des facteurs de régulation permettent ainsi d’envisager des pistes de transformation. Cette représentation, tensions/facteurs de régulation, construite pour l’intervention dans l’entreprise se veut intégratrice de dimensions présentes dans les questionnaires pour évaluer les risques psychosociaux. Ce n’est évidemment pas un « modèle » universel mais un point d’appui, différent de l’approche épidémiologique, pour favoriser l’adhésion des acteurs. Pour nous aujourd’hui, sa vertu pédagogique n’est plus à démontrer. Nous utilisons volontairement la métaphore du « ressort » pour favoriser la compréhension des acteurs et leur adhésion à la démarche. En effet, cette représentation n’a de sens que si les acteurs s’en saisissent pour enclencher leur propre progression. Car l’enjeu de notre approche est là : mobiliser les acteurs pour qu’ils s’emparent des questions d’organisation du travail dans un but de prévention des risques psychosociaux.
Traditionnellement, la plupart des interventions conduites en entreprise fonctionnent selon le modèle diagnostic/préconisations/plan d’actions. Nous savons depuis la réalisation de l’étude sur la prévention durable des troubles musculosquelettiques (2005-2008) que nous avons conduite avec des équipes de chercheurs
3
qu’un des obstacles majeurs à vaincre pour la prévention reste le temps, c’est-à-dire la pérennisation de la préoccupation prévention dans l’entreprise. C’est vrai pour les troubles musculosquelettiques, pour l’ensemble des risques et aussi pour les risques psychosociaux.
Ceci nous a amenés à porter une attention particulière à cette dimension temporelle. Elle ne peut tenir que si au moins trois conditions sont réunies : l’intérêt maintenu des acteurs pour le sujet, l’installation d’un dispositif, la vivacité du débat social sur la question. La démarche que nous mettons en œuvre tient ensemble ces trois objectifs. Pour qu’il y ait intérêt, il faut élever le niveau de connaissance des acteurs pour qu’ils puissent se détacher des représentations faciles que chacun peut avoir sur les risques psychosociaux, c’est un enjeu majeur. Le dispositif quant à lui est une création sociale originale spécifique à l’entreprise, certaines entreprises installent des commissions, d’autres mettent en place des réseaux sentinelles, des cellules, des groupes d’analyses, des rencontres... Enfin sur le débat social, il permet l’échange, la confrontation de points de vue dans des lieux dédiés réinvestis pour cela comme le CHSCT (Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) ou la rencontre avec les délégués du personnel.
Dès lors, la démarche que nous proposons met en exergue des phases clés que nous avons intitulées : « se mettre d’accord ». Derrière cette dénomination, nous parions sur la mise en mouvement des acteurs et leur capacité à se saisir ensemble de la problématique. « Se mettre d’accord » ne signifie pas qu’il faut aboutir à un seul et même point de vue mais que le compromis élaboré pour entrer dans les phases suivantes de la démarche est d’une part une progression voire un progrès dans la compréhension du phénomène et d’autre part une étape d’enrichissement collectif. Il construit de l’histoire partagée entre les acteurs, fondement pour une pérennisation. Notre expérience nous apprend que l’entrée par le travail de la démarche de prévention des risques psychosociaux permet d’atteindre cet objectif.
Analyser le travail pour mettre à jour les situations qui posent problème
Le repérage des situations posant problème présente deux avantages : en premier lieu elles traduisent des difficultés éprouvées par les personnes et en second lieu, elles sont également un support d’émergence des débats sur le travail parce qu’elles sont identifiées collectivement.
Il s’agit de situations caractéristiques du travail porteuses de difficultés (en termes de réalisation du travail ou de relation de travail) pour les salariés. Lorsque ces situations sont pérennes, c’est-à-dire se reproduisent avec des variabilités mais toujours de manière récurrente et sans que l’organisation y ait trouvé remède, on peut alors parler de « situations problème ».
Ce travail collectif de repérage offre de nombreux avantages pour poser les hypothèses du diagnostic. Le travail est au cœur des échanges puisque ces hypothèses sont supportées par des récits d’événements passés particulièrement perturbateurs pour les salariés. Il s’agit toujours de situations dont les tensions ou les absences de régulation sont clairement identifiées par les salariés. Elles sont porteuses de pistes de transformations. C’est aussi un bon point de départ pour enclencher des analyses rétrospectives, pour remonter aux décisions ou aux événements qui ont façonné l’expression de la difficulté actuelle. C’est une porte d’entrée dans l’analyse rétrospective et dans l’objectivation.
Dans le même temps, l’exercice collectif de travail sur les « situations problème » présente des vertus pédagogiques sur la manière de se saisir des questions du travail, de les débarrasser des éléments qui embrouillent ou masquent la compréhension des phénomènes ou processus à l’œuvre (c’est le travail de l’intervenant). Les situations clairement exposées peuvent alors être observées en situations réelles de travail pour en compléter la description et en optimiser l’analyse.
Favoriser la reconnaissance de « l’objet » travail
Notre approche des risques psychosociaux privilégie un mode d’action « bottom up » (bas vers le haut). Nous pensons fondamentalement, et c’est notre parti pris, que le travail est peu pris en considération. Ce thème est marginalisé. Il a du mal à s’imposer dans les représentations des décideurs, étant trop souvent mis à l’écart au profit d’autres thèmes jugés plus importants comme l’économie, l’emploi voire aujourd’hui l’environnement. Une des hypothèses que nous avons bâties autour de cette émergence des risques psychosociaux provient de ce déficit de prise en compte du travail. Globalement, on peut lire les risques psychosociaux sur le plan collectif comme la traduction d’une faiblesse de reconnaissance de ce qui se joue dans le travail de chacun.
Nos stratégies d’intervention (mais nous ne sommes pas les seuls) visent à réhabiliter le travail dans l’entreprise, à le (re)mettre en visibilité sociale. Nous savons que les entreprises sont généralement bien structurées, y compris les plus petites, pour faire descendre de l’information, top down (haut vers le bas). Les « autoroutes » de circulation de l’information, bien identifiées et très entretenues, existent : notes de service, fiches de poste, fixation d’objectifs, procédures nombreuses et diverses. Ces « autoroutes » fonctionnent toutes avec des boucles de rétroaction là encore bien connues : rapports d’encadrement, contrôle qualité, entretiens d’évaluation, indicateurs de production... L’organisation tient (se tient) avec ce système qui alimente les décisions stratégiques de l’entreprise.
Face à ce système de routage de l’information descendante, le travail (celui qui est réalisé au quotidien) ne dispose pas d’un système de circulation de son information aussi sophistiqué. Tout au plus, il a à sa disposition des « chemins de traverse » (les CHSCT ou délégués du personnel) et quelques « chemins de randonnée » quand l’encadrement met parfois en place des réunions ou échanges de régulation sur le travail. Les informations du terrain ont donc beaucoup de mal à remonter et pénétrer le système de décisions. Une des missions de nos interventions est de défricher du chemin, de construire un système de circulation de l’information ascendant pour permettre à l’information issue du travail d’interagir avec d’autres sources et d’influencer les décisions stratégiques de l’entreprise.
La tâche est ardue. Dans certaines entreprises, on cherchera à élargir des chemins déjà existants ou à « débroussailler » d’anciens chemins abandonnés depuis (par exemple des réunions d’équipe délaissées car jugées improductives), dans d’autres il faudra les créer (défricher) et les faire admettre. Pour le coup « le chemin » est long ! Les oppositions à vaincre sont nombreuses parce que les nouveaux chemins bouleversent un paysage établi. C’est là que les « situations problème » apportent leur force, véritables engins de chantier de crédibilité capables de renverser par leur pertinence bien des obstacles.
Pour que ce nouveau réseau « routier » puisse vivre et tenir dans le temps, il est important de mobiliser les acteurs pour qu’ils prennent conscience de sa plus-value. Le paradoxe est que souvent ce sont les dirigeants qui accordent le plus de crédits à cette nouvelle circulation d’informations. Les salariés souvent résignés et déçus n’y croient plus et l’encadrement ne comprend pas toujours ce nouveau rôle qu’ils doivent jouer. Les représentants du personnel craignent « un court-circuitage » des instances. Les règles et les objets doivent clairement être définis : ils sont l’enjeu majeur de la réussite.
Risques psychosociaux chez des travailleurs qui n’ont pas le statut de salariés
La partie qui suit traite de notre expérience auprès des indépendants (gérants, patrons, artisans, commerçants et agriculteurs) et des hypothèses qui s’en dégagent concernant les facteurs de risque psychosociaux propres aux indépendants.
Expérience auprès des agriculteurs
L’action du réseau Anact est tournée vers l’amélioration des conditions de travail des salariés principalement du secteur privé. Avant de rejoindre le réseau Anact, j’ai travaillé sur la prévention des risques professionnels au sein de la MSA (Mutualité sociale agricole). Cet organisme de sécurité sociale agricole développe des actions de prévention à destination des salariés agricoles mais aussi depuis la loi dite Atexa
4
(accidents du travail des exploitants agricoles) en direction des exploitants. Dans ce cadre, j’ai eu à m’intéresser aux conditions d’installation de nouveaux exploitants ou entrepreneurs agricoles.
La phase d’installation pour ces travailleurs tient à la fois de l’enthousiasme, réussir son projet d’entreprise, et du stress, affronter tous les obstacles et les renverser un à un. Le trait marquant dans ce milieu est le soutien dont bénéficie le candidat à l’installation. Ce soutien revêt plusieurs formes :
• le soutien familial qui apporte de l’expérience, de la main d’œuvre bénévole, de l’encouragement et parfois du capital mais aussi du soutien local ;
• les pairs qui conseillent, orientent (ils sont tous présidents d’une structure locale : assurance, mutualité, crédit, chambre consulaire, coopératives...) et aident par leurs réseaux à lever les obstacles « par un coup de fil bien adressé » disent-ils ;
• les organisations professionnelles qui se sont aussi construites pour aider le « jeune agriculteur » : la chambre d’agriculture, le fonds de formation, mais surtout le syndicat professionnel qui négocie aides et avantages pour le candidat, les centres techniques et les organismes professionnels agricoles (OPA) qui disposent de cellules d’accueil des nouveaux installés. Néanmoins, plus on s’éloigne du cœur de métier agricole (élevage, céréales, viticulture, arboriculture) pour aller vers des entreprises périphériques (paysagisme, horticulture, travaux agricoles) et moins les soutiens structurels sont en place.
Quand on sait le rôle fondamental du soutien (modèle de Karasek) lorsque des personnes ont à faire face à des situations difficiles, stressantes telles que celles vécues lors du lancement d’une activité, le modèle mis en place par l’agriculture est plutôt performant. Cependant, si cette performance est battue en brèche ou si le bouclier du soutien vient à s’effacer, la chute n’est-elle pas alors vertigineuse ? Les résultats de l’étude centrée sur les suicides présentée lors d’un récent colloque de l’InVS (Cohidon, 2010)
5
pointait un niveau de risque trois fois supérieur à celui des cadres...
Cas du chef d’entreprise d’une TPE
Dans les métiers industriels ou commerciaux, les risques psychosociaux des travailleurs indépendants ou chefs d’entreprise de très petites entreprises (TPE) trouvent leur source dans un sentiment profond d’isolement face à un monde hostile.
Le livre autobiographique de Régis Berthier
6
raconte son histoire de chef d’une petite entreprise de moins de 10 salariés, exemple type de la TPE. Construit sous la forme d’un journal, il raconte ses tracas qui deviennent vite des soucis pérennes, profonds qui lui minent sa vie et le tirent (ou le poussent) vers un abîme coloré de noir. Au fil du récit, il est possible de mettre à jour les tunnels dans lesquels il s’enfonce et les dédales et labyrinthes au sein desquels il essaie d’avancer sans résultats si ce n’est celui de l’affaiblir et de le perdre. Ces tunnels et labyrinthes l’emprisonnent littéralement et d’une certaine manière le dématérialisent parce qu’il est cerné et dans plusieurs d’entre eux à la fois.
Où qu’il se tourne, il est coincé. Quatre tunnels peuvent être repérés spécifiques à ce statut de travailleurs. Le premier, et c’est un labyrinthe pour lui, est celui de l’Administration (par Administration il faut entendre sécurité sociale : caisses et Urssaf, préfecture ou sous-préfecture, diverses directions administratives, ANPE mais aussi banque...). L’horreur des injonctions qui se contredisent, des réponses à côté des questions, des transferts infinis vers un autre service qui n’aboutissent pas, des interlocuteurs qui changent indéfiniment et qui fournissent des réponses différentes. On pourrait croire qu’il n’a pas de chance mais non ce sont des formes d’inadéquation du système à la réalité de la petite entreprise. Il faudrait des réponses fines taillées sur mesure aux problématiques de la petite entreprise. Ce n’est pas le cas. Le système produit de la réponse générale, massive éloignée de la préoccupation immédiate de l’entrepreneur. La pression pour lui est forte car au delà de chaque question administrative il y a en arrière plan une sanction possible à un horizon temporel donné. Cette pression renforce la sensation d’isolement, d’exclusion d’un système qui ne comprend pas, d’être dans un affrontement du petit face à une énorme machinerie capable de broyer.
Il y a dans le même temps la gestion sociale des hommes (ses salariés) avec l’adéquation entre la commande et les ressources pour les honorer. Une TPE de 8 personnes, qui a donc 5 ou 6 ouvriers en production, est fragile sur l’effectif : un absent, c’est près de 20 % de l’effectif de production qui s’absente. La prévision est donc capitale, toute absence fortuite est une dégradation forte, deux absents fortuits c’est la panique. Aussitôt il cherche à pallier, il prend sur lui et fait le travail, remplaçant son ouvrier absent. Honorer la commande, ce n’est pas la fierté, c’est l’enjeu de la pérennité. La fierté est rangée dans un placard depuis longtemps. Les sentiments de déception, de colère, d’incompréhension, de jugements sur les personnes se bousculent avec en plus la surcharge de travail à faire en plus du sien. C’est épuisant physiquement, nerveusement. S’installe alors le découragement. Cette situation pose la question des effectifs, de la prévision, du lissage des activités, de la gestion des ressources humaines dans les très petites entreprises et des mutualisations ou solidarités à inventer.
Le troisième tunnel est celui du temps. Un tunnel dont les contours ne sont pas parallèles mais qui se rétrécit en un point et dont les goulots d’étranglement portent les noms d’échéances : échéance des factures, des livraisons, des contrôles des matériels, des accords ou contrats... L’échéance le suit et le poursuit partout la nuit aussi, lui dérobant son sommeil ! Certes, chaque entreprise doit faire face à des échéances mais dans le cas de la petite entreprise les échéances ne sont pas réparties entre plusieurs personnes et sont, au contraire, concentrées et portées par le seul chef d’entreprise, poids permanent sur les épaules, épée dont la piqûre de la pointe se fait toujours sentir au dessus de la tête. Vivre avec, c’est déployer sans cesse des efforts pour contenir la charge et tenir à distance cette épée capable de se transformer si vite en couperet. La peur s’invite.
Le quatrième tunnel propre à cet entrepreneur se faufile dans le milieu des partenaires. Les partenaires sont ceux avec lesquels on travaille et on s’entraide. Ils font le même métier et sont censés vous comprendre, vous aider. Bref, dans la difficulté, on a envie de leur faire confiance. Mais la concurrence est sévère, la compétition se cache mais reste toujours là et distille ses coups tordus, les promesses de soutien défaillantes où ceux qui les font savent par avance qu’ils ne les tiendront pas. Ils compatissent par devant alors que par derrière ils n’espèrent que la chute. Le sentiment de trahison s’installe. Ce dernier interroge sur la solidité des réseaux et leur fiabilité et sur les niveaux d’investissement personnel consentis, pour quelle rétribution in fine ?
Isolement, épuisement, peur ou angoisse, trahison, le récit de Régis Berthier dévoile des déterminants de risques psychosociaux bien spécifiques à ce travailleur particulier qu’est un chef d’entreprise. Au travers de cet exemple, on perçoit aussi la limite des modèles couramment employés pour apprécier les risques psychosociaux. Le chef d’entreprise dispose d’une autonomie, d’une très large autonomie. Sa latitude décisionnelle est apparemment étendue mais elle finit toujours par se heurter à un mur. La nuance avec l’appréciation que portent les salariés vis-à-vis de cette latitude est qu’il s’agit pour l’entrepreneur d’un mur d’enceinte : celui du carcan administratif. Est-ce que le modèle de Siegrist, « effort récompense », est applicable à ces chefs d’entreprise ? Sans doute la reconnaissance recherchée s’enracine moins dans le pécuniaire ou le statut que dans l’estime portée à la défense de son entreprise et au déploiement des efforts pour en assurer la survie. C’est d’une reconnaissance symbolique dont ces chefs d’entreprise ont besoin. Il y a là matière à réfléchir dans les instances professionnelles. Par rapport au modèle d’intervention que nous portons à l’Anact, les espaces de régulation font cruellement défaut.
Expérience avec les artisans du bâtiment
Le dernier exemple que je souhaite évoquer sur la question de la population particulière des travailleurs indépendants provient d’une intervention conduite en Auvergne, en septembre 2005, avec un groupe d’artisans du bâtiment. La demande est intéressante. La Capeb
7
, par l’intermédiaire de son délégué départemental, sollicite l’Aract à partir de cette observation : « depuis quelque temps nous avons l’impression qu’il y a de plus en plus de divorces dans les couples d’artisans autour de nous. On se demande au Conseil d’Administration si ce n’est pas leur travail qui est en cause ? ».
Ce sentiment n’est appuyé par aucun chiffre, aucune donnée d’évolution de la situation matrimoniale de cette catégorie socioprofessionnelle. A priori, il n’y a pas de raisons particulières pour que les artisans soient concernés plus que d’autres catégories par ce phénomène par ailleurs bien identifié. Seulement la question du lien possible avec le travail mérite d’être creusée. Sans entrer dans le jeu « cause conséquence », la question du rapport vie professionnelle/vie personnelle de cette catégorie se pose. Un groupe de travail composé de 4 artisans dont une conjointe, non divorcés, est alors constitué pour travailler ce sujet.
L’expérience a été très riche pour tous. Pour les intervenants par le côté innovant mais surtout pour les artisans parce qu’elle a permis de rendre visible une des facettes de leur statut d’artisan, celui de travailleur. Jamais cet aspect de leur statut dans leur milieu n’est mis en avant d’une façon analytique mettant à jour ce qui détermine leur charge de travail et structure leur journée de travail. Comme à chaque fois que les personnes parlent, comprennent et d’une certaine manière découvrent comment se construit leur propre activité de travail en présence d’autres personnes, elles éprouvent une satisfaction. La mise en visibilité de leur activité dévoilée devant autrui est une forme de reconnaissance. Ce n’est pas spécifique des artisans, mais il y avait comme du soulagement chez eux à décrire les enjeux de leur entreprise mêlés à leur savoir-faire de peintre, couvreur, plombier, menuisier et intriqués dans leur responsabilité d’encadrant d’une équipe de salariés.
Après de longs échanges sur le travail qui ont permis de façonner et solidifier le groupe, deux questions différentes mais intimement liées sont alors très nettement apparues : celle du temps et celle de l’entourage. Le temps, question classique peu originale, a été envisagé dans ce cas sous son aspect débordement avec ses impacts sur la vie familiale, sociale et personnelle. L’échelle habituelle des arbitrages s’est une fois de plus confirmée : chacun gère le débordement en sacrifiant (en amputant), de son point de vue d’abord sa vie personnelle, puis sa vie sociale et enfin sa vie familiale. Le constat a été partagé, cependant le groupe, et c’est là son intérêt, s’est demandé si l’entourage avait la même analyse. Des entretiens séparés ont été conduits avec les conjoints sur la représentation qu’ils ont du travail de leur mari (femme) artisan. La réponse n’est pas identique : pour les conjoints, le sacrifice est d’abord au niveau de la famille. Le ressenti est donc différent. Pour les conjoints, les artisans peuvent être à la maison physiquement mais ailleurs mentalement. Autrement dit, le temps de présence et le temps de partage réel ne coïncident pas, le second étant nettement plus restreint que le premier. Le travail s’invite de manière assez permanente à la maison. Les tâches réalisées portent pour l’essentiel sur les rédactions de devis, de facturations et de comptabilité.
Avec le groupe et la Capeb locale, nous avons tiré plusieurs conclusions :
• remettre régulièrement le thème du travail à l’ordre du jour dans les réunions courantes de cette organisation par le jeu de témoignages ;
• installer un dispositif de soutien accessible aux artisans en difficulté, pas seulement économique même si la difficulté économique nourrit la difficulté personnelle ;
• développer un auto-questionnaire sur les relations vie professionnelle/vie privée ;
• lancer une campagne de sensibilisation et de promotion de l’auto-questionnaire par les artisans du groupe.
L’artisan porte l’ambiguïté en lui : il est à la fois ouvrier et entrepreneur. La facturation, la comptabilité, les clients prennent le dessus sur son savoir-faire, son habileté, sa capacité créatrice. Tout le travail a été de le « décoller » de son entreprise pour ramener les questions sur son travail, le sien. C’est paradoxal dans une intervention classique au sein d’une entreprise avec salariés, nous recherchons toujours à conduire un mouvement de l’individuel vers le collectif. Avec les artisans, il fallait faire le chemin inverse, les ramener à eux, à leur travail pour bien en préciser le sens, les éléments de la charge, leurs rapports aux autres, en premier lieu à leur famille. L’expérience a permis de parler des conditions de travail de leurs salariés, de la manière dont ils prévoyaient leur charge de travail. Ils nous ont assuré avoir pris conscience de la notion de conditions de travail pour leurs propres salariés.
Ces trois situations présentées démontrent l’intérêt de conduire une réflexion particulière sur les facteurs de risques psychosociaux pour cette catégorie de travailleurs. En les reprenant, il serait aussi possible de creuser davantage les dispositifs, processus, caractéristiques ou évènements qui soutiennent les non-salariés ou au contraire les précipitent dans des difficultés. Par exemple, le modèle développé par l’agriculture fondé sur la coopération et le mutualisme (les deux « mamelles » de la solidarité agricole) a longtemps encadré rigoureusement les agriculteurs ne les laissant jamais seuls face à l’adversité : soutien aux investissements au travers des prêts bonifiés et de la possibilité de mise en commun de matériel (Cuma
8
), soutien lors d’événements impromptus tels que la mise en place des mutuelles « coups durs ». Néanmoins, de nos jours, ce modèle se craquelle sous les effets de la concurrence agricole et des luttes pour maintenir une Politique agricole commune toujours favorable aux agriculteurs, du vieillissement de la population, de la réduction massive de la population des exploitants et de la survenue du statut de double actif où l’activité agricole est pratiquée à temps partiel. Les impacts à moyen terme sur la santé mentale de cette catégorie de travailleurs risquent d’être sévères. Sur le troisième exemple, nous aurions pu davantage développer les aspects sexués du conflit vie professionnelle/vie privée tant il nous semble que malgré tout si l’artisan est une « artisane » la répartition du travail domestique reste une charge lourde toujours délicate à négocier dans les couples. Enfin sur le deuxième exemple cité, il nous semble que la question de l’isolement du chef d’entreprise d’une TPE dans un système concurrentiel sans concession mériterait d’être approfondie notamment au regard des réseaux dans lesquels s’inscrivent ces TPE qui sont des réseaux de survie pour être informé plutôt que des réseaux de soutien. Dans ces réseaux, la solidarité n’existe pas.
Il serait sans doute temps d’installer un dispositif qui puisse soutenir des études et des actions à l’intention de ces populations de travailleurs si particuliers !
Jack Bernon
Responsable du département Santé Tavail, Anact Lyon
Ancien directeur de l’Aract Auvergne
Ergonome, spécialiste des questions de prévention des risques professionnels
 ). Un questionnement de même nature doit être envisagé lorsque sont considérés le conjoint collaborateur ou l’aide familial qui participent activement à l’activité de l’entreprise sans recevoir de rémunération pécuniaire (Laferrère, 2000
). Un questionnement de même nature doit être envisagé lorsque sont considérés le conjoint collaborateur ou l’aide familial qui participent activement à l’activité de l’entreprise sans recevoir de rémunération pécuniaire (Laferrère, 2000 ).
). ; Lurton et Toutlemonde, 2007
; Lurton et Toutlemonde, 2007 ) ;
) ; ; Burke et coll., 2008
; Burke et coll., 2008 ) ;
) ; ; Constant et Zimmermann, 2006
; Constant et Zimmermann, 2006 ).
). ; Torres, 2003
; Torres, 2003 ). Parallèlement, les approches sociologiques soulignent l’importance du métier dans la construction de l’identité sociale des non-salariés (Gresle, 1981
). Parallèlement, les approches sociologiques soulignent l’importance du métier dans la construction de l’identité sociale des non-salariés (Gresle, 1981 ; Zarca, 1988
; Zarca, 1988 ). Des travaux sociométriques viennent confirmer ces analyses (Beugelsdijk et Noorderhaven, 2005
). Des travaux sociométriques viennent confirmer ces analyses (Beugelsdijk et Noorderhaven, 2005 ; Garner et coll., 2006
; Garner et coll., 2006 ). Dès lors, il convient certainement d’intégrer un critère fondé sur la pratique effective du métier, quels que soient le statut du non-salarié et la structure de son entreprise. Bien que délicate, cette approche laisse espérer une assez grande homogénéité comportementale par l’intégration de l’objet premier du travail indépendant : l’exercice de la profession.
). Dès lors, il convient certainement d’intégrer un critère fondé sur la pratique effective du métier, quels que soient le statut du non-salarié et la structure de son entreprise. Bien que délicate, cette approche laisse espérer une assez grande homogénéité comportementale par l’intégration de l’objet premier du travail indépendant : l’exercice de la profession. ), 10,8 % des actifs occupés – soit 2,8 millions d’individus – sont non-salariés. Bien que cette proportion soit la plus faible observée depuis 2003, elle reste dans une tendance laissant entrevoir un accroissement de la population des non-salariés dans les décennies à venir (Rapelli et Lespagnol, 2007
), 10,8 % des actifs occupés – soit 2,8 millions d’individus – sont non-salariés. Bien que cette proportion soit la plus faible observée depuis 2003, elle reste dans une tendance laissant entrevoir un accroissement de la population des non-salariés dans les décennies à venir (Rapelli et Lespagnol, 2007 ). Comme le montre la figure 1
). Comme le montre la figure 1 , près de 54 % des non-salariés sont des indépendants au sens de l’Insee (non-employeurs). La part des aides familiaux est très faible – moins de 6 % – et tend à décroître régulièrement. Cette évolution participe d’un double phénomène : la diminution continue des effectifs non-salariés du secteur agricole et la recherche d’un statut garantissant une meilleure couverture sociale. Toutefois, le détail des familles professionnelles met en valeur quelques contrastes notables.
, près de 54 % des non-salariés sont des indépendants au sens de l’Insee (non-employeurs). La part des aides familiaux est très faible – moins de 6 % – et tend à décroître régulièrement. Cette évolution participe d’un double phénomène : la diminution continue des effectifs non-salariés du secteur agricole et la recherche d’un statut garantissant une meilleure couverture sociale. Toutefois, le détail des familles professionnelles met en valeur quelques contrastes notables.
 )
) et 1988
et 1988 ).
). ). D’autre part, l’asymétrie observée s’inverse lorsqu’est considéré le détail des métiers. Ainsi, plus de huit psychothérapeutes ou infirmiers libéraux sur dix sont des femmes. Elles représentent plus de 70 % des artisans coiffeurs, des manucures, des esthéticiens et des traducteurs-interprètes. Elles sont aussi majoritaires dans certains segments du commerce (détaillants en alimentation et en habillement, fleuristes, exploitants de café, hôteliers-restaurateurs) et des professions libérales (avocats, notaires, spécialistes de la rééducation, moniteurs d’auto-école). En revanche, elles restent très minoritaires dans les métiers de l’artisanat du bâtiment.
). D’autre part, l’asymétrie observée s’inverse lorsqu’est considéré le détail des métiers. Ainsi, plus de huit psychothérapeutes ou infirmiers libéraux sur dix sont des femmes. Elles représentent plus de 70 % des artisans coiffeurs, des manucures, des esthéticiens et des traducteurs-interprètes. Elles sont aussi majoritaires dans certains segments du commerce (détaillants en alimentation et en habillement, fleuristes, exploitants de café, hôteliers-restaurateurs) et des professions libérales (avocats, notaires, spécialistes de la rééducation, moniteurs d’auto-école). En revanche, elles restent très minoritaires dans les métiers de l’artisanat du bâtiment. ). En outre, il faut noter que, dans l’ensemble, les employeurs sont en moyenne plus diplômés que les non-employeurs et que trois quarts des aides familiaux ont un niveau de diplôme inférieur ou égal au CAP. Ces caractéristiques sont sans doute à mettre en relation avec la fonction effective du non-salarié au sein de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur tend à s’apparenter à un gestionnaire d’entreprise au fur et à mesure que l’effectif salarié s’accroît alors que, par définition, l’indépendant reste un homme de métier.
). En outre, il faut noter que, dans l’ensemble, les employeurs sont en moyenne plus diplômés que les non-employeurs et que trois quarts des aides familiaux ont un niveau de diplôme inférieur ou égal au CAP. Ces caractéristiques sont sans doute à mettre en relation avec la fonction effective du non-salarié au sein de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur tend à s’apparenter à un gestionnaire d’entreprise au fur et à mesure que l’effectif salarié s’accroît alors que, par définition, l’indépendant reste un homme de métier. ) : 57,1 et 55,7 heures respectivement. Viennent ensuite les artisans (53,2 heures) puis les professionnels libéraux avec 47,8 heures. Il convient toutefois de souligner deux éléments. D’une part, l’intensité du travail11
est sensiblement la même pour tous les non-salariés. Ils travaillent en moyenne près de 10 heures par jour, même si des variations saisonnières sont à prendre en compte notamment pour les professions agricoles ou l’artisanat du bâtiment dont l’activité reste fortement corrélée au rythme des saisons. D’autre part, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux déclarent à plus de 65 % travailler le soir et à leur domicile. Cette particularité est le signe d’un impact certain de l’exercice du métier sur la vie extra-professionnelle, mais aussi d’un enchevêtrement du capital professionnel et personnel.
) : 57,1 et 55,7 heures respectivement. Viennent ensuite les artisans (53,2 heures) puis les professionnels libéraux avec 47,8 heures. Il convient toutefois de souligner deux éléments. D’une part, l’intensité du travail11
est sensiblement la même pour tous les non-salariés. Ils travaillent en moyenne près de 10 heures par jour, même si des variations saisonnières sont à prendre en compte notamment pour les professions agricoles ou l’artisanat du bâtiment dont l’activité reste fortement corrélée au rythme des saisons. D’autre part, les exploitants agricoles et les professionnels libéraux déclarent à plus de 65 % travailler le soir et à leur domicile. Cette particularité est le signe d’un impact certain de l’exercice du métier sur la vie extra-professionnelle, mais aussi d’un enchevêtrement du capital professionnel et personnel. ). Ces derniers sont fortement corrélés au secteur d’activité, à l’âge de l’individu, à son ancienneté dans la profession, à la taille de l’entreprise et au sexe (Favre, 2009
). Ces derniers sont fortement corrélés au secteur d’activité, à l’âge de l’individu, à son ancienneté dans la profession, à la taille de l’entreprise et au sexe (Favre, 2009 ). Ainsi, en 2006, les exploitants agricoles tirent un revenu moyen annuel compris entre 6 600 € et 41 800 € qui est, en outre, très dépendant des aides directes. Dans l’artisanat, un entrepreneur individuel sans salarié spécialisé dans les biens de consommation déclare en moyenne 15 000 €, ce montant atteignant 40 200 € pour le gérant d’une SARL de construction. Des revenus similaires sont observés dans le commerce. Les professions libérales sont caractérisées par une très forte amplitude de revenus – de 9 000 € à 198 500 € – qui n’est pas sans rappeler la très forte hétérogénéité des métiers concernés. En effet dans ce groupe, les activités libérales non-réglementées, comme l’enseignement ou certaines prestations de service aux particuliers, côtoient les activités réglementées du droit et de la santé. Or, c’est au sein des professions non-réglementées que se développe un emploi parfois précaire, souvent partiel ou d’appoint.
). Ainsi, en 2006, les exploitants agricoles tirent un revenu moyen annuel compris entre 6 600 € et 41 800 € qui est, en outre, très dépendant des aides directes. Dans l’artisanat, un entrepreneur individuel sans salarié spécialisé dans les biens de consommation déclare en moyenne 15 000 €, ce montant atteignant 40 200 € pour le gérant d’une SARL de construction. Des revenus similaires sont observés dans le commerce. Les professions libérales sont caractérisées par une très forte amplitude de revenus – de 9 000 € à 198 500 € – qui n’est pas sans rappeler la très forte hétérogénéité des métiers concernés. En effet dans ce groupe, les activités libérales non-réglementées, comme l’enseignement ou certaines prestations de service aux particuliers, côtoient les activités réglementées du droit et de la santé. Or, c’est au sein des professions non-réglementées que se développe un emploi parfois précaire, souvent partiel ou d’appoint.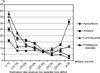
 )
) ). Outre l’intérêt du travail ou la réalisation de projets entrepreneuriaux, cette satisfaction repose avant tout sur l’autonomie dont jouit le non-salarié. Pourtant, la pratique effective d’une activité indépendante se heurte de plus en plus fréquemment à des restrictions de l’indépendance.
). Outre l’intérêt du travail ou la réalisation de projets entrepreneuriaux, cette satisfaction repose avant tout sur l’autonomie dont jouit le non-salarié. Pourtant, la pratique effective d’une activité indépendante se heurte de plus en plus fréquemment à des restrictions de l’indépendance. ). Parmi toutes les méthodes d’externalisation, l’essaimage retient l’attention. Cette appellation désigne les appuis et accompagnements apportés par une entreprise à un ou plusieurs de ses salariés qui souhaitent créer ou reprendre une activité avec l’objectif de contribuer à leur réussite (Sabot, 2007
). Parmi toutes les méthodes d’externalisation, l’essaimage retient l’attention. Cette appellation désigne les appuis et accompagnements apportés par une entreprise à un ou plusieurs de ses salariés qui souhaitent créer ou reprendre une activité avec l’objectif de contribuer à leur réussite (Sabot, 2007 ). L’accompagnement prend des formes variées comme l’information, l’appui technique, l’apport d’expertise, l’aide financière, le parrainage ou le transfert de brevet. Si l’essaimage constitue une aide effective au passage à l’indépendance, les risques de subordination technique et économique restent prégnants. La nature même des aides apportées ainsi que les relations privilégiées pré-existantes à l’installation entre le prestataire essaimé et l’entreprise externalisante devenant son client en sont la cause. Une relation de pouvoir asymétrique est alors susceptible d’émerger favorisant la mise en place d’un monopsone14
.
). L’accompagnement prend des formes variées comme l’information, l’appui technique, l’apport d’expertise, l’aide financière, le parrainage ou le transfert de brevet. Si l’essaimage constitue une aide effective au passage à l’indépendance, les risques de subordination technique et économique restent prégnants. La nature même des aides apportées ainsi que les relations privilégiées pré-existantes à l’installation entre le prestataire essaimé et l’entreprise externalisante devenant son client en sont la cause. Une relation de pouvoir asymétrique est alors susceptible d’émerger favorisant la mise en place d’un monopsone14
. ) montrent que l’appel de l’indépendance reste un des principaux déterminants de l’entrée dans le non-salariat, l’absence d’emploi est une motivation pour près d’un quart des répondants. En outre, pour 65 % des nouveaux non-salariés, la mise à son compte vise essentiellement à générer leur propre emploi. En 2002, ils n’étaient que 54 % à retenir cet objectif. Enfin, la part des créateurs qui se trouvaient initialement au chômage croît au cours des années, passant de 34 % en 2002 à 40 % en 2006.
) montrent que l’appel de l’indépendance reste un des principaux déterminants de l’entrée dans le non-salariat, l’absence d’emploi est une motivation pour près d’un quart des répondants. En outre, pour 65 % des nouveaux non-salariés, la mise à son compte vise essentiellement à générer leur propre emploi. En 2002, ils n’étaient que 54 % à retenir cet objectif. Enfin, la part des créateurs qui se trouvaient initialement au chômage croît au cours des années, passant de 34 % en 2002 à 40 % en 2006. ). Un tel phénomène conduit à s’interroger sur une possible précarisation des professions indépendantes et la pérennité des emplois non-salariés créés. Plus encore, le statut d’indépendant et ses caractéristiques socioéconomiques forment un ensemble cohérent aussi longtemps que le travailleur s’expose aux risques qu’il a choisi d’assumer par son mode d’activité et qu’il peut maîtriser. À n’en pas douter, les déterminants de ce choix constituent un moteur comportemental capital.
). Un tel phénomène conduit à s’interroger sur une possible précarisation des professions indépendantes et la pérennité des emplois non-salariés créés. Plus encore, le statut d’indépendant et ses caractéristiques socioéconomiques forment un ensemble cohérent aussi longtemps que le travailleur s’expose aux risques qu’il a choisi d’assumer par son mode d’activité et qu’il peut maîtriser. À n’en pas douter, les déterminants de ce choix constituent un moteur comportemental capital.




























 ).3
).3
 ).
).
 ; Poitrineau, 1992
; Poitrineau, 1992 ; Kaplan, 2001
; Kaplan, 2001 ; Kaplan et Minard, 2004
; Kaplan et Minard, 2004 ) en passant par l’invention de « l’artisan fiscal » sous la Troisième République (Zdadtny, 1999
) en passant par l’invention de « l’artisan fiscal » sous la Troisième République (Zdadtny, 1999 ), la charte du travail corporatiste de Vichy (Le Crom, 1995
), la charte du travail corporatiste de Vichy (Le Crom, 1995 ; Margairaz et Tartakowsky, 2008
; Margairaz et Tartakowsky, 2008 , voir en particulier la première partie de l’ouvrage consacrée aux « Patrons et artisans, corporatisme, syndicalisme »), jusqu’aux toutes dernières lois concernant la création d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), le statut d’auto-entrepreneur, les règles qui encadrent l’activité des travailleurs indépendants font florès. Elles concernent aussi bien la taille des entreprises, la fiscalité, le statut des conjoints et des aides familiaux, le pré-requis éventuel de titres ou de diplômes pour l’exercice de certains métiers ou professions... La capacité d’auto-organisation des travailleurs indépendants varie par ailleurs fortement d’un métier à l’autre selon une multiplicité de critères (monopole ou non de l’exercice d’une pratique, maîtrise reconnue d’un métier, caractéristiques du marché...). Un certain nombre de professions réglementées, remplissant, pour certaines, une mission de service public, sont dotées d’instances spécifiques (les ordres professionnels : des médecins, avocats, architectes...) qui exercent une véritable juridiction sur leurs membres. Pour les artisans, comme le souligne Bernard Zarca (1986
, voir en particulier la première partie de l’ouvrage consacrée aux « Patrons et artisans, corporatisme, syndicalisme »), jusqu’aux toutes dernières lois concernant la création d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), le statut d’auto-entrepreneur, les règles qui encadrent l’activité des travailleurs indépendants font florès. Elles concernent aussi bien la taille des entreprises, la fiscalité, le statut des conjoints et des aides familiaux, le pré-requis éventuel de titres ou de diplômes pour l’exercice de certains métiers ou professions... La capacité d’auto-organisation des travailleurs indépendants varie par ailleurs fortement d’un métier à l’autre selon une multiplicité de critères (monopole ou non de l’exercice d’une pratique, maîtrise reconnue d’un métier, caractéristiques du marché...). Un certain nombre de professions réglementées, remplissant, pour certaines, une mission de service public, sont dotées d’instances spécifiques (les ordres professionnels : des médecins, avocats, architectes...) qui exercent une véritable juridiction sur leurs membres. Pour les artisans, comme le souligne Bernard Zarca (1986 , 1987
, 1987 , 1998
, 1998 ), l’identité collective se construit autour du métier conduisant à un morcellement de leur représentation au sein des chambres de métiers. Mais un même constat peut être fait pour les métiers du commerce fourmillant d’organisations chargées de la défense de leurs intérêts (à titre d’exemple, la chambre de commerce de Lyon accueille à elle seule 222 organisations) (Offerlé, 1998
), l’identité collective se construit autour du métier conduisant à un morcellement de leur représentation au sein des chambres de métiers. Mais un même constat peut être fait pour les métiers du commerce fourmillant d’organisations chargées de la défense de leurs intérêts (à titre d’exemple, la chambre de commerce de Lyon accueille à elle seule 222 organisations) (Offerlé, 1998 et 2009
et 2009 ; Rapelli et Piatecki, 2008
; Rapelli et Piatecki, 2008 ). Ces diverses organisations sont regroupées au sein de fédérations ou confédérations plus ou moins puissantes, certaines intégrées au sein du Medef, d’autres non (comme l’Union nationale des professions libérales, UNAPL créée en 1977), toutes visant les mêmes objectifs : l’obtention d’une législation, notamment fiscale, qui leur soit la plus favorable possible, des formes de couverture sociale adaptée à leur situation et, le cas échéant, la régulation des relations avec leurs salariés (conventions collectives sur les salaires et la durée du travail, conditions d’accès à la profession...).
). Ces diverses organisations sont regroupées au sein de fédérations ou confédérations plus ou moins puissantes, certaines intégrées au sein du Medef, d’autres non (comme l’Union nationale des professions libérales, UNAPL créée en 1977), toutes visant les mêmes objectifs : l’obtention d’une législation, notamment fiscale, qui leur soit la plus favorable possible, des formes de couverture sociale adaptée à leur situation et, le cas échéant, la régulation des relations avec leurs salariés (conventions collectives sur les salaires et la durée du travail, conditions d’accès à la profession...). ). Ils restent encore aujourd’hui les dépositaires du vieux rêve proudhonien d’une disparition possible du salariat que le maître appelait de ses vœux. Derrière le mot d’indépendant se love pour les artisans la possibilité d’une pratique autonome du métier entendu comme « un corps constitué de techniques, de savoir faire en vue de la production d’une gamme relativement restreinte de biens et services qui ne s’acquièrent que dans le temps long et positif de l’expérience professionnelle » permettant l’émergence « des composantes d’une culture telles que le langage, la gestuelle ou la transmission intergénérationnelle des techniques et des coutumes » (Zarca, 1998
). Ils restent encore aujourd’hui les dépositaires du vieux rêve proudhonien d’une disparition possible du salariat que le maître appelait de ses vœux. Derrière le mot d’indépendant se love pour les artisans la possibilité d’une pratique autonome du métier entendu comme « un corps constitué de techniques, de savoir faire en vue de la production d’une gamme relativement restreinte de biens et services qui ne s’acquièrent que dans le temps long et positif de l’expérience professionnelle » permettant l’émergence « des composantes d’une culture telles que le langage, la gestuelle ou la transmission intergénérationnelle des techniques et des coutumes » (Zarca, 1998 ). La maîtrise complète du processus, le bel ouvrage réalisé selon les règles de l’art sont leur fierté. Ce qui est vrai pour l’artisan et sans doute également pour les membres des professions libérales1
prend, comme le montre bien François Gresle, un autre sens pour le commerçant pour qui l’indépendance « n’existe que par l’acte commercial, les relations avec « ses pratiques », la présence publique de la boutique... L’indépendance reste le but ultime du détaillant ; elle est seulement pour l’artisan le moyen d’atteindre son idéal professionnel » (Gresle, 1980
). La maîtrise complète du processus, le bel ouvrage réalisé selon les règles de l’art sont leur fierté. Ce qui est vrai pour l’artisan et sans doute également pour les membres des professions libérales1
prend, comme le montre bien François Gresle, un autre sens pour le commerçant pour qui l’indépendance « n’existe que par l’acte commercial, les relations avec « ses pratiques », la présence publique de la boutique... L’indépendance reste le but ultime du détaillant ; elle est seulement pour l’artisan le moyen d’atteindre son idéal professionnel » (Gresle, 1980 , 1981a
, 1981a et b
et b ).
). ). On trouve proportionnellement un peu plus d’immigrés parmi eux qu’au sein de la population active, « la mise à son compte » étant sans doute aussi un moyen pour ces derniers d’échapper à l’ostracisme de l’emploi salarié les concernant. Enfin, ces indépendants ont une durée hebdomadaire du travail et une longévité dans l’activité sans commune mesure avec celles de leurs homologues salariés, ceci étant particulièrement notoire pour les commerçants et les artisans2
.
). On trouve proportionnellement un peu plus d’immigrés parmi eux qu’au sein de la population active, « la mise à son compte » étant sans doute aussi un moyen pour ces derniers d’échapper à l’ostracisme de l’emploi salarié les concernant. Enfin, ces indépendants ont une durée hebdomadaire du travail et une longévité dans l’activité sans commune mesure avec celles de leurs homologues salariés, ceci étant particulièrement notoire pour les commerçants et les artisans2
. , en l’adaptant, le raisonnement retenu pour comparer la relation au travail des agents des secteurs public et privé lorsqu’il écrit : « Tandis que le contrat permet de faire du travail un objet de négoce, le statut (il s’agit de celui des fonctionnaires) isole au contraire le travail de la sphère marchande. Par le contrat, le salarié vend son travail au plus offrant sur le marché (du travail) ; la relation est dissymétrique (l’un des contractants se place sous les ordres de l’autre) ; synallagmatique (le salaire est la contrepartie du travail fourni) et sa durée est aléatoire. Aucun de ces traits ne se retrouve dans le statut, qui implique un autre rapport au temps, au pouvoir et à l’argent ». Si le contrat de travail est bien un contrat de subordination à un employeur (subordination bornée par le code du travail mais bien réelle) dans le cadre de la fonction publique, « l’agent n’est pas assujetti à un homme déterminé, mais à une organisation et aux valeurs qu’elle incarne ». Le fonctionnaire est certes soumis aux ordres de son supérieur hiérarchique, l’un et l’autre cependant le sont au service d’une même cause : le service de l’intérêt général. Le salaire est la contrepartie de la valeur estimée du travail accompli dans un système concurrentiel et conventionnel, le traitement du fonctionnaire est la contrepartie de son engagement sans lien avec une quelconque valeur marchande. Le lien qui unit un salarié à son employeur est précaire, le fonctionnaire a une garantie d’emploi à vie correspondant au principe de continuité du service public.
, en l’adaptant, le raisonnement retenu pour comparer la relation au travail des agents des secteurs public et privé lorsqu’il écrit : « Tandis que le contrat permet de faire du travail un objet de négoce, le statut (il s’agit de celui des fonctionnaires) isole au contraire le travail de la sphère marchande. Par le contrat, le salarié vend son travail au plus offrant sur le marché (du travail) ; la relation est dissymétrique (l’un des contractants se place sous les ordres de l’autre) ; synallagmatique (le salaire est la contrepartie du travail fourni) et sa durée est aléatoire. Aucun de ces traits ne se retrouve dans le statut, qui implique un autre rapport au temps, au pouvoir et à l’argent ». Si le contrat de travail est bien un contrat de subordination à un employeur (subordination bornée par le code du travail mais bien réelle) dans le cadre de la fonction publique, « l’agent n’est pas assujetti à un homme déterminé, mais à une organisation et aux valeurs qu’elle incarne ». Le fonctionnaire est certes soumis aux ordres de son supérieur hiérarchique, l’un et l’autre cependant le sont au service d’une même cause : le service de l’intérêt général. Le salaire est la contrepartie de la valeur estimée du travail accompli dans un système concurrentiel et conventionnel, le traitement du fonctionnaire est la contrepartie de son engagement sans lien avec une quelconque valeur marchande. Le lien qui unit un salarié à son employeur est précaire, le fonctionnaire a une garantie d’emploi à vie correspondant au principe de continuité du service public. et 2009
et 2009 ; Zdadtny, 1999
; Zdadtny, 1999 ). La pérennité de l’exercice de leur activité dépend fortement de l’environnement économique au sein duquel ils opèrent, et ils ne reçoivent ni un salaire, ni un traitement mais un revenu fruit de la vente de leurs prestations. Ce revenu est de l’ordre de 23 000 € en moyenne par an (Favre, 2008
). La pérennité de l’exercice de leur activité dépend fortement de l’environnement économique au sein duquel ils opèrent, et ils ne reçoivent ni un salaire, ni un traitement mais un revenu fruit de la vente de leurs prestations. Ce revenu est de l’ordre de 23 000 € en moyenne par an (Favre, 2008 ) soulignant par là même que c’est bien l’indépendance et l’autonomie dans l’exercice de l’activité plus que l’appât du gain qui motivent les indépendants (quand bien même certains d’entre eux ont des revenus qui dépassent largement cette moyenne). Si enfin on étend la comparaison à la qualification, c’est l’emploi occupé qui définit la qualification du salarié alors que c’est le concours passé et son niveau qui classe le fonctionnaire dans une catégorie ; le métier et la profession exercés définissent la qualification du travailleur indépendant et sont un élément essentiel de son patrimoine. Le tableau I
) soulignant par là même que c’est bien l’indépendance et l’autonomie dans l’exercice de l’activité plus que l’appât du gain qui motivent les indépendants (quand bien même certains d’entre eux ont des revenus qui dépassent largement cette moyenne). Si enfin on étend la comparaison à la qualification, c’est l’emploi occupé qui définit la qualification du salarié alors que c’est le concours passé et son niveau qui classe le fonctionnaire dans une catégorie ; le métier et la profession exercés définissent la qualification du travailleur indépendant et sont un élément essentiel de son patrimoine. Le tableau I résume les éléments de comparaison qui viennent d’être évoqués.
résume les éléments de comparaison qui viennent d’être évoqués. ; dans le domaine des relations sociales : Verrier, 2009
; dans le domaine des relations sociales : Verrier, 2009 ). La sociologie politique contribue pour sa part à une meilleure connaissance des comportements politiques et des modes de défense de leurs intérêts par les indépendants (Offerlé, 1998
). La sociologie politique contribue pour sa part à une meilleure connaissance des comportements politiques et des modes de défense de leurs intérêts par les indépendants (Offerlé, 1998 et 2009
et 2009 ; Bosc, 2009
; Bosc, 2009 ). Les professions libérales, au moins les plus prestigieuses d’entre elles, ont en revanche fait l’objet de nombreux travaux tant en France qu’à l’étranger (pour la France on peut citer sans prétendre à l’exhaustivité : Karpik, 1995
). Les professions libérales, au moins les plus prestigieuses d’entre elles, ont en revanche fait l’objet de nombreux travaux tant en France qu’à l’étranger (pour la France on peut citer sans prétendre à l’exhaustivité : Karpik, 1995 ; Hassenteufel, 1997
; Hassenteufel, 1997 ; Quemin, 1997
; Quemin, 1997 ; Champy, 1998
; Champy, 1998 ; Mathieu-Fritz, 2005
; Mathieu-Fritz, 2005 ). Bien des raisons expliquent cette attention particulière portée aux professions libérales qui reproduisent encore le mieux les traits des anciennes corporations. Le débat qu’elles ont suscité et suscitent encore au sein de ce qui est devenu une branche particulière de la discipline – la sociologie des professions – est intéressant dans la mesure où il porte précisément sur la légitimité de l’indépendance et de l’autonomie qu’elles revendiquent comme étant essentielles à l’exercice de leurs pratiques (Dubar et Tripier, 1998
). Bien des raisons expliquent cette attention particulière portée aux professions libérales qui reproduisent encore le mieux les traits des anciennes corporations. Le débat qu’elles ont suscité et suscitent encore au sein de ce qui est devenu une branche particulière de la discipline – la sociologie des professions – est intéressant dans la mesure où il porte précisément sur la légitimité de l’indépendance et de l’autonomie qu’elles revendiquent comme étant essentielles à l’exercice de leurs pratiques (Dubar et Tripier, 1998 ; deux ouvrages défendant encore des thèses opposées viennent d’être très récemment publiés : Champy, 2009
; deux ouvrages défendant encore des thèses opposées viennent d’être très récemment publiés : Champy, 2009 ; Demazière et coll., 2009
; Demazière et coll., 2009 ). Au sein de ce champ de la discipline, la controverse s’est nouée essentiellement autour des médecins, ces derniers étant érigés en représentants archétypiques de la notion de profession.
). Au sein de ce champ de la discipline, la controverse s’est nouée essentiellement autour des médecins, ces derniers étant érigés en représentants archétypiques de la notion de profession. ; Demazière, et coll., 2009
; Demazière, et coll., 2009 ). Dans cette perspective, les statuts (salariés, fonctionnaires, indépendants) sont supposés n’avoir aucune inférence sur le travail.
). Dans cette perspective, les statuts (salariés, fonctionnaires, indépendants) sont supposés n’avoir aucune inférence sur le travail. met particulièrement bien en évidence les nouvelles formes de dépendance et la perte d’autonomie des médecins libéraux à partir de l’atteinte portée à trois éléments essentiels de la profession :
met particulièrement bien en évidence les nouvelles formes de dépendance et la perte d’autonomie des médecins libéraux à partir de l’atteinte portée à trois éléments essentiels de la profession : ). Cette affirmation est sans doute fondée dans le cas des architectes fortement soumis aux choix de leur client mais qui devraient rester maître du projet architectural, est-elle aussi pertinente dans le cas des médecins ? Le point essentiel de l’approche suggérée que l’on souhaite souligner ici est l’importance nouvelle accordée au lien entre autonomie et qualité de l’activité. Si la qualité de l’acte professionnel dépend de l’autonomie de celui qui l’accomplit, alors il est effectivement essentiel de défendre l’autonomie, ce que les sociologues critiques ont ignoré. Mais l’autonomie dans l’accomplissement du travail peut-elle être garantie sans l’indépendance qui la protège ?
). Cette affirmation est sans doute fondée dans le cas des architectes fortement soumis aux choix de leur client mais qui devraient rester maître du projet architectural, est-elle aussi pertinente dans le cas des médecins ? Le point essentiel de l’approche suggérée que l’on souhaite souligner ici est l’importance nouvelle accordée au lien entre autonomie et qualité de l’activité. Si la qualité de l’acte professionnel dépend de l’autonomie de celui qui l’accomplit, alors il est effectivement essentiel de défendre l’autonomie, ce que les sociologues critiques ont ignoré. Mais l’autonomie dans l’accomplissement du travail peut-elle être garantie sans l’indépendance qui la protège ? ) font état de cette progression de l’autonomie n’excluant évidemment pas le contrôle, ce dernier se situant désormais a posteriori sur les objectifs atteints et non plus, comme dans le modèle taylorien, sur le modus operandi. La qualification, longtemps définie par celle du poste occupé, se « personnalise » dans le cadre de la mise en œuvre de ce que le Medef nomme « la logique compétence ». Le travail en équipes, en groupes de projets, change les relations sociales et favorise un apprentissage de type compagnonnique. La modernisation de la fonction publique, sans remettre en cause radicalement le statut, modifie profondément les conditions de travail des fonctionnaires par le biais de l’importation des pratiques de gestion du secteur privé (la RGPP, Réforme générale des politiques publiques ; la LOLF, Loi organique relative aux lois de finances). La volonté d’individualiser les salaires (attribution de primes de performance ou d’excellence !) fait dériver le traitement vers un salaire. Par ailleurs, un nombre croissant d’agents contractuels dans certaines administrations et grandes entreprises publiques conduisent à la cohabitation au sein de mêmes entités d’agents aux statuts hétérogènes. La transformation de l’usager en client affecte l’ethos même de l’engagement du fonctionnaire (Warin, 2002
) font état de cette progression de l’autonomie n’excluant évidemment pas le contrôle, ce dernier se situant désormais a posteriori sur les objectifs atteints et non plus, comme dans le modèle taylorien, sur le modus operandi. La qualification, longtemps définie par celle du poste occupé, se « personnalise » dans le cadre de la mise en œuvre de ce que le Medef nomme « la logique compétence ». Le travail en équipes, en groupes de projets, change les relations sociales et favorise un apprentissage de type compagnonnique. La modernisation de la fonction publique, sans remettre en cause radicalement le statut, modifie profondément les conditions de travail des fonctionnaires par le biais de l’importation des pratiques de gestion du secteur privé (la RGPP, Réforme générale des politiques publiques ; la LOLF, Loi organique relative aux lois de finances). La volonté d’individualiser les salaires (attribution de primes de performance ou d’excellence !) fait dériver le traitement vers un salaire. Par ailleurs, un nombre croissant d’agents contractuels dans certaines administrations et grandes entreprises publiques conduisent à la cohabitation au sein de mêmes entités d’agents aux statuts hétérogènes. La transformation de l’usager en client affecte l’ethos même de l’engagement du fonctionnaire (Warin, 2002 ; Cartier, 2003
; Cartier, 2003 ; Weller, 2003
; Weller, 2003 ), la prise en compte des situations individuelles se substituant progressivement à l’égalité de traitement de l’usager. Paradoxalement, c’est encore dans certains grands corps de l’État que l’on retrouve le mieux préservé l’idéal des professions libérales : indépendance et autonomie dans l’exercice de la fonction (Latour, 2002
), la prise en compte des situations individuelles se substituant progressivement à l’égalité de traitement de l’usager. Paradoxalement, c’est encore dans certains grands corps de l’État que l’on retrouve le mieux préservé l’idéal des professions libérales : indépendance et autonomie dans l’exercice de la fonction (Latour, 2002 ).
). ). Ils sont cependant beaucoup moins soumis que les salariés du secteur privé à un rythme de travail contraint, plus autonomes, et vivent, le cas échéant, des relations de travail moins conflictuelles. Ils sont relativement optimistes sur leur avenir et envisagent sans inquiétude la possibilité d’exercer jusqu’à leur retraite le métier qu’ils ont choisi. On comprend mieux pourquoi, malgré ses difficultés, ses défauts, ses ambiguïtés, le statut de travailleur indépendant reste attractif pour tous ceux qui rêvent « d’un travail à soi ».
). Ils sont cependant beaucoup moins soumis que les salariés du secteur privé à un rythme de travail contraint, plus autonomes, et vivent, le cas échéant, des relations de travail moins conflictuelles. Ils sont relativement optimistes sur leur avenir et envisagent sans inquiétude la possibilité d’exercer jusqu’à leur retraite le métier qu’ils ont choisi. On comprend mieux pourquoi, malgré ses difficultés, ses défauts, ses ambiguïtés, le statut de travailleur indépendant reste attractif pour tous ceux qui rêvent « d’un travail à soi ».























 ). Le poids de ces décès est de 2 % dans la mortalité toutes causes (530 820 décès). Les hommes sont plus touchés que les femmes : 7 décès sur 10 sont masculins, représentant plus d’un tiers des morts violentes chez les hommes. Avec 2 698 décès, la part des suicides chez les femmes est trois fois moins élevée (1 % de la mortalité générale féminine) correspondant à un décès féminin sur cinq par mort violente.
). Le poids de ces décès est de 2 % dans la mortalité toutes causes (530 820 décès). Les hommes sont plus touchés que les femmes : 7 décès sur 10 sont masculins, représentant plus d’un tiers des morts violentes chez les hommes. Avec 2 698 décès, la part des suicides chez les femmes est trois fois moins élevée (1 % de la mortalité générale féminine) correspondant à un décès féminin sur cinq par mort violente. ). Pour l’ensemble de la population, on distingue très nettement trois phases : une forte augmentation jusqu’à 45-54 ans, suivi d’un fléchissement entre 55 et 64 ans. À partir de 65 ans, le taux de décès par suicide croît à nouveau considérablement. Ces tendances sont particulièrement marquées chez les hommes.
). Pour l’ensemble de la population, on distingue très nettement trois phases : une forte augmentation jusqu’à 45-54 ans, suivi d’un fléchissement entre 55 et 64 ans. À partir de 65 ans, le taux de décès par suicide croît à nouveau considérablement. Ces tendances sont particulièrement marquées chez les hommes. ).
). ). En premier lieu, la pendaison avec près d’un décès sur deux. Ce mode est suivi à part égale (15 %), par l’ingestion d’une substance liquide ou solide (principalement des médicaments) et l’utilisation d’une arme à feu. Le saut d’un lieu élevé et la noyade représentent conjointement 12 % des décès par suicide. Le gaz domestique ou l’arme blanche sont nettement moins usités.
). En premier lieu, la pendaison avec près d’un décès sur deux. Ce mode est suivi à part égale (15 %), par l’ingestion d’une substance liquide ou solide (principalement des médicaments) et l’utilisation d’une arme à feu. Le saut d’un lieu élevé et la noyade représentent conjointement 12 % des décès par suicide. Le gaz domestique ou l’arme blanche sont nettement moins usités. ). Le taux de mortalité standardisé des professions libérales et indépendantes se situe à un niveau intermédiaire.
). Le taux de mortalité standardisé des professions libérales et indépendantes se situe à un niveau intermédiaire. ). Depuis 2006, le CépiDc-Inserm met en place la certification électronique des causes médicales de décès en France (Pavillon et coll., 2007
). Depuis 2006, le CépiDc-Inserm met en place la certification électronique des causes médicales de décès en France (Pavillon et coll., 2007 ). Ce projet a pour objectif de raccourcir le délai de mise à disposition des causes médicales de décès et d’accroître la qualité des données. Dans le cas des causes indéterminées quant à l’intention, cette procédure permettra au CépiDc d’obtenir très rapidement des informations complémentaires auprès du médecin certificateur. L’autre source de biais considérée, les causes inconnues, s’explique souvent par une absence de retour d’informations suite à une enquête médico-légale, ce qui est en particulier le cas pour Paris. Deux enquêtes effectuées avec les instituts médico-légaux de Paris et de Lyon ont permis d’estimer qu’environ 25 % de ces cas étaient des suicides (Tilhet-Coartet et coll., 2000
). Ce projet a pour objectif de raccourcir le délai de mise à disposition des causes médicales de décès et d’accroître la qualité des données. Dans le cas des causes indéterminées quant à l’intention, cette procédure permettra au CépiDc d’obtenir très rapidement des informations complémentaires auprès du médecin certificateur. L’autre source de biais considérée, les causes inconnues, s’explique souvent par une absence de retour d’informations suite à une enquête médico-légale, ce qui est en particulier le cas pour Paris. Deux enquêtes effectuées avec les instituts médico-légaux de Paris et de Lyon ont permis d’estimer qu’environ 25 % de ces cas étaient des suicides (Tilhet-Coartet et coll., 2000 ; Jougla et coll., 2002
; Jougla et coll., 2002 ). Ces études ont conclu que les taux de suicides déterminés à partir des données officielles étaient sous-évalués d’environ 20 %. Une enquête réalisée plus récemment par le CépiDc a cependant réévalué cette sous-estimation à 10 % (résultats non publiés). L’amélioration des statistiques de décès en France impose un retour exhaustif des informations issues des instituts médico-légaux.
). Ces études ont conclu que les taux de suicides déterminés à partir des données officielles étaient sous-évalués d’environ 20 %. Une enquête réalisée plus récemment par le CépiDc a cependant réévalué cette sous-estimation à 10 % (résultats non publiés). L’amélioration des statistiques de décès en France impose un retour exhaustif des informations issues des instituts médico-légaux. et b
et b ). Outre les apports complémentaires de ces méthodes à la connaissance épidémiologique du suicide, ces analyses permettent de constater le faible écart entre les résultats basés sur les certificats de décès et ceux utilisant d’autres sources.
). Outre les apports complémentaires de ces méthodes à la connaissance épidémiologique du suicide, ces analyses permettent de constater le faible écart entre les résultats basés sur les certificats de décès et ceux utilisant d’autres sources.






 ). Pour s’approcher au plus près de la tâche, il faut réajuster le mode opératoire, parce que le travail ne se présente jamais exactement comme prévu (pannes, incidents, bugs, accidents, dysfonctionnements, défection du client, retard administratif...).
). Pour s’approcher au plus près de la tâche, il faut réajuster le mode opératoire, parce que le travail ne se présente jamais exactement comme prévu (pannes, incidents, bugs, accidents, dysfonctionnements, défection du client, retard administratif...). ).
). ; Tronto, 1993
; Tronto, 1993 ; Molinier, 2003
; Molinier, 2003 ).
). ). On peut toutefois souligner deux choses :
). On peut toutefois souligner deux choses :