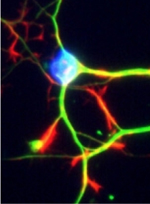. Sur la photo : Oliver Sacks bébé, tenu par son père, les pieds dans l’eau, parés pour la baignade (© artiste : Arthur Aufrand).
Nous étions des « bébés de l’eau », tous les quatre. Notre père, qui était un authentique champion de natation (il avait gagné la course des quinze « miles » au large de l’île de Wight trois ans de suite) et aimait nager plus que tout, nous avait chacun initié à l’élément aquatique alors que nous avions à peine une semaine. Nager relève de l’instinct à cet âge, si bien que nous n’avons jamais réellement appris à nager, pour le meilleur ou pour le pire.
Je me suis souvenu de cela récemment alors que j’étais de passage aux Îles Caroline, en Micronésie, où j’ai vu vraiment de tout petits enfants plonger sans l’ombre d’une appréhension dans les lagons, et nager, de façon assez caractéristique un peu comme nagerait un chien. Tout le monde là-bas nage, il n’y a personne qui ne soit « capable » de nager, et le style des insulaires est superbe. Magellan et les autres navigateurs, lorsqu’ils ont atteint la Micronésie au XVIe siècle, furent ébahis devant cette technique, et voyant les insulaires nager et plonger, virevolter de vague en vague, ne pouvaient s’empêcher de les comparer à des dauphins. Les enfants, en particulier, paraissaient tellement à l’aise dans l’eau qu’« ils semblaient plus tenir du poisson que de l’être humain », comme le dit un explorateur.
(C’est en fait en observant les habitants des îles du Pacifique, que, nous occidentaux, avons appris au début du XXe siècle à nager le crawl, cette nage magnifique, puissante, venue de l’océan, qu’ils avaient perfectionnée au fil des âges – tellement plus adaptée à la morphologie humaine que la brasse qui était principalement utilisée jusque-là.)
Quant à moi, je n’ai aucun souvenir qu’on m’ait enseigné la natation ; j’ai appris à nager les différents styles, je pense, en nageant avec mon père – bien que son mouvement lent, mesuré, à avaler les miles (c’était un homme puissant qui pesait presque 18 stones
2
) ne fût pas précisément adapté pour un petit garçon. Mais je voyais comment mon vieux père, massif et encombré de son corps à terre, se transformait dans l’eau, devenait gracieux comme un marsouin ; et moi qui étais timide, nerveux, et aussi plutôt maladroit, j’ai vécu et ressenti cette même transformation délicieuse, j’ai découvert dans l’eau un nouvel être, une nouvelle manière d’être.
J’ai ce souvenir vivace de vacances d’été au bord de la mer, en Angleterre, juste après mon cinquième anniversaire. J’ai déboulé dans la chambre de mes parents et j’ai commencé à tirer sur mon père – je m’attaquais à sa masse gigantesque, une baleine. « Allez viens Papa ! » J’ai dit. « Viens nager ». Il se tourna avec lenteur et ouvrit un œil : « Qu’est ce que ça veut dire, réveiller comme ça un vieil homme de quarante-trois ans à six heures du matin ? ». Maintenant que mon père est mort, et que j’ai moi-même soixante-trois ans, ce souvenir qui vient de si loin me chahute aussi à sa façon, il me donne tout autant envie de rire que de pleurer.
L’adolescence ne fut pas une période facile. Je développai une étrange maladie de peau : Erythema annulare centrifugum, dit un expert ; Erythema gyratum perstans, dit un autre – des mots précis, qui résonnent, pleins d’emphase, mais aucun de ces spécialistes ne pouvait faire quoi que ce soit, et j’étais couvert de plaies suintantes. Ayant tout du lépreux – en tout cas c’est comme cela que je le ressentais – je n’osais plus me dévêtir à la plage ou à la piscine, et ne pouvais plus nager que de temps en temps lorsque par chance je trouvais un lac éloigné de tout.
À Oxford, ma peau guérit d’un coup, et le sentiment de soulagement fut si intense que je voulais nager nu, pour sentir l’eau ruisseler sur chaque parcelle de mon corps, sans entrave. Parfois, j’allais nager à l’aube, au « Parson’s Pleasure »3,, dans un coude de la rivière Cherwell, une zone naturiste depuis la fin du XVIIe siècle, pour me baigner nu, en compagnie – c’était palpable – des fantômes de Swinburne et Clough4,. Les après-midi d’été, j’aimais à partir en barque sur la Cherwell et trouver un endroit isolé pour l’amarrer, puis ensuite passer le reste de la journée à nager paresseusement. Parfois la nuit je partais courir sur le chemin de halage le long de l’Isis5,, au-delà d’Iffley Lock6, bien après les limites de la ville. Et alors je plongeais, je nageais dans la rivière, jusqu’à ce que moi, elle, nous coulions ensemble, jusqu’à ce que nous ne fassions plus qu’un.
Nager devint une réelle passion à Oxford, et après il n’y eut plus de retour en arrière. Quand je suis arrivé à New York au milieu des années soixante, j’ai commencé à nager à la plage d’Orchard Beach, dans le Bronx, et parfois je faisais le tour de l’île de City Island7,– un parcours qui me prenait plusieurs heures. En fait, c’est comme cela que j’ai trouvé la maison où je vis maintenant : je m’étais arrêté à peu près à la moitié du parcours pour contempler un charmant gazébo8, puis après être sorti de l’eau et avoir remonté la rue, j’ai vu une petite maison rouge qui était à vendre ; les propriétaires, tout décontenancés, me l’ont fait visiter – je dégoulinais ; j’ai marché jusqu’à l’agence immobilière et convaincu la femme du sérieux de mon intérêt (elle n’avait pas l’habitude des clients en slip de bain), je suis entré à nouveau dans l’eau de l’autre côté de l’île, et suis revenu en nageant à Orchard Beach, après avoir acquis une maison entretemps.
J’aimais énormément nager en lac aussi, et je louais souvent une chambre dans un vieil hôtel délabré sur le lac Jefferson, au nord de New York – un lac plutôt petit (50 acres9), assez peu profond, où il n’y avait pas de bateau à moteur, pas de ski nautique, et où je pouvais nager ou faire la planche, sur le dos, toute la journée sans danger, un continent hors des frontières et du temps. Parmi mes week-ends les plus heureux, un grand nombre l’ont été à nager dans ce petit lac – parmi mes week-end les plus productifs aussi – car il y a quelque chose dans le fait d’être dans l’eau et de nager qui change mon humeur générale, modifie la marche de mon cerveau, et met en route les pensées, comme par magie. Je ne connais rien d’autre qui me fasse un tel effet. Des théories et des histoires se construisaient toute seules dans ma tête alors que j’allais, que je revenais, ou que je nageais en faisant le tour, encore et encore, du lac Jefferson. Les phrases et les paragraphes s’écrivaient d’eux-mêmes dans mon esprit, et dans ces moments-là il fallait que je revienne à la rive de temps en temps pour m’en délester sur le papier. L’essentiel du livre « Sur une jambe » [2] a été écrit de cette façon, les paragraphes s’assemblaient tout seuls pendant mes longs moments passés à nager dans le lac Jefferson, et toutes les demi-heures, à peu près, dégoulinant, je m’épanchais sur le papier. (Mon éditeur était perplexe devant les traînées d’eau et les taches d’encre maculant le manuscrit, et insista pour que je le fasse dactylographier.)
J’avais tendance à nager en extérieur d’avril jusqu’à novembre – j’étais plus hardi à cette époque – mais je nageais à la piscine pendant l’hiver. En 1976-1977, j’ai été le meilleur nageur du club Mount Vernon, à Westchester10, pour les longues distances : j’avais nagé cinq cents longueurs – six miles – pendant la compétition, et j’aurais bien continué, mais les juges ont dit : « Ça suffit ! S’il vous plaît, rentrez chez vous. » On pourrait penser que cinq cents longueurs ce soit monotone, ennuyeux, mais je n’ai jamais trouvé que nager, ce soit monotone ou ennuyeux. Nager me procure une sorte de joie, une sensation de bien-être tellement intense qu’il y eut véritablement des moments où cela tournait à une sorte d’extase. Il y avait un total engagement dans l’acte de nager, dans chaque mouvement, et en même temps l’esprit peut flotter librement, envoûté, dans un état proche de la transe. Je n’ai jamais rien connu d’aussi puissant, d’aussi sainement euphorisant – c’était une addiction pour moi, c’est toujours une addiction, je ne me sens pas bien lorsque je ne peux pas nager.
Au XIIIe siècle, Duns Scotus, parlait de « condelectari sibi », la volonté trouvant du plaisir dans son propre exercice. Et Mihaly Csikszentmihalyi, à notre époque, parle de « flow »11. Il y a quelque chose de fondamentalement juste dans le fait de nager, comme c’est le cas pour toutes ces activités qui s’accomplissent dans la fluidité, des activités pour ainsi dire musicales. Et puis, il y a ce prodige qu’est la poussée d’Archimède, le fait d’être suspendu dans ce milieu épais, transparent, qui vous porte et vous enveloppe. On peut bouger dans l’eau, jouer avec, d’une façon qui n’a pas d’équivalent pour l’air. On peut explorer sa dynamique, son écoulement, de mille façons ; on peut mouvoir ses mains comme des hélices, ou les diriger comme de petits gouvernails ; on peut être hydroglisseur ou sous-marin, et se mettre à étudier la physique des fluides juste avec son propre corps.
Et, au-delà de tout ça, il y a aussi tout le symbolisme associé à la natation – ses résonances pour l’imaginaire, son potentiel mythique. Mon père appelait la natation « l’élixir de vie », et effectivement ça semble bien avoir été le cas pour lui : il a nagé tous les jours, réduisant la cadence tout doucement au fil du temps, jusqu’à l’âge vénérable de 94 ans. J’espère que je pourrai suivre son exemple, et que je nagerai jusqu’à l’heure de ma mort.